Mon Patient, Hitler – Par le Dr. Eduard Bloch
Le Récit du Docteur Bloch, le Médecin Juif d'Hitler
Première partie

Nous étions partis de Lisbonne trois jours plus tôt, cap à l’ouest destination New York. Samedi nous avons essuyé une tempête sévère, mais l’océan est redevenu calme. Un peu avant 11 heures du soir ce même samedi, notre bateau, un petit paquebot espagnol, le Marques de Comillas, reçut l’ordre de mettre en panne. Des officiers anglais arrivés à bord d’un chalutier voulaient contrôler les passagers, nous devions tous nous tenir en rang dans le salon principal.
Quatre officiers anglais en gilet de sauvetage sont entrés. Sans un mot, ils ont commencé à nous passer en revue et à examiner nos passeports. Il régnait une certaine tension. La plupart des passagers fuyaient le continent, ils avaient le sentiment d’avoir fait le plus dur au moment où le bateau avait levé l’ancre, et maintenant, qu’allait-il se passer? Peut-être que certains allaient être contraints de quitter le navire.
Et puis cela a été mon tour. L’agent prit mon passeport, y jeta un œil puis releva les yeux en souriant : « vous étiez le médecin d’Hitler, non ? » me demanda-t-il. C’était bien vrai, s’il avait ajouté que j’étais Juif, il ne se serait pas trompé non plus.
J’ai connu Hitler alors qu’il était adolescent, presque encore un enfant. Je l’ai eu plusieurs fois en consultation et j’étais intimement familier du modeste entourage dans lequel il grandissait. Dans les derniers moments de sa maladie, j’étais au chevet de la personne qu’il chérissait le plus et dont il était le plus proche : sa mère.
La plupart des biographes, bienveillants ou antagonistes, ont éludé la jeunesse d’Adolf Hitler. Les hostiles l’ont fait par nécessité, ils n’auraient pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Quant aux biographes officiels, ils ont dû se plier aux désirs du dictateur. Pourquoi une telle pudeur au sujet de sa jeunesse ? Je n’en sais rien. Il n’y a pourtant pas d’épisode scandaleux qu’Hitler pourrait vouloir cacher, à moins de remonter un siècle en arrière, à la naissance de son père. Certains biographes disent qu’Alois Hitler était un enfant illégitime, mais je ne saurais le certifier.
Qu’en était-il de ses années de jeunesse à Linz en Autriche ? quel genre de garçon était-il ? Quelle vie menait-il ? C’est de cela que nous allons parler ici.
Hitler à l’âge de treize ans
Il faut d’abord que je me présente. Je suis né à Frauenbourg, un village minuscule du sud de la Bohême qui au cours de ma vie est passé sous trois drapeaux, autrichien, tchèque et allemand. J’ai soixante-neuf ans, j’ai étudié la médecine à Prague, puis j’ai incorporé l’armée autrichienne comme médecin militaire. En 1899, j’ai été affecté à Linz, capitale de la Haute Autriche et troisième plus grande ville du pays. À la fin de mon service militaire en 1901, j’ai décidé de m’établir à Linz pour exercer.
Comme ville, Linz a toujours été aussi calme et réservée que Vienne était gaie et bruyante. À l’époque où nous nous situons, alors qu’Hitler avait 13 ans [en réalité 14], Linz comptait 80 000 habitants. J’avais mon bureau de consultation dans ma propre maison, une ancienne demeure baroque sur la Landstrasse, la principale artère de la ville.
La famille d’Hitler est arrivée à Linz en 1903, attirée, il me semble, par la réputation de ses écoles. L’arrière-plan familial est bien connu. Alois Schicklgruber Hitler était le fils d’une pauvre petite paysanne. Quand il a été en âge de travailler, il a trouvé une place d’apprenti chez un cordonnier puis a suivi son chemin en devenant fonctionnaire, inspecteur des douanes à Braunau, une petite ville frontalière entre la Bavière et l’Autriche. Brunau est à quatre-vingts kilomètres de Linz. À 56 ans, Alois, dès qu’il l’a pu, a pris sa retraite. Fier de sa propre réussite, il voulait que son fils suive ses traces et devienne aussi fonctionnaire. Mais le jeune Adolf ne l’entendait pas de cette oreille, ce qu’il voulait, c’était devenir un artiste. Le père et le fils se querellaient constamment à ce sujet tandis que la mère, Klara Hitler, essayait de maintenir la paix.
Jusqu’au bout, Alois Hitler a tenté de calquer l’avenir de son fils sur ses propres ambitions. Son fils allait recevoir l’éducation que lui-même n’avait pu avoir et qui lui assurerait une bonne place dans l’administration. Grâce à son statut d’ancien fonctionnaire, il bénéficierait de réduction sur les frais d’entrée pour son fils à la Realschule [école secondaire], c’est avec toutes ces idées en tête qu’Alois père s’est décidé à quitter son hameau de Braunau pour la ville de Linz, faisant l’acquisition d’une petite ferme à Leonding dans la banlieue de la ville.
La famille était assez étoffée même si par la suite les autres membres ont été éclipsé par Adolf et largement oubliés. Il y avait le demi-frère Alois que je n’ai jamais connu. Il a quitté le foyer familial à un âge précoce et s’est trouvé un emploi de serveur à Londres, puis il a ouvert son propre restaurant à Berlin. Il n’a jamais eu d’accointances avec son plus jeune frère.
Venait ensuite Paula, l’ainée des filles. Elle s’est mariée avec un certain Herr Rubal, un fonctionnaire des impôts à Linz. Par la suite, à la mort de son mari et dans le sillage de l’accession au pouvoir de son frère, elle est partie à Berchtesgaden pour y devenir une femme de ménage dans la résidence d’Hitler. La puinée, Klara, a pendant un temps tenu un restaurant pour étudiants juifs à l’université de Vienne, il y avait enfin Angela, la plus jeune des filles, qui s’est mariée au professeur Hamitsch à Dresde où elle vit toujours.
Un travail pour Madame Hitler
La famille s’était à peine installée dans leur nouvelle maison des faubourgs de Linz, qu’Alois père décédait d’une crise d’apoplexie.
À l’époque, Madame Hitler avait passé la quarantaine, c’était une femme simple, modeste et gentille. Elle était grande, brune, ses cheveux toujours bien coiffés, un visage qui s’inscrivait dans un ovale allongé avec des yeux bleu-gris merveilleusement expressifs. Elle était toute perdue du fait des responsabilités qui s’abattaient sur elle du fait de la perte de son mari. Alois, plus vieux qu’elle de vingt-trois ans avait toujours dirigé le foyer, maintenant, c’était à elle de le faire.
Il était manifeste qu’Adolf était à la fois trop jeune et trop fragile pour faire fermier. Ce qu’elle avait de mieux à faire, c’était de vendre la ferme et de louer un petit appartement, ce qu’elle fit sans attendre. Avec le prix de la vente et la petite pension de réversion qui lui revenait de son mari, elle réussit à maintenir à flot sa famille.
Dans les petites villes autrichiennes, la pauvreté n’atteint pas les niveaux d’indigence des grandes villes. Il n’y a pas de problème d’entassement et d’insalubrité. Je ne connais pas le montant exact des ressources de la famille, mais familier du niveau des pensions de la fonction publique, je pense qu’elles devaient se situer aux environs des $25 par mois. Cette petite somme leur permettait de vivre décemment et sans souci, sans se faire remarquer dans le flot des petites gens de la ville.

Leur appartement se composait de trois petites pièces dans la maison de deux étages au n° 9 de la Bluetenstrasse, une rue située sur la rive opposée du Danube par rapport à la partie principale de Linz. Ses fenêtres offraient une excellente vue sur les montagnes environnantes.
L’impression générale qui se dégageait de cet appartement simplement meublé, c’était sa propreté. Ça brillait, pas un grain de poussière sur les chaises ou les tables, pas la moindre trace de boue sur le sol impeccablement récuré, pas la moindre coulure sur les vitres, Madame Hitler était une perle.
La famille n’avait que peu d’amis, il y avait essentiellement cette veuve de facteur qui habitait dans la même maison qu’eux.
Le budget limité n’autorisait pas le plus petit écart. Nous avions à Linz l’habituel opéra de province le Schauspielhaus, ni bon ni mauvais, ceux qui voulaient entendre ce qui se faisait de mieux allaient à Vienne. On pouvait avoir des places dans la galerie pour l’équivalent de 10 à 15 cents, et pourtant, s’y rendre pour entendre une troupe quelconque donner le Lohengrin était une telle occasion qu’Hitler en parlait dans Mein Kampf!
Dans l’ensemble, les loisirs du garçon se limitaient à ce qui était gratuit: des marches dans les montagnes, nager dans le Danube, un concert de plein air. Il lisait beaucoup, il était particulièrement fasciné par les histoires d’Indiens d’Amérique. Il dévorait les livres de James Fenimore Cooper et de l’écrivain allemand Karl May, qui n’était jamais allé en Amérique et qui n’avait jamais vu le moindre Indien.
L’alimentation était par nécessité simple et consistante. La nourriture était abondante et bon marché à Linz et Hitler et sa famille se nourrissaient des mêmes choses que les personnes dans leur situation: de la viande peut-être deux fois dans la semaine, du chou ou des pommes de terre, du pain, des boulettes et un pichet de cidre de pomme et de poire.
Pour vêtements, ils portaient les lainages inusables appelés Loden. Adolf portait bien sûr l’uniforme de tous les petits garçons: short en cuir, bretelles brodées et petit chapeau à plume.
Une maman admirablement affectueuse
Quel genre de garçon était Adolf Hitler ? Certains biographes ont voulu en faire un rebelle débraillé, un petit voyou intenable, l’archétype de tout ce qu’on ne veut pas d’un adolescent. Mais ce n’était pas du tout ça, en fait, c’était un garçon tout à fait tranquille, polis et proprement vêtu. Il dit se souvenir qu’à quinze ans déjà il se considérait comme un révolutionnaire. C’est possible, mais il nous faut voir l’impression qu’il donnait de lui à son entourage, pas l’impression qu’il avait de lui-même.
Il était grand, le teint jaunâtre, mûr pour son âge. Il n’était ni costaud ni chétif, disons qu’il avait peut-être un air un peu fragile. Ses grands yeux, qu’il avait hérité de sa mère, lui donnaient un regard pensif et mélancolique. Dans une large mesure, le garçon vivait replié sur lui-même. À quoi pouvait-il bien rêver ? Je ne peux pas le dire.
Vu de l’extérieur, c’est son attachement à sa mère qui frappait le plus. Même si ce n’était pas à proprement parler un petit garçon à sa maman, je n’avais jamais vu une telle proximité. Certains disent que cet amour frisait le pathologique, mais en tant qu’intime de la famille, je ne dirais pas ça.
Klara Hitler adorait son fils, le benjamin de la famille, elle le laissait libre de faire ce qu’il voulait chaque fois que c’était possible. Son père insistait pour qu’il soit fonctionnaire, mais il se rebiffait et a réussi à mettre sa mère de son côté. Il en a eu vite assez de l’école, alors sa mère l’a laissé abandonner les études.
Tous les amis de la famille savaient à quel point Madame Hitler encourageait les efforts juvéniles d’Hitler pour devenir artiste, même si comme on l’imagine, ça devait lui revenir cher. Malgré leur précarité, elle a accepté qu’il refuse une place à la poste pour qu’il puisse continuer à peindre. Elle admirait ses aquarelles et ses croquis des paysages, s’agissait-il d’une admiration sincère, ou d’un simple encouragement à persévérer, je ne saurais dire.
Elle a fait de son mieux pour élever son garçon. Elle a fait en sorte qu’il soit propre et net, aussi bien nourri que le permettait son porte-monnaie. Chaque fois qu’il venait à mon cabinet, il s’asseyait au milieu des autres patients et attendait son tour.
Il n’a jamais rien eu de grave. Parfois une angine. Il restait sage et stoïque tandis que j’examinais sa langue et sonder les points douloureux. Parfois un petit coup de froid, je le soignais et le laissais repartir. Comme tous les enfants bien élevés de quatorze ou quinze ans, il me remerciait en s’inclinant courtoisement.
Bien sûr, j’étais au courant des problèmes gastriques qu’il a eus plus tard, dus en grande partie à sa mauvaise alimentation alors qu’il était ouvrier de base à Vienne. Par contre, je ne vois pas d’où sortent ces allusions fréquentes à des troubles pulmonaires qu’il aurait eus dans sa jeunesse. J’étais son seul médecin à l’époque où il était censé en avoir souffert, mais mes dossiers ne contiennent rien de la sorte. C’est vrai qu’il n’avait pas les joues roses et la santé d’autres jeunes de son âge, mais il n’était pas non plus maladif.
Au lycée, Adolf était tout sauf brillant, je le tiens de son ancien professeur, le Dr. Karl Hümer, une de mes vieilles connaissances, j’étais le médecin de son épouse. Dans Mein Kampf, Hitler se souvient qu’aucune matière ne l’intéressait particulièrement sauf l’histoire, c’est aussi ce que dit le Professor Hümer.
Désirant se perfectionner dans la peinture, Hitler décida qu’il irait à Vienne pour étudier à l’Académie. C’était une décision lourde pour quelqu’un d’une famille pauvre. Sa mère se demandait comment il y arriverait. J’ai compris qu’elle avait même envisagé de restreindre encore son maigre budget pour lui fournir une petite allocation. Mais le jeune homme refusa le crédit, il alla même plus loin en abandonnant par écrit sa part d’héritage à ses sœurs, il avait alors 18 ans.
Je ne suis pas très sûr de ce qui s’est passé au cours de ce voyage à Vienne. Certains soutiennent qu’il n’a pas été reçu à l’Académie en raison de la médiocre qualité artistique de ses œuvres, d’autres admettent les dires d’Hitler selon lesquels il n’a pas été reçu parce qu’il n’a pas obtenu son diplôme à la sortie du secondaire, l’équivalent de la high school en Amérique. Quoi qu’il en soit, il était de retour à la maison dans les quelques semaines. Ce n’est que plus tard au cours de cette même année – 1908 [1907 selon certaines sources] – que j’ai dû annoncer à Hitler ce qui constituait sans doute la plus triste nouvelle de sa vie.
Un jour, Madame Hitler est venue me voir au cabinet, en consultation du matin. Elle se plaignait d’une douleur à la poitrine. Elle parlait calmement d’une voix basse, presque un murmure. La douleur, disait-elle, a été assez forte pour la tenir éveillée toute la nuit. Elle avait été très occupée à tenir son foyer et avait négligé de demander un avis médical. D’ailleurs, se disait-elle, ça passerait tout seul. Lorsqu’un médecin entend une telle histoire, il pense presque automatiquement à un cancer. Une auscultation montrait que Madame Hitler avait une tumeur du sein déjà bien avancée: je ne le lui ai pas dit au moment du diagnostic.
La famille se décide
J’ai fait venir les enfants à mon cabinet le lendemain et leur exposais la situation en toute franchise: leur mère, leur dis-je, était une femme gravement atteinte. Une tumeur maligne c’est déjà grave de nos jours, il y a trente ans, c’était bien pire. Les techniques chirurgicales n’étaient pas si avancées et les connaissances sur le cancer pas si développées.
Sans opération, leur expliquais-je il n’y avait absolument aucun espoir de guérison, mais même avec de la chirurgie, les espoirs de survie étaient des plus minimes. Il fallait qu’ils décident en famille de ce qu’il fallait faire.
La réaction d’Adolf Hitler à la nouvelle a été touchante. Sa longue figure jaunâtre s’est crispée, ses yeux débordaient de larmes. Sa mère, demandait-il était condamnée ? Ce n’est qu’alors que j’ai réalisé à quel point les liens entre la mère et le fils étaient forts. Je lui disais qu’il lui restait une chance, mais petite et il s’est raccroché à cette faible lueur d’espoir.
Les enfants transmirent mon message à leur mère. Elle reçut le verdict comme je m’y attendais, avec fermeté. Très croyante, elle pensait que son sort était la volonté de Dieu, il ne lui serait pas venu à l’idée de se plaindre. Elle subirait l’opération dès que possible.
Je présentais le cas au Dr. Karl Urban, le chef de l’équipe chirurgicale de l’hôpital des Sœurs de la Miséricorde à Linz. Urban était l’un des chirurgiens les plus réputés de Haute-Autriche. Il était – et est toujours – un homme d’une grande bienveillance, un honneur pour sa profession. Il était d’accord pour entreprendre l’opération sur telle base que je lui indiquerais. Après consultation, il alla dans le sens de ce que je pensais, que Madame Hitler avait peu de chances de survivre, mais que l’opération était le seul espoir.
Il est intéressant de noter ce qui est arrivé à cet homme si généreux quelques décennies plus tard – après l’Anschluss. En raison de ses relations dans le monde politique, il a été obligé d’abandonner sa situation à l’hôpital. Son fils également, un pionnier de la chirurgie du cerveau, a été évincé de plusieurs services.
Madame Hitler est arrivée à l’hôpital un soir au début de l’été 1908 [1907 ?]. Je n’ai pas la date exacte, car mon dossier d’elle a été transféré dans les archives du Parti nazi à Munich. Quoi qu’il en soit, elle a passé la nuit à l’hôpital et a été opérée le lendemain matin. À la demande de cette âme dans l’épreuve, je suis resté près de la table d’opération aux côtés du Dr. Urban et de son assistant.
Deux heures plus tard, je traversais le Danube dans mon attelage pour me rendre dans la petite maison au 9 de la Bluetenstrasse, dans le quartier Urfahr. Là, les enfants m’attendaient.
Les filles recevaient les nouvelles avec calme et retenue. Le visage du garçon était strié de larmes, ses yeux rougis de fatigue. Il écoutait jusqu’à ce que j’aie fini de parler. Il n’avait qu’une question, d’une voix étouffée, il demanda : « est-ce que ma mère a souffert ? »
Les pires moments d’Hitler
Au fur et à mesure des semaines et des mois qui suivirent l’opération, les forces de Madame Hitler ne cessèrent de décliner. Au mieux, elle ne pouvait plus sortir de son lit qu’une ou deux heures par jour. Durant cette période, Adolf passait le plus clair de son temps dans cette maison dans laquelle sa mère était revenue. Il dormait dans la petite chambre attenante à celle de sa mère en sorte qu’elle puisse l’appeler à n’importe quelle heure de la nuit. Dans la journée, il tournait autour du lit sur lequel elle était allongée.
Une telle maladie s’accompagne généralement de grandes souffrances. Elle portait son fardeau sans fléchir et sans se plaindre. Mais on aurait dit que c’était une torture pour son fils. Il grimaçait d’angoisse chaque fois qu’une douleur contractait le visage de sa mère. Il n’y avait pas grand-chose à faire. Une piqûre de morphine de temps à autre procurait un soulagement provisoire tout relatif, mais Adolf paraissait accueillir ces brèves périodes de soulagement avec la plus vive reconnaissance.
Je n’oublierai jamais la Klara Hitler de ces jours. Elle avait alors 48 ans, elle était grande, svelte, plutôt belle même flétrie par la maladie. Elle parlait d’une voix douce et patiente. Elle était plus préoccupée par ce que deviendrait sa famille que par la mort qui approchait. Elle ne faisait pas mystère de ses inquiétudes, ni du fait qu’elle pensait surtout à son fils: «Adolf est encore si jeune» disait-elle constamment.
Le 20 décembre 1908 [ou 1907], je suis allé la voir deux fois. La fin approchait, et je voulais que tout se passe pour le mieux pour cette femme méritante. Je ne savais pas si elle allait vivre encore une semaine ou encore un mois, ou si le décès surviendrait dans les heures suivantes.
Les mots que m’apporta Angela Hitler le lendemain ne furent donc pas une surprise: sa mère était morte paisiblement dans la nuit. Les enfants ont préféré ne pas me déranger sachant que toute aide médicale était vaine. Mais elle me demandait si je pouvais venir maintenant, une autorité officielle devait signer le certificat de décès. J’enfilais mon manteau et me rendis avec elle dans la maison endeuillée.
La veuve du facteur, leur plus proche amie, était avec les enfants, ayant plus ou moins pris les choses en main. Hitler dont le visage portait les stigmates d’une nuit sans sommeil était assis au chevet de sa mère. C’est lui qui l’avait étendue avec dignité dans la position où elle se trouvait.
Je me suis assis avec la famille un moment, essayant de soulager leur chagrin. Je leur disais que pour leur mère, la mort était venue comme une délivrance, ils comprenaient.
Dans l’exercice de ma profession, j’ai naturellement eu plusieurs fois l’occasion d’assister à des scènes comme que celle-ci, mais aucune ne m’a fait la même impression. De toute ma carrière, je n’ai jamais vu personne aussi affligée par le deuil qu’Adolf Hitler.
Je n’ai pas assisté aux funérailles de Klara Hitler qui avaient lieu la veille de Noël. Le corps a été emmené d’Urfahr à Leonding à quelques kilomètres à peine. Klara Hitler a été enterrée aux côtés de son mari dans le cimetière catholique, derrière la petite église de stuc jaune. Tandis que les autres – ses sœurs et la veuve du facteur – étaient partis, Adolf, lui, restait à la traîne, incapable de s’arracher à la tombe qu’on venait de refermer. C’est ainsi que le jeune homme pâle et décharnée a passé le réveillon dans le froid tandis que le monde faisait la fête.
Quelques jours plus tard, la famille est passée me voir à mon cabinet. Ils voulaient me remercier pour le soutien que je leur avais apporté. Il y avait Paula, trapue, assez quelconque, Angela, plus mince et jolie mais plutôt anémique, Klara et Adolf. Les sœurs se sont librement épanchées tandis Hitler restait taciturne. Je me souviens de cette scène particulière aussi vivement que si elle s’était déroulée la semaine dernière.
Adolf portait un costume sombre et une cravate négligemment nouée. Il avait déjà sa mèche de cheveux qui lui tombait sur le front. Ses yeux fixaient le sol tandis que ses sœurs parlaient. Puis vint son tour, il s’est avancé me regardant dans les yeux et dit «Je vous serai reconnaissant pour toujours». C’était tout. Puis il s’inclina. On pourra se demander si aujourd’hui il se rappelle cette scène. Je suis persuadé que oui, même si c’est simplement en ce sens qu’il m’aurait épargné, Hitler a tenu sa promesse de reconnaissance. J’ai eu droit à un traitement de faveur dont, j’en suis sûr, aucun autre Juif, dans toute l’Allemagne ou en Autriche n’a bénéficié.
Deuxième Partie
Presque aussitôt après les funérailles de sa mère, Hitler part pour Vienne pour de nouveau tenter une carrière d’artiste. L’adolescence aura été une expérience douloureuse pour celui qui vivait replié sur lui-même, mais des temps plus difficiles encore l’attendaient. Même pauvre comme elle l’était, sa famille lui assurait au moins le gîte et le couvert, à Vienne, il n’en ira pas ainsi, désormais, la lutte pour la survie va être pour lui une occupation à plein temps.
Nous avons tous entendu parler de bribes de sa vie d’alors: comment il a fait l’arpète sur les chantiers à transporter des charges jusqu’au jour où des ouvriers ont fait mine de le faire tomber d’un échafaudage, nous savons qu’il a déneigé des trottoirs et pris tous les petits boulots qu’il pouvait trouver. Durant les trois années de cette période, Hitler vivait dans un foyer, l’équivalent d’un flophouse (refuge) qu’on trouve dans toutes les grandes villes en Amérique. C’est à ce moment-là qu’il a commencé à rêver à un monde refait selon ses conceptions.
« Passant d’un foyer à un autre, entouré de la lie de l’humanité des grandes villes », disait Hitler, « pour la première fois de ma vie, je me suis dégoûté de moi-même ». Ce dégoût de lui-même s’accompagnait d’un dégoût pour tout ce qui l’entourait et du désir de changer les choses à sa convenance.

Le venin de la haine commençait à s’infiltrer et à faire son effet. Les dures réalités de la vie qu’il menait le poussaient à haïr le gouvernement, les syndicats et même ses propres compagnons d’infortune. Mais il n’avait pas encore commencé à haïr les Juifs : il a même pris la peine de m’adresser une carte postale, au dos, on trouvait ce petit mot : « Je vous adresse mes vœux depuis Vienne, bien à vous fidèlement, Adolf Hitler ». Ce n’était pas grand-chose, mais ça m’a fait plaisir. J’avais consacré pas mal de mon temps à la famille d’Hitler, et j’étais heureux de voir que tous mes efforts n’avaient pas été oubliés.
Les brochures officielles nazies font aussi état d’une peinture d’Hitler que j’aurais reçu, un petit paysage. Si c’est le cas, je ne m’en souviens pas. Mais il est très possible qu’il m’en ait envoyée une et que je n’y ai pas fait attention. Il est fréquent en Autriche que les patients adressent des peintures ou d’autres petits cadeaux à leur médecin en remerciement. Même encore maintenant j’ai gardé une demi-douzaine de ces huiles ou aquarelles, mais aucune de la main d’Hitler.
Mais j’ai malgré tout conservé une des œuvres d’Hitler. Elle datait de sa période viennoise, alors qu’il peignait des cartes postales ou des affiches, ça lui faisait assez d’argent pour vivre, c’était la première fois qu’Hitler trouvait un débouché utile à son talent.
Il peignait ces cartes et les faisait sécher devant un feu fort ce qui leur donnait une patine pas déplaisante. Et puis les pensionnaires du refuge essayaient de les refourguer. De nos jours en Allemagne, les quelques échantillons qui restent de ce travail sont plus recherchés et se vendent plus cher que des Picasso, des Gauguin ou des Cézanne!
Hitler m’en envoya une, elle représentait un moine capucin levant un verre de champagne pétillant. Sous l’image il y avait une légende: « Bonne année – un toast à la nouvelle année ». Au verso, il avait écrit un petit mot : « La famille Hitler vous adresse ses meilleurs vœux pour la nouvelle année. En témoignage d’éternelle reconnaissance, Adolf Hitler ».
Pourquoi est-ce que j’ai mis de côté et conservé ces deux cartes? Je ne sais pas trop, peut-être en raison de la peine que m’a faite ce garçon dans son malheur. Même encore aujourd’hui, je ne peux m’empêcher de penser à lui au travers de son deuil et non au travers de ce qu’il a fait au monde.
J’ai une petite anecdote sur ces cartes qui montre à quel point Hitler était entré dans l’imaginaire de certaines personnes. Un riche industriel de Vienne – dont je ne connais pas l’identité parce qu’il traitait par un intermédiaire – m’a fait une offre étonnante: il voulait acheter les deux cartes et m’en proposait 20 000 marks ! J’ai rejeté l’offre en disant que je ne pouvais pas moralement effectuer une telle vente.
Et il y a encore une autre histoire au sujet de ces cartes. Dix-sept jours après la chute du gouvernement Schuschnigg [chancelier d’Autriche opposé à l’Anschluss] et l’occupation de l’Autriche par des troupes allemandes, un agent de la Gestapo s’est présenté à mon domicile. J’étais en visite et c’est ma femme qui l’a reçu.
« Confisqué pour préservation »
« Je suis informé », disait-il, « de ce que vous avez des souvenirs du Führer, j’aimerais les voir ». Prudente, ma femme ne fit pas d’objection. Elle ne tenait pas à ce que son domicile soit retourné comme celui de tant d’autres Juifs. Elle mis la main sur les deux cartes et les passa à l’agent. Celui-ci griffonna un reçu sur lequel on pouvait lire : « Certificat pour la préservation de deux cartes (dont une, peinte de la main d’Hitler), saisies au domicile du Docteur Eduard Bloch ». C’était signé de l’agent Grömer dont nous n’avions jamais entendu parler auparavant. Il disait que je devais me présenter au quartier général le lendemain matin.
Pratiquement dès l’entrée des nazis dans la ville, la Gestapo a réquisitionné un petit hôtel dans la Gesellenhausstrasse jusque-là réservé à l’usage des pèlerins. C’est là que je devais me rendre, j’ai été reçu tout de suite. J’ai été accueilli aimablement par le Dr. Rasch, le responsable de l’antenne locale. Je lui demandais pourquoi on m’avait pris ces choses qui m’appartenaient.
Ça avait été des jours mouvementés pour la Gestapo, il y avait beaucoup de choses à régler dans une ville de 120 000 habitants. Il s’avérait que le Dr. Rasch n’était pas très au fait de mon affaire. Il me demandait si j’étais suspecté d’activités politiques défavorables aux nazis. Je répliquais que non, que j’étais un professionnel sans aucune attache politique.
Puis, comme une idée qui lui serait venue après coup, il me demandait si j’étais un non-Arien. J’ai répondu sans ambiguïté : « Je suis cent pour cent Juif ». Le changement d’attitude fut immédiat, jusqu’ici il était professionnel mais courtois, il était à présent distant.
Les cartes, disait-il, seraient consignées pour leur sauvegarde. Puis il m’a donné congé, ne me tendant pas la main comme il l’avait fait à mon arrivée. Pour autant que je sache, les cartes sont toujours entre les mains de la Gestapo, je ne les ai jamais revues.
En partant pour Vienne, Adolf Hitler devait disparaître de nos vies pour des années. Il n’avait pas d’ami à Linz à qui il aurait pu rendre visite quelques jours et peu avec qui il pouvait correspondre. Ce n’est donc que bien plus tard que nous avons appris ses années de misère et son départ pour Munich en 1912 [en réalité en mai 1913].
Jamais nous n’avons su qu’il s’était agenouillé pour remercier Dieu quand la guerre a éclaté en 1914, qu’il avait été caporal au 16e régiment bavarois d’infanterie de réserve, qu’il avait été blessé et gazé. Jamais, jusqu’au jour où sa carrière politique a démarré, en 1920. Ce n’est qu’alors que nous devions recevoir des nouvelles d’un garçon tranquille et poli, celui qui avait grandi parmi nous.
Serait-ce Adolf ?
De temps à autre, des journaux locaux publiaient des articles sur un groupe d’activistes politiques qu’Hitler réunissait autour de lui à Munich. On y parlait de leur haine des Juifs, du Traité de Versailles et d’à peu près tout, mais sans y attacher une importance particulière. Jusqu’au jour où il y a eu vingt morts dans le putsch de la brasserie le 8 novembre 1923, ce jour-là, Hitler se gagnait une notoriété locale. Se pourrait-il, me demandais-je, que l’homme derrière ces événements soit le gentil garçon que j’ai connu, le fils de la douce Klara Hitler ?
Finalement, il sera interdit à la presse autrichienne ne serait-ce que de mentionner le nom d’Hitler. Mais le bouche-à-oreille continuait à fonctionner bon train, et les nouvelles de notre ancien concitoyen continuaient d’affluer: les persécutions qu’il avait lancées, le réarmement de l’Allemagne, la guerre qui venait. Ces nouvelles passées en contrebande trouvaient des oreilles attentives et un parti nazi local voyait le jour.
En théorie, un tel parti ne pouvait pas exister, il avait été déclaré illégale par le gouvernement. En pratique, il avait la bénédiction des autorités. Même si les uniformes étaient interdits, les nazis locaux savaient se rendre reconnaissables de tous. Ils portaient des bas blancs, sur leurs manteaux ils arboraient une petite fleur sauvage qui ressemblait beaucoup à la marguerite que connaissent les Américains, et à Noël ils allumaient des cierges bleus dans leurs maisons.
Ce sont des choses que nous savions tous, mais rien n’était fait. Parfois, la police locale découvrait un drapeau nazi sur la tombe de Klara Hitler à Leonding et le retirait sans cérémonie. Tout de même, la tempête qui se préparait en Allemagne semblait loin. Il a fallu un certain temps avant que je n’aie des échos de première main d’Adolf Hitler. En 1937, des nazis locaux se sont rendu à Nuremberg pour assister aux rassemblements. Après les discours, Hitler convia plusieurs de ces personnes à l’accompagner dans sa villa de montagne à Berchtesgaden. Le Führer leur demanda des nouvelles de Linz. Comment allait la ville? Est-ce que ses habitants le soutenaient? Il a demandé de mes nouvelles, est-ce que j’étais encore en vie, est-ce que j’exerçais toujours? Puis il a fait une déclaration assez contrariante pour les nazis locaux. « Dr. Bloch », disait Hitler, « est un Edeljude – un Juif noble. Si tous les Juifs étaient comme lui, il n’y aurait pas de question juive ». Il était étonnant, et en un sens flatteur, qu’Hitler puisse dire du bien d’au moins un membre de ma race.
Curieux, quand on y repense, ce sentiment de sécurité que nous avions parce que nous étions du bon côté d’une ligne imaginaire, la frontière internationale. Sûrement que l’Allemagne n’oserait pas envahir l’Autriche. La France était une amie. L’occupation de l’Autriche serait inamicale envers les intérêts de l’Italie. Comme nous étions aveugles alors! Puis nous avons été emportés par un tourbillon d’événements à couper le souffle. C’est avec un certain espoir que nous avions appris la visite de Schuschnigg à Berchtesgaden, son plébiscite, l’intégration de Seyss-Inquart à son cabinet. Nous espérions traverser cette crise sans trop de dommages. Mais les espoirs ont été douchés en quelques heures. Dès que Seyss-Inquart a été incorporé au cabinet, des bourgeons ont éclos sur tous les revers de veste : « Ein volk, ein Reich, ein Führer ».
Tandis que l’Autriche disparaissait
Le vendredi 11 mars 1938 la radio diffusait une émission de musique légère. Il était huit heures moins le quart du soir. Soudain la dépêche tombait, le chancelier allait prendre la parole, Schuschnigg se présenta sur les ondes et dit que pour éviter toute effusion de sang, il capitulait devant les demandes d’Hitler, on ouvrirait la frontière, il terminait son allocution par ces mots : « Gott schütze Oesterreich » – que Dieu protège l’Autriche. Hitler était de retour chez lui à Linz. Dans les journées sans sommeil qui suivirent, nous étions rivés à nos radios. Des troupes se déversaient sur la frontière à Passau, Kufstein et Mittenwalde entre autres [dans le même temps, une division autrichienne passait la frontière dans l’autre sens, vers l’Allemagne]. Hitler lui-même passait l’Inn à Braunau, sa ville natale. Sans souffler, le présentateur narrait sa progression: le Führer devait faire étape à Linz, la ville était en liesse. Le lecteur [Américain du Collier’s magazine] ne doit pas avoir le moindre doute sur la popularité de l’Anschluss avec l’Allemagne. Le peuple tout entier le voulait. Les gens accueillaient les vagues incessantes des troupes allemandes avec des fleurs, des acclamations, des chansons. Les cloches des églises sonnaient, les troupes autrichiennes et la police fraternisaient avec les envahisseurs dans l’allégresse générale.
Le petit jardin public à un pâté de maisons de chez moi à Linz était en ébullition, toute l’après-midi il raisonnait aux accents du Horst Wessel et du Deutschland über Alles. Des avions nous survolaient et l’annonce des avancées des unités allemandes étaient accueillies avec des acclamations assourdissantes. Enfin, la radio annonçait qu’Hitler était à Linz. Des consignes avaient été diffusées, toutes les fenêtres sur le trajet du cortège devaient être fermées, toutes devaient être éclairées. Je me tenais à ma fenêtre qui donnait sur la Landstrasse, Hitler allait passer devant moi.


Le retour du Héros
Bientôt le cortège se présente, la grande Mercedes noire à six roues flanquée de son escorte de motards. Le frêle adolescent que j’avais si souvent soigné et que je n’avais plus vu depuis trente ans, était là debout dans la voiture. Je ne lui avais prodigué qu’affections, qu’allait-il faire à ceux que j’aimais ? Mon regard passant au-dessus de la marée humaine fixait Adolf Hitler.
C’était un moment d’une rare intensité. Pendant des années Hitler s’était vu refuser le droit revenir voir son pays natal et maintenant ce pays lui appartenait. Une exaltation jubilatoire se lisait sur son visage. Il souriait, saluait, faisait le salut nazi à la foule massée sur le boulevard. Et puis, à un moment, il a levé les yeux vers ma fenêtre. Je doute qu’il m’ait aperçu, mais il a dû avoir une pensée. C’était là la maison de l’Edeljude qui avait diagnostiqué le fatal cancer du sein de sa maman, là se trouvait le cabinet de consultation de l’homme qui soignait ses sœurs, là qu’il était allé pour se faire soigner ses petits maux. Cela a duré le temps d’un éclair puis le cortège a poursuivi lentement vers le centre-ville, vers ce qui était la Franz Josef platz mais qui allait bientôt devenir la Adolf Hitler platz. Il a parlé depuis le balcon de la mairie, je l’ai écouté à la radio. Des paroles historiques: l’Allemagne et l’Autriche ne faisaient plus qu’un.
Hitler est descendu à l’hôtel Weinzinger, exigeant expressément une suite avec vue sur le Pöstlingberg, le paysage qu’il voyait depuis le modeste appartement où il avait grandi.
Les jours suivants, il rendit visite à quelques vieilles connaissances: Oberhummer, un permanent de l’antenne locale du parti, Kubitschek [Kubizek] le musicien [chef d’orchestre, voir plus bas la bibliographie], Liedel, l’horloger, le Dr. Hümer son ancien professeur d’histoire. Il était compréhensible qu’il ne pût pas demander à me voir moi, un Juif, mais il s’est quand même enquis de moi. J’ai pensé un moment demander audience, puis je me suis ravisé, estimant que ce serait déplacé.
Hitler était arrivé le samedi soir, le dimanche il se rendait sur la tombe de sa mère et passait en revue les nazis locaux qui défilaient devant lui. Ils n’étaient pas en uniforme, ils étaient en salopette courte ou en pantalon de ski ou dans des shorts en cuir. Le lundi, Hitler partait pour Vienne.
Nous n’allions pas tarder à nous rendre compte des changements. Il y avait 700 Juifs à Linz. Leurs commerces, leurs habitations, leurs bureaux se retrouvaient tous marqués de la bannière de papier jaune qu’on voit maintenant partout en Allemagne, JUDE— Juif.

J’ai cru percevoir un premier signe d’un traitement de faveur le jour ou j’ai reçu un coup de téléphone de la Gestapo locale: je devais retirer les écriteaux jaunes de mon cabinet et de mon domicile. Un deuxième signe semblait venir confirmer le premier : mon propriétaire, un aryen, s’est rendu au siège de la Gestapo pour demander si j’étais autorisé à rester dans mon appartement. « Nous nous garderons bien de nous occuper de ça », lui fut-il répondu, « c’est à Berlin de trancher ». Hitler, apparemment, s’était souvenu. Et puis, quelque chose est arrivé qui m’a fait douter.
Sans la moindre raison, mon beau-fils, un jeune médecin, a été jeté en prison. Personne n’était autorisé à le voir et nous ne recevions aucune nouvelle de lui. Ma fille est allé à la Gestapo. « Est-ce que le Führer aimerait apprendre que le beau-fils de son ancien docteur a été mis en prison ? » demanda-t-elle. On l’a rabrouée sans ménagement pour sa témérité : est-ce que les écriteaux n’avaient pas été retiré de la maison de son père ? Est-ce que ce n’était pas assez ? Pourtant, sa visite a dû avoir un certain effet, dans les trois semaines, son mari était relâché.
Mon cabinet, un des plus importants de Linz, je pense, avait déjà commencé à décliner depuis une bonne année avant l’arrivée d’Hitler. J’aurais dû y voir comme un présage de ce qui allait arriver. Les plus anciens de mes fidèles patients l’avouaient avec franchise: la haine prêchée par les nazis avait eu barre sur les plus jeunes et ils ne fréquenteraient plus un Juif.
Par décret, l’activité de mon cabinet était limité aux seuls patients juifs. Une façon comme une autre de dire que je devais arrêter de travailler complètement puisqu’il était prévu de débarrasser la ville de tous ses Juifs. Le 10 novembre 1938 [effet nuit de cristal du 9 au 10?], un avis à la population disait que tous les Juifs devaient avoir quitté la ville sous 48 heures et qu’ils devaient se rendre à Vienne. On peut imaginer le choc produit par ce décret. Des gens qui avaient passé toute leur vie à Linz avaient deux jours pour vendre leurs biens, faire leurs valises et partir.
Je me suis allé à la Gestapo: est-ce que je devais partir ? On m’informa qu’on avait fait une exception dans mon cas. Je pouvais rester. Ma fille et son mari ? Puisqu’ils avaient déjà signifié leur intention d’émigrer en Amérique, ils pouvaient aussi rester. Mais ils devront vider leur maison, s’il y a de la place dans mon appartement, ils seront autorisés à y habiter.
Fini les faveurs
Après trente-six ans d’activité, mon cabinet arrivait au bout. Je n’avais plus le droit de soigner que les Juifs, après l’ordre d’évacuation, il n’en restait plus que sept à Linz, tous avaient plus de quatre-vingts ans.
Il est compréhensible que ma fille et son mari aient voulu emporter les économies de leur vie avec eux en Amérique, c’est ce que je ferai quand ce sera mon tour de partir. Mais obtenir une décision en ce sens des autorités locales était hors de question, par ailleurs, je savais que je ne pouvais pas voir Hitler, mais j’avais le sentiment que si j’arrivais à lui faire passer un message, il pourrait peut-être m’aider un peu.
Si Hitler lui-même était inaccessible, peut-être qu’une de ses sœurs pourrait nous aider à le joindre. Klara était la plus proche, elle habitait Vienne. Son mari était décédé et elle vivait seule dans un modeste appartement d’un quartier résidentiel tranquille. On décidait que ma fille Gertrud irait faire un saut à Vienne pour la voir. Elle se rendit à l’appartement, toqua, mais n’eut pas de réponse. Elle était pourtant sûre qu’il y avait quelqu’un.
Elle se renseigna auprès d’une voisine. Celle-ci lui dit que Madame Wolf – Klara Hitler – ne recevait plus personne à part quelques amis intimes. Mais l’aimable voisine acceptait volontiers de porter le message à Madame Wolf et de lui rapporter sa réponse. Ma fille patienta et bientôt la réponse arriva: Madame Wolf la saluait et allait faire tout son possible. Par chance, Hitler se trouvait à Vienne ce soir-là pour une de ces sorties fréquentes, mais non annoncées, à l’opéra de Vienne. Madame Wolf le vit et, j’en suis certain, lui a donné le message, mais aucune exception n’a été faite dans notre dossier. Lorsque notre tour est venu, nous avons été forcés, comme des milliers d’autres, de partir sans un sou.
Comment Hitler avait traité un vieil ami, – celui qui s’était occupé de sa famille avec patience, considération et charité ? résumons les faveurs : je ne pense pas qu’un autre Juif en Autriche ait été autorisé à conserver son passeport. Il n’y avait pas de « J » tamponné sur ma carte de ration lorsque la nourriture s’est faite rare. C’était très utile, car les Juifs aujourd’hui ne peuvent plus faire leurs courses qu’à certaines heures, souvent les moins pratiques. Sans le « J » sur ma carte, je pouvais faire mes courses quand je voulais. J’ai même eu une carte de ration pour les habits, chose qui était généralement refusée aux Juifs.
Si mes relations avec la Gestapo n’avaient pas été précisément cordiales, je n’ai du moins pas eu, comme tant d’autres, à souffrir de mes passages chez eux. Une bonne source m’a confié, et je veux bien la croire, que le bureau de Linz avait reçu des instructions particulières de la chancellerie à Berlin pour qu’on m’accorde toute faveur raisonnable.
Il est possible, mais peu probable, que les états de service durant la guerre aient joué un rôle pour ces petites marques de considération. J’avais la charge d’un hôpital de 1 000 lits et ma femme supervisait les soins, j’ai été décoré deux fois pour les services rendus.
Hitler reconstruit sa ville
Hitler a toujours considéré que sa vraie maison c’était Linz et les changements qu’il y a apportés sont étonnants. La paisible ville de province a été métamorphosée par son « parrain » – un titre honorifique auquel Hitler tenait tout particulièrement. Des vieux pâtés de maisons ont été entièrement rasés pour laisser place à des immeubles modernes – provoquant au passage une brève mais sévère crise du logement. Un nouveau théâtre est sorti de terre et un nouveau pont a été jeté sur le Danube. Selon une légende locale, le pont a été dessiné par Hitler en personne et les plans étaient déjà terminés au moment de l’Anschluss. Le vaste réseau ferré Hermann Göring a été construit en deux ans et entre en service. Pour permettre la poursuite de ce programme de construction, on a fait venir des travailleurs par trains entiers : des Tchèques, des Polonais ou des Belges. Hitler s’est rendu à deux reprises dans la ville depuis l’Anschluss, une fois au moment des élections pour approuver l’union avec l’Allemagne, une autre fois, en secret, pour suivre l’avancement des travaux, à chaque fois, il est descendu à l’hôtel Weinzinger [le chanteur de Vienne].
Lors de sa seconde visite, le tenancier de l’hôtel a été prévenu de ce que la présence d’Hitler ne devait pas être divulguée, qu’il effectuerait sa tournée d’inspection dans la matinée. Mais enchanté par la présence chez lui d’un hôte aussi important, le propriétaire n’a pas pu s’empêcher de se vanter. Il a téléphoné la nouvelle à plusieurs amis, cette entorse à la discipline lui a coûté cher, son hôtel lui a été confisqué.
Bien des fois j’ai été sollicité par les biographes d’Hitler pour des notes sur sa jeunesse. La plupart du temps j’ai refusé de donner suite. J’ai quand même accepté de parler à l’un d’entre eux. C’était un Viennois charmant d’âge moyen, il était du service dirigé par Rudolf Hess, un nazi du premier cercle, il rédigeait une biographie officielle. Je lui donnais tous les détails dont je pouvais me rappeler et lui remit le dossier médical qui fut par la suite transféré au siège du Parti nazi à Munich. Il a fait des séjours de plusieurs semaines à Linz et à Braunau, puis le projet s’est arrêté brusquement. On m’a dit qu’on l’avait envoyé dans le silence des camps de concentration, je ne sais pas pour quel motif.
Quand cela a été finalement mon tour de quitter Linz pour l’Amérique, je savais qu’il ne me serait pas possible d’emporter avec moi mes économies. Mais la Gestapo avait encore une faveur à m’accorder. J’étais autorisé à sortir seize marks du pays au lieu de dix !
L’ordre des médecins nazis m’a fourni une lettre dont je ne sais pas bien ce que je pourrais en faire, selon laquelle « j’étais digne de recommandation». Elle déclarait en outre que «mon caractère, mon savoir médical et mon dévouement aux malades m’avaient gagné la considération et l’estime de mes confrères ».
Un officiel du Parti avait suggéré qu’on attendait de moi que j’exprime une certaine reconnaissance pour ces faveurs. Peut-être une lettre au Führer ? Avant de quitter Linz par un froid matin de novembre, je l’ai écrite, je me demande si elle est jamais parvenue à son destinataire, elle disait :
Votre Excellence :
Avant de passer la frontière, je voudrais exprimer mes remerciements pour les protections dont j’ai bénéficié. Dans le dénuement matériel, je quitte une ville où j’ai vécu pendant quarante et un ans avec la conscience d’avoir accompli sans failles tout mon devoir. À soixante-neuf ans, je dois recommencer ma vie dans un pays étranger dans lequel ma fille travaille dur pour subvenir aux besoins de la famille.
Fidèlement votre,
Eduard Bloch
Traduction : Francis Goumain
Note : Nous avons titré « récit » parce que c’est presque une œuvre littéraire que propose ici le médecin d’Hitler, avec le chassé-croisé entre Bloch et Hitler qui est superbement rendu : à la fin de la première partie, c’est l’orphelin Hitler qui quitte Linz sans un sou et le médecin Juif qui tient le haut du pavé ; à la fin de la deuxième partie, c’est Hitler qui revient à Linz dans son carrosse et qui tient le haut du pavé, qui le reconstruit même, tandis que le médecin Juif, Bloch, quitte Linz avec quelques marks en poche. Un vrai conte de fées, seulement, le véritable auteur n’est pas tant celui qui raconte l’histoire que celui qui l’a faite : Adolf Hitler. C’est peut-être pour cela que le gentil qui forcément gagne en fin de compte (et de conte), ne fait pas ici l’unanimité, n’est pas du goût de tout le monde. Le message de Bloch aux Américains est clair: on ne peut pas laisser l’histoire se terminer ainsi.
Mais attention, comme Bloch a choisi de raconter une histoire, tout n’est pas à prendre au pied de la lettre, par exemple la scène, car c’en est une, avec Hitler dans le froid du cimetière un soir de Noël comme un épagneul sur la tombe de sa maîtresse, c’est du concerto pour flûte à bec, clarinette et hautbois dans les grandes largeurs, version Musikverein de Vienne. D’ailleurs Bloch nous prévient qu’il n’a pas pu assister à l’enterrement, il faut comprendre que tout est inventé, et la raison qu’il donne de son absence est aussi suspecte : le réveillon de Noël, mais en quoi lui, Juif, devrait-il être absorbé par les préparatifs du réveillon ?
Source : « My Patient, Hitler » (ihr.org) Tiré du Journal of Historical Review, May/June 1994 (Vol. 14, No. 3), pages 27-35; originally published in two parts in Collier’s magazine, March 15 and 22, 1941
Pour aller plus loin :
- August Kubizek, The Young Hitler I Knew(Greenhill, 2006)
- Werner Maser, Hitler: Legend, Myth and Reality (HarperCollins, 1975)
- John Toland, Adolf Hitler (Doubleday & Co., 1976; Anchor, 1991)
























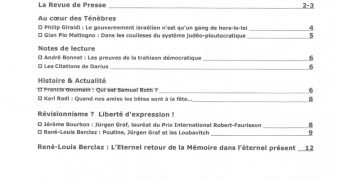


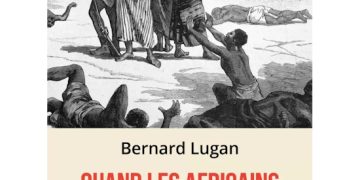
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV







Appris par DP S06E09 du 9 mars 2021 à 5.40 mn / site : jesuispartout.com qui présente en photos les membres parfois insoupçonnés de la « Sainte Famille » . Merci DP .
On y voit Marion , d’ailleurs mais quoi de plus naturel puisque papa appartenait à la fratrie ?…
Merci.
Correction : La transmission du message de Schuschnigg est du 11 mars (!) 1938. L‘Anschluß a été fait le 12 mars 1938.
Merci, très bien vu
« Au travers de son deuil, et non de ce qu’il a fait au monde »
Pas bien apprécié le commentaire, dommage qu’il suggère et ne développe pas.
Pourquoi refuse t il 20000 marks pour 2 cartes postales ,pour des raisons morales, s’il pense aussi peu de bien d’Adolf?
On pourrait conclure que la plupart des genicidaires étaient au départ des chics types, et qu’ils pouvaient s’en prendre à n’importe qui, selon des motifs parfois les plus injustes, absurdes ou calculés.
Le charisme qui subitement peut animer de tels créatures, malgré tout de Dieu, est-il le fruit d’une possession diabolique ?
Comment tout un peuple a t-il pu se laisser embarquer dans une aventure aussi diabolique ? Est-ce le renoncement au Christ et à son Église et à son enseignement au profit de vanités matérialistes et vaines ?
Marrant, il y a un épisode de Derrick qui s’appelle « le sourire du docteur Bloch ».
https://www.youtube.com/watch?v=h8fzPWBwrKs
(attention, c’est très mauvais; Derrick, c’est bon jusqu’à 1984, ça va encore jusqu’à 1986, voire, encore un épisode en 1987, mais ensuite, c’est définitivement mauvais, tout simplement parce qu’il n’y a plus « d’époque » en arrière plan, c’est fini.