Grande Guerre : une lettre du grand-père
Par Jean-Claude FERRER
Passez donc me voir au pays !
Tiens, aujourd’hui il pleut !
Derrière ma vitre, je vois le parc à voitures, encore désert à cette heure matinale, et la haie qui se fond derrière le rideau de la pluie bouche mon horizon. Avec ce temps, il n’y aura pas grand monde aujourd’hui. Je risque de m’ennuyer.
Enfin on ne sait jamais. Le progrès, la semaine de travail modulable, le chômage, les touristes, ça peut quand même faire venir du monde.
Depuis que je suis installé, j’en ai vu passer, des gens. Et des voitures, ah ! les voitures !
Au village, à l’époque, il n’y en avait pas. Dame ! C’étaient des chevaux. Plus simple et pas polluant. « Écolo », comme ils disent.
Par contre, au bourg, le jour du marché, j’en voyais, des autos : belles, luisantes, impressionnantes. Fallait avoir de quoi pour s’offrir de pareils engins. C’est pas avec mes quatre sous de garçon de ferme que je pouvais m’offrir ça. Alors, en revenant au village, le cul du cheval se balançant devant moi, je rêvais à ces belles autos que je n’aurais jamais. Sauf imprévu.
L’avenir me donna raison : je n’eus jamais d’auto ; par contre, côté imprévu, je fus servi. Portion royale. Gros lot.
Mais, pour l’heure, c’est d’autos que je vous parle. Et depuis que je suis installé ici, je peux dire que j’en ai vu. Des plus vieilles aux plus récentes, et de toutes couleurs. Elles sont toutes passées devant moi, sur cette grande esplanade.
Il faut dire que je suis bien situé, question vue.
Mais le bruit, vous allez me dire ?
Rien ! Silence total. Il faut dire que le parc est assez éloigné, et puis, la vitre est très épaisse. Un verre de protection, incassable. On ne sait jamais, avec le monde actuel, plein de fous : l’architecte a construit solide, pour éviter les effractions.
Il y a des cars de touristes aussi. Des quantités.
On les appelle « touristes », les étrangers maintenant. Et ils ont des droits. Rien que des droits, plus de droits que ceux du pays.
A mon époque, c’était pas comme ça. L’étranger, fallait qu’il soit sage et respectueux de nos coutumes. Et au besoin, on savait le faire tenir.
C’est même pour ça que je suis derrière ma vitre maintenant, à regarder leurs héritiers déambuler devant moi.
Au début où j’étais installé ici, c’étaient surtout des gens de la région qui venaient. Je le voyais aux vêtements. Tous en noir. Pour visiter un parent, sans doute. Puis, les autos ont commencé à arriver.
Aux plaques, on les reconnaissait : Belges, Suisses, Anglais, même des Allemands. Maintenant les Américains viennent aussi. Oh, je ne suis jamais seul !
Une chose m’intrigue pourtant. Au début, c’étaient surtout des gens comme moi. Puis, j’ai vu arriver des noirs. Viennent de loin, les touristes, maintenant : d’Afrique, d’Asie… Pas besoin de visiter le monde ; c’est le monde qui vient à moi !
Ce qui m’étonne, c’est que leurs voitures ont des numéros de par ici. C’est des « pays » comme on disait à l’armée.
Au temps des colonies, bien sûr, j’en ai vu une fois, à la grande foire du chef-lieu. Très beau dans leurs costumes traditionnels. Mais il y en avait guère.
A présent ils sont nombreux, mais en habits ordinaires. Finis les costumes exotiques ! Les jeunes surtout, ils s’habillent comme l’as de pique, ceux-là. N’ont donc pas de parents pour les guider ? Pantalons de coutil bleu, sales, déchirés des fois. Casquettes enfoncées à l’envers, comme l’idiot du village. Il y en a même qui ont une boucle à l’oreille, et de grands cheveux. Vous vous rendez compte ? Au village, avec une boucle d’oreille j’aurais fait tourner le lait des vaches, et les chevaux m’auraient lancé des ruades !
Les filles aussi ont changé. S’habillent en pantalons aussi. Avec les mêmes taches et des déchirures aux genoux. Je regrette bien les robes et les jupes, je dois dire. Car, d’où je suis, j’en verrais des gambettes. Légèrement en contre-bas du passage, le regard pratiquement à hauteur des genoux, si vous aimez mieux…
Que voulez-vous : un homme est toujours un homme ! C’est pour ça que je préfère les beaux jours à l’hiver : les femmes sont plus jolies à regarder.
Enfin, je peux pas critiquer : c’est déjà beau qu’ils viennent.
Passé le « parkigne » comme ils disent maintenant, à main gauche, je vois des arbustes et un massif de fleurs. De temps en temps un chien va faire son pipi dans le massif. J’aime bien les chiens. Changent pas, eux. Les modes passent, les voitures évoluent, les gens changent, mais les chiens, non. Toujours les mêmes. Plus vrais que les humains. Quand ils regardent vers moi, leurs yeux sont doux, francs, naturels.
L’homme, lui, il a un regard bizarre. Comme un malaise, un étonnement, un mélange de curiosité et de peur.
Ils se penchent vers moi parce que le regard sur la vitre les gêne ; ils mettent une main en visière et scrutent mon intérieur. C’est là que je vois passer les générations : à mille lieues de moi, de mes traditions, de ce que nos maîtres nous ont appris.
Nos enfant, ça ? Des étrangers, plutôt.
Alors la question revient. Ça a servi à quoi ?
Voilà trois quarts de siècle que je me la pose. Et je n’ai toujours pas la réponse.
Ça a servi à quoi ? Tu le sais, toi, lecteur ?
Si oui, viens donc me le dire, tu me trouveras sans peine.
Mon bâtiment est juste en face du parking. Septième fenêtre à partir de la gauche. Oh, tu me reconnaîtras ! Je suis bien conservé malgré mon âge. J’ai encore toutes mes dents, le crâne blanchi par le temps et les orbites vides.
Je suis en haut du tas d’ossements.
A Douaumont.
« L’ossuaire », ça s’appelle.

Source : LE LIBRE JOURNAL page 9 N°166 du 11 NOVEMBRE 1998
























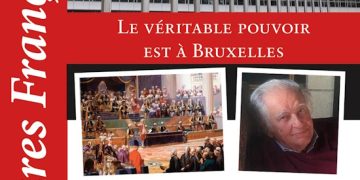




 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV


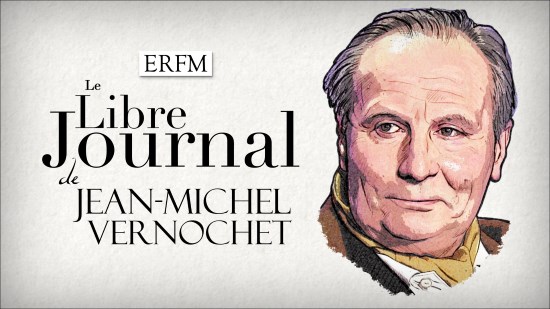
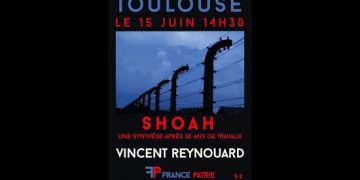






Un grand merci pour avoir publié mon texte qui me semble toujours d’actualité.
Texte de 1998, mais pourtant toujours d’actualité dans notre pauvre monde actuel.
Publié en novembre 1998 dans le numéro 166 du libre journal de la France courtoise de Serge de Beketch