Vaccination : pourquoi la liberté doit primer sur l’obligation
1. Introduction – Une société sous seringue ?
En France, l’élargissement de l’obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins en 2018, puis à 13 en 2025, a rendu la vaccination infantile un pilier central de la politique de santé publique. Cette évolution pose une question fondamentale : au nom de quoi peut-on imposer un acte médical à un nourrisson en parfaite santé ? les impératifs de santé publique et les droits individuels se situent au cœur du dispositif, obligeant une réflexion rigoureuse des dimensions scientifiques, éthiques, politiques du thème.
2. L’obligation vaccinale : un choix politique, pas scientifique
Des pays comme la Suède, la Norvège, le Japon ou le Royaume-Uni, misant sur des politiques de vaccination sans contrainte, ne connaissent pas d’épidémies importantes de maladies ayant une vaccination, alors qu’en France, les obligations se traduisent par une exclusion sociale : refus d’accès à la crèche ou à l’école.
Certains vaccins administrés en France visent des maladies aujourd’hui exceptionnelles, voire presque disparues. La poliomyélite, épuisée du pays depuis 1989, ou la diphtérie, quasi absente depuis la décennie des années 1990, n’offrent pas de danger épidémiologique immédiat en raison de l’amélioration des niveaux d’hygiène. Le vaccin contre l’hépatite B, administré à partir de 2 mois, cible une maladie transmissible par le sang ou la relation sexuelle – voies de transmission étrangères aux nourrissons. Le tétanos, maladie non transmissible, atteint moins de 10 individus par année, principalement des adultes d’un certain âge. Aucun cas pédiatrique n’a été signalé (Santé publique France, 2023). Le danger réel pour un nourrisson
Déjà en 2017, l’Association Internationale pour une Médecine Scientifique Indépendante et Bienveillante (AIMSIB) critiquait, à travers une lettre ouverte aux députés, la justification épidémiologique qui sous-tendait l’extension de l’obligation vaccinale de 3 à 11 vaccins, préconisée par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. L’AIMSIB résumait ainsi ce qui se pouvait constater quant aux maladies. contre lesquels cette extension était préconisée : des maladies comme la rougeole, qui entre 2008 et 2016 ont tué 23 personnes, frappaient d’abord des individus immunodéprimés ou non vaccinés pour des motifs médicaux, pas des refus de vaccins système
Cette politique stricte est disproportionnée, inutilement dit-on, car des options sont possibles : ciblage des risques, épidémiologie renforcée, liberté vaccinale encadrée. La prise en main par l’industrie pharmaceutique des orientations sanitaires renforce la méfiance. Des firmes comme Sanofi ont un quasi-monopole sur le marché français du vaccin ; l’étendu en 2018, se juchant sur la promotion de vaccins combinés coûteux, a nourri des soupçons d’un agenda pharmaceutique. L’AISM pointait aussi des conflits d’intérêts au sein des organes décisionnels, mentionnant la parenté d’Agnès Buzyn avec des établissements proches de l’industrie pharmaceutique, qui nourrissait des soupçons d’une influence Big Pharma sur la politique publique. Le scandale Mediator vent la corruption de l’entrelacement des intérêts publics et privés (Rapport IGAS, 2011)
Ces événements alimentent la perception d’une politique vaccinale gouvernée non par la science, mais par les lobbys économiques. La consultation citoyenne de 2016, confiée au Pr Alain Fischer, avait révélé une défiance importante envers les vaccins. Plutôt que d’ouvrir le dialogue, l’État a opté pour un durcissement. À rebours des modèles scandinaves, où la confiance prévaut sur la contrainte, la France semble avoir préféré imposer que convaincre.
3. Une médecine sans consentement n’est plus de la médecine
Le principe éthique fondamental de la médecine repose sur le consentement libre et éclairé. La Déclaration d’Helsinki (Association médicale mondiale, 2013) en fait un fondement incontournable. Or, dans le cas de la vaccination infantile, ce droit est confisqué dès la naissance. Les parents, pourtant garants de l’intérêt de leur enfant, sont contraints de suivre un calendrier vaccinal unique, sous peine de sanctions sociales ou légales. Reporter un vaccin, espacer les doses ou demander un schéma personnalisé devient quasi impossible.
Cette critique n’est pas nouvelle. Dès 2017, l’AIMSIB, dans une lettre ouverte aux députés, alertait sur les atteintes aux libertés fondamentales engendrées par l’extension de l’obligation vaccinale infantile. Imposer 11 vaccins dès la naissance était perçu comme une violation du consentement éclairé, les parents risquant des sanctions sociales – comme l’exclusion des crèches – ou légales en cas de refus. L’association déplorait l’absence de débat démocratique sur une mesure aussi intrusive, arguant qu’une politique de santé doit respecter les droits fondamentaux et non les contourner sous prétexte de santé publique. De manière similaire, l’Association Liberté Information Santé (ALIS) défend le « libre consentement éclairé », érigé en norme juridique depuis 1947 dans la foulée du Code de Nuremberg, qui jugea les médecins nationaux-socialistes allemands pour leurs expérimentations en temps de guerre. ALIS argue que l’obligation vaccinale viole ce droit fondamental en imposant des vaccins sans tenir compte des choix individuels ou des contre-indications médicales, transformant les citoyens en sujets passifs d’une politique sanitaire autoritaire.
Cette dérive autoritaire affaiblit la relation patient-médecin, transformant l’acte de soin en exécution administrative. L’article L3111-2 du Code de la santé publique impose une logique de conformité au détriment de l’individualisation des soins, reléguant l’éthique au second plan. Cette uniformisation, dictée par l’État, fragilise le principe même de médecine : soigner une personne, non une statistique.
4. Des risques niés, un débat verrouillé
Le livre de Suzanne Humphries et Roman Bystrianyk, Vaccination : La Grande Désillusion, apporte une contribution majeure à cette question en démontant, documents historiques et statistiques à l’appui, l’idée reçue selon laquelle la vaccination aurait été la cause principale de la disparition des grandes épidémies. Les auteurs montrent que la mortalité liée à des maladies comme la rougeole, la coqueluche ou la diphtérie avait déjà fortement décliné avant l’introduction des vaccins, grâce aux progrès en matière d’hygiène, de nutrition et de conditions de vie. Ils soulignent également que de nombreuses épidémies ont persisté, voire empiré, malgré des taux de vaccination élevés, ce qui remet en cause l’efficacité réelle des campagnes vaccinales de masse. Humphries, médecin hospitalier ayant constaté des effets secondaires graves chez ses patients, dénonce une médecine industrialisée qui impose des protocoles standardisés au mépris de l’individualisation thérapeutique et de l’écoute du patient. Le livre insiste par ailleurs sur l’opacité systémique entourant les effets indésirables : pharmacovigilance passive, conflits d’intérêts, dissimulation de données, marginalisation des voix critiques.
Ces préoccupations rejoignent celles exprimées par l’AIMSIB en 2017, qui mettait en doute l’efficacité de certains vaccins obligatoires. Par exemple, une étude publiée dans The Lancet montrait que le vaccin contre la coqueluche offrait une protection limitée et que les vaccinés pouvaient malgré tout transmettre la maladie, ce qui relativise l’argument de l’immunité collective. L’association s’inquiétait également des risques d’effets secondaires graves, notamment liés aux adjuvants comme l’aluminium, dont les effets à long terme – maladies auto-immunes, troubles neurologiques – restent insuffisamment étudiés. ALIS partage ces inquiétudes, dénonçant l’absence d’évaluation individuelle des risques avant vaccination, comme les allergies, qui peuvent rendre certains nourrissons particulièrement vulnérables. Face à ces effets secondaires graves et à l’absence de consensus scientifique solide, l’AIMSIB appelle à suspendre la vaccination de masse pour éviter une potentielle « catastrophe de santé publique ».
Enfin, dans Vaccins Assassins, le Dr Tal Schaller qualifie la vaccination moderne de « religion scientifique ». Il démontre que l’immunisation collective a été largement surestimée et que l’efficacité réelle des vaccins est contestable, surtout dans un contexte où l’hygiène, l’alimentation et la prévention naturelle jouent un rôle prépondérant. Il dénonce l’uniformisation des protocoles, la non-prise en compte des spécificités immunitaires, et la criminalisation de toute remise en question. Selon lui, moins de 1 % des effets indésirables sont effectivement déclarés, ce qui rend toute évaluation honnête impossible.
Ces ouvrages convergent vers une critique structurée et approfondie de la stratégie vaccinale contemporaine. les vaccins ne sont pas exempts de risques. L’ANSM a recensé plus de 1 200 effets indésirables graves en lien avec les vaccins en 2022, incluant des troubles neurologiques ou auto-immuns (ANSM, 2023). Ces effets sont souvent minimisés, classés comme coïncidences ou non déclarés, du fait d’un système de pharmacovigilance essentiellement passif. Les familles confrontées à des effets secondaires graves, tels que convulsions ou régressions post-vaccinales, se heurtent à un mur de silence institutionnel. Ce constat s’inscrit dans un phénomène plus large de sous-déclaration massive : selon plusieurs études et revues scientifiques, seulement 2 à 10 % des effets indésirables seraient effectivement signalés, laissant entre 90 % et 98 % d’événements sans aucune déclaration officielle. Une revue systématique de 37 études a estimé un taux médian de sous-notification de 94 %, avec une fourchette allant de 82 % à 98 % selon les pays et les systèmes (Hazell & Shakir, Drug Safety, 2006). Le Dr Bernard Dalbergue, ancien cadre chez Merck, déclarait que les industriels « planquent toutes les données de pharmacovigilance, au mépris de la santé, des lois et de l’éthique ». Ce défaut structurel, bien documenté, fausse la perception du risque réel et alimente un discours officiel reposant sur des statistiques incomplètes.
Les chercheurs indépendants, comme Andrew Wakefield, sont disqualifiés sans que leurs interrogations ne soient examinées en détail (Godlee et al., 2011). Le débat est cadenassé. L’opinion publique est privée d’un discours équilibré, toute nuance étant rejetée.
5. Vaccins : même dose pour tous, même protocole pour tous
Les nourrissons reçoivent des doses vaccinales identiques, sans ajustement à leur poids, leur système immunitaire ou leur historique médical. Par exemple, le vaccin contre l’hépatite B, injecté dès 2 mois, est dosé comme pour un adulte de 70 kg (Vidal, 2023). De plus, jusqu’à six antigènes peuvent être administrés en une seule séance, sans évaluation préalable du système immunitaire.
Peu d’études examinent en profondeur les interactions entre composants de vaccins combinés (Tichmann-Schumann et al., 2005). Les variations génétiques du système HLA, connues pour influencer la réponse immunitaire, ne sont jamais prises en compte (Poland et al., 2008). Ignorer cette complexité revient à faire de la médecine un automatisme industriel, non un acte clinique individualisé.
6. La peur comme outil politique
Le discours officiel s’appuie sur une arme redoutable : la peur. « Si vous ne vaccinez pas, vous mettez les autres en danger », martèle-t-on aux parents, transformant une décision médicale en faute morale. Cette rhétorique, fondée sur la culpabilisation, vise à étouffer toute réflexion critique et à marginaliser les voix dissidentes. Les parents réticents ou opposés à la vaccination de leurs enfants sont non seulement stigmatisés, mais aussi criminalisés, dans un climat où la délation l’emporte sur le dialogue – allant parfois jusqu’à des mesures extrêmes comme le retrait de leurs enfants.
Cette logique s’est étendue à la vaccination infantile avec une sévérité accrue. Les parents qui s’interrogent sur le calendrier vaccinal, demandent des ajustements ou refusent certains vaccins sont immédiatement accusés d’irresponsabilité, voire de mise en danger d’autrui. Ce discours binaire – « vous êtes avec nous ou contre la santé publique » – ne tolère aucune nuance. Les familles souhaitant espacer les doses ou attendre que leur enfant soit plus âgé pour certaines injections se retrouvent ostracisées, souvent dénoncées par des institutions ou des membres de leur communauté. Des témoignages rapportent des signalements aux services sociaux pour « négligence » à l’encontre de parents refusant de suivre le calendrier vaccinal, une pratique qui s’est intensifiée depuis l’extension de l’obligation à 13 vaccins en 2025 (témoignages recueillis par ALIS, 2024).
Pire encore, certains parents se sont vus retirer la garde de leurs enfants pour avoir résisté à l’obligation vaccinale. L’Association Liberté Information Santé (ALIS) a documenté des cas où des familles, après avoir été signalées pour « mise en danger » par des écoles ou des médecins, ont été confrontées à des interventions des autorités sociales. Dans des situations extrêmes, des juges des affaires familiales ont ordonné le placement des enfants dans des foyers ou chez des proches, sous prétexte que les parents, en refusant les vaccins, représentaient un danger pour leur santé. Un cas emblématique, rapporté par ALIS en 2023, concerne une famille de la région Auvergne-Rhône-Alpes : après avoir refusé le vaccin contre l’hépatite B pour leur nourrisson de 3 mois, invoquant des antécédents familiaux d’effets secondaires graves, les parents ont été dénoncés par leur pédiatre. S’en est suivi un signalement, une enquête sociale, et finalement le retrait temporaire de leur enfant, placé sous tutelle de l’État pendant six mois, le temps d’une « réévaluation de leur capacité parentale » (ALIS, 2023). Ces mesures, bien que rares, témoignent d’une dérive autoritaire où l’État se substitue aux parents dans des décisions aussi intimes que la santé de leurs enfants, sous couvert de protection publique.
La criminalisation prend également une forme légale. Le Code de la santé publique (article L3111-2) prévoit des sanctions contre les parents réfractaires, allant de amendes à des peines plus lourdes en cas de récidive. Depuis 2018, des cas médiatisés ont vu des familles poursuivies pour avoir refusé des vaccins jugés non pertinents pour leur situation, comme celui contre l’hépatite B pour un nourrisson sans facteur de risque. Ces poursuites judiciaires, même peu fréquentes, envoient un message clair : l’État est prêt à punir ceux qui s’écartent de la norme vaccinale, au point de briser des familles pour imposer sa vision.
Cette stratégie s’appuie sur une instrumentalisation des données. Les chiffres sur les risques épidémiques sont souvent mal contextualisés – par exemple, en omettant que les flambées de rougeole touchent surtout des populations immunodéprimées ou des adultes non vaccinés pour raisons médicales, et non des enfants non vaccinés par choix parental (AIMSIB, 2017). Les parents sont ainsi dépeints comme des vecteurs de danger public, une accusation qui alimente la honte sociale et la pression communautaire. Les médias, en relayant ce narratif, contribuent à cette diabolisation en publiant des articles alarmistes sur les « anti-vaxs », amalgamant ceux qui refusent catégoriquement et ceux qui posent des questions légitimes sur les risques ou la pertinence de certains vaccins.
Le climat créé est oppressant. Les familles hésitantes vivent dans la crainte d’être jugées, dénoncées ou sanctionnées. Des forums en ligne, comme ceux animés par ALIS, regorgent de récits de parents décrivant des pressions exercées par des pédiatres, des directeurs d’école, voire des voisins, pour se conformer au calendrier vaccinal. Certains rapportent avoir été exclus de groupes de parents ou avoir vu leurs enfants privés d’accès à des activités extrascolaires, sous prétexte qu’ils représentaient un « risque » pour les autres. Cette exclusion sociale, combinée à la menace de sanctions légales et, dans les cas les plus graves, au retrait de leurs enfants, transforme le choix vaccinal en un acte de résistance face à une machine répressive implacable.
La peur, utilisée comme outil politique, a déjà servi à justifier des mesures extrêmes lors de la crise Covid : confinement, pass sanitaire, obligation vaccinale pour les soignants, souvent appuyées sur des données partielles (efficacité vaccinale variable, impact selon l’âge ou les comorbidités). Aujourd’hui, elle est recyclée pour imposer la vaccination infantile, dans un contexte où les parents sont non seulement culpabilisés, mais aussi transformés en boucs émissaires d’une politique sanitaire qui refuse de reconnaître ses limites. Ce climat de suspicion, de répression et de sanctions extrêmes, comme le retrait d’enfants, ne fait qu’aggraver la défiance envers les institutions sanitaires, au détriment d’un dialogue constructif
7. La liberté vaccinale : une voie responsable et digne, fondée sur le choix et une information libre
Défendre la liberté vaccinale, ce n’est pas rejeter les vaccins, mais exiger un cadre où chaque individu – parent ou adulte – puisse faire un choix éclairé, basé sur une information complète, transparente et dénuée de biais. Actuellement, le système impose une politique vaccinale rigide qui prive les citoyens de leur autonomie, en s’appuyant sur une communication orientée qui privilégie la peur et la coercition au détriment du dialogue et de la vérité. Pour que la liberté vaccinale soit une réalité, il faut non seulement offrir des options adaptées, mais aussi garantir un accès à une information libre, indépendante et pluraliste, permettant à chacun de peser les bénéfices et les risques sans pression ni manipulation.
Le choix vaccinal doit commencer par des calendriers vaccinaux personnalisés, tenant compte des spécificités de chaque individu. Les nourrissons ne sont pas des entités uniformes : leur poids, leur système immunitaire, leurs antécédents familiaux ou leurs éventuelles prédispositions génétiques varient. Par exemple, un enfant avec une histoire familiale de réactions allergiques graves ou de maladies auto-immunes pourrait nécessiter un calendrier ajusté, avec des doses espacées ou des vaccins administrés plus tard. Pourtant, le système actuel impose un protocole unique, sans considération pour ces différences. Permettre aux parents de travailler avec des médecins pour élaborer un plan vaccinal sur mesure, adapté à leur enfant, serait une première étape vers une liberté vaccinale responsable.
Ensuite, le choix ne peut exister sans des tests préalables pour identifier les contre-indications potentielles. Les variations génétiques du système HLA, qui influencent la réponse immunitaire, devraient être prises en compte avant toute vaccination (Poland et al., 2008). De même, des tests pour détecter des immunodéficiences ou des sensibilités aux adjuvants, comme l’aluminium, pourraient éviter des effets secondaires graves. Actuellement, ces évaluations sont inexistantes dans le cadre des campagnes vaccinales de masse. Offrir aux familles la possibilité de réaliser ces tests, et d’adapter les décisions vaccinales en conséquence, renforcerait leur autonomie et leur confiance dans le système de santé.
La liberté vaccinale implique également le droit de différer ou de refuser certains vaccins sans crainte de sanctions. Aujourd’hui, les parents qui refusent ou reportent une vaccination s’exposent à des exclusions sociales (crèches, écoles) ou à des sanctions légales (amendes, voire retraits d’enfants, comme mentionné précédemment). Cette pression coercitive est incompatible avec un véritable choix. Une politique de santé respectueuse des droits fondamentaux devrait permettre aux familles de dire non, de temporiser ou de sélectionner les vaccins qu’elles jugent pertinents, sans être stigmatisées ou punies. Cela inclut la possibilité de refuser des vaccins contre des maladies rares ou peu pertinentes pour leur situation, comme l’hépatite B pour un nourrisson sans facteur de risque, tout en maintenant un dialogue avec des professionnels de santé pour évaluer les besoins réels.
Cependant, pour que ce choix soit véritablement éclairé, il doit s’appuyer sur une information libre et non orientée. Actuellement, la communication officielle sur les vaccins est largement biaisée, dominée par des messages alarmistes qui exagèrent les risques épidémiques tout en minimisant les effets secondaires. Les campagnes publiques, souvent financées ou influencées par l’industrie pharmaceutique, présentent les vaccins comme une solution universelle et sans risque, occultant les incertitudes scientifiques et les données sur les effets indésirables graves. Par exemple, l’ANSM a recensé 1 200 effets secondaires graves liés aux vaccins en 2022 (ANSM, 2023), mais ces chiffres sont rarement mis en avant dans les messages officiels. De plus, les conflits d’intérêts au sein des instances sanitaires, comme ceux dénoncés par l’AIMSIB concernant les liens entre certains décideurs et Big Pharma, jettent un doute sur l’indépendance de l’information fournie.
Pour garantir une information libre, il est essentiel de briser le monopole des autorités sanitaires et des laboratoires sur le discours vaccinal. Cela passe par la création de plateformes indépendantes, où des experts de divers horizons – médecins, chercheurs, épidémiologistes, mais aussi patients ayant subi des effets secondaires – pourraient partager leurs analyses et témoignages sans crainte de censure. Ces plateformes devraient inclure des données brutes et accessibles sur l’efficacité des vaccins, leurs risques, et leur pertinence dans le contexte épidémiologique actuel, permettant aux citoyens de se forger une opinion éclairée. Par exemple, une information honnête sur le vaccin contre la poliomyélite préciserait qu’aucun cas n’a été recensé en France depuis 1989 (Institut Pasteur, 2023), tout en expliquant les raisons du maintien de l’obligation vaccinale. Une telle transparence, loin de semer le doute, renforcerait la confiance en montrant que les autorités respectent l’intelligence des citoyens.
Enfin, une pharmacovigilance active et transparente est cruciale pour soutenir ce droit au choix. Actuellement, le système de pharmacovigilance est passif, sous-déclarant massivement les effets indésirables – 94 % d’entre eux ne seraient pas signalés, selon une revue systématique (Hazell & Shakir, Drug Safety, 2006). Une pharmacovigilance proactive, qui recueille systématiquement les retours des patients et des médecins, et qui publie ces données en toute transparence, permettrait aux familles de mieux comprendre les risques réels. Cela inclut la reconnaissance des effets secondaires graves, comme les troubles neurologiques ou auto-immuns, et la prise en charge rapide des familles affectées, sans les laisser affronter un mur institutionnel.
En 2017, l’AIMSIB proposait une approche similaire pour l’obligation vaccinale infantile, plaidant pour l’éducation et la transparence plutôt que la coercition. Elle appelait à un débat public pluraliste, incluant des experts indépendants, pour évaluer la pertinence de chaque vaccin – une démarche qui reste pertinente aujourd’hui. En France, instaurer une liberté vaccinale véritable nécessiterait de rompre avec la communication orientée et de redonner aux citoyens les moyens de décider en toute connaissance de cause, dans un climat de respect mutuel et de dialogue.
8. Conclusion – La santé ne se décrète pas : vers une médecine humaine et personnalisée.
L’autoritarisme médical est une impasse qui aliène les citoyens, brise la confiance et compromet l’essence même de la médecine : soigner l’individu dans le respect de son autonomie. La santé ne se commande pas par des décrets imposés d’en haut, elle se construit par le dialogue, le respect mutuel et une transparence sans faille. La liberté vaccinale incarne cette voie : une médecine ancrée dans l’éthique, la responsabilité et la vérité scientifique, où le droit de dire non, de temporiser ou de questionner n’est pas une menace pour la santé publique, mais sa condition fondamentale. Face aux dérives actuelles, il est urgent de repenser la politique vaccinale pour la recentrer sur l’intérêt réel des individus, et non sur des impératifs administratifs ou industriels.
L’obligation vaccinale, qu’elle concerne les enfants ou les soignants, manque de fondements scientifiques et éthiques solides, comme l’ont souligné les analyses de l’AIMSIB en 2017 et 2021. En 2017, l’association appelait les députés à rejeter l’extension à 11 vaccins, plaidant pour un moratoire afin d’ouvrir un débat démocratique et scientifique sur la pertinence de chaque vaccin. Ces demandes convergent vers une nécessité impérieuse : un moratoire global sur l’obligation vaccinale, tant pour les enfants que pour les soignants, le temps de réévaluer rigoureusement les bénéfices, les risques et les alternatives possibles.
Ce moratoire ne doit pas être une simple pause, mais le point de départ d’une réforme profonde de la politique de santé publique. Il s’agit de replacer l’individu au centre des décisions médicales, en commençant par les nourrissons, trop souvent traités comme un troupeau à vacciner au profit des intérêts financiers des grandes firmes pharmaceutiques. Les laboratoires comme Sanofi, qui dominent le marché vaccinal français, ont bénéficié de l’extension des obligations vaccinales, souvent au détriment d’une réflexion sur l’utilité réelle de ces mesures. Par exemple, le vaccin contre l’hépatite B, imposé dès 2 mois alors que les nourrissons ne sont pas exposés aux modes de transmission (sang, rapports sexuels), illustre une logique de surmédicalisation dictée par des agendas économiques plutôt que par des besoins sanitaires. Un débat public rigoureux doit examiner la pertinence de chaque vaccin dans le contexte épidémiologique actuel – où des maladies comme la poliomyélite ou la diphtérie sont quasi absentes (Institut Pasteur, 2023) – et évaluer si l’obligation est justifiée ou si des approches ciblées et volontaires seraient plus adaptées.
Cette réforme doit aussi s’attaquer à la crise de confiance qui mine les relations entre les citoyens et les institutions sanitaires. La consultation citoyenne de 2016, menée par le Pr Alain Fischer, avait révélé une défiance profonde envers les vaccins, alimentée par des scandales comme celui du Mediator (Rapport IGAS, 2011) ou les négociations opaques entre Ursula von der Leyen et Pfizer pour les vaccins Covid (Euractiv, 2023). Plutôt que de répondre à cette méfiance par un dialogue ouvert, l’État a choisi la coercition, renforçant l’obligation vaccinale et marginalisant les voix critiques. Ce choix a aggravé le fossé entre les autorités et la population, comme en témoignent les mouvements de résistance croissants, portés par des associations comme ALIS. Cette dernière a engagé des actions juridiques concrètes, soutenant des plaintes contre X pour violation du consentement éclairé et obtenant l’abrogation de dispositions imposant des vaccins non obligatoires dans certains contextes (ALIS, 2024). Ces victoires juridiques montrent que la mobilisation citoyenne peut faire plier un système trop rigide, mais elles ne suffisent pas : il faut un changement systémique.
Un tel changement passe par la création d’un espace de débat public pluraliste et non idéologique, où toutes les parties prenantes – scientifiques indépendants, médecins, patients, associations, et représentants des autorités – puissent confronter leurs points de vue. Ce débat doit inclure des questions essentielles : Quels vaccins sont réellement nécessaires dans le contexte actuel ? Quels sont les risques réels, y compris les effets secondaires graves sous-déclarés ? Comment garantir une pharmacovigilance active et transparente pour restaurer la confiance ?
Enfin, il est crucial de redonner à la médecine sa dimension humaine et éthique. L’obligation vaccinale transforme les médecins en exécutants administratifs, contraints d’appliquer des protocoles uniformes au détriment de l’individualisation des soins. Elle prive les parents de leur rôle de décideurs pour leurs enfants, les soumettant à des sanctions sociales, légales, voire au retrait de leurs enfants dans les cas les plus extrêmes (ALIS, 2023). Une médecine humaine doit reposer sur le consentement libre et éclairé, comme le stipule la Déclaration d’Helsinki (Association médicale mondiale, 2013), et sur une relation de confiance entre soignants et patients. Cela signifie reconnaître le droit des individus à questionner, à demander des ajustements, et à refuser des interventions médicales sans être stigmatisés ou punis. La santé publique ne peut prospérer en écrasant les libertés fondamentales ; elle doit les intégrer comme un pilier de sa légitimité.
Il est temps de mettre fin à cette logique autoritaire qui infantilise les citoyens et alimente la défiance. La santé est un bien commun qui exige la participation active de tous, et non l’obéissance aveugle à des décrets. Un moratoire sur l’obligation vaccinale, suivi d’un débat public rigoureux et pluraliste, est une étape incontournable pour rétablir la confiance, la transparence et le discernement dans la politique de santé. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons bâtir une médecine où la santé des individus et de la collectivité ne s’opposent pas, mais se renforcent mutuellement dans le respect de l’éthique et de la liberté.


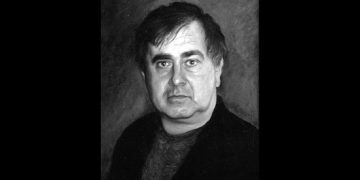



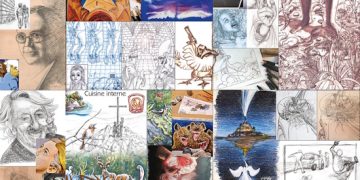







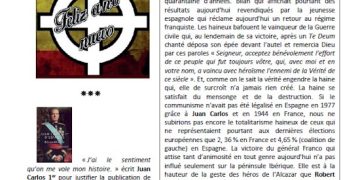


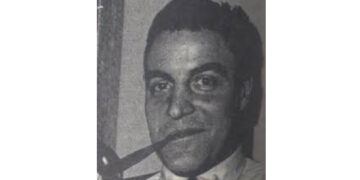




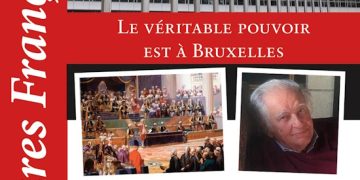



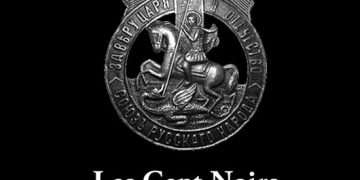


 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV

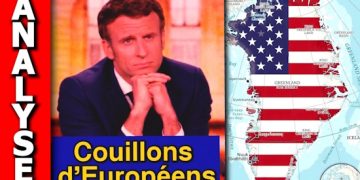

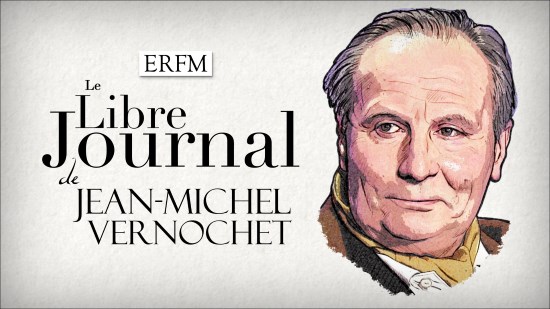
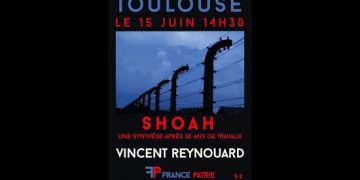





Franchement, ceux qui font encore confiance aux autorités dans le domaine de la médecine, je pense que ce sont des fous ! On l’a bien vu lors de la tyrannie sanitaire. Le système est complètement pourri, ceux qui nous gouvernent veulent empoisonner la population. Les vaccins ils sont soupçonnés pour l’autisme. Franchement, une maladie comme ça dont la progression est exponentielle, il faut bien qu’elle soit causée par quelque chose. L’Etat, apparemment, il ne cherche pas outre mesure. Je suis désolé pour les parents, je n’ai pas de solution, avec de pareils tyrans au pouvoir, on ne peut qu’espérer passer entre les gouttes. Il paraît aussi qu’ils veulent remplacer les vaccins actuels par des vaccins à ARN messagers, comme ceux qui ont tant tué et tant rendu malade pendant la folie du coronavirus. Et ils utilisent déjà ce type de vaccins pour les canards et les porcs. Là aussi je n’ai pas de solution, il faut bien manger.