Joseph Darnand (par Charles Ambroise-Colin)
À l’occasion de la commémoration de l’assassinat de Joseph Darnand, le 10 octobre 1945, nous publions un récit de son avocat Charles Ambroise-Colin. Il y évoque la haute figure de ce grand soldat français, tel qu’il l’a connu durant ses derniers jours.
Il y a trente ans, je défendais Joseph Darnand et l’accompagnais à la mort.
Ces instants vivent en moi avec une présence et une couleur qui me contraignent, pour cet anniversaire, à ne pas garder le silence. Certes, les hommages ne manquent pas à Darnand. Ses amis lui sont restés fidèles. Je n’ai rien à ajouter à cette constance dans l’amitié, si ce n’est mon témoignage personnel. Il a sa valeur.
Je n’avais fait qu’entrevoir Darnand avant d’assurer sa défense. À partir de ce moment, pendant ces quelques semaines, je ne l’ai pour ainsi dire pas quitté. Il s’est livré à moi avec une confiance entière. L’image qu’il m’a laissée correspondait à ce que j’imaginais de lui. C’était un soldat loyal. Rien d’autre et c’est immense.
L’amas de calomnies, d’erreurs, de faux jugements, qu’on a fait sur sa personne, amènerait à une contrepartie aussi manichéenne. La vérité suffit dans sa simplicité, sa nudité abrupte. Elle dissipe les faux semblants. Telle quelle, elle ne peut inspirer qu’un sentiment, celui-là même que j’ai ressenti. Le respect.
Je n’ai ici qu’à évoquer certaines phrases, certaines attitudes, qui donnent à la vraie figure de Joseph Darnand sa simplicité mais aussi sa grandeur.
Lorsque j’acceptai de prendre sa défense, sans hésiter, il paraît, m’a-t-on dit à l’époque, que j’avais quelque mérite Je n’en ai pas eu conscience. Si j’avais eu quelque doute, le seul contact que j’eus avec son juge d’instruction, chez qui j’allais solliciter un permis de communiquer, aurait dissipé, s’il y avait lieu, de vains scrupules. À peine étais-je entré dans le cabinet du juge, que ce dernier poussa un véritable cri de satisfaction. « Enfin, Me Colin, cet homme sera défendu. Il le mérite, croyez-moi ». Ce magistrat avait abordé Darnand dans un état d’esprit qu’on peut imaginer à l’époque. À mesure qu’il avait parlé avec lui, scruté sa vie, les intentions et les actes de l’homme qu’il avait devant lui, il avait compris qu’il n’avait affaire ni à une brute sanguinaire, ni à un aventurier, ni à un pauvre d’esprit, mais au héros que l’atroce conjoncture dans laquelle s’était trouvé notre malheureux pays, avait conduit là où le juge comme moi le trouvions.
Lorsque j’allai voir Darnand nous nous comprimes. Nous avions presque le même âge. Nous avions connu les mêmes guerres, les mêmes sentiments, je parle des plus honorables, qui avaient pu animer un Français patriote de cet âge. Avec chez lui, certes, un héroïsme qui m’aurait fait le suivre n’importe où dans n’importe quelle circonstance. Sur sa défense, nous fûmes d’accord. Il savait son sort et ne voulait sauver que son honneur. J’aurais pu croire, par une de ces sinistres ironies de la condition humaine, que ma tâche serait facile, tant il me semblait que l’homme que j’avais à défendre incarnait l’honneur militaire. Nous ne divergeâmes que sur un point. Darnand ne voulait pas que je mette en cause le Maréchal. En 1918, jeune adjudant de vingt ans, il avait reçu la Médaille Militaire de ses mains. Le grand Chef, illustre, avait suscité dans le cœur de ce tout jeune homme un culte qui ne s’effacerait jamais. Je dois avouer que sur ce seul point, en plaidant, j’enfreignis ma promesse, emporté par la rigueur logique de ma démonstration. Darnand, comme au combat, avait suivi son chef jusqu’au bout, sans se poser de questions, comme au combat on suit les chefs que l’on admire. Je savais ce qu’était ce sentiment, je comprenais Darnand dans sa loyauté, mais je pouvais, moi, reprocher au chef de l’avoir un jour, sans raison, désavoué.
« Voyez-vous, me disait Darnand, j’aurais été fait pour être moine-soldat ; une règle, une obéissance, des sacrifices, une acceptation sans crainte ni réserve. »
Il disait vrai. Tous les entretiens que nous avions ne venaient que me confirmer dans la limpidité de ce cœur simple. Qu’on m’entende bien, l’intelligence ne manquait pas à Darnand. Loin de là. Est-ce que les qualités de l’esprit obligent à ne croire à rien ou à ne considérer que soi-même ? Ils sont innombrables ceux qui démentent comme Darnand cette conviction basse et sommaire que l’intelligence est réservée aux lâches, aux cyniques, aux crapules et aux « malins ».
Je pourrais citer des phrases touchantes de Darnand à ce sujet si je n’avais comme lui-même la répugnance naturelle des gens sincères pour la grossière imagerie d’Épinal à quoi on ramène, pour la masse, les grands sentiments générateurs de sacrifices. Comme l’amour, certains « engagements » ont leurs pudeurs.
J’eus une surprise lorsque je pris contact avec l’Avocat général. Celui-ci, spontanément, se crut obligé de me dire qu’il avait étudié le dossier et que mon client « était un honnête homme ». Je le savais bien mais je sus gré à l’Avocat général de me le dire. Et je fus d’autant plus indigné lorsque, dans son réquisitoire, quelques phrases de lui qu’on lui avait probablement imposé de dire, démentirent sa conviction. Je l’ai relevé vigoureusement. Darnand devait le lui reprocher, comme on sait, à son heure dernière. Ce magistrat n’était pas un Mornet, j’eus l’impression qu’il en emporta des remords.
Lorsqu’approcha la date de l’audience, Darnand me confia la crainte qu’il éprouvait. Ce n’était pas celle de sa condamnation qu’il savait acquise avant jugement. Il était intimidé par l’appareil de la Justice devant lequel il voulait se présenter dans sa sincérité et sa dignité. Pour ma part, tout à la fois par ma déformation d’avocat et la connaissance que j’avais déjà de ces parodies de justice, j’avais plutôt du mépris pour ses juges. C’était l’accusé et non eux qui avait grande figure.
Cette impression de scandale du respect pour l’accusé et le dégoût pour les juges, combien l’ont ressentie et en quelles circonstances ! Il est dommage que les passions politiques et les « nécessités d’État » aient si souvent insulté et défiguré l’image naïve de la justice que nous portons dans notre cœur.
Les craintes de Darnand furent dissipées. Il répondit avec dignité et pertinence. Personne ne l’interrompit. À vrai dire tout fut vite expédié. Ce ne fut qu’à 16 h 30 que la Haute Cour commença à siéger. L’interrogatoire, le témoignage du R.-P. Bruckberger et les plaidoiries ne durèrent que quatre heures. Le délibéré fut d’une remarquable brièveté, mais l’arrêt fut plus long à lire que la soi-disant élaboration de son texte…
Darnand était soulagé et heureux. Il avait fait bonne figure, il acceptait sa mort. Il est facile pour les autres de se résigner à l’inéluctable, mais je pense que, même pour un homme de la trempe de Joseph Darnand, il faut un exceptionnel courage pour accepter une telle mise à mort.
Ces huit derniers jours qui séparèrent l’arrêt de l’exécution, j’allai le voir quotidiennement. Le Père Bruckberger a déjà raconté ce qu’avaient été ces entretiens. Il en partagea la plupart. Il y avait une singulière grandeur dans le dialogue entre le soldat et le moine qui avait été membre de son corps franc. Lorsque j’étais seul avec Darnand, il me confia certaines pensées que j’ai, par la suite, confiées à ses amis, comme il me l’avait demandé. Je n’ai jamais entendu de lui que des paroles de patriotisme, de droiture et de bon sens.
Une angoisse cependant l’étreignait. Le sort de ceux qui l’avaient suivi. Déjà, lorsque nous attendions l’arrêt, il m’avait dit : « Comment pourrais-je échapper à la mort, alors que tant de ceux qui m’ont suivi ont péri ? » Lorsque le Père Bruckberger lui apporta l’assurance que son exécution sauverait les jeunes miliciens (on sait ce qu’il en a été1), le soulagement de Darnand fut immense.
Je ne veux pas ici revenir sur ce que furent les dernières heures de Joseph Darnand. Je ne veux ici qu’insister sur son caractère et ce que fut son engagement. Un soldat ai-je dit. Il était normal qu’il fut intrépide devant la mort qu’il avait tant de fois bravée. Mais je dois rappeler ici la véritable oraison funèbre qui résume ce qu’il fut.
La salve venait de retentir et, dans un flot de sang Darnand s’effondrait. À peine le coup de grâce venait de lui être donné, on se précipitait sur son cadavre pour le jeter dans la boîte de sapin qui devait lui servir de cercueil. J’entendis derrière moi un sanglot. C’était le Père Bruckberger qui l’ensevelissait et s’écriait : « S’il y avait eu dix mille hommes comme lui, jamais les Allemands ne nous auraient vaincus. » C’était la vérité. Elle choqua un colonel imbécile qui se trouvait là et à qui je répondis grossièrement. La vérité était là, éclatante.
Il avait manqué des héros à la France, elle ne s’est pas rachetée avec des juges et des bourreaux.
__________________























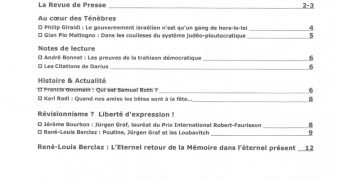


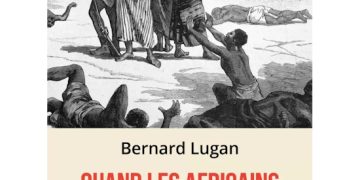


 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV







Je souhaiterais mettre ici mon discours rendant hommage à Joseph Darnand le 12.10.13 : http://youtu.be/02t6Nw_LFlw
Avec aussi le lien du texte : http://textup.fr/72607lZ