Vingt ans au crépuscule
Ramper, se lever, observer, courir, se jeter à couvert, contrôler, puis ramper encore.
Les mois d’entraînement intensif qu’avait subi Jean depuis son engagement avaient imprimé à son corps une mécanique telle que son esprit n’avait plus à s’en soucier.
Couché dans la poussière derrière des gravats de la taille d’un autobus, il prit le temps de souffler.
Cela faisait maintenant une semaine qu’il était parvenu à entrer dans Berlin avec ses camarades, et les combats incessants avaient été d’une férocité incroyable.
Il ramassa de la terre qu’il émietta dans sa main. Cette terre qui n’était pas la sienne, et pourtant qu’il était venu défendre avec une ferveur qu’il n’aurait pu imaginer quelques années auparavant.
Jean contemplait cette terre noire et songea au pays. Il revoyait son sud, ses roches sèches et ses plateaux arides. Et la mer. Bleu et infinie. Si belle que les montagnes étaient venues s’y jeter.
Tout cela lui semblait loin, si loin. Et pourtant il n’était parti qu’au plus depuis sept mois.
Mais durant cette période, ce qu’il avait traversé l’avait transformé. Après les trois mois de formation, au bout desquels il eut le privilège d’arborer les deux runes argentées à son col, il partit immédiatement vers la Poméranie.
Il y connut l’enfer gelé et la mort, puis la retraite. Ce fut pour ne plus fuir qu’il se porta volontaire pour entrer dans Berlin et défendre la ville coûte que coûte.
Depuis trois jours, ils se battaient seuls. Les derniers scandinaves qui les accompagnaient avaient disparu hier et les renforts allemands étaient bloqués en dehors de la ville. Ils étaient seuls. Seuls contre l’innombrable.
Le Chef avait sollicité Jean hier pour qu’il parte en reconnaissance tenter de trouver d’autres soldats et leur indiquer que les Français se repliaient sur la place centrale pour tenir l’entrée du bunker, désormais vide de vie et de lumière.
Une journée durant, il avait erré, ne croisant que des coups de feu russes. Dans l’après-midi, il était tout de même tombé sur les derniers survivants des Espagnols de la division Bleue.
Sacrés personnages que ceux-là aussi. Refusant également la retraite lorsque Franco rappela sa division en 1943, après Stalingrad, nombreux s’engagèrent dans la SS pour ne pas retourner au pays.
Ils choisirent le chemin de l’honneur, et s’y taillèrent une large voie. Les Russes les craignaient par-dessus tout avec leurs imposants coutelas qui pendaient à leurs ceinturons, et qu’ils n’hésitaient pas à brandir dans de violents corps-à-corps.
Les rouges, avec cette superstition accrochée à eux et que les soviétiques n’avaient malgré tout jamais réussi à arracher, les prenaient pour des démons, venus de l’enfer pour les chercher. Et ces braves espagnols se démenaient plutôt bien pour ne pas faire mentir ces croyances.
Leur chef, après l’avoir salué chaleureusement et lui avoir offert son propre quignon rassis et son ersatz de café tiède, car la camaraderie était totale entre volontaires européens, lui fit comprendre dans un français approximatif qu’ils avaient trop de blessés pour pouvoir bouger, et qu’ils avaient quelque compte à régler avec les Russes d’en face. Ils resteraient donc ici, à mourir dans leur nouvel Alcazar.
Tandis qu’il s’éloignait de leur camp, comprenant qu’il ne trouverait personne d’autres portant un uniforme allemand dans la ville, il songea à la destinée de ces volontaires.
Quels incroyables parcours ils avaient connus, tous. Quelles que fussent leurs motivations initiales, ils se retrouvaient à défendre le centre vital d’une terre qui leur était étrangère, dans une guerre perdue d’avance. Fallait-il qu’ils soient fous, ou totalement convaincus de leur bon droit.
Ils restaient debout, en dignes héritiers des légionnaires romains ou des chevaliers de Charlemagne, forgeant l’Europe par l’épée et la sagesse, par le feu et la lumière.
Combien de morts, combien de martyrs et de héros disparus. La fureur de leurs ennemis s’était déchaînée sur leurs terres. Ils préféraient raser jusqu’au sol tout germe de ce nouvel espoir, et pour cela procédaient à une destruction systématique des corps et des esprits.
Quel sort sera réservé aux survivants qui auront le malheur de vieillir dans ce nouveau monde que préparaient les libérateurs sanguinaires de l’Europe ?
Jean vérifia le chargeur de son arme. Il ne préférait pas le savoir. Jusqu’à son dernier souffle, il avait prêté serment de se battre pour ne pas avoir à connaître ce sort.
Aujourd’hui, l’heure était au respect de cette parole donnée.
Continuant ses reptations et ses brèves courses, il réussit à éviter des patrouilles russes. La nuit allait bientôt tomber, et les violences sur les civils allaient à nouveau reprendre. Les hordes ivres de Staline n’avaient pas pour mission uniquement de prendre la ville. Leurs supérieurs leur avaient laissé carte blanche pour leurs nuits, et ils pouvaient laisser libre cours à leurs fureurs sanguinaires sur les femmes et les enfants n’ayant pas eu la chance de quitter la capitale. Les cris qui déchiraient toutes ces nuits obscures, Jean ne pouvait les oublier.
Il distingua au loin, entre les ruines, des mouvements de troupes et de blindés. La zone devenait extrêmement périlleuse et s’y promener de jour allait bientôt être suicidaire.
Il avisa rapidement une bouche de métro permettant un accès au sous-sol.
Si ses estimations s’avéraient exactes, il devrait pouvoir rejoindre sa brigade par ce chemin.
Il rampa jusqu’à l’entrée. L’obscurité était rassurante, cela indiquait qu’aucun ne s’y cachait.
Une forte odeur d’humidité en remontait. Depuis que les soviétiques avaient détruit les systèmes de tuyauterie du métro, le fleuve avait inondé les sous-sols, noyant la grande majorité des civils qui s’y étaient réfugiés pour échapper à leurs exactions.
Il s’enfonça dans les ténèbres, se dirigeant péniblement grâce à sa lampe tempête. Il se sentait extrêmement vulnérable avec son fusil d’assaut en bandoulière, ne pouvant que braquer son luger vers le tunnel obscur.
Soudain, il sentit le contact glacé de l’eau stagnante, l’informant brutalement qu’il arrivait au niveau de la station d’arrêt. Jean priait silencieusement pour ne pas tomber sur une voie noyée ou sur une patrouille russe, même si ceux-ci semblaient détester se déplacer en sous-sol.
Continuant sa progression dans le long des rails, il aperçut des lumières au bout du tunnel, au niveau de la station suivante. Il éteint prestement sa lampe et rangea son pistolet. Il se plaqua au mur et épaula son fusil, commençant à avancer, toujours selon ces méthodes apprises à l’entraînement et tellement répétées qu’elles en devenaient machinales.
Il distinguait de voix parlant allemand, mais cela ne le rassurait pas. Il savait que l’avancée des Russes avait réveillé les anciennes cellules communistes en sommeil et que des partisans commençaient à se répandre dans les rues, tirant traîtreusement dans le dos des soldats, et principalement des SS.
Lorsqu’il arriva près de la sortie du tunnel, il distingua un attroupement de femmes, d’enfants et de vieillards qui avaient établi un véritable campement dans la station de métro.
Les réfugiés sous-terrain, ceux qui avaient perdu leur toit sous les bombardements ou qui se cachaient des bombes et des Russes. Pour combien de temps encore ?
Jean sortit de l’ombre, conservant toujours son arme épaulée, en criant son matricule et sa division. Le silence tomba soudainement, le campement se figea, comme si le temps était suspendu. Puis un homme d’une cinquantaine d’années s’approcha. Il portait une chemise brune dont l’usure laissait deviner l’appartenance du porteur aux premières brigades de la SA.
Cet homme avait dû certainement fréquenter le Führer il y avait vingt ans de cela.
Sur son épaule pendait un fusil hors d’âge. Jean savait fort bien quelle était la fonction de cet homme, il ne la lui enviait pas.
Il était là pour faire la chasse aux partisans et aux traîtres qui gangrénaient la ville. Tâche indispensable, pensait Jean, mais pour rien au monde il n’aurait pris sa place. Lui se battait contre un ennemi en uniforme bien déterminé, tandis que l’autre devait traquer l’ennemi intérieur, les gens de son propre peuple.
Il pensa aux miliciens et leur uniforme bleu si décrié. Pourtant, il savait parfaitement que dans une telle guerre, il était nécessaire de posséder des soldats capables d’arrêter l’envahisseur, mais aussi des hommes prêts à couper court à tout défaitisme ou tout vent de traîtrise au sein de la patrie.
Jean le salua et l’autre lui rendit respectueusement son salut, lui tendant une tasse remplie d’une boisson indéterminée, mais chaude que Jean accepta volontiers.
Derrière ce pauvre berger, son troupeau de femmes et d’enfants misérables reprit leurs activités.
Debout dans les ténèbres, une femme d’une quarantaine d’années appelait son fils qui semblait avoir disparu dans les couloirs sombres.
« Personne ne va l’aider à chercher son enfant ? » demanda Jean, au quatrième appel désespéré de la mère.
« Malheureusement, son fils est mort sous les bombes. Depuis, elle a quelque peu perdu la raison. Elle pense le voir dans l’obscurité. Elle va bientôt se calmer. Nous préférons la laisser dans son rêve. Pour ce qui nous reste à vivre… » répondit le vieil homme, les yeux troublés.
La femme se calma subitement et appela doucement son enfant. Elle ouvrit grand ses bras et enlaça le vide. Puis, chuchotant aux ténèbres, elle s’éloigna, semblant s’appuyer sur son fils disparu.
Jean sentit sa gorge se nouer et ses yeux s’emplir de larmes. Il ne pouvait plus rester ici, se mit à suffoquer.
Il demanda rapidement son chemin au vieux gardien, qui lui indiqua les bonnes coursives à suivre, et Jean partit précipitamment.
L’image de cette femme cherchant son enfant mort le hantait. Il ne parvenait plus à respirer. Il avait besoin de se battre, de sentir l’odeur de la poudre et du feu. Il avait besoin d’air et d’espace.
Jean émergea enfin du métro et il lui sembla reprendre vie en respirant à nouveau l’air libre.
Autour de lui, à nouveau, un horizon de destruction. Partout des cadavres russes parsemaient les rues, entourant les épaves fumantes de chars éventrés.
Embusqué au milieu carrefour, impraticable désormais, tellement les ruines avaient enseveli les routes, se tenait un canon de 88mm.
Les Russes avaient dû tenter une percée par ici qui avait été stoppée net. Ils reviendraient sous peu, pensa Jean, connaissant maintenant trop bien l’inhumaine insistance des généraux russes, prêts à sacrifier une division entière pour prendre une cabane.
« C’est la guerre » comme répétaient souvent les prisonniers russes avec leur irrémédiable fatalisme slave.
Un jeune garçon, qui ne devait pas avoir plus de 14 ans sorti sa tête des sacs de sable entourant la redoutable pièce d’artillerie. Ses cheveux blonds semblaient briller même dans la nuit.
Il surveilla son approche, les mains serrées sur son fusil, puis sembla se détendre en voyant les runes ornant son col.
Il salua le Français de la façon la plus réglementaire qui soit, tandis que Jean sautait à l’abri derrière les sacs.
Le jeune garçon sembla surpris par le drapeau tricolore ornant la manche du soldat.
« – Salut garçon » trouva seulement à dire Jean, tandis qu’il s’asseyait sur une caisse de munitions.
Le garçon hocha la tête, visiblement intimidé.
« – Vous êtes français, vous êtes encore ici ? Il y a encore des soldats ? »
« – Il ne reste plus grand monde pour être honnête. Nous sommes une trentaine en position devant le bunker. Il reste quelques Espagnols et peut-être encore des Norvégiens qui vont essayer de nous rejoindre. Et puis, toi. Je désespérais de trouver encore quelques Allemands dans les rues de Berlin. » Jean sourit largement et offrit une cigarette à son jeune camarade qui refusa poliment.
« Dieu nous a donc abandonnés » murmura l’enfant.
Jean sursauta à ces mots. Être témoin d’un tel effondrement, de l’annihilation totale de tout ce qui pouvait représenter la civilisation, pouvait aisément inciter ces ultimes guerriers à se croire abandonnés des Dieux.

Il se ressaisit immédiatement. Les deux runes argentées qui brillaient à son col lui interdisaient le défaitisme et l’avachissement.
« Non. Les Dieux ne nous ont pas abandonnés. Au contraire. Aujourd’hui nous combattons le mal véritable et sommes le dernier rempart contre ces ténèbres galopantes. Tout ce qui accourt des quatre coins du monde et nous assaille de l’ouest jusqu’à l’est, représente ce qu’il y a de plus mauvais et maléfique sur cette terre. Et Dieu guide notre bras dans cette guerre sainte.
J’ignore si Saint Pierre viendra m’accueillir, ou si des Valkyries cueilleront mon esprit à mon dernier soupir, mais je me sais combattre pour le bien.
Malheureusement, la Lumière ne triomphe pas toujours des ténèbres. Parfois, il arrive qu’elles étouffent l’horizon, mais jamais elles ne peuvent l’anéantir complètement.
La Lumière persiste. Infime, si fragile, et pourtant présente, cachée au fond du cœur des hommes purs. Cette flammèche, les Dieux nous donnent la force de la préserver. Cette étincelle blanche, par tous ces combats menés, nous la transmettons à ceux qui nous succéderont.
Le monde nous haïra après ce conflit. On salira notre nom et notre idéal, car les ténèbres ne savent que souiller ce qu’elles ne peuvent pas détruire. Néanmoins, elles n’atteindront jamais cette flamme, que nous avons généreusement nourrie de notre sang.
Lorsque l’Ordre reviendra sur l’Europe, comme l’Aube revient toujours, même après la plus noire des nuits, alors nos enfants se tourneront vers nos ombres, leur visage baigné par un Soleil régénéré, et célébreront la valeur de notre combat.
Aujourd’hui, tu gagnes l’éternité par ta foi et ton courage. Aujourd’hui, tu es investi par les Dieux pour marquer l’histoire des hommes. Notre triomphe, c’est notre sacrifice. »
L’enfant hocha doucement sa tête ceinte de cheveux d’or et sourit.
« Si les rouges ne m’attrapent pas, je descendrai vers le sud. J’ai entendu dire que d’autres Jeunesses ont formé un groupe de résistance dans les forêts, conformément aux ordres. J’essaierai de ramener des armes avec moi.
Tu ne veux pas m’accompagner ? Nous aurons besoin de soldats comme toi pour nous guider. »
Jean jeta son mégot et se leva. Il avait achevé sa mission et devait rejoindre maintenant ses camarades.
Il prit alors l’enfant dans ses bras, comme un père aurait embrassé son fils. Le petit homme retrouva un peu de son enfance perdue par ce geste. Ses yeux bleus se troublèrent un instant.
« Adieu petit. Je suis désolé, ma place est ici. Avec les camarades, nous avons décidé de rester pour empêcher les Russes de prendre la ville au 1er mai. Désormais, chaque jour tenu de plus est une victoire.
Tu imagines, peut-être que des Français seront les derniers à défendre Berlin. Un comble ! »
Ils rirent tous deux de bon cœur et se quittèrent, ne devant plus se revoir.
L’enfant n’atteindrait jamais le sud et ses forêts emplies de loups-garous. Il ne verrait pas non plus la fin de cette journée si sombre, dont la seule éclaircie fut cette rencontre fortuite.
Quelques heures plus tard, les chars russes s’engageaient dans la rue. Il périt derrière sa pièce d’artillerie, après avoir tiré ses derniers projectiles, détruisant plusieurs des monstres soviétiques.
Le sourire aux lèvres, il rendit son âme à Dieu, une âme pure et belle, telle qu’elle lui avait été offerte à sa naissance.
Alors que les tirs d’artillerie continuaient sans fin et que l’espace ne semblait plus rempli que de feu et d’épaisses fumées, Jean parvint enfin à rejoindre les derniers survivants de son bataillon, tous fidèlement fortifié autour du bunker central de la capitale.
Le jour allait bientôt se lever, mais le ciel était resté rougeoyant toute la nuit, éclairé par un terrible brasier de fin des temps.
Il fit son rapport à son supérieur. Le chef hocha la tête. Il était désormais clair qu’ils étaient seuls, et se tenaient aujourd’hui en ultime défenseur de la forteresse Europe, tragiquement réduite à une place dans le centre-ville de Berlin.
Une simple poignée de soldats avaient réussi à tenir tête à la plus formidable vague humaine que l’histoire ait certainement connue.
Le chef réunit sa vingtaine de survivants auprès du feu de camp.
« Camarades, nous avons respecté notre serment, fidèlement et jusqu’aux portes de la mort. Vu les munitions qu’il nous reste et la réorganisation des troupes russes, la prochaine attaque sera la dernière. À cette heure, nous sommes les deniers défenseurs de la ville et nous sommes parvenus à empêcher les Russes de prendre cette place emblématique pour le 1er mai.
Nous avons rempli notre devoir au-delà de ce que l’on pouvait exiger de nous.
Notre position est désormais intenable et la retraite inévitable. Il nous faut gagner les sous-sols de la ville afin de tenter de nous sortir de cette nasse afin de rejoindre les postes de résistance qui se sont formés dans les campagnes alentour. »
Chacun se regarda silencieux. Durant ces derniers jours, ils avaient réalisé l’impossible à chaque geste, mais maintenant, la bataille était finie, et une nouvelle guerre allait commencer pour eux, celle de la survie.
Les sinistres bruits de moteurs et de chenilles, écrasant tout sur leur passage, commençaient à se faire entendre. Les cris avinés des hordes soviétiques envahissaient l’espace. Les Russes arrivaient, bien décidés à prendre ce dernier bastion et massacrer ses ultimes défenseurs.
Pour cela, ils devraient emprunter la seule route encore praticable donnant accès à la place. Et cela, Jean le savait parfaitement. Il s’avança.
« Chef, avec votre permission, je reste. Laissez-moi des chargeurs et quelques panzerfausts, je me fais fort de retenir ces salauds-là suffisamment longtemps pour vous permettre d’évacuer la zone.
Vous n’avez pas le droit de mourir aujourd’hui, Chef. Ni vous ni tous les autres. Demain cette guerre sera finie, et le monde retournera à ses occupations. Si aucun de nous n’est encore vivant pour transmettre le souvenir de notre combat, celui-ci disparaîtra, soit dans l’oubli, soit dans l’opprobre. Notre serment nous interdit de voir notre mémoire salie et anéantie.
Demain, il vous faudra subir la haine et l’injustice de la foule déchaînée contre ce qu’elle ne peut pas comprendre, mais pourtant, vous devrez rester droit et inflexible, fidèle à notre parole et à notre souvenir.
À chacun, vous devrez enseigner notre mémoire et notre lutte.
Votre devoir est de survivre, le mien est de vous le permettre. »
Le Chef leva vers lui ses yeux francs, cerclés de ses lunettes rondes. Toujours gravement blessé depuis les premiers engagements, il claudiqua jusqu’à lui.
Il lui serra la main et le salua silencieusement. Il était de ces instants où les regards suffisaient.
Les derniers survivants lui offrirent un dernier salut et restèrent droit et silencieux en le contemplant s’avancer vers les flammes et la rue sur laquelle les Russes allaient s’engager dans les prochaines minutes.
Jean repéra immédiatement des caches idéales pour prendre de flanc les chars et semer la zizanie chez les Russes. Il fallait qu’il ajuste le blindé de premier rang puis celui fermant la marche afin de bloquer l’avancée et permettre l’évacuation des copains.
Il s’embusqua derrière un mur éventré et attendit, guettant fiévreusement le coin de rue d’où le vacarme russe se faisait de plus en plus proche.
Semblant sortir droit des flammes de l’enfer, un char monstrueux émergea des ruines pour s’engager dans la rue, suivi pas une quarantaine de fantassins. Un autre tank fermait la marche.
Jean se recroquevilla derrière les gravats, observant entre les interstices l’avancée. Les Russes ne prenaient aucune précaution, saouls et déjà victorieux, ayant passé la nuit à chasser les civils pour leur faire subir les plus infâmes violences.
Le char passa lentement devant lui. Une petite centaine de mètres à peine les séparait.
Jean ajusta son arme antichar comme à l’exercice. Il connaissait tous les points faibles des blindés russes, et savait pertinemment que les dérisoires grilles soudées à la hâte sur les flancs n’empêcheraient en aucun cas la percée du projectile.
Le char passait devant lui, les Russes ne prêtaient même pas attention aux alentours. Dans sa mire, l’arrière du char commençait à s’offrir, vulnérable.
La charge creuse sembla s’envoler lentement, décrivant laissant une traînée blanche derrière elle, tandis qu’autour du soldat s’enroulait une bienveillante langue de feu.
Sans attendre le résultat de son tir, qu’il savait déjà parfait, Jean sauta vers le second abri qu’il s’était aménagé une dizaine de mètres plus loin, et, tandis que le char de tête était littéralement décapité par l’explosion déclenchée entre la tourelle et le corps d’acier, répandant la panique dans les rangs russes qui se mirent à tirer au jugé, il s’empara du deuxième panzerfaut dont il fit feu sans prendre la peine de viser, sur le second char.
L’obus s’écrasa sur le bas du caisson avant du second blindé, éventrant le monstre qui sembla s’enflammer de l’intérieur. Jean avait épaulé son fusil et commençait à mitrailler les Russes en pleine réorganisation, faisant mouche à chaque coup tandis que les balles soviétiques s’écrasaient aléatoirement autour de lui.
Il sautait vers un autre couvert, quand une rafale le faucha. Le temps sembla s’arrêter. Une chaleur intense l’envahit soudainement et il se retrouva projeté au sol.
Jean tenta vainement de se relever, et se mit à ramper vers les ruines. Se hissant péniblement sur un tas de briques effondrées, il parvint à s’asseoir, adossé à un mur défoncé.
Lentement, il démonta la culasse de son fusil d’assaut. Il jeta au loin le percuteur parmi les gravats, neutralisant l’arme, conformément aux instructions apprises durant son entraînement.
Il arma son pistolet qu’il posa sur ses genoux tremblants, puis souffla.
Malgré ses intenses souffrances, il tira d’une poche son mouchoir brodé à ses initiales que lui avait offert sa mère à son départ, avec lequel il fit briller la croix de fer qui pendait sur sa poitrine, ainsi que la médaille de chasseur de chars témoignant de son rang. Il réajusta son uniforme, ferma ses boutons, puis regarda le ciel.
Une lumière intense l’inondait. Malgré les nuages épais et la fumée des incendies, le soleil était tout de même parvenu à percer et semblait même, lui d’habitude si distant, s’être approché afin de l’assister dans son agonie.
Dans un suprême effort de volonté, tandis que les Russes approchaient avec précaution, impressionnés par ce Saint Michel auréolé de gloire, il tendit son bras vers l’astre invaincu, dans un ultime salut, puis, la vie s’échappant de ses blessures, il consentit à rendre son dernier soupir.


























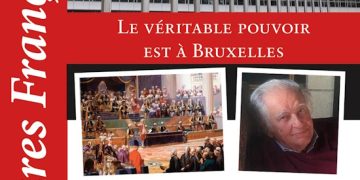






 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV







Merci Mr Leroy pour cet instant de poésie à la lecture de votre texte,qui est très émouvant.
Je veux rappeler que si Hitler a perdu la guerre,il a remporté une victoire qui n’a jamais été acquise au cours de l’histoire,car la victoire n’a été toujours qu’entendue matériellement ou territorialement.
Je veux dire qu’il a remporté incontestablement la plus belle et la plus incommensurable victoire de l’Histoire,la victoire des Ames.
A moins que la victoire de la démocrâssie et du communisme,dont le symbole à notre époque est Conchita Wurtz,ou « Plus belle la vie »,soit une avancée pour l’humanité.
J’ai peut-être pas l’esprit assez ouvert,ou « open » comme ils disent,je suis rétrograde et ne vois qu’ un moyen pour nous régénérer,dans l’ordre et la discipline,acceptée librement et dans la joie,promesse des joies futures!
Un seul mot pour décrire ce texte : magnifique.
Et merci pour l’auteur !