Comment des décennies de folie ont conduit à la guerre en Ukraine
En février 2016, lors d’une réunion publique organisée par CNN à Columbus, dans l’Ohio, Donald Trump a provoqué un véritable scandale parmi les élites du Parti républicain en qualifiant l’invasion de l’Irak par George W. Bush de « grosse erreur » et de « pire décision jamais prise par un président dans l’histoire de ce pays ». Cette affirmation a indigné les membres influents du Parti républicain, non pas parce qu’elle était manifestement erronée ou même facilement réfutable, mais parce qu’elle était malheureusement trop vraie. Un simple coup d’œil aux titres des principaux ouvrages consacrés à l’action américaine au Moyen-Orient, écrits par des auteurs de tous bords politiques – Fiasco , Grande Illusion , Perdre la partie à long terme , L’Âge des illusions – révèle que nombre d’experts étaient parvenus, ou parviendraient, à la même conclusion négative que Trump.
La capacité de Trump à mobiliser les électeurs et à s’assurer leur loyauté faisait qu’il était, contrairement aux experts, incontournable. Ces mêmes républicains, furieux, se consolèrent d’abord en prédisant que, puisque Trump avait dénoncé l’invasion de l’Irak en Caroline du Sud – bastion de la fierté patriotique envers l’armée américaine –, sa campagne contestataire s’effondrerait sous le poids d’une telle hérésie. Mais c’est l’inverse qui se produisit. Les électeurs républicains, et les anciens combattants en particulier, exaspérés par le refus de l’establishment de faire face à une vérité évidente, se rallièrent à lui.
La propension de Trump à dire des vérités dérangeantes a été essentielle à sa capacité à enflammer les passions de ses partisans comme de ses adversaires. Sa volonté de rompre avec la politique antérieure envers l’Ukraine et d’organiser un sommet avec le président russe Vladimir Poutine a de nouveau provoqué la colère des instances dirigeantes de la politique étrangère américaine.
Les enjeux de la politique américaine en Eurasie sont aujourd’hui plus importants qu’il y a vingt-cinq ans au Moyen-Orient. Washington est profondément engagé dans le conflit le plus vaste et le plus intense que le supercontinent ait connu depuis la guerre de Corée. De fait, compte tenu du rôle essentiel que joue Washington dans le financement, l’armement, la formation et l’assistance directe aux forces de combat ukrainiennes en matière de ciblage et de renseignement, les États-Unis sont quasiment un belligérant. Bien que la Fédération de Russie soit nettement moins redoutable que l’Union soviétique par sa taille et sa puissance, elle est incomparablement plus puissante et dangereuse que l’Irak de Saddam Hussein, les talibans en Afghanistan ou les coalitions djihadistes comme Daech et Al-Qaïda réunies.
« Washington a lancé un défi à Moscou. »
En courtisant agressivement l’Ukraine comme alliée et en en faisant un partenaire militaire contre la Russie, Washington a lancé un défi à Moscou. Ce fut l’aboutissement d’un long processus de confrontation inconsidérée. Le même consensus bipartisan post-Guerre froide, celui d’internationalistes libéraux imprudents et de partisans d’une primauté mondiale quasi-utopique qui a gaspillé des vies et des ressources américaines au Moyen-Orient, a maintenant conduit le pays dans une impasse stratégique sur la Grande Steppe eurasienne, engloutissant des fonds, des ressources et des armements précieux nécessaires ailleurs. Plus de trois ans après le début du conflit, rien ne permet de croire que la Russie sera vaincue. Son économie a démontré sa résilience face aux sanctions, et elle dispose d’une armée plus nombreuse et mieux équipée que l’Ukraine.
Pourtant, confirmant l’intuition de Thucydide selon laquelle les hommes agissent par espoir lorsque la raison les abandonne, les élites américaines, toutes tendances politiques confondues, s’accrochent, par indignation et fierté blessée, à la conviction que la Russie sera vaincue d’une manière ou d’une autre – prolongeant ainsi une guerre qu’elles ne peuvent gagner. Les partisans de la poursuite du conflit affirment qu’il a affaibli la Russie. C’est discutable. Ce qui est incontestable, c’est que la guerre a ravagé l’Ukraine, paralysé l’économie européenne et épuisé les ressources américaines. Elle a également poussé la Russie dans les bras de la Chine, offrant ainsi au seul rival de taille des États-Unis une longue frontière tranquille et un accès sûr à de précieuses ressources naturelles.
Pour étouffer toute dissidence concernant la guerre et ses origines, ses défenseurs, issus des deux partis, déplorent l’ignorance, la naïveté ou l’infâme influence secrète de Vladimir Poutine envers Trump et les autres sceptiques. En réalité, ce scepticisme pragmatique à l’égard de la guerre et de la politique qui l’a engendrée s’inscrit dans la tradition de certains des diplomates, agents de renseignement et responsables de la sécurité nationale les plus brillants d’Amérique, qui ont mené – et remporté – la Guerre froide. Cette génération d’anciens combattants de la Guerre froide s’est élevée avec véhémence contre l’élargissement de l’OTAN. Parmi leurs successeurs, certains ont également remis en question la pertinence de la stratégie de Washington, mais, sous l’influence de dirigeants moins clairvoyants, ils ont mené à bien cet élargissement, n’exprimant leurs réserves et objections qu’en privé ou dans leurs mémoires. Le fiasco ukrainien des États-Unis est donc le fruit d’une coalition bipartite où les plus égarés étaient animés d’une ferveur passionnée, tandis que les plus avisés manquaient de toute conviction.
La volonté d’étendre l’Alliance du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) à l’Europe de l’Est et à l’Eurasie durant le second mandat de Bill Clinton a suscité de vifs débats parmi les experts en politique étrangère. Le critique le plus notable et le plus clairvoyant fut George Kennan, qui avertissait dans un article du New York Times de 1997 que « l’élargissement de l’OTAN serait l’erreur la plus fatale de la politique américaine depuis la fin de la Guerre froide ». Il prédisait également que cet élargissement provoquerait une réaction de Moscou et que, le cas échéant, ses partisans la minimiseraient en disant : « C’est ainsi que sont les Russes. » Kennan, ancien ambassadeur en Union soviétique sous Staline et architecte de la politique d’endiguement qui a permis de remporter la Guerre froide, était largement considéré comme l’un des plus grands diplomates américains et un expert reconnu de la Russie. Même les partisans de l’élargissement le reconnaissent à contrecœur : la condamnation sans équivoque de l’élargissement de l’OTAN par Kennan mérite d’être prise en compte.
Kennan n’était pas une voix isolée. Au contraire, il exprimait le consensus des experts. Strobe Talbott, principal conseiller de Bill Clinton pour l’élargissement de l’OTAN, déplorait que la quasi-totalité de ses connaissances en matière de Russie et d’Europe de l’Est s’y opposent. Aux côtés de Kennan contre l’élargissement de l’OTAN se trouvait une coalition des plus brillants et des plus expérimentés spécialistes américains de la politique étrangère. Parmi eux figuraient des républicains réputés pour leur fermeté anti-soviétique, tels que Fred Ikle et Paul Nitze, ainsi que des figures emblématiques de la politique étrangère démocrate, comme les sénateurs Sam Nunn et Bill Bradley. Richard Pipes, historien à Harvard et conseiller de Reagan pour les affaires d’Europe de l’Est et l’Union soviétique – connu pour son profond pessimisme quant à la culture politique russe – non seulement s’insurgeait contre l’élargissement de l’OTAN, le jugeant inutile et imprudent, mais considérait même l’alliance comme un anachronisme qu’il convenait de dissoudre. De plus, en 1997, le débat sur l’élargissement de l’OTAN concernait la Pologne, la Hongrie et la République tchèque, et peut-être la Roumanie et la Slovénie par la suite. L’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie n’était pas à l’ordre du jour. Néanmoins, même à cette époque, la majorité des experts considéraient l’expansion de l’OTAN comme une folie.
Zbigniew Brzezinski était sans doute le plus éminent opposant et partisan de l’élargissement. Politologue et spécialiste de l’Union soviétique, il fut conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter et était connu pour son hostilité constante envers Moscou. Comme il l’expliquait dans son ouvrage de 1997, « Le Grand Échiquier » , qui exposait pourquoi et comment l’Amérique devait rechercher la primauté en Eurasie, Brzezinski considérait l’OTAN comme un instrument d’extension de la puissance américaine.
Bill Clinton s’est rangé du côté de Brzezinski pour passer outre l’avis des vétérans de la Guerre froide et plaider en faveur de l’élargissement de l’OTAN. Ce baby-boomer, ayant atteint l’âge adulte à une époque d’abondance américaine sans précédent et ayant échappé à la dure réalité de la puissance américaine en évitant de servir au Vietnam, s’intéressait principalement à l’armée américaine dans le but de l’utiliser à l’étranger pour détourner l’attention de ses scandales privés à répétition. Certains membres de son administration, cependant, étaient plus ambitieux. La secrétaire d’État Madeleine Albright, protégée de Brzezinski, était connue pour son attitude désinvolte vis-à-vis du recours à la force. Comme elle l’avait tristement déclaré au général Colin Powell, alors chef d’état-major des armées, lors d’un débat sur les bombardements de la Serbie au sujet du Kosovo en 1999 : « À quoi bon avoir cette armée formidable dont vous parlez sans cesse si nous ne pouvons pas l’utiliser ? »
L’administration Clinton a déployé cette force militaire de premier ordre sous l’égide de l’OTAN à deux reprises, menant des frappes aériennes et coordonnant des offensives terrestres en Bosnie-Herzégovine en 1994-1995 et au Kosovo et en Serbie en 1999. L’administration a présenté ces deux opérations comme humanitaires, bien qu’elles aient impliqué un partenariat entre les États-Unis ou l’OTAN et des entités que les agences de sécurité américaines et européennes considéraient auparavant comme terroristes et criminelles, telles que les djihadistes en Bosnie , l’Armée de libération du Kosovo (UCK) et des éléments de l’armée croate. Ces opérations ont marqué un tournant radical pour l’OTAN. Une alliance initialement fondée pour l’autodéfense menait désormais des interventions hors du territoire de ses membres, redessinant les frontières de l’Europe et participant même à la création d’un nouvel État (le Kosovo).
L’insistance de Washington à maintenir l’OTAN malgré la fin de la Guerre froide avait déconcerté certains Russes, mais sa transformation de cette alliance en un instrument d’intervention et sa volonté de l’élargir alarmèrent les Russes de tous bords politiques. Aleksandr Lebed, général russe dont les critiques de l’invasion de la Tchétchénie par Boris Eltsine avaient fait de lui l’une des figures les plus populaires de Russie dans les années 1990, prédit que l’élargissement de l’OTAN mènerait à une guerre mondiale . L’intervention de l’OTAN en Bosnie l’amena à comparer l’OTAN à « un gros voyou ivre dans une cour de récréation qui dit qu’il frappera qui bon lui semble ». Grigori Iavlinski, figure de proue du libéralisme russe de l’époque, déclara : « Si l’élargissement de l’OTAN visait l’adhésion définitive des États baltes et de l’Ukraine, sans la Russie, ce serait totalement inacceptable. »
Eltsine était un fervent partisan des États-Unis et entretenait d’excellentes relations avec Bill Clinton, au point que leur duo était surnommé le « spectacle Bill et Boris ». Le recours par Washington à l’OTAN pour bombarder la Serbie en 1999 mit un terme brutal à ce spectacle. Eltsine, brandissant la menace d’une guerre, alla même jusqu’à la provoquer en ordonnant à des parachutistes russes de s’emparer de l’aéroport de Pristina avant l’arrivée des troupes de l’OTAN. Avant la fin de cette année-là, la Russie avait un nouveau dirigeant : Vladimir Poutine. De toute évidence, l’opposition russe à l’OTAN était due non pas à sa politique intérieure, mais au comportement des États-Unis et de l’OTAN.
À Washington, rares étaient ceux qui s’en souciaient. Les responsables ont ignoré les protestations véhémentes des Russes contre les actions de l’OTAN. Lorsque le secrétaire à la Défense, William Perry, a mis en doute l’intention de Clinton d’intégrer la Pologne, la Hongrie, la Tchéquie et les pays baltes à l’OTAN, le vice-président Al Gore a jugé ses inquiétudes exagérées.
« Kennan ne criait pas dans le désert. »
À l’instar de son prédécesseur, George W. Bush était un baby-boomer dont le contact le plus marquant avec les affaires de sécurité internationale avant son entrée en fonction fut une tentative réussie d’échapper au service militaire au Vietnam grâce à un engagement comme pilote dans la Garde nationale aérienne du Texas. Bien que Bush ait vivement critiqué la politique étrangère de son prédécesseur démocrate, il maintint le cap sur l’élargissement de l’OTAN, même après avoir entraîné les États-Unis plus profondément au Moyen-Orient suite aux attentats du 11 septembre.
Le premier contact de Bush avec un dirigeant russe eut lieu lors d’un sommet en Slovénie en juin 2001. L’administration Bush privilégiait la coopération au conflit avec la Russie, mais uniquement selon les conditions de Washington. Comme l’exprimait Donald Rumsfeld dans un mémorandum , la Russie était confrontée à un choix binaire : soit elle « s’alliait avec Cuba, la Corée du Nord, l’Iran et l’Irak », se privant ainsi des investissements occidentaux et se condamnant à la faiblesse ; soit elle adoptait les normes démocratiques et économiques libérales, s’intégrait à l’ordre international libéral sous l’égide des États-Unis et prospérait. Rumsfeld exposa son point de vue avec objectivité lors d’une rencontre à Moscou avec son homologue russe en août 2001. Son raisonnement est difficilement contestable, mais le plus révélateur est que, dans son mémorandum, il citait l’Allemagne, le Japon et l’Italie de l’après-Seconde Guerre mondiale comme modèles à suivre pour la Russie. Aux yeux de Washington, les États-Unis avaient vaincu la Russie, et cette dernière devait se comporter en conséquence.
Les attentats du 11 septembre 2001 ont bouleversé la vision de l’administration Bush quant au rôle des États-Unis dans le monde. À l’époque, la Russie était aux prises avec une insurrection islamiste qui avait pris racine dans son Caucase du Nord lors de la première guerre de Tchétchénie (1994-1996). Pendant et après ce conflit, des djihadistes, dont Al-Qaïda, s’étaient efforcés de tirer profit de la défaite russe en Tchétchénie pour transformer le Caucase du Nord en un second Afghanistan, d’où ils pourraient exporter le djihad à travers le reste du Caucase et même le Tatarstan, au cœur de la Russie, sur les rives de la Volga. Ils ont mené une insurrection et une campagne de terreur déterminées, incluant des enlèvements de masse, des actes de torture et, finalement, une invasion du Daghestan et des attentats à la bombe contre des immeubles résidentiels dans cette région, puis contre Moscou, durant l’été 1999. C’est la menace djihadiste qui a catalysé l’ascension de Poutine, passé d’officier du renseignement à président de la Russie.
Les attentats du 11 septembre ont offert à Poutine ce qu’il considérait comme une opportunité d’établir une relation de coopération avec Washington. Clinton, contrairement aux médias occidentaux, avait soutenu Eltsine contre les rebelles tchétchènes au milieu des années 1990 ; Poutine avait donc des raisons de penser qu’après le 11 septembre, Bush pourrait le soutenir contre les djihadistes. Il s’est assuré d’être le premier dirigeant étranger à téléphoner à Bush après les attentats et lui a immédiatement proposé son aide. Lorsqu’il a reçu une délégation du Pentagone début novembre 2001, le sous-secrétaire à la Défense, Douglas Feith, l’a trouvé nerveux mais compétent, sincère et concret dans ses connaissances et ses propositions d’aide. Poutine a tenu ses promesses, facilitant l’établissement rapide de bases américaines dans les anciennes républiques soviétiques d’Ouzbékistan et du Kirghizistan et fournissant d’autres formes de soutien à la campagne militaire américaine en Afghanistan.
Un mois plus tard, Washington annonçait son retrait du Traité sur les missiles antibalistiques. Bush justifiait cette décision par la nécessité pour les États-Unis de développer des systèmes de défense antimissile face aux menaces limitées émanant d’acteurs « voyous » comme l’Iran et la Corée du Nord. Moscou, quant à elle, y voyait une tentative de déstabilisation visant à exploiter l’avance technologique américaine, à affaiblir ou neutraliser les forces nucléaires russes et à asseoir sa domination stratégique. En novembre 2002, Bush annonçait à Prague que l’OTAN accepterait sept nouveaux États d’Europe de l’Est comme membres, dont les trois anciens États baltes soviétiques frontaliers de la Russie.
La décision de Bush d’envahir l’Irak, malgré les objections de la France, de l’Allemagne et de la Russie, n’a guère rassuré Poutine quant à la prudence de Washington, d’autant plus que les services de renseignement russes savaient que les allégations de Bush concernant la possession d’armes de destruction massive par le régime de Saddam Hussein étaient infondées. Ces événements ont éclipsé la création, en mai 2002, d’un organe conjoint appelé Conseil OTAN-Russie, d’autant plus que ce conseil n’était qu’un organe consultatif.
En 2004, l’OTAN a accueilli la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, ainsi que les trois républiques baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie). L’administration Bush n’a vu aucune raison de freiner ce processus et a envisagé une nouvelle phase d’élargissement, prévoyant notamment l’extension des plans d’action pour l’adhésion à deux autres anciennes républiques soviétiques frontalières de la Russie : l’Ukraine et la Géorgie.
« L’hostilité de Cheney envers la Russie est bien antérieure à celle de Poutine. »
Poutine continua de coopérer avec l’OTAN, quoique à contrecœur, tout en reprenant les critiques de Eltsine à l’égard de l’élargissement de l’alliance. Mais plus Poutine s’y opposait, plus le vice-président Dick Cheney se montrait déterminé à poursuivre cet élargissement.
L’hostilité de Cheney envers la Russie était bien antérieure à Poutine. Alors que l’Union soviétique se dissolvait en 1990 – un processus si soudain et si fluide qu’il semblait presque miraculeux –, Cheney, alors secrétaire à la Défense, estimait que cela ne suffisait pas. Il chercha à accélérer son démantèlement en attisant la rivalité entre le Premier ministre soviétique Mikhaïl Gorbatchev et le président de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, Boris Eltsine, en invitant ce dernier à une importante réception au Pentagone. En réalité, Cheney était déjà convaincu que l’objectif devait être le démembrement de la Russie elle-même, afin qu’elle ne puisse plus jamais constituer une menace pour le monde. Cette vision d’un monde sans Russie, avec sa promesse utopique et séduisante de paix permanente en Eurasie, séduisit d’autres personnes à Washington.
La pensée de Cheney sur la Russie reflétait le même maximalisme que les controversées Orientations de planification de la défense, élaborées sous sa supervision en 1992. Ce document préconisait que les États-Unis agissent – unilatéralement et préventivement, si nécessaire – pour dissuader ou réprimer l’ascension de toute puissance susceptible de remettre en cause leur prééminence mondiale. La logique sous-jacente à cette vision d’une hégémonie infinie, maintenue par une vigilance constante, était irrémédiablement chimérique. Patrick Buchanan déplorait ces Orientations, les qualifiant de « formule pour une intervention sans fin » et de « chèque en blanc donné à tous les amis et alliés de l’Amérique, les autorisant à entrer en guerre pour défendre leurs intérêts ». William Pfaff, écrivant trois décennies avant que la guerre en Ukraine ne révèle l’effroyable incapacité de l’industrie de la défense américaine, notait avec une pointe de critique que ces Orientations « tentent de substituer la primauté militaire à la prééminence industrielle et économique dont les États-Unis ont joui entre 1945 et 1975, mais qu’ils ont désormais perdue ».
Les candidatures de la Géorgie et de l’Ukraine à l’OTAN différaient fondamentalement de celles des États baltes, pour des raisons culturelles, historiques et géostratégiques. Alors même que les administrateurs tsaristes reconnaissaient ouvertement le caractère atypique de leur domination sur la périphérie balte de l’empire, celle-ci affichant un niveau de développement supérieur à celui du centre impérial grâce à la longue tradition d’intégration des Baltes catholiques et luthériens à l’Europe, la Géorgie, terre orthodoxe du Caucase reculé, subissait les déprédations perses et les incessants raids des négriers musulmans venus de Crimée et du Caucase du Nord. La Russie, répondant aux appels à la protection de ses coreligionnaires orthodoxes, l’annexa en 1801. Ce sont les autorités tsaristes qui abolirent le servage en Géorgie, un peu plus tard toutefois que dans les territoires slaves de l’empire, par égard pour la noblesse géorgienne.
Que la Géorgie devienne elle aussi un avant-poste de l’Occident était insupportable. Mais plus alarmant encore était le fait qu’elle partage une frontière avec la Tchétchénie, où les forces fédérales russes et les Tchétchènes fidèles luttaient contre une insurrection djihadiste chronique, marquée par des attentats-suicides, des prises d’otages et des décapitations. Le territoire géorgien avait servi de voie de transit pour les combattants, les fonds et les armes destinés à ces djihadistes. Les précédents de Bosnie et du Kosovo, où Washington et l’OTAN avaient toléré, voire facilité, le flux d’armes vers les djihadistes et le Kuomintang avant d’intervenir et de modifier les frontières internationales, étaient une menace sérieuse.
Alors même que les Américains traquaient les djihadistes en Irak, en Afghanistan et dans le monde entier, en détenant certains à Guantánamo et en extradant d’autres vers des pays moins hospitaliers comme l’Albanie, l’Égypte, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la Syrie, les médias occidentaux critiquaient sans relâche la conduite de la guerre par la Russie en Tchétchénie. La présidence par Brzezinski du Comité américain pour la paix en Tchétchénie, basé à Washington, qu’il avait fondé en 1999 avec l’ancien secrétaire d’État, le général Alexandre Haig, et dont les membres comptaient de nombreux partisans d’une politique de défense américaine musclée, n’a guère contribué à apaiser les soupçons russes quant aux véritables intérêts des États-Unis dans le Caucase.
« L’expérience du communisme soviétique a inévitablement intensifié leurs sentiments anti-moscovites. »
L’Ukraine était un enjeu plus important que la Géorgie, car son territoire et sa population sont bien plus vastes et plus proches du centre de la Russie. Sa frontière avec la Russie s’étendait sur plus de 2 000 kilomètres, principalement à travers la steppe. Délimitée dans les années 1920 par les autorités soviétiques, initialement comme une frontière administrative interne, cette frontière n’a acquis une importance pratique qu’en 1991, avec l’effondrement de l’Union soviétique. La Crimée, autrefois lieu de villégiature estivale privilégié des tsars et des dirigeants soviétiques et base de la flotte russe de la mer Noire, est devenue un objet de conflit persistant.
La population ukrainienne partageait de nombreux points communs avec celle de la Fédération de Russie sur les plans linguistique, culturel et religieux. Près d’un citoyen ukrainien sur cinq se déclarait d’origine ethnique russe, et une proportion bien plus importante parlait russe et était affiliée au Patriarcat de Moscou de l’Église orthodoxe. Le surjik , mélange d’ukrainien et de russe, était parlé dans une grande partie de l’Ukraine. Les origines spirituelles et historiques des Russes et des Ukrainiens étaient profondément imbriquées. Pendant des siècles avant Poutine, les Russes considéraient Kiev comme le berceau de leur civilisation. Les deux nations commémorent la conversion au christianisme du prince Vladimir (ou Volodymyr) en 988 comme un moment fondateur de leur histoire. Ce n’est pas un hasard si les dirigeants des deux pays portent le même nom de prince. Contrairement à ce qu’affirme Poutine, ces faits ne signifient pas que les Russes et les Ukrainiens ne constituent pas des nations distinctes et séparées, mais ils révèlent que les conventions étatiques, certes nécessaires mais artificielles, telles que des frontières clairement définies et des identités indivisibles, sont en forte tension avec les réalités sociales en Ukraine et en Russie.
Dans les années 1990, journalistes et autres observateurs décrivaient couramment l’Ukraine indépendante comme un pays « déchiré » ou « clivé », les habitants de l’est étant généralement neutres ou favorables à la Russie, tandis que ceux de l’ouest lui étaient farouchement hostiles. Cette dynamique d’hostilité était antérieure à la période soviétique et découlait du statut de l’Ukraine comme zone frontalière entre Polonais catholiques et Russes orthodoxes. Staline l’a renforcée lorsqu’après la Seconde Guerre mondiale, il a annexé à l’Ukraine soviétique la Volhynie et la Galicie orientale, territoires dont les populations, majoritairement ukrainiennes, avaient connu la domination des Habsbourg et jamais celle des Tsaristes, encore moins celle des Soviétiques. L’expérience du communisme soviétique a inévitablement exacerbé leurs sentiments anti-Moscovites.
Compte tenu de la polarisation de la population ukrainienne et de la faiblesse de sa tradition étatique, son orientation politique était incertaine et son nationalisme en construction. L’opposition à la Russie constituant la raison d’être de l’OTAN, l’adhésion à l’alliance modifierait inévitablement l’attitude des Ukrainiens envers la Russie, la rendant plus hostile. Les points communs, autrefois sources de solidarité, deviendraient des sujets de discorde.
L’Ukraine, au début du siècle, était une candidate des plus improbables à l’OTAN. Sa gouvernance était si défaillante et la corruption si endémique que, malgré un territoire parmi les plus riches d’Europe et une population nombreuse et instruite, son économie n’a retrouvé son niveau de 1990 qu’en 2006. Les économies de la Russie, du Bélarus et du Kazakhstan, sans parler de la Pologne, avaient toutes affiché une croissance supérieure à celle de l’Ukraine. En 2009, le Fonds monétaire international a quitté le pays pour protester contre la corruption généralisée et la gouvernance catastrophique. De plus, la population ukrainienne ne manifestait aucune aspiration à l’OTAN. Au contraire, les sondages d’opinion révélaient que moins de 30 % de la population était favorable à une adhésion à l’OTAN, tandis qu’une forte majorité s’y opposait. Alors, pourquoi Washington insistait-il tant pour que ce pays lointain, timide et en difficulté devienne un allié ?
En 2007, Vladimir Poutine, visiblement nerveux, a prononcé un discours à la Conférence de Munich sur la sécurité. Il a commencé par avertir son auditoire que ses propos seraient probablement perçus comme « excessivement polémiques ». Il a ensuite fustigé le recours à la force par Washington au mépris du droit et des normes internationales, et dénoncé ce qu’il a qualifié d’adhésion américaine à la notion d’« hyperpuissance ». L’élargissement de l’OTAN, a-t-il déclaré, « constitue une grave provocation ». Posant la question rhétorique : « Contre qui cet élargissement est-il destiné ? », il a juré de tout faire pour l’empêcher.
Le discours a provoqué un tollé au sein des autorités américaines, bien que son contenu n’ait surpris personne. De plus, comme l’a reconnu Angela Stent, ancienne fonctionnaire et universitaire américaine, la réaction de certains Européens a révélé qu’ils partageaient une grande partie des critiques formulées par Poutine.
Le secrétaire à la Défense, Robert Gates, assistait à la conférence. Analyste de carrière à la CIA et ancien directeur du renseignement central, titulaire d’un doctorat en études soviétiques, Gates était particulièrement bien placé pour interpréter le message et la pensée de Poutine. Pourtant, le discours de Poutine, se souvient Gates, l’a déconcerté. Le lendemain, Gates a refusé d’alimenter la polémique et d’envenimer les choses, préférant désamorcer la situation avec humour, déclarant qu’« une Guerre froide, c’était bien assez », et acceptant l’invitation de Poutine à lui rendre visite en Russie.
À son retour de Munich à Washington, Gates choisit cependant de perpétuer l’illusion qui régnait alors à Washington quant au caractère imprévisible de Poutine. Interrogé par George W. Bush sur son discours, Gates le minimisa en l’attribuant à des raisons essentiellement psychologiques, « le fruit d’un ressentiment et d’une amertume profonds et anciens » face au déclin de la Russie de son statut de superpuissance. Pourtant, dans ses mémoires, Gates confesse ne pas avoir été franc avec Bush père. Inexplicablement, il omet de faire part au président de sa conviction que « la relation avec la Russie avait été très mal gérée après Bush père ». Au cœur de cette mauvaise gestion, selon Gates, se trouvait l’élargissement de l’OTAN.
Gates n’était pas le seul à s’inquiéter de l’élargissement de l’OTAN. L’ambassadeur à Moscou à l’époque était William Burns, un diplomate très respecté, parfaitement qualifié pour son poste grâce à sa connaissance du russe et son expérience antérieure dans le pays. Le projet d’intégrer l’Ukraine et la Géorgie à l’OTAN l’inquiétait également. Comme il l’avait clairement indiqué à sa supérieure, la secrétaire d’État Condoleezza Rice, en février 2008 : « L’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN est la ligne rouge la plus claire pour l’élite russe », des « traînards » du Kremlin aux « critiques libéraux les plus virulents de Poutine ». Si Washington persistait à faire pression pour l’adhésion de la Géorgie, prédisait l’ambassadeur, « le risque d’un conflit armé russo-géorgien ultérieur » serait élevé.
À l’instar de Gates et Burns, Rice possédait une expertise pointue sur la Russie et l’Europe de l’Est, acquise grâce à une formation universitaire spécialisée et à son expérience au sein de l’administration de George H.W. Bush. Comme ses collègues, elle nourrissait de profondes réserves quant à l’élargissement de l’OTAN, notamment parce que la France et l’Allemagne avaient clairement manifesté leur opposition à l’adhésion de l’Ukraine et de la Géorgie. Elle jugeait les candidatures de ces deux pays si problématiques qu’elle espérait que le président, alors dans la dernière année de son second mandat, se contenterait de ne pas aborder la question et laisserait le temps faire son œuvre.
Pourquoi, dès lors, Washington a-t-il insisté pour faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN ?
Dick Cheney est resté un fervent partisan de l’expansionnisme, même si ses connaissances étaient parfois limitées. Malgré le fiasco concernant les prétendues armes de destruction massive irakiennes, ses collaborateurs ont tenté de faire pression sur Fiona Hill, membre du Conseil de sécurité nationale, pour qu’elle modifie son évaluation. Lors d’un briefing au président Bush sur l’Ukraine et la Géorgie, Hill avait fait part des conclusions des services de renseignement selon lesquelles le risque de conflit avec la Russie était élevé.
Le conseiller à la sécurité nationale de Bush, Stephen Hadley, convoqua une réunion du Conseil de sécurité nationale pour aborder la question ukrainienne et géorgienne. À moins d’un an de la fin de son mandat, Bush cherchait à concrétiser son « Programme de liberté », fondé sur la conviction quasi mystique que « la survie de la liberté dans notre pays dépend de plus en plus du succès de la liberté dans d’autres pays » et que l’Amérique avait pour mission, d’origine divine, de répandre la démocratie dans « chaque nation et chaque culture ».
Ce programme était en difficulté en Irak et en Afghanistan, mais l’adhésion de la Géorgie et de l’Ukraine à l’OTAN pourrait au moins partiellement le redresser. Hadley a donc dépêché l’ambassadrice auprès de l’OTAN et ancienne adjointe de Cheney, Victoria Nuland, pour intervenir par téléconférence depuis Bruxelles. Nuland a assuré à Bush que les Géorgiens et les Ukrainiens avaient réussi à lutter contre la corruption et à réformer leurs systèmes politiques et économiques, et qu’ils méritaient donc d’adhérer à l’OTAN. Elle a ensuite déclaré à propos de cette adhésion : « S’ils le souhaitent et remplissent les critères, comment les États-Unis pourraient-ils s’y opposer ? »
Selon le raisonnement simpliste, clair et erroné de Nuland, la question de savoir si les États-Unis devaient s’engager par traité à faire la guerre au nom de deux États souverains était désormais une question de procédure. La décision finale échappait déjà au contrôle des représentants élus du peuple américain.
George W. Bush s’est rangé du côté de Nuland, reprenant son raisonnement selon lequel la souveraineté américaine devait être subordonnée à la mission de démocratisation : « Si ces deux États démocratiques souhaitent des MAP [Plans d’action pour l’adhésion], je ne peux pas refuser. » Gates et Rice ont conseillé la prudence lors de la réunion, mais n’ont émis aucune objection malgré leurs réserves. Rice a justifié son hésitation en se disant que Bush avait pris sa décision « par principe », et que c’était son engagement à faire « ce qui était juste » qu’elle admirait tant.
« L’opinion publique en Ukraine était massivement opposée à l’adhésion à l’OTAN. »
Si le raisonnement de Nuland était sans doute fallacieux, ses analyses de la Géorgie et de l’Ukraine étaient trompeuses, voire délibérément mensongères. L’opinion publique ukrainienne était massivement opposée à l’adhésion à l’OTAN, de nombreux sondages indiquant que 55 à 70 % de la population y étaient opposées et seulement 20 à 25 % y étaient favorables. Comme Nuland l’a elle-même déclaré plus tard, l’OTAN était alors si impopulaire qu’elle était considérée comme un gros mot en Ukraine. Pour contourner cette opposition populaire, les Américains ont fait signer une lettre demandant l’adhésion au président, au Premier ministre et au président du Parlement ukrainiens. Cet acte a indigné de nombreux électeurs ukrainiens. La Première ministre, Ioulia Timochenko, a commencé à vaciller. Inquiète pour sa réélection, elle a déclaré que l’Ukraine n’avait pas besoin de l’OTAN. Le secrétaire d’État américain a dû intervenir personnellement pour la ramener sur le droit chemin.
Rice anticipait une bataille acharnée lors du sommet de l’OTAN à Bucarest, prévu en avril 2008. Seuls quatorze des vingt-six membres de l’OTAN étaient prêts à soutenir l’adhésion de l’Ukraine. L’Allemagne et la France menaient la résistance, suivies par l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal et la Norvège. Même la Grande-Bretagne, d’ordinaire si dévouée à Washington, hésitait. Mais Rice avait reçu des ordres de Bush. Là où la logique et l’argumentation ne pouvaient prévaloir, il fallait recourir à la réprimande moralisatrice. Lorsque le ministre allemand des Affaires étrangères fit part de ses réserves quant aux candidatures de la Géorgie et de l’Ukraine, Rice laissa la place au ministre polonais des Affaires étrangères, Radoslaw Sikorski, ancien journaliste et figure de proue du think tank néoconservateur American Enterprise Institute, réduire son homologue au silence en l’interrogeant avec véhémence sur la responsabilité allemande dans la Seconde Guerre mondiale. Comment un Allemand pouvait-il réagir ?
Le deuxième jour fut tout aussi tendu, Bush faisant personnellement pression sur la chancelière allemande Angela Merkel pour qu’elle cède. Finalement, Merkel accepta une déclaration de compromis affirmant que la Géorgie et l’Ukraine deviendraient membres, sans toutefois fixer de date précise.
Washington avait affirmé sa volonté : l’OTAN s’élargirait, malgré le scepticisme des alliés, les réticences des Ukrainiens et la réticence des Russes. Comme l’a déclaré Rice, « Moscou doit savoir que la Guerre froide est terminée et que la Russie a perdu ». Le secrétaire d’État américain a apparemment pris la thèse de Francis Fukuyama sur la « Fin de l’Histoire » au pied de la lettre, au point de croire que le temps s’était arrêté en 1991 et que la Fédération de Russie, successeur de l’Union soviétique, était condamnée à rester indéfiniment un pays soumis.
La décision de Bucarest combinait l’idéalisme mystique du programme de liberté de Bush avec la primauté maximaliste pseudo-machiavélique exprimée dans les directives de planification du Pentagone de Cheney de 1992.
Dans la nuit du 7 août 2008, le président géorgien Mikheil Saakashvili ordonna à son armée, entraînée par les Américains, d’ouvrir le feu sur les forces de maintien de la paix russes et d’attaquer l’Ossétie du Sud afin de s’emparer de cette république, qui avait fait sécession de la Géorgie à la suite d’une guerre civile au début des années 1990, et de la ramener sous le contrôle de Tbilissi. Cependant, des unités de l’armée russe, qui attendaient, lancèrent une offensive, repoussèrent les Géorgiens et pénétrèrent en Géorgie, menaçant Tbilissi. Après une médiation française, la guerre, qui dura cinq jours, se termina par une victoire russe décisive.
La guerre russo-géorgienne de 2008 n’aurait surpris personne. Burns l’avait prédite et Poutine, à Bucarest, l’avait promise. Les tensions entre la Géorgie et la Russie s’étaient considérablement accrues tout au long du printemps et de l’été. Rice s’était rendue en juillet auprès de Saakashvili, formé aux États-Unis, et avait tenu à apparaître publiquement à ses côtés pour témoigner de la solidarité de Washington. En privé, cependant, elle l’avait mis en garde contre le risque de déclencher une guerre. Or, c’est précisément ce qu’il fit, comme l’a formellement établi une mission d’enquête de l’UE . Après la crise, Rice déplora le comportement de Saakashvili, le qualifiant d’« orgueilleux » et d’« impulsif », tandis que Gates qualifia cet ancien allié de l’OTAN de « nationaliste agressif et impétueux ».
Pourtant, malgré les nombreux avertissements et signes d’un affrontement imminent dans le Caucase, le directeur de la CIA, Michael Hayden, fut surpris lorsqu’il reçut, le 8 août, un appel de la Maison-Blanche lui demandant une assistance urgente en matière de renseignement pour la Géorgie. La Géorgie figurait si bas dans sa liste de priorités qu’il ignorait même si la CIA disposait de personnel sur place et dut se démener pour constituer une équipe d’agents de terrain afin de se rendre sur place et de repérer les forces russes les plus avancées grâce à des GPS. Tandis que la CIA s’efforçait de comprendre ce qui se passait, des discussions enflammées sur des représailles contre la Russie animaient la Maison-Blanche. Selon différents témoignages, Cheney commença à préconiser des frappes aériennes contre les forces russes jusqu’à ce que Hadley ramène les esprits à la raison par une question : « Sommes-nous prêts à entrer en guerre contre la Russie pour la Géorgie ? » C’était une rare invocation des intérêts nationaux américains, et la question s’est tranchée d’elle-même.
La guerre fut dévastatrice pour la Géorgie et un camouflet pour les États-Unis. Rares étaient les pays aussi ouvertement pro-américains que la Géorgie, qui avait même déployé une brigade en Irak pour conforter l’illusion, entretenue par Washington, d’un soutien multinational massif à la guerre américaine. Pourtant, lorsque la Géorgie se trouva dans le besoin, le mieux que Washington put faire pour remercier son allié potentiel de l’OTAN fut de rapatrier ces soldats d’Irak par avion et de leur fournir de l’aide humanitaire. Dick Cheney, l’aspirant artisan d’une primauté perpétuelle, se rendit en Géorgie. Son ignorance du conflit dans lequel il proposait d’intervenir était telle qu’après sa visite, il restait persuadé, à tort, que l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie étaient majoritairement peuplées de Russes, alors qu’en réalité, ces régions n’en comptaient qu’une infime minorité.
C’est précisément parce que l’Amérique avait si peu à perdre que Cheney et le reste de Washington pouvaient se permettre le luxe de négliger la Géorgie. Pour quiconque y prêtait attention, ce fiasco avait révélé un niveau inquiétant d’illettrisme stratégique et d’incompétence de la part de George W. Bush et de son équipe de sécurité nationale. Mais quel Américain jugerait utile de s’intéresser à un petit pays à la périphérie de l’Eurasie ? Revenant en 2014 sur l’élargissement de l’OTAN à la Géorgie, Robert Gates a reconnu que les efforts déployés pour intégrer la Géorgie à l’alliance avaient été « véritablement excessifs ». Son jugement sur le projet américain en Ukraine était encore plus acerbe.
« Cette vision du monde niait à la Russie toute prétention légitime à la souveraineté. »
Reconnaissant qu’en 2009, les relations avec la Russie étaient dans une impasse, Barack Obama, à son arrivée au pouvoir, espérait un nouveau départ. Cependant, l’initiative d’Obama connut un début peu prometteur lorsque la secrétaire d’État Hillary Clinton remit à son homologue russe un badge gadget dont l’étiquette, au lieu du mot russe signifiant « Réinitialisation », indiquait « Surcharge ». La responsabilité de cette erreur de traduction incomba à Michael McFaul, professeur de sciences politiques à Stanford et directeur principal d’Obama pour les affaires russes et eurasiennes.
McFaul avait été l’un des premiers soutiens d’Obama et les deux hommes étaient proches. En 2012, Obama le nomma ambassadeur à Moscou. Ce choix, inhabituel, ne fit pas l’unanimité parmi les diplomates américains de carrière. Certes, McFaul connaissait la Russie : il y avait fait ses études, y avait travaillé, parlait la langue, même si son niveau était imparfait, et continuait d’écrire sur la politique du pays. Pourtant, comme il le souligna lui-même dans une interview accordée à une publication russe juste avant de prendre ses fonctions d’ambassadeur, il ne se considérait pas comme un spécialiste de la Russie. Il ne maîtrisait pas les sujets qui définissaient traditionnellement l’expertise diplomatique sur la Russie, tels que la littérature russe ou la stratégie nucléaire, et décrivait plutôt son domaine de spécialisation comme « la démocratisation, les mouvements antidictatoriaux et les révolutions ».
Ainsi, de son propre aveu, McFaul était moins un spécialiste de la démocratie qu’un fervent défenseur de la démocratisation. Sa mission n’était pas de comprendre ou d’interpréter la Russie, mais de la transformer. L’ambassadeur d’Obama était peut-être plus exubérant et moins discret que la moyenne des diplomates américains, mais sa conviction du triomphe imminent d’un ordre libéral pro-américain, et son incrédulité naïve quant à la possibilité d’une objection légitime, ne relevaient pas d’une simple excentricité, mais plutôt d’une illusion partagée par les deux partis. Comme l’a observé l’historien et ancien fonctionnaire du département d’État sous Obama, Michael Kimmage, la politique américaine envers la Russie et ses voisins était animée par la conviction persistante que « la promotion de la démocratie – un enthousiasme des administrations Clinton, George W. Bush et Obama – était une entreprise neutre, presque un acte de philanthropie politique ».
Cette vision du monde niait à la Russie toute prétention légitime à la souveraineté. Les régimes non démocratiques, selon McFaul, perdaient leur droit à la souveraineté internationale faute de respecter celle de leurs citoyens. Il reconnaissait que ce déni était en contradiction flagrante avec les normes diplomatiques, mais estimait ces dernières obsolètes . « Il fut un temps où défendre la souveraineté des États était une idée progressiste », écrivait-il, « car l’avènement de l’État a contribué à la chute des empires. » Mais aujourd’hui, « ceux qui défendent la souveraineté du peuple sont les nouveaux progressistes », et le progressisme dicte les normes internationales.
L’internationalisme libéral de McFaul était parfaitement cohérent avec le programme de liberté de George W. Bush. En effet, McFaul a écrit en faveur de Bush et de l’invasion de l’Irak dans les colonnes du Wall Street Journal en 2003, arguant que pour « gagner en légitimité en tant que porte-parole de la communauté internationale, l’ONU devait s’efforcer de représenter les peuples du monde ». Autrement dit, « s’engager pour la démocratisation » sous peine de devenir insignifiante, voire pire.
McFaul était un militant, mais un militant naïf. Le défenseur de la révolution démocratique n’avait aucune chance à Moscou, ancien épicentre des révolutions mondiales. Fidèle à son instinct d’activiste, McFaul ignora les conseils des diplomates de carrière et se lança dans une guerre de l’information contre le Kremlin sur les réseaux sociaux russes. Il découvrit rapidement qu’il était désavantagé : si l’ambassade américaine à Moscou disposait de moyens considérables, le gouvernement de la Fédération de Russie bénéficiait de ressources bien plus importantes pour communiquer avec l’opinion publique russe. En février 2014, un peu plus de deux ans après son arrivée à Moscou, plein d’espoir et d’ambition, il annonça sa démission prématurée.
Le départ de McFaul coïncida avec une nouvelle dégradation des relations avec la Russie, mais cela n’avait que peu à voir avec sa tentative maladroite de réinventer la diplomatie en s’immisçant dans la politique intérieure de son pays hôte. Une lutte bien plus importante se déroulait en Ukraine voisine, où des manifestations massives contre le gouvernement élu atteignaient leur paroxysme.
Le mouvement qui a secoué l’Ukraine durant l’hiver 2013-2014 était préfiguré par la « Révolution orange » survenue dix ans plus tôt. Lorsque, lors du second tour de l’élection présidentielle de l’automne 2004, le candidat soutenu par Moscou, Viktor Ianoukovitch, a revendiqué la victoire, une vaste coalition d’organisations non gouvernementales, en Ukraine et à l’étranger, s’est mobilisée. Presque aussitôt, des bus transportant des partisans du pro-occidental Viktor Iouchtchenko ont afflué vers la capitale ukrainienne pour manifester. Fin novembre, les manifestants se comptaient par centaines de milliers, installés dans un immense campement de tentes dressé à leur intention et réclamant l’annulation des élections. Cette pression a contraint les autorités à convoquer un troisième tour. Iouchtchenko a remporté ce second tour et a ainsi accédé à la présidence.
Le degré de coordination des manifestations – avec des flottes de véhicules pour transporter les participants, des camps de tentes pour les abriter, des approvisionnements en eau et en nourriture, et des concerts et feux d’artifice pour les divertir – témoignait d’une logistique impressionnante. Comme l’attestait McFaul dans son analyse de la Révolution orange en 2007 : « La protestation n’était pas spontanée . » Elle était le fruit de mois de planification et de préparation minutieuses par un réseau de militants pro-démocratie originaires d’Ukraine et des pays voisins (Géorgie, Serbie, Slovaquie et Roumanie), formés, financés et conseillés par des experts américains et européens. Il ne s’agit pas de nier la sincérité des frustrations et des aspirations des partisans ukrainiens de Iouchtchenko, mais de reconnaître, comme McFaul, le rôle crucial de l’aide américaine dans le succès de la Révolution orange.
Pourquoi Washington s’est-il autant investi dans les élections ukrainiennes, les manifestations et la transformation du paysage politique intérieur du pays ? Charles Krauthammer l’a clairement exprimé dans le Washington Post : la Révolution orange « vise d’abord la Russie, la démocratie n’étant qu’une question secondaire ». « L’Occident, a-t-il poursuivi, veut achever l’œuvre commencée avec la chute du mur de Berlin et poursuivre la marche de l’Europe vers l’Est. » Il fallait repousser définitivement la Russie, et l’Ukraine était le lieu idéal pour y parvenir.
Démentant le triomphalisme de 2004, les vainqueurs de la Révolution orange ont rapidement démontré que leur soif d’enrichissement personnel primait sur leur attachement à la démocratie, à l’autodétermination et à l’État de droit. C’est ainsi qu’en 2010, les électeurs ukrainiens ont choisi Ianoukovitch. Les observateurs internationaux ont jugé les élections libres et équitables. Ces élections ont confirmé moins une polarisation des valeurs parmi les électeurs qu’une fracture géographique profonde et inquiétante : les électeurs de l’est ont largement soutenu Ianoukovitch, tandis que ceux de l’ouest ont voté pour Timochenko.
La Révolution orange avait tourné au vinaigre, mais comme le sommet de Bucarest l’avait clairement démontré, l’ardeur de Washington pour l’Ukraine ne s’était jamais démentie. Dans une tribune publiée dans le Washington Post en septembre 2013, Carl Gershman, directeur du National Endowment for Democracy, décrivait une intense compétition d’influence qui s’intensifiait tout le long des frontières russes. Reprenant les propos de Krauthammer, il désignait l’Ukraine comme « l’enjeu majeur » de cette compétition et appelait à une position plus ferme. En exerçant une pression accrue sur la Russie dans son voisinage, avançait Gershman, Washington pourrait même faire tomber Poutine.
La description que Gershman faisait de populations opprimées avides de protection occidentale ne reflétait guère la réalité ukrainienne. Les sondages menés de 2009 à 2013 ont constamment montré un faible soutien à l’adhésion à l’OTAN en Ukraine (généralement entre 15 et 25 %) et une forte opposition, oscillant entre 57 et 70 %.
À l’automne 2013, Ianoukovitch devait signer un accord d’association avec l’Union européenne. Pour les Ukrainiens, englués dans une économie stagnante, cet accord offrait une lueur d’espoir et bénéficiait donc d’un large soutien populaire. Un obstacle majeur résidait dans la forte réduction des échanges commerciaux avec la Russie, de loin le principal partenaire commercial de l’Ukraine. L’Ukraine était ainsi contrainte à un choix binaire : l’Europe ou la Russie. Poutine a réagi à l’offre de l’UE par un mélange de menaces et d’incitations économiques à l’égard de Kiev, notamment des prêts très avantageux. Le 28 novembre, Ianoukovitch a rencontré des représentants de l’UE à Vilnius et les a stupéfiés en refusant de signer l’accord.
Sa décision n’a cependant pas surpris tout le monde à Kiev, où les manifestations contre Ianoukovitch avaient débuté une semaine avant la rencontre de Vilnius. Dès le refus de Ianoukovitch, un réseau de militants de l’opposition s’est mobilisé, coordonnant l’arrivée de dizaines de milliers de manifestants sur la place de l’Indépendance, le Maïdan Nezalezhnosti . Comme en 2004, nombre d’entre eux avaient été formés en Pologne et à l’étranger aux tactiques de protestation et de désobéissance civile.
Washington était au cœur de la confrontation qui se déroulait. S’exprimant devant la conférence de la Fondation États-Unis-Ukraine à Washington, D.C., le 13 décembre 2013, Victoria Nuland s’est vantée que l’investissement de 5 milliards de dollars de Washington dans la promotion de la démocratie en Ukraine portait désormais ses fruits. Alors que le nombre de manifestants sur et autour du Maïdan, au centre de Kiev, atteignait 200 000, le soutien de Washington était manifeste et significatif. Victoria Nuland, ainsi que les sénateurs américains John McCain et Chris Murphy, figuraient parmi les Américains qui se sont rendus à Kiev pour encourager les manifestants du Maïdan.
Les premières tentatives des forces de police et de sécurité ukrainiennes pour disperser les manifestants ont eu l’effet inverse, car les informations et les images de leurs violences ont incité davantage d’Ukrainiens à rejoindre le Maïdan ou des manifestations locales dans leurs propres villes.
Cependant, les forces de sécurité gouvernementales n’avaient pas le monopole de la violence sur le Maïdan. Aux côtés des manifestants pacifiques se trouvaient des milices de nationalistes ukrainiens radicaux, armées, prêtes et même désireuses d’en découdre avec le gouvernement. Le 18 février, les affrontements de rue ont dégénéré en fusillades lorsque des miliciens se sont joints aux combats. L’identité de ceux qui ont ouvert le feu est vivement contestée et, en grande partie, sans importance. Le 20 février, plus de 100 manifestants et 13 policiers avaient perdu la vie.
Face à l’escalade de la violence lors des manifestations, Ianoukovitch, cédant notamment aux pressions de Poutine, accepta le 21 février de signer un accord négocié par les Européens avec l’opposition. Cet accord prévoyait la tenue d’une élection présidentielle avant la fin de l’année et exigeait de l’opposition qu’elle renonce à toute nouvelle violence et qu’elle dépose les armes. Cependant, quelques heures plus tard, l’accord vola en éclats et Ianoukovitch, craignant pour sa vie, s’enfuit en Russie. Le Parlement ukrainien le destitua et nomma un rival président par intérim.
Ce fut un moment d’euphorie pour l’establishment de la politique étrangère américaine. L’administration Obama et le département d’État échangèrent des courriels de félicitations. Certains spéculèrent que le triomphe de l’Euromaïdan précipiterait la chute de Poutine, une théorie en chaîne de la démocratisation au service de la géopolitique.
Mais la joie fut prématurée. Le 20 février, des manifestations éclatèrent en Crimée. Sept jours plus tard, des militaires russes en uniformes verts sans insigne firent leur apparition dans toute la péninsule. Dès le lendemain, ils en avaient pris le contrôle, presque sans effusion de sang. Le 16 mars, la Crimée vota par référendum son rattachement à la Russie et, deux jours plus tard, Moscou officialisa son annexion.
L’opinion publique russe a toujours considéré la Crimée comme faisant partie intégrante de la Russie, et Poutine a vu sa reconquête de la péninsule récompensée par un regain de popularité. Parallèlement, le renversement de Ianoukovitch a été mal perçu dans le Donbass, région de l’est de l’Ukraine où, comme en Crimée, les habitants s’identifiaient culturellement à la Russie. Ils se sentaient marginalisés par les événements de Kiev et craignaient des pertes économiques liées à l’accord d’adhésion à l’UE. Portés par ce sentiment, des séparatistes pro-russes – soutenus par Moscou mais majoritairement locaux – ont proclamé l’indépendance de Louhansk et de Donetsk en avril. Une violente riposte militaire ukrainienne, menée avec vigueur par le président Petro Porochenko, a infligé souffrances et pertes humaines à la population du Donbass. Alors que la guerre, au cours des deux années suivantes, a coûté la vie à plus de 10 000 personnes, dont plus de 3 000 civils, l’opinion publique locale et russe s’est ralliée à la cause séparatiste. L’arrivée dans le Donbass de milices nationalistes ukrainiennes radicales, prônant des idées farouchement anti-russes et adoptant une esthétique pro-nazie, a renforcé le soutien au séparatisme russe.
« Cela avait entraîné l’Amérique dans une lutte qui n’avait que des intérêts périphériques pour elle. »
Loin d’offrir à l’Occident le « grand prix » que représentait l’Ukraine, l’Euromaïdan a déchiré le pays. Les passions attisées par les manifestations et alimentées par des personnalités comme Nuland et McCain ont polarisé et radicalisé la population ukrainienne. Ce résultat était parfaitement prévisible. L’Ukraine a toujours été une société divisée et un État fragile. De plus, l’imprudence de Washington a même inversé la tendance à la démocratisation. Loin de fragiliser Poutine, l’Euromaïdan a renforcé son soutien là où il comptait le plus : au pays et dans l’est de l’Ukraine.
La deuxième erreur stratégique majeure de Washington fut d’avoir entraîné les États-Unis dans un conflit d’intérêts périphériques pour le pays, mais d’une importance capitale pour son rival, Moscou. Même Barack Obama l’ a reconnu : l’Ukraine étant un enjeu fondamental pour la Russie, mais pas pour les États-Unis, Washington s’exposerait inévitablement à des désavantages considérables sur place.
Entre-temps, Brzezinski, le vieux maître de la primauté américaine en Eurasie, reconnut tardivement que ses disciples n’étaient pas à la hauteur de la tâche. Voyant que les événements échappaient à tout contrôle et que la politique de Washington en Ukraine menait l’Amérique, ses alliés et l’Ukraine en terrain miné, il exhorta Washington, le 24 février 2014, à garantir à Moscou que l’Ukraine, suivant le modèle de la Finlande de la Guerre froide, maintiendrait une stricte neutralité et « aucune participation à une alliance militaire que Moscou considérerait comme dirigée contre elle ».
« Washington a rejeté toute notion de « finlandisation » comme une lâche trahison de sa souveraineté. »
Mais Washington a rejeté toute idée de « finlandisation », la qualifiant de lâche trahison de souveraineté et d’acte honteux d’apaisement. La bureaucratie de sécurité nationale américaine souhaitait une confrontation, et c’est ce qu’elle a fait. Comme l’a révélé le New York Times , quelques heures seulement après le départ de Ianoukovitch d’Ukraine, la CIA et le MI6, le service de renseignement extérieur britannique, ont entamé un partenariat avec les services de renseignement ukrainiens. Et ce, avant même l’intervention russe en Crimée et dans le Donbass.
L’attrait était évident. Aucun autre service de renseignement au monde ne connaissait aussi bien la Russie et ses services de sécurité que celui d’Ukraine. Outre la proximité linguistique et culturelle entre les deux pays, nombre d’agents des services de renseignement ukrainiens avaient été formés en Union soviétique aux côtés de leurs homologues russes. Les Ukrainiens offraient une capacité inégalée, non seulement pour espionner et opérer sur le territoire russe, mais aussi pour mener des opérations contre les Russes dans des pays tiers. Malgré les instructions formelles de la Maison Blanche de faire preuve de retenue dans cette coopération sécuritaire naissante, la CIA a formé avec enthousiasme des commandos ukrainiens aux opérations cinétiques, en plus des techniques d’espionnage. Lorsque, en 2016, ses partenaires ukrainiens ont mené un raid raté en Crimée et assassiné des Russes à l’aide d’explosifs, la Maison Blanche a réagi avec fureur. Obama, cependant, s’est montré incapable ou peu disposé à reprendre le contrôle. Comme l’écrivait le New York Times en décrivant l’étroite collaboration entre les services de renseignement américains, britanniques et ukrainiens contre les Russes, « une guerre de l’ombre était désormais engagée à plein régime ».
Ainsi, lorsque Donald Trump a pris ses fonctions en 2017, l’appareil de sécurité nationale américain était profondément enlisé dans une guerre civile opposant des populations russophones à la frontière russe. Ce nouveau partenariat a rendu la question de l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN largement caduque. Le scepticisme de Trump quant à l’opportunité d’un conflit avec la Russie a scandalisé l’élite de la politique étrangère, au point que nombre d’entre eux ont formulé, ou envisagé, des allégations de collusion entre le président américain et la Russie, réduisant ainsi sa marge de manœuvre diplomatique. Ses nominations, en avril 2018, de deux faucons notoires à l’égard de la Russie – l’ambitieux mais peu visionnaire Mike Pompeo au poste de secrétaire d’État et le simpliste et comiquement belliqueux John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale – ont garanti que l’Amérique continuerait de s’engager sur la même voie vers une confrontation en Eurasie.
Pompeo et Bolton ont tous deux étendu et approfondi la collaboration militaire et de renseignement américaine avec Kiev, autorisant la création de nouvelles bases et de programmes d’entraînement « secrets ». Si le caractère secret de ces installations les dissimulait peut-être au citoyen américain lambda, elles n’échappaient pas à l’attention des Russes. Plusieurs membres de l’OTAN, tels que le Royaume-Uni, la France, la Pologne et la Turquie, ont également fourni du matériel militaire et une formation aux forces armées ukrainiennes, renforçant progressivement leurs capacités. L’Ukraine était de facto un partenaire militaire occidental.
Les partisans d’une ligne agressive aiment parfois souligner que Poutine avait, par ses propres actions, créé à ses frontières le cauchemar stratégique qu’il prétendait vouloir éviter. En annexant la Crimée et en soutenant les séparatistes du Donbass, il avait transformé l’Ukraine, d’un voisin potentiellement hostile, en un ennemi déclaré. Moscou, cependant, y voyait une manière de tirer le meilleur parti d’une situation devenue irrémédiable en février 2014, de sauver ce qui pouvait l’être d’une Ukraine que les États-Unis avaient cooptée.
Washington n’avait assurément aucun intérêt pour la réconciliation ukraino-russe. Bien au contraire, les États-Unis ont creusé le fossé entre les deux pays en favorisant la rupture des liens culturels et spirituels qui les unissaient encore. En 1991, l’Ukraine a hérité de ses frontières et de sa souveraineté politique de l’Ukraine soviétique, mais l’Église orthodoxe ukrainienne, institution antérieure à l’ère soviétique, est restée sous la juridiction du patriarcat de Moscou. Après l’accession de l’Ukraine à l’indépendance en 1992, un patriarcat rival a été établi à Kiev, mais il ne bénéficiait pas de l’autocéphalie, c’est-à-dire que son patriarche n’était pas reconnu comme légitime et indépendant par les autres patriarches orthodoxes. Pompeo, l’ambassadeur itinérant américain pour la liberté religieuse internationale, Sam Brownback, ainsi que les ambassadeurs en Ukraine et en Grèce, entre autres responsables, ont soutenu et appuyé une campagne concertée et controversée visant à obtenir l’autocéphalie pour l’Église orthodoxe d’Ukraine.
En 2019, le patriarche de Constantinople a accordé l’autocéphalie à l’Église d’Ukraine, une décision soutenue par trois autres Églises mais contestée ou ignorée par dix autres, divisant le monde orthodoxe et provoquant de vives querelles entre Ukrainiens au sujet des paroisses et des biens de l’Église. Ce qui était un héritage religieux commun est devenu une source de discorde – une habile manœuvre de sabotage culturel.
Alors que la guerre du Donbass restait irrésolue, que le processus de paix mené par l’OSCE était au point mort et que les forces armées et les services de sécurité ukrainiens se renforçaient et s’intégraient davantage en tant que partenaire militaire de l’OTAN, Moscou se trouvait une fois de plus face à un dilemme : l’escalade immédiate ou la concession ultérieure. Les responsables américains, tant au sein de l’administration Biden que dans les bureaucraties, n’avaient guère intérêt à faire des compromis avec la Russie, qu’ils considéraient, comme ils le soulignaient régulièrement, comme une puissance en déclin inéluctable.
En juillet 2021, Poutine publiait un article intitulé « Sur l’unité historique des Russes et des Ukrainiens ». Son argument selon lequel Russes, Ukrainiens et Biélorusses constituent un seul peuple en vertu d’une ascendance commune issue de la Rus’ antique et d’expériences historiques partagées est certes discutable, mais il n’avait rien de nouveau ni d’extravagant. L’histoire est faite de changements autant que de continuité et ne peut donc jamais être déterminante dans les débats sur l’identité et l’appartenance. Elle peut cependant apporter un éclairage. Il est utile de rappeler que la Russie et l’Ukraine ont fait partie du même État plus longtemps que les territoires ayant constitué la Louisiane n’ont fait partie des États-Unis, plus longtemps que Genève n’a fait partie de la Suisse, Rome de l’Italie, ou la Lorraine et Nice de la France. Le message fondamental que Poutine cherchait à transmettre était que Moscou considérait l’Ukraine comme une partie inaliénable de sa sphère d’influence et qu’elle se battrait pour elle plutôt que de la voir se retourner contre elle comme un pays « anti-russe ». Loin de toute duplicité ou obscurcissement, Poutine s’exprimait une fois de plus avec clarté et franchise.
La perspective d’une guerre n’intimidait pas Washington. Les États-Unis n’avaient que peu à perdre dans ce conflit. Certains responsables politiques semblaient même s’en délecter. Si la Russie envahissait l’Ukraine, expliquaient-ils, ils la réduiraient à néant en soutenant une insurrection ukrainienne vigoureuse, destinée à l’affaiblir et à l’anéantir. Cette idée faisait écho aux propos optimistes de Brzezinski à Jimmy Carter après l’invasion soviétique de l’Afghanistan : « Nous avons maintenant l’occasion d’offrir à l’URSS sa guerre du Vietnam. » La conviction que la guerre soviétique en Afghanistan avait précipité l’effondrement de l’Union soviétique s’est ensuite ancrée dans les mentalités à Washington. Ironie du sort, le désir de venger la défaite américaine en Afghanistan en 2021 a influencé la position des Américains sur l’Ukraine en 2022. Si l’utilisation des Ukrainiens pour saigner à blanc les Russes ne suffisait pas, l’administration Biden était absolument convaincue de pouvoir anéantir l’économie russe par des sanctions économiques sans précédent et ainsi contraindre Poutine à se soumettre.
Mais qu’en est-il de l’Ukraine et des Ukrainiens ? Quel prix devront-ils payer ?
En 1980, alors que la Pologne communiste était secouée par des troubles sociaux, les États-Unis apprirent, grâce à un espion de haut rang infiltré dans l’armée polonaise, que l’armée soviétique était sur le point d’envahir le pays pour rétablir l’ordre. Une telle invasion aurait suscité une forte résistance populaire, et le bain de sang qui s’en serait suivi aurait plongé le Pacte de Varsovie dans une crise profonde, offrant à l’Occident une aubaine en termes d’image comparable à l’invasion de la Hongrie par les Soviétiques en 1956. Mais comme Brzezinski le savait, elle aurait également dévasté sa Pologne natale et porté un coup fatal aux relations américano-soviétiques.
Un an auparavant à peine, Brzezinski avait exploité les craintes soviétiques pour les inciter à intervenir en Afghanistan. En Pologne, il fit tout le contraire. Déterminé à éviter une invasion, il s’assura que le message de Carter à Brejnev associe les avertissements de représailles à la promesse de « ne pas exploiter les événements en Pologne, ni de menacer les intérêts de sécurité soviétiques légitimes dans cette région ».
Malgré un fossé idéologique bien plus profond que tous ceux d’aujourd’hui et une compétition mondiale aux enjeux considérablement plus élevés, Washington et Moscou ont su, durant la Guerre froide, maintenir des relations mesurées, fondées sur le respect mutuel et une compréhension partagée – suffisantes pour communiquer efficacement et éviter toute escalade. L’invasion a ainsi été déjouée.
Les renseignements américains sur les mouvements et activités militaires russes près de la frontière ukrainienne étaient d’une qualité exceptionnelle. Fin 2021, ils ont détecté des préparatifs d’invasion. En novembre, Biden a dépêché Bill Burns, alors directeur de la CIA, pour adresser un message sans équivoque à Poutine : « Nous savons parfaitement que vous envisagez d’envahir l’Ukraine et, si vous passez à l’acte, nous aiderons l’Ukraine, nous mobiliserons l’Occident tout entier et nous vous imposerons des sanctions sévères. » Ce message, transmis oralement et par lettre personnelle de Biden à Poutine, visait à intimider et à dissuader. Il a échoué.
Cette tentative a échoué car elle a enfreint le précepte ancestral de Sun Tzu de ne pas trop presser un ennemi désespéré, car même un adversaire faible se battra avec acharnement s’il est convaincu de n’avoir d’autre choix. Dès la fin de la Guerre froide, Washington n’a cessé d’étendre sa présence en Eurasie, doublant quasiment la taille de l’OTAN, qui est passée de 16 membres en 1991 à 30 en 2022. Washington a agi ainsi malgré les objections constantes, puis les avertissements explicites, de la seule cible logique de cette alliance : la Fédération de Russie. Bien que Washington n’ait pas réussi à faire entrer l’Ukraine dans l’OTAN en tant que membre formel, les États-Unis l’ont transformée en un allié de facto après 2014. Suite à l’invasion russe, plusieurs responsables à Washington ont ouvertement – et cyniquement – salué la guerre en Ukraine comme un moyen d’affaiblir la Russie.
Comme si elle craignait que l’on s’interroge sur sa responsabilité dans la guerre en Ukraine, l’administration Biden a insisté pour qualifier d’« injustifiée » toute référence à l’invasion russe. Pourtant, même Robert Gates – un partisan déclaré d’une ligne dure envers la Russie, dont les antécédents le prouvent – avait qualifié la tentative de Washington d’intégrer l’Ukraine à l’OTAN de « provocation particulièrement grave ».
La situation actuelle des États-Unis, à deux doigts de devenir un belligérant direct contre une puissance nucléaire rivale dans une guerre qui n’implique ni territoire ni principes vitaux, est déconcertante. L’expérience de la Guerre froide offre des précédents instructifs sur la manière de gérer la crise avec la Russie. Il existe également une abondante littérature sur les multiples lacunes structurelles, faiblesses et dilemmes insolubles de la Russie autoritaire de Poutine, dont certains sont encore plus aigus que ceux qui ont provoqué la chute de l’Union soviétique. Paradoxalement, affronter la Russie sur un territoire que l’on peut qualifier à juste titre de sacré pour elle, tant du point de vue religieux (la Rus’ de Kiev) que séculier (l’histoire tsariste et de la Seconde Guerre mondiale), était peut-être le meilleur moyen de redonner un second souffle au régime de Poutine.
Depuis la fin de la Guerre froide, Washington s’est persuadé que l’expansion de sa puissance en Eurasie relevait de l’altruisme. Il s’est accroché à cette conviction tout en bafouant les principes et valeurs démocratiques qu’il prétendait promouvoir : en orchestrant l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN malgré l’opposition de l’opinion publique ukrainienne ; en niant l’implication de la Géorgie dans le déclenchement de la guerre en 2008 ; et en soutenant le soulèvement populaire qui a engendré des violences et abouti au renversement du gouvernement ukrainien, démocratiquement élu mais gangrené par la corruption, en 2014.
Convaincus que tous ceux qui s’y opposaient étaient antidémocratiques, donc illégitimes et animés par de vils motifs, les décideurs politiques de Washington ont mis en œuvre des politiques et un discours de volonté et de puissance qui ont transformé le monde en une arène de compétition : certains pays comme des trophées à conquérir, d’autres comme des leviers de contrôle, et d’autres encore comme des régimes à contrer. Cette confusion stratégique et morale en matière de politique étrangère a engendré un excès de confiance et une incompétence stupéfiante qui ont non pas assuré la primauté, mais le désastre pour l’Amérique, ses alliés et ses partenaires.
L’enlisement eurasien de Washington est le fruit de décennies de tensions. En sortir l’Amérique sera un défi de longue haleine et périlleux. Donald Trump est quasiment le seul dirigeant occidental majeur à avoir eu le courage de qualifier la guerre en Ukraine de calamité. Puisse le sommet de l’Alaska marquer le début d’un retour à une politique étrangère américaine fidèle à sa tradition d’analyse lucide des intérêts nationaux et d’usage mesuré de la force.
Michael A. Reynolds, 15 août 2025
Source : Compact Mag
L’auteur : Michael A. Reynolds est professeur agrégé d’études du Proche-Orient et codirecteur du programme d’histoire et de pratique de la diplomatie à l’université de Princeton.
























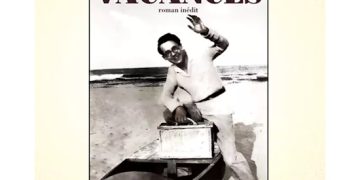




 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV










Mais concrètement, que va-t-il se passer dans les six prochains mois en Ukraine?
Vous n’avez pas encore compris ? La question est vaine. Personne n’a encore inventé la boule de cristal. Il faudra attendre six mois.
Certains analystes (dont je fais partie) prévoient la fin du conflit en 2029, date à laquelle les capitales européennes ont provisionné leur aide en matériels de guerre (jamais humanitaire) et en subventions à fonds perdus. Donc, demain n’est pas la veille de la fin de cette catastrophe européenne. Comme vous l’avez souligné, nous n’avons pas encore de boule de cristal.
En science, quand on a compris quelque chose, on est capable de prévoir.
Si l’article ne permet pas de prévoir quoi que ce soit, et il fait 18 pages, alors…
–> Dès le début de la guerre en Ukraine, j’avais vu sur Ria Novosti un article qui disait que la crise ukrainienne pourrait durer 5 ans.
Je regrette de n’avoir pas gardé le lien; à l’époque, je n’avais absolument pas trouvé la prévision crédible et j’avais tort, le diagnostic était parfaitement bon.
Il est vrai que la prévision n’était pas étayée, il était simplement dit quelque chose comme « selon certains experts, la crise ukrainienne pourrait durer 5 ans ».
Pourtant, on avait quelques indices: la livraison annoncée dès le début d’avions de chasse OTAN à l’Ukraine. Tout le monde était d’accord pour dire qu’il faudrait au moins deux ans pour former les pilotes et les mécaniciens, mettre en place l’infrastructure etc. Mais comme j’étais persuadé que la guerre n’allait pas durer, j’en ai conclu que c’était de la propagande.
–> Voilà, quand on n’a pas les cartes en mains et quand en plus on ne sait pas à quoi on joue, il vaut mieux se taire.
–> prévoir le passé, tout le monde sait plus ou moins le faire et ça fait rire, ou ça lasse.
En sciences dures, en sciences exactes… Pas dans la « science » de la destinée du monde. La guerre n’est pas une manipulation d’éprouvettes sous microscope.
Non, mais on doit au moins pouvoir donner des scénarios et des clés de lecture.
En voici une: une guerre doit permettre de clarifier les rapports de forces.
Muni de cette grille de lecture, je peux dire que …
Si la guerre s’arrêtait aujourd’hui, je pencherais plutôt pour une défaite aux points de la Russie, en effet, la bataille se déroulait chez elle, à 500 km de sa capitale, et quand on n’est pas capable de gagner une guerre à 500 km de sa capitale, c’est qu’il y a un grave problème.
Qu’on imagine une seconde que l’OTAN conclut une paix avec un front à 500 km de Paris, voire, à 500 km de New York, je ne considèrerais pas que mon pays est vainqueur.
–> De plus, au début de la guerre, je croyais que la balance des forces était nettement en faveur de la Russie, non seulement par rapport à l’Ukraine, mais bien par rapport à l’OTAN, se retrouver sur une sorte de match nul est déjà une révision de l’équilibre en défaveur de la Russie.
–> Nombre de pays limitrophes de la Russie ont pris acte de la supériorité de l’OTAN: tous les pays « frères slaves » passent du côté de l’OTAN: Bulgarie, Serbie, Roumanie, Moldavie. Les pays soi-disant neutres sont officiellement rentrés dans l’OTAN: Suède et Finlande. Toutes les républiques musulmanes ex-URSS sont en train de passer à l’Ouest.
–> Pour 2026, et je le prévois depuis février 2025 https://jeune-nation.com/actualite/geopolitique/laide-americaine-a-israel-un-rapport-du-congres-us
je pense qu’il y aura une guerre contre l’Iran: parce qu’en 2026, il est prévu des livraisons à Israël d’armes de projection de force: nouveaux avions ravitailleurs en vol et hélicoptères de transport. Si l’Iran tombe, et ça en prend bien le chemin, la Russie aura son immense flanc sud complètement ouvert, ce sera la fin.
–> Or, la Russie ne soutiendra pas l’Iran, non seulement parce qu’elle n’est pas capable de mener un guerre sur deux fronts (on l’a bien vu avec l’effondrement de la Syrie), mais parce que se mettre du côté de l’Iran c’est se mettre automatiquement contre Israël (et les Juifs), ce que la Russie ne veut pas faire et pour cause.
L’heure de vérité approche pour la Russie.