11 février 1945 : « Jour de l’Honneur » des défenseurs de Budapest
À la fin de 1944, la Hongrie demeure l’un des seuls alliés du IIIe Reich. Des efforts désespérés sont donc entrepris pour conserver dans l’alliance allemande ce pays dont les richesses sont nécessaires au Reich et à son effort de guerre, d’autant plus que la dernière raffinerie de pétrole de l’Axe encore intacte se trouve dans le sud-ouest du pays. La plaine hongroise est en effet productrice d’hydrocarbures et constitue, en cet automne 1944, la dernière source d’approvisionnement accessible. Budapest et la Hongrie occidentale constituent également le dernier rempart avant la conquête de l’Autriche, un des cœurs du Reich.
Budapest est aussi une cible majeure pour les Soviétiques. Dès la fin du mois d’octobre, une consigne de la Stavka (quartier-général du commandant des forces armées d’Union soviétique) ordonne la prise de la ville. En effet, la conférence de Yalta approche et Staline veut démontrer sa puissance à Churchill et Roosevelt. Il envoie donc des directives au général Malinovski, lui ordonnant de prendre la ville le plus vite possible !
Le 16 octobre 1944, l’Allemagne force le régent Miklós Horthy à abdiquer, et appelle Ferenc Szálasi, chef du Parti des Croix fléchées (Nyilaskereszt), au pouvoir.
C’est dans ce contexte qu’eut lieu la bataille de Budapest (en hongrois : Budapest ostroma) dont le siège dura du 29 décembre 1944 au 13 février 1945.
L’assaut soviétique
Le 29 octobre 1944, l’Armée rouge et les forces roumaines récemment ralliées commencent leur offensive sur Budapest. Les troupes germano-hongroises multiplient les contre-offensives afin de tenter d’éloigner l’Armée rouge de la capitale hongroise. Plus de 1 000 000 d’hommes se divisent en deux corps se ruant en direction de la ville, dans le but de la couper du reste des troupes germano-hongroises, concentrées dans l’ouest du pays.
Le 7 novembre 1944, les troupes soviétiques entrent dans Budapest par les faubourgs est, à 20 km de la Vieille Ville, puis se mettent en défense. Très peu d’habitants décident de quitter la ville. Le 19 décembre, après une pause, ils reprennent leur offensive. Le 26 décembre, la route reliant Vienne à Budapest est coupée par l’Armée rouge, encerclant ainsi la ville.
Environ 100 000 soldats se retrouvent pris au piège, dont la moitié étaient des Allemands et l’autre moitié des Hongrois. Ils réussissent à tenir la ville pendant 52 jours contre des forces soviétiques supérieures.
Desserrer l’étau
Après deux tentatives infructueuses de desserrer l’étau, les Allemands ne s’avouent pas encore vaincus. À partir du 11 janvier, dans le plus grand secret, le IV.SS.Panzer Korps du général Gille est envoyé un peu plus au sud pour lancer une dernière offensive pour sauver la garnison de Budapest, ce sera l’opération « Konrad III ». Au total, les forces allemandes alignent 6 000 fantassins et 300 blindés, soit deux fois moins que les Soviétiques.
L’offensive est lancée le 18 janvier, au matin, par une aube froide et brumeuse. Contre toute attente, les assaillants ouvrent rapidement une brèche à travers les champs de mines, mais dès le 24 les troupes allemandes sont à bout de souffle. Les SS parviennent quand même à repousser les assauts soviétiques. Même incomplètes, les unités allemandes gardent une impressionnante efficacité guerrière qui leur permet de continuer à avancer. Le 25, la Totenkopf et la 1re Panzerdivision percent les lignes soviétiques à Petend, mais doivent également reculer dès le 26.

« Jour de la rupture du siège »
À l’intérieur de Budapest, la journée du 11 février, 30 000 combattants hongrois avec leurs familles et leurs camarades allemands assiégés entreprirent de rompre l’encerclement soviétique en trois groupes, afin de tenter d’atteindre Vienne par les forêts avoisinantes : le premier réussit à tromper la vigilance de l’armée Rouge à cause du brouillard, mais les deux autres connurent un sort moins heureux et furent écrasés par l’artillerie et notamment les canons antichars, non sans s’être héroïquement défendus dans la proportion de trois soviétiques tués pour un combattant de l’Axe. Les survivants furent pour beaucoup torturés et exécutés.
Mais 700 Allemands échappèrent à ce massacre terrifiant, et aussi sadique que ceux accomplis par l’ignoble chef rouge de la dite République hongroise de 1921, Béla Kun (né Béla Kohn, figure majeure du judéo-bolchevisme, un des fondateurs du Parti des communistes de Hongrie et haut dirigeant de la IIIe Internationale le Komintern). Kun s’était déjà illustré en ordonnant, entre autre, l’exécution d’officiers blancs de l’armée de Piotr Nikolaïevitch Wrangel, alors que ceux-ci s’étaient rendus après la victoire de bolcheviques en Crimée en 1920.
À Budapest, la garnison qui ne tient plus que Buda sans plus aucun espoir de secours, se rend le 13 février : l’armée Rouge pille tout et viole 200 000 femmes. Dans les jours et les semaines qui suivent la prise de la ville, des civils sont capturés par les soldats soviétiques, qui leur annoncent avoir besoin d’eux pour faire du malenkirobot (du « petit travail »). Il s’agit en fait de les emmener vers l’Union Soviétique, où ils sont mis au travail forcé afin de reconstruire le pays. Peu revinrent.
Ce fut l’un des sièges les plus sanglants de la guerre, comparable, du point de vue du nombre de morts, aux sièges de Berlin et de Stalingrad.
Commémoration du « Jour de l’honneur »
Chaque année, des nationalistes se réunissent dans la capitale hongroise pour commémorer le « Tag der Ehre », « le jour de l’honneur » ou « jour de la rupture du siège », en hommage aux forces allemandes et hongroises (Wehrmacht, SS, Honved – Armée territoriale royale hongroise, et les volontaires des Croix fléchées de Ferenc Szálasi), derniers défenseurs de Budapest, qui ont tenu tête jusqu’au bout à l’Armée rouge en 1945 durant plus de deux mois.

Pour aller plus loin :
15 mars 1935 : fondation du Parti des Croix fléchées en Hongrie
12 mars 1946 : assassinat de Ferenc Szálasi par l’occupant soviétique en Hongrie




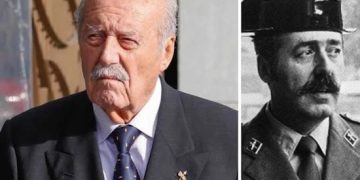





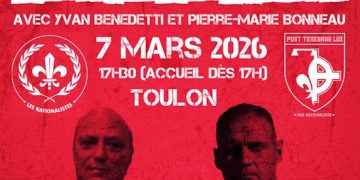


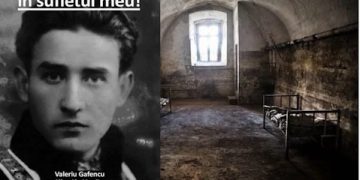


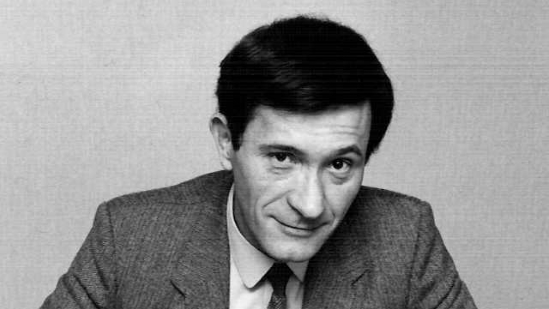
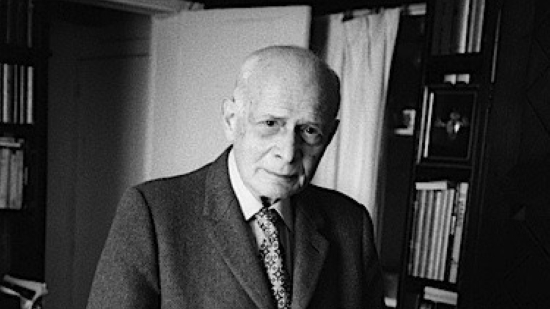


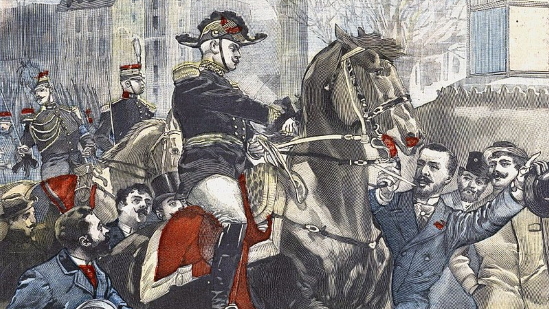






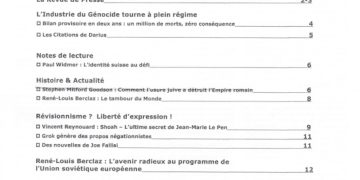
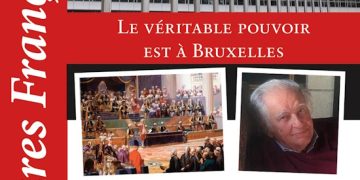

 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV





