30 décembre 2006 : la pendaison de Saddam Hussein consacre les États-Unis comme la puissance du mensonge, du chaos et de la mort
Saddam Hussein Abd al-Majid al-Tikriti, communément appelé Saddam Hussein, est un homme d’État irakien, présumément né le 28 avril 1937 à Al-Awja, près de Tikrit, président de la République de 1979 à 2003. Il fût un inlassable militant du parti Baas, de la Renaissance arabe, qu’il porta au pouvoir.
Ayant fait de son pays une puissance régionale moderne, il apporta son soutien à la création d’un État palestinien sur la totalité du territoire de la Palestine historique et à la lutte menée par les Palestiniens pour parvenir à cet objectif.
Il défendit également, notamment au Liban, les minorités chrétiennes, avec l’aide de son ministre chrétien des Affaires étrangères et proche conseiller, Tarek Aziz.

Il tenta de récupérer la 19e province irakienne, débouché indispensable vers le golfe arabo-persique, en envahissant l’état artificiel du Koweït.
Lorsque le 4 août 1990 l’armée de Saddam Hussein franchit la frontière, les États-Unis sonnaient le clairon. Washington dépêchait un demi-million d’hommes en Arabie saoudite pour l’opération Tempête du désert en janvier 1991. Les troupes irakiennes étaient défaites en un peu plus d’un mois.
Toutefois, l’Irak parvint à bombarder l’État d’Israël à l’aide de missiles « Scud B » (Al Hussein) modifiés par les ingénieurs locaux.
1991-2003 : un demi-million d’Irakiens périssaient sous le poids des sanctions
S’ensuivait la mise en place d’un véritable embargo économique sur tout le pays. Le Pentagone et Londres décidaient de surcroît de bombarder l’Irak en 1998, détruisant les principales infrastructures du pays. Routes, ponts, centrales d’électricité, d’eau, tout y passait.
Par l’intermédiaire de la CIA, Washington créait également le média de propagande Radio Free Iraq pour promouvoir ses valeurs dites démocratiques. Malgré le plan international, proposant de la nourriture contre du pétrole, l’imposition des sanctions s’était avérée une catastrophe humanitaire pour l’Irak. Dans la décennie 90, plus de 500 000 Irakiens mouraient. Ce qui n’a pas empêché Madeleine Albright, alors représentante des États-Unis à l’Onu, d’affirmer, lors d’un entretien télévisé, que le jeu en valait la chandelle.
Mais comme si ce n’était pas assez pour Bagdad, Washington affirmait sans preuve que Saddam Hussein entretenait des liens avec la mouvance djihadiste d’Al-Qaïda, impliquée dans les attentats du 11 septembre. Pour les États-Unis, il fallait trouver un prétexte pour chasser le président irakien.

Dès l’été 2002, Dick Cheney, le vice-président américain, déclarait qu’il « n’y a pas de doute » que Saddam Hussein, ait « des armes de destruction massive ». Mais le 5 février 2003, devant le conseil de sécurité des Nations unies, le secrétaire d’État américain Colin Powell alla encore plus loin dans le mensonge. Brandissant, une fiole d’anthrax, il assurait qu’il n’y avait « aucun doute que Saddam Hussein a des armes biologiques et la capacité d’en produire rapidement davantage ».
Une information qui s’est révélée plus tard fausse : le rapport des services de renseignements américains déclassifié en 2015 démontrait que rien n’indiquait que Bagdad avait eu des armes de destruction massive.
2003 : la traque et un prétendu « jugement » de Saddam Hussein
Malgré ce mensonge à la face du monde, les États-Unis débarquaient en mars 2003 en Irak avec ses alliés britanniques et australiens. Et ce, sans l’aval du Conseil de sécurité de l’Onu. La France, la Russie et la Chine s’y étant opposées. La débâcle de l’armée irakienne était totale. Mais pour les Américains, il fallait à tout prix mettre la main sur Saddam Hussein en cavale. Une récompense de 25 millions de dollars était promise à quiconque pouvait fournir toute information sur l’endroit où se cachait le Président de l’Irak.
L’un des traducteurs irakiens ayant travaillé pour les Américains revient sur la traque de Saddam Hussein : « Environ huit mois après avoir commencé à travailler avec eux, nous avons reçu des informations, bien sûr top secrètes, dont personne n’était au courant, sur l’endroit où se cachait Saddam Hussein dans le district d’Ad-Dawr dans la province de Salah ad-Din. C’était dans une ferme, littéralement à quelques mètres du fleuve Tigre ». Mais malheureusement pour les mouchards irakiens, ils n’ont jamais vu un centime des 25 millions de dollars.

Saddam Hussein réussit à se maintenir plusieurs mois dans la clandestinité, avant d’être capturé en décembre 2003. « Mesdames et Messieurs, nous l’avons eu ! Le tyran est prisonnier », c’est en ces termes que Paul Bremmer, l’administrateur en chef américain en Irak, annonçait la capture de Saddam Hussein le 13 décembre 2003.
C’est alors que commençait son procès à partir de juillet 2004. Certains Irakiens voulaient qu’il soit jugé par la justice américaine, d’autres – par la Cour internationale, mais c’est finalement la justice irakienne qui s’en chargeait. Les premières accusations portaient essentiellement sur les crimes de guerre commis par Saddam Hussein dans les années 80 envers les populations kurdes et chiites. Mais ce procès était un véritable casse-tête car Saddam Hussein défendit sans relâche à la barre son travail et sa patrie.
Entre les pressions des anciens du parti Baas en faveur de l’accusé, les intimidations du camp adverse, l’assassinat de trois avocats de la défense, la démission d’un juge, le verdict final était rendu avant même la fin de la procédure d’appel. Peu de temps après, Rauf Rashid Abd al-Rahman, juge qui condamnait à mort l’ancien Président irakien, demandait l’asile au Royaume-Uni.
2006 : l’assassinat de Saddam Hussein
Le 30 décembre 2006, les mains dans le dos, les chevilles liées, Saddam Hussein fait preuve d’un calme et d’un courage exemplaires devant la potence. Il prie et demande qu’on remette son Coran à sa famille, chose qui sera faite. Le bourreau s’avance et lui dépose un linge autour du cou pour atténuer la douleur du choc. La trappe s’ouvre, l’ancien Président irakien meurt instantanément quelques heures avant le début de l’Aïd, fête musulmane. C’est ainsi que l’homme fort qui régna sur l’Irak depuis 1979 mourut.

De A à Z, l’exécution de Saddam Hussein était une farce. L’Irak post-Hussein a vu le chaos s’installer et Daech émerger et prospérer.
Quelques années plus tard, les mêmes causes produisant les mêmes effets, l’assassinat de Kadafi, au cours d’une opération militaire lancée par la France sarköziste ralliée à l’hégémon yankee, entraîna chaos sécuritaire au Sahel (favorisant l’émergence d’Aqmi) et le chaos migratoire en Méditerranée (avec son flot d’envahisseurs prêts à tout pour venir coloniser notre Europe).
Sans oublier la contribution de la folle tentative occidentale de reproduire le scénario en Syrie contre Bachar el-Assad donnant un tremplin à Daech pour ses activités terroristes jusque chez nous et poussant d’autres foules d’envahisseurs vers notre continent.
Errare humanum est. Perseverare diabolicum.


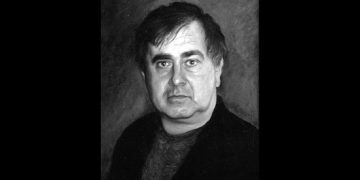



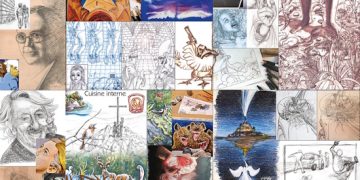




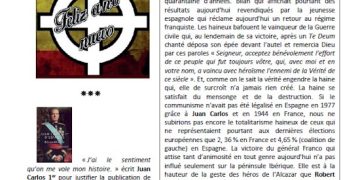

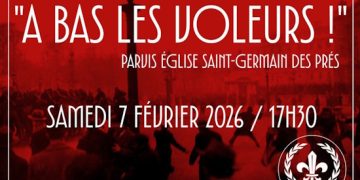










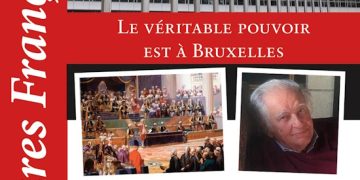

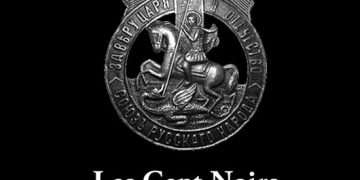


 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV
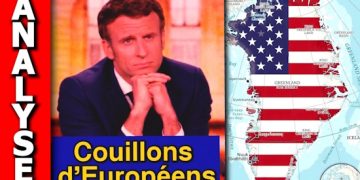

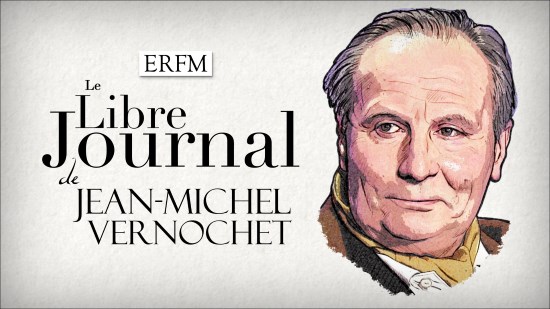
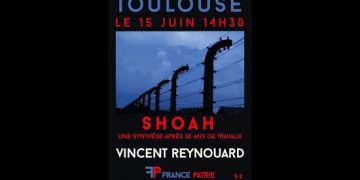



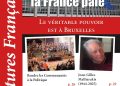


Les « crimes » de Saddam et du Colonel Kadafi, pour rendre caduc les sanctions: se dédollariser et adosser leurs monnaies à l’or, leurs réserves d’or furent d’ailleurs pillées, ils échouèrent mais les pays des BRICS sont en train de réussir.
Gloire éternelle au Raïs de Bagdad, authentique expression du fascisme arabe, qui a mené une véritable révolution sur les infrastructures de son pays, pour le convertir en cinquième puissance régionale, après avoir modernisé l’État irakien, extirpé l’analphabétisme, inauguré des réformes agraires et industrielles innovantes par une juste redistribution des ressources, unifié les tribus ethno-confessionnelles, transcendé le sectarisme, et placé sous son aile le christianisme contre les assauts perfides de l’hydre islamiste aussi bien que sioniste. Les idéaux qui ont mu jadis les forces de l’Axe étaient tenus par Saddam comme la panacée doctrinale pour répondre aux défis auxquels étaient restreints sa patrie sur un socle panarabiste. Le Baath irakien s’efforçait volontiers de se poser en troisième voie au Proche-Orient face à la prédation capitaliste et à la tentation communiste.
En effet, les sorts funestes de Saddam Hussein puis de Mouammar Kadafi ont été voulus et orchestrés par les mêmes mauvais génies occidentaux dont on retrouve les successeurs donnant aujourd’hui blanc seing aux bourreaux des Palestiniens et de tous ceux s’opposant au grand Israël.
Fieffés menteurs, êtres sans foi ni loi hormis la leur, ne reculant devant aucune bassesse, ils sont l’incarnation du Mal dans toute sa puissance ! Qui en viendra à bout ?