8 mai 1945 : La capitulation allemande ouvre la voie au dernier secret de Yalta : un crime de guerre des Alliés
Article écrit et publié dans un ancien numéro des Écrits de Paris, sous le titre : « Le dernier secret de Yalta : Un crime de guerre des Alliés ». L’auteur revient sur les centaines de milliers d’Européens qui s’étaient placés sous la protection des « Alliés », que ces derniers livrèrent sans scrupule à Staline, pour la plupart à une mort certaine.
Le dernier secret de Yalta. Un crime de guerre des Alliés
Au cours de la dernière guerre, Winston Churchill a commis quelques fautes magistrales : le bombardement, totalement injustifié de la flotte française à Mers el-Kébir où 1 500 marins français trouvèrent la mort ; le bombardement de Dresde, ville ouverte, où 300 000 civils innocents furent exterminés ; le bombardement de Hiroshima et de Nagazaki auquel acquiesça le chef du gouvernement britannique ; son refus de dire la vérité sur les massacres des officiers polonais à Katyn et Starobielsk par les Soviétiques, de peur d’offenser « l’oncle Joe » (suppressio veri doublée d’une suggestio falsi puisqu’il laissait accuser les Allemands de ce crime). Il faut mettre enfin au passif de Winston Churchill et d’Anthony Eden – Lord Avon – un autre épisode particulièrement honteux : la livraison aux Soviétiques de deux millions de Russes qui avaient tenté d’échapper à la tyrannie communiste. Churchill et Eden ne doutaient pas qu’ils envoyaient à la mort – une mort atroce – ces malheureux et pourtant, invoquant la raison d’État, ils conclurent à Yalta un ignoble marchandage et donnèrent l’ordre fatal. Lord Bethell, dans un livre courageux, Le Dernier Secret, expose en détail comment Anglais et Américains remirent à Staline des millions d’hommes. De même, ils livrèrent à Tito des dizaines de milliers de Croates et de « tchetniks » du général Mihailovitch, qui furent impitoyablement massacrés.
Lord Bethell a eu accès aux archives du Foreign Office et du War Office à Londres et aux « National Archives » de New York. Il a interrogé des survivants des rapatriements forcés, des diplomates et des officiers qui participèrent à ces sanglantes opérations. Son livre constitue un hallucinant réquisitoire contre la barbarie d’une époque où les adversaires rivalisèrent de cruauté. À la « guerre en dentelles » d’un siècle aimable et civilisé (où les généraux, à la veille des combats, échangeaient galamment les actrices de leur théâtre aux armées) ont succédé des guerres d’extermination, des guerres « zoologiques » – selon le mot de Renan – fruit hideux de la Démocratie… Velasquez, dans son tableau fameux les Lanciers, montre le vainqueur de Bréda recevant courtoisement le général vaincu ! Les temps ont changé !
Alexandre Soljénitsyne, dans L’Archipel du Goulag fut le premier à révéler comment Churchill et Roosevelt, par une clause secrète des accords de Yalta, consentirent lâchement à livrer aux Soviets deux millions de Russes qui, en 1945, se trouvaient en Allemagne de l’Ouest au pouvoir des armées anglaises et américaines auxquelles ils s’étaient rendus. En deux mois, les Alliés livrèrent aux Soviétiques 1 398 902 personnes et les opérations allaient durer de longs mois. Il s’agissait des unités russes passées, sous le commandement du général Vlassov, dans l’armée allemande, des divisions cosaques des « atamans » Naoumenko, Krasnov, Chkouro, de la Division Caucasienne du Sultan Klych Girey, du XVe Corps de cavalerie cosaque commandé par le général allemand Helmut von Pannwitz, toutes troupes qui n’avaient pas combattu l’Angleterre et les États-Unis, mais seulement les Soviets. Il y avait encore, par dizaines de milliers, des prisonniers de guerre, des réfugiés, des personnes déplacées, des anciens émigrés, des Croates, des Polonais des marches annexées par les Soviets, etc.
Soljénitsyne qui, déporté en Sibérie, y connut les survivants de ces déportations, n’a pas été tendre pour Churchill et Roosevelt : « Considérés dans leur pays comme des modèles de sagesse politique, dans nos discussions entre prisonniers, leur myopie systématique, leur bêtise nous semblaient manifestes ». « Churchill, écrit-il encore, livra, en Autriche, au commandement soviétique 90 000 cosaques, ainsi que de nombreux convois de vieillards, de femmes et d’enfants qui, pour rien au monde, ne voulaient rentrer en Russie. La manière dont ces gens ont été livrés avait le caractère perfide de la diplomatie britannique traditionnelle ». Les cosaques préféraient se battre jusqu’à la mort, ou partir n’importe où – au Paraguay, en Indochine – plutôt que de se rendre vivants. Aussi les Anglais leur proposèrent-ils d’abord de déposer leurs armes sous couleur de les rassembler, puis les officiers furent convoqués seuls, sans leurs soldats et sous prétexte de discuter de l’avenir de leurs unités avec le commandement anglais, dans la vallée de Judenburg non loin de Vienne, en zone britannique d’occupation. Quarante autobus remplis d’officiers – depuis les commandants de compagnie jusqu’au général Krasnov, franchirent un viaduc élevé puis arrivèrent à un endroit où se tenait l’escorte, listes nominatives en mains. Des chars soviétiques barraient la route. Toutes les armes avaient été confisquées. Il était donc impossible de se défendre ou de se suicider. Pourtant, des officiers réussirent à se jeter du haut du viaduc. Puis les officiers anglais livrèrent les soldats en usant de la même ruse et en leur laissant croire qu’on les envoyait rejoindre leurs chefs…
« Churchill et Roosevelt, s’indigne Soljénitsyne, n’avaient pas su assurer une garantie d’indépendance à l’Europe de l’Est. Comment avaient-ils pu, en échange du joujou dérisoire que constituait Berlin (divisé en quatre zones), abandonner la Pologne, la Saxe, la Thuringe ? Et quelle raison, d’ordre militaire ou politique, pouvait justifier la livraison à Staline de millions d’êtres qui ne voulaient se rendre à aucun prix ? On a dit qu’ils payaient à Staline sa participation – tardive – à la guerre contre le Japon. En fait, alors que les Alliés possédaient l’arme atomique, ils payèrent le prix du sang à Staline pour qu’il ne refuse pas d’occuper la Mandchourie ; de renforcer la position de Mao et de Kim Il-soung sur la moitié de la Corée… Marché de dupes et calculs déshonorants. »

Voilà qui traduit l’indigence politique d’un Roosevelt physiquement et mentalement diminué, circonvenu par des conseillers traîtres comme Alger Hiss et Hopkins, et d’un Churchill, qui, au dire de son médecin Lord Moran, était déjà profondément éthylique…
« Plus tard, lorsque l’on écarta Micolajczyk et que la Pologne fut abandonnée aux communistes, lorsque Masaryk fut “suicidé” à Prague, que fut établi le blocus de Berlin, que Budapest fut livré aux flammes et la Corée mise à feu et à sang, que le gouvernement conservateur anglais décampa de Suez, comment ceux des Anglais qui avaient la mémoire moins courte ne se sont-ils pas rappelé la honteuse histoire des Cosaques livrés à Staline ? » interroge Soljénitsyne,
Mais, à Yalta, Churchill, dans un étrange délire de capitulation n’avait-il pas offert gratuitement à Staline un déshonorant partage de l’Europe, abandonnant au communisme la Pologne, la Bohème, la Yougoslavie ?
Dans le Dernier Secret, et en termes plus mesurés que ceux dont s’est servi Soljénitsyne mais dont la sobriété accusatrice n’en est pas moins terrible, Lord Bethell a tenté d’expliquer (sans le justifier) le comportement de Churchill et de Eden. Il rappelle l’état d’esprit courant à cette époque en Angleterre où l’opinion publique avait été chauffée à blanc par une propagande absurde en faveur de l’« oncle Joe », célébrant l’héroïsme de l’armée rouge et fomentant une haine aveugle contre les Allemands, l’espoir naïf que les accords de Yalta perpétueraient l’alliance avec la Russie en temps de paix. Il y a quelques années, à Londres, le maréchal Montgomery, auquel je demandai, au cours d’un déjeuner, pourquoi le gouvernement britannique n’avait pas décidé à temps – une fois la capacité offensive de l’Allemagne brisée en 1943 – de renverser sa politique à l’égard des Soviets devenus menaçants, me répondit que, malheureusement, en régime démocratique, pareil virage est impossible à prendre vu l’incapacité de modifier l’opinion des masses…
Pour calmer leurs scrupules de conscience – qui, d’ailleurs, n’étouffèrent jamais Winston Churchill – les dirigeants britanniques se persuadèrent que les Soviétiques ne relâcheraient pas les prisonniers alliés détenus dans les camps en Allemagne occupée par l’armée rouge, si, de leur côté, Anglais et Américains ne leur livraient pas les Russes qui s’étaient rendus à eux. Le Foreign Office fut particulièrement implacable, notamment le chef de la section russe, Christopher Warner et ses adjoints John Galsworthy et Patrick Dean. Brimelow et Cadogan furent plus humains. Churchill lui-même semble avoir eu un moment quelques hésitations, et avait songé tout au moins à faire traîner les choses en longueur. En effet, le 17 juillet 1944, le cabinet de guerre britannique avait entériné le principe selon lequel il fallait remettre les prisonniers de guerre à l’URSS. Mais Lord Selborne, ministre de l’Économie de guerre, fit part de sa répugnance à Anthony Eden : « L’idée d’envoyer par milliers des hommes à la mort, que ce soit directement au poteau d’exécution ou en Sibérie, ne peut que soulever le cœur de tout Anglais. » À cela, cet honnête homme, Eden, répondit froidement : « Si ces hommes ne retournent pas en Russie, où iront-ils ? Nous n’en voulons pas ici. »

Le secrétaire d’État à la Guerre, Sir Edward Grigg, que j’ai bien connu alors, trouvait, lui aussi, « la chose assez révoltante ». Il finit pourtant pas adopter la thèse d’Eden : « S’il faut choisir entre les souffrances qui menacent nos propres prisonniers et la mort certaine promise aux soldats russes, nos prisonniers, il n’y a pas à hésiter. » Égoïsme sacré ! Pourtant il était clair que les soldats alliés détenus par les Russes ne risquaient pas la mort.
Bien des militaires n’exécutèrent ces ordres cruels qu’avec la plus grande répugnance. Le maréchal Alexander qui, en 1919, avait servi dans les pays baltes contre l’armée rouge, aux côtés d’officiers russes qu’il détenait maintenant prisonniers (comme l’ataman Krasnov, le célèbre ataman Chkouro, héros de l’armée blanche de 1919 et commandeur de l’Ordre du Bain, ou le non moins célèbre ataman Naoumenko, ancien major général des armées blanches) résista tant qu’il put aux décisions iniques de Londres, les déclarant « tout à fait contraires aux principes de la justice ». De même, au reçu de l’ordre fatal en mai 45, le général Sir Horatius Murray (qui commandait à l’époque la VIe division blindée dans le secteur Villach-Klagenfurt), convoqua les officiers cosaques et leur annonça qu’il n’appliquerait pas immédiatement ses consignes. C’était inciter ces hommes à s’échapper, ce qu’ils firent presque tous. En revanche, des généraux comme Geoffrey Musson et Keightley, obéirent comme le colonel Malcolm (des Highlanders d’Argyll), sans hésitation, sous prétexte qu’il fallait respecter les accords de Yalta !
Le 22 mai, au château d’Eberstein, en Autriche, non loin de Klagenfurt, le général allemand Helmut von Pannwitz, qui commandait la division cosaque (c’était un Allemand d’origine balte, parlant russe et très populaire dans la troupe) fut appelé à conférer avec les officiers anglais. Il devait être livré aux Rouges et exécuté (bien que, officier allemand, l’accord de Yalta ne lui fût pas applicable). Il fut pendu le 17 janvier 1947 en même temps que les atamans Chkouro, Piotr Krasnov, le Prince-Sultan Kych Girey, commandant en chef de la Division caucasienne et le général Domanov. Le général Vlassov et ses officiers avaient été exécutés un an auparavant, le 2 août 1946.

L’ataman Naoumenko (chef illustre des Cosaques du Kouban) qui réussit à s’échapper, a stigmatisé, dans un livre vengeur (Vyelikoyé predateltsvo, la Grande Trahison), le comportement du gouvernement britannique :
« Le recours à la traîtrise avait permis, écrit-il, de livrer le corps de cavalerie cosaque à l’armée rouge. Les officiers anglais avaient bercé de mensonges le général von Pannwitz… les officiers cosaques, élevés dans les nobles traditions de l’armée impériale, ne pouvaient imaginer une telle duplicité. Pour les officiers russes, la parole d’un autre officier valait de l’or. Jamais ils n’auraient imaginé que les officiers anglais fissent une chose pareille. »
Nicolas Krasnov, fils de l’ataman exécuté par les Rouges qui, lui, réussit à survivre à des années de Sibérie, a déclaré : « Nul d’entre nous n’imaginait que le haut commandement britannique puisse être capable d’une telle noirceur. »
L’ataman Krasnov, lorsqu’il comprit que ses hommes allaient être livrés, rédigea, à l’intention des autorités anglaises et internationales (le roi George VI, Churchill, l’archevêque de Cantorbery, la Croix-Rouge et l’ONU), un document émouvant expliquant que les Cosaques n’avaient jamais combattu l’Angleterre et les États-Unis, mais seulement le régime communiste. Ce document apparemment ne fut jamais transmis à ses destinataires. Le 16 mai 1945, non loin de Klagenfurt, furent livrés aux Rouges 22 000 cosaques, 4 193 femmes et 2 436 enfants et, non loin de là, les 19 792 hommes du XVe corps de cavalerie de Pannwitz subirent le même sort.
Dans le cas des Cosaques et des Caucasiens qui servaient avec les troupes croates contre les partisans communistes de Tito, il n’y avait, pour le gouvernement britannique, nulle obligation de les livrer à ce dernier puisque les accords de Yalta ne les visaient pas. Il y avait, dans le secteur occupé en Autriche par les Anglais, 50 000 Cosaques et 25 000 Croates. Ils furent livrés sans pitié. Des scènes atroces se produisirent lorsque les prisonniers, trop confiants dans la parole des officiers anglais et ayant rendu leurs armes, s’aperçurent qu’ils étaient trahis.
Ainsi, à Bleiburg, on vit de longues files de prisonniers, les bras liés derrière le dos avec des fils de fer, poignardés et abattus sur place s’ils ne pouvaient suivre les convois. Certains officiers anglais (comme à Peyffelz) sauvèrent la vie de quelques-uns. Le lieutenant John Greigh, du 46e régiment de reconnaissance à Neumark, dit la vérité aux Cosaques et les invita à se sauver dans les bois. « Nous étions effondrés à la suite des ordres reçus. Nos hommes qui étaient pourtant des durs, vétérans des combats d’Afrique, ne pouvaient supporter l’idée de voir ces Cosaques assassinés de sang froid. C’était trop fort pour eux. » Mais à Judenburg, à Lienz, dans la vallée de la Drave, des scènes épouvantables se produisirent. Quatre mille femmes (la plupart enceintes), 2 500 enfants furent enfournés de force dans les wagons et livrés aux Rouges. Les soldats anglais, à coups de manches de pioche ou de pelles et de crosses de fusils, forcèrent les hommes à s’embarquer. L’aumônier des Highlanders, Kenneth Tyson, indigné, eut beau condamner cette « mauvaise action » en rappelant que « les prisonniers avaient droit à un traitement correct de la part de l’armée anglaise qui avait accepté leur reddition », rien n’y fit. Le major Davies, du même régiment, a écrit depuis lors « qu’on ne peut penser sans horreur à ces événements », et rapporté qu’un officier cosaque, plutôt que d’être livré aux Rouges, tua de sa main sa femme et ses trois enfants avant de se suicider. À Spittal, des hommes se suicidèrent en masse en s’étranglant avec des fils de fer ou en s’égorgeant avec des morceaux de verre ! À Dachau, le 19 janvier 1946, des scènes d’horreur semblables se produisirent. Il en fut de même à Plattling, à Peggetz (où, se voyant perdus, les Cosaques s’assemblèrent autour de leurs popes brandissant des icônes et entonnant avec ferveur des hymnes religieux en criant « Seigneur, sauve ton peuple… ») Ou encore, à Lienz, où on vit des hommes et des femmes se jeter dans la Drave. Une jeune femme accompagnée de ses deux petits enfants les embrassa frénétiquement, puis jeta le plus petit dans l’abîme, tandis que le plus âgé, s’accrochant en pleurant à elle, la suppliait : « Maman, j’ai peur. – N’aie pas peur, je viens avec toi » répliqua-t-elle en se jetant avec lui dans le fleuve en criant : « Seigneur, aie pitié de ma pauvre âme pécheresse ! »
Les soldats anglais, témoins de ces scènes atroces, étaient épouvantés et au bord de la mutinerie. Pourtant ils durent obéir aux ordres. À Lienz, selon le général Naoumenka, « les soldats anglais frappaient les Cosaques à la tête à coups de gourdin, le sang coulait, les hommes perdaient conscience. Les soldats les ramassaient et les jetaient dans les camions. Arrivés à la ligne du chemin de fer, on les lançait dans les wagons de marchandises. »
Le colonel Malcolm, des Highlanders, expliqua que « ayant trahi leur pays, il fallait que les Cosaques paient le prix de leur trahison ». Mais un officier de liaison répliqua à un autre, qui traitait ces hommes de traîtres : « Pas plus traîtres que ne le furent Washington et Benjamin Franklin… »
Le caporal Smith, sous les ordres du major Burns, à Lienz, se souvient de « vieillards apeurés et désespérés et d’enfants en pleurs, ainsi que de deux ou trois vieux à barbe blanche qui avaient reçu des coups de crosse et étaient en sang. Les vieilles gens ne cessaient de dire leurs prières. Des enfants séparés de leurs parents, trop commotionnés, ne pouvaient ni pleurer ni prier. J’étais écœuré de voir cela. » Mais le général Musson exigea la poursuite des opérations. Le 1er juin 1945, les Anglais acheminèrent encore un nouveau convoi de 1 858 Cosaques, le 3 juin un autre de 1 467. Le capitaine Baker, qui assistait à la remise des prisonniers aux Soviétiques au pont de Judenberg, raconte que, dans chaque train, il y avait pas mal de suicidés : « La plupart se tuaient au moyen d’une écharpe ou s’égorgeaient avec du fil de fer barbelé. »
Par excès de zèle, les autorités britanniques avaient même violé les accords de Yalta qui ne s’appliquaient pas aux détenteurs de passeports Nansen et aux anciens émigrés des années 1920, qui n’avaient pas la nationalité soviétique. C’était le cas des atamans Chkouro, Krasnov, Naoumenko, etc. En outre, Londres n’avait pas respecté les principes fondamentaux du droit britannique (le droit d’asile, celui de tout accusé d’être jugé régulièrement et la présomption d’innocence de tout individu inculpé). On avait, d’ailleurs, délibérément oublié que Prague avait été libéré le 5 mai 1945 non par les Alliés, mais par les 22 000 soldats russes anti-soviétiques du général Bouniatchenko ! On ne leur en sut aucun gré.
Non seulement, écrivait récemment The Economist, « on peut reprocher aux dirigeants britanniques (Churchill et Eden) la brutalité de leur attitude, mais aussi leur duplicité et leur hypocrisie car ils dissimulèrent sciemment au Parlement et à la presse la situation véritable. »
Le 5 mars 1946, dans son fameux discours de Fulton, Churchill dénonça enfin le « rideau de fer et les méfaits du régime soviétique ». Il reconnut (trop tard) son erreur et il avoue même la faute commise en n’épargnant pas l’Allemagne et en ne s’opposant pas aux Soviets qu’il eût fallu traiter non en alliés, mais en simples « co-belligérants » temporaires : « Nous avons tué le mauvais cochon » (We have killed the wrong pig ). Remords inutiles et tardifs.
M. Stimson, qui fut secrétaire d’État US, avait, dès janvier 1945, compris l’ignominie commise à l’égard des malheureux Russes anti-communistes : « Avant de livrer aux Soviets quelqu’un, nous devrions nous assurer, écrivait-il, que nous ne l’envoyons pas au poteau d’exécution ou en prison. » Mais le général Eisenhower déclarait, au contraire, le 12 janvier, « que le rapatriement des prisonniers russes devait se faire au plus vite ». Il devait pourtant, quelques mois plus tard, s’opposer lui aussi au rapatriement forcé. Mais l’opinion américaine écrivait alors : « Le suicide des traîtres russes est une boucherie », sans s’émouvoir davantage.
En vain, le 20 février 1946, le pape Pie XII rendit publique une déclaration dans laquelle il s’élevait hautement contre le rapatriement, contre leur gré, des prisonniers et le refus d’accorder le droit d’asile à ces malheureux Russes. Des représentants du Vaticanconfièrent à des représentants américains que « la politique de Yalta était une trahison des principes moraux et des idéaux pour lesquels les Alliés prétendaient s’être battus, car elle violait toute idée de justice et d’humanité ».
Le 24 février 1946, 1 590 prisonniers russes furent encore livrés aux Soviétiques à Schœnberg, au nord de Munich. Le 6 juin, les Britanniques livrent les prisonniers russes, croates et les tchetniks encore détenus dans les camps d’Aversa et de Bagnoli, en Italie. Ce fut l’opération « Vent d’Est » et l’opération « Grand Saut », ainsi baptisées avec un humour macabre par le personnage qui avait ordonné cette ignoble affaire. Le 8 mai, le premier train de déportés quitta Riccione au milieu de scènes d’horreur semblables aux précédentes.
En mai 1947, cependant, des informations avaient commencé à filtrer en Angleterre, dans le Manchester Guardian notamment. Richard Stokes, aux Communes, interpella le gouvernement. Déjà, le 5 mai 1945, il avait demandé (sans succès) « si les accords de Yalta ne comportaient pas de clauses secrètes. » Churchill, sans rougir, n’hésita pas à mentir. Il affirma impudemment « qu’il n’y avait pas de clauses secrètes ».
Mon courageux ami, Frédéric Voigt (hélas disparu), dirigeait le Nineteenth Century et était l’auteur de ce terrible réquisitoire contre la politique aveugle de Churchill, Pax Britannica. Il avait lui aussi dénoncé les fautes commises. Le 11 juin 1947, Richard Stokes, appuyé cette fois par un autre député, Godfrey Nicolson, revint à la charge et protesta contre les déportations forcées, « acte contraire à la tradition britannique ». Ernest Bevin, qui avait succédé à Anthony Eden à la tête du Foreign Office, répliqua que, « aux termes des accords de Yalta, le devoir du gouvernement britannique était tout à fait clair ».
Le rapatriement par mer d’Angleterre à Odessa donna lieu aussi à des incidents affreux. Ainsi, le 18 avril 1945, alors que commençaient à Odessa les opérations de débarquement du cargo « Almanzora », les officiers anglais entendirent des rafales de mitraillettes provenant d’un hangar sur le quai. Les Rouges venaient de fusiller des « prisonniers vendus aux capitalistes ». Même scènes sanglantes lors du voyage de l’« Empire Pride » (Gloire de l’Empire !…) qui avait appareillé de Liverpool le 31 mai avec 3 000 prisonniers, dont plusieurs se suicidèrent, et dont trente furent abattus dès leur arrivée. Le commandant du bord refusa longtemps de réembarquer les officiers soviétiques de la mission de liaison et les officiers anglais refusèrent de leur adresser la parole lors du voyage de retour.
Trop tard Anglais et Américains devaient s’apercevoir de leurs fautes. Le 12 mars 1947, devant la menace d’un putsch communiste en Grèce, Harry Truman déclara que, « désormais, la politique américaine consisterait à prêter assistance aux peuples libres ». La « Grande Alliance » avait vécu. La guerre froide commençait. Mais les pays occidentaux n’eurent pas la force de refouler les Soviets hors d’Europe.
Le général William Morgan, honnête soldat qui avait été le chef d’état-major du maréchal Alexander et avait été témoin des opérations de rapatriement forcé, devait écrire plus tard : « Il n’y a plus rien à faire aujourd’hui pour venir en aide à ces pauvres malheureux. Mais qu’au moins leur sort nous serve de leçon. »
En mai 1952, alors que la guerre de Corée tirait à sa fin, les communistes insistèrent pour que les alliés leur livrent tous les prisonniers chinois et coréens sans exception. Le Times écrivit alors : « Malgré ce qui a été fait en 1945-46, forcer un homme à retourner contre son gré dans tel ou tel pays heurte tout sentiment libéral et chrétien » Eden lui-même, le 7 mai 1952, acquiesça : « Il serait, avoua-t-il, contraire absolument aux valeurs du monde libre de renvoyer ces hommes chez eux. »
Que n’eut-il ce scrupule à l’égard des Russes et des Croates anticommunistes ! Churchill et lui-même auraient dû se souvenir de l’adage de Démosthène : « Les alliances avec les despotes ne sont jamais sans danger pour les pays libres. »
En 1939, l’Angleterre était entrée en guerre sous prétexte de sauvegarder le respect des traités et du Droit international. En 1945, elle avait fini par faire bon marché de ces beaux principes. Inter arma silent leges…
Il n’en reste pas moins que Churchill et Eden se sont, devant l’Histoire, rendus coupables du crime de complicité de génocide. En bonne justice, comme l’a dit le général Naoumenko, ils auraient dû être considérés comme des criminels de guerre. Mais, à notre époque cruelle, le coupable et l’agresseur c’est le vaincu.
Raymond Lacoste


























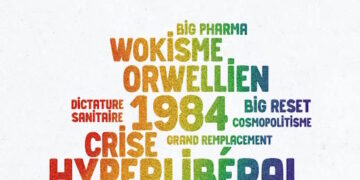

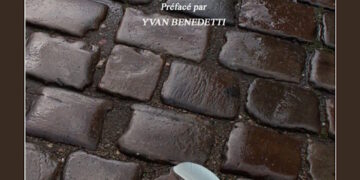
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV








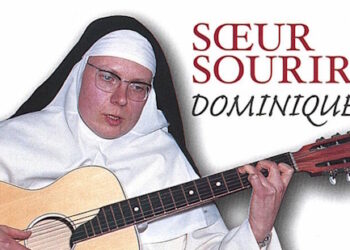
La grande leçon de cette terrible page d’histoire, c’est que les pertes humaines, les blessures, la mort qui fait sa moisson parmi les combattants, ne sont rien, en termes de souffrances et d’humiliation comparés à ce qui vous attend après la défaite ou la reddition !
Autant de raison, lorsqu’on a commencé le combat, de lutter jusqu’à l’extrême limite, laquelle ne peut être que la mort les armes à la main.
Mais mort au combat qui, cependant, fuit parfois celui qui la recherche. Ce qui lui donne une occasion de témoigner.
Et de témoigner notamment de la justesse de la dernière phrase de ce texte de Raymond Lacoste : » Le coupable et l’agresseur, c’est le vaincu ! »
Tant il est vrai que le premier droit que s’arroge le vainqueur est celui de mentir effrontément, notamment pour dissimuler sa lâcheté ou l’attribuer au vaincu !
Il semble même – il est évident ! – que, plus le vainqueur a torturé et plus il fera du vaincu un tortionnaire de même qu’il n’aura de cesse d’attribuer au vaincu sa propre lâcheté !
Ainsi en fut-il plus près de nous, en 1962 : Si mes camarades de l’OAS et moi-même avons supporté la tête haute les accusation de multiples meurtres parmi la racaille gaulliste et notamment les barbouzes extraites de prison pour nous combattre, que nous avons massacrées par centaines ; l’accusation de DESERTION, alors qu’au contraire nous avions été les seuls à continuer le combat par fidélité au sacrifice de nos camarades tombés avant nous contre le FLN…. Cette accusation-là, proférée par ceux-là mêmes qui les avaient trahis nous révoltait au plus haut point.
Condamnés pour désertion par un peuple de déserteurs… C’était trop !
A tel point que, lors de notre jugement, en 1963, nous avons sauté la barrière nous séparant du tribunal pour rosser les magistrats félons, que les gendarmes présents eurent tout le mal du monde à protéger, tandis que cette racaille s’enfuyait, en se bousculant, du tribunal.
Un spectacle de cette engeance apeurée qui valait bien quelques mois de prisons de plus…
Vous avez bien raison, l’inversion acusatoire de la part des vainqueurs à été systématique dans toutes les guerres. Surtout la 2eme guerre mondiale, plus proche de nous et ses canulars afférents. A tel point qu’on peut se demander quelle est la proportion de mensonge dans l’histoire passée, qui ne sera plus contesté ni corrigé.
Dans votre anecdote, bravo si vous avez pu rosser quelques membres de ce tribunal, une fois n’est pas coûtume et ils le méritent bien.
Lecture éprouvante devant tant d’ignominie et d’horreur mais remerciements au témoignage de Raymond Lacoste et reconnaissance au commentaire de Jean-Paul Le Perlier. Un homme digne d’honneur !