- Accueil
- Actualité
- Nationalisme
Trending Tags
- Culture
Trending Tags
- Édition
Trending Tags
- Nos évènements
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TVTrending Tags
- Boutique Jeune NationNouveau !
- Accueil
- Actualité
- Nationalisme
Trending Tags
- Culture
Trending Tags
- Édition
Trending Tags
- Nos évènements
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TVTrending Tags
- Boutique Jeune NationNouveau !
23 mars 1950 : Dépôt officiel du mouvement Jeune Nation
Le 22 octobre 1949, le mouvement Jeune Nation est présenté pour la première fois au siège du Souvenir napoléonien, rue du Cirque à Paris. François, Jacques et Pierre Sidos, déclarent Jeune Nation comme association loi 1901 le 23 mars 1950 à la Préfecture de police de Paris.
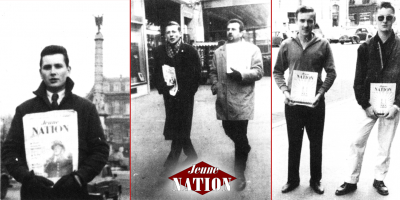 Jeune Nation monte en puissance à partir de 1954 et se transforme en véritable mouvement militant, l’événement déclencheur étant l’humiliation de Dien Bien Phu au mois de mai suivie de la capitulation en juillet de la même année du gouvernement Mendès.
Jeune Nation monte en puissance à partir de 1954 et se transforme en véritable mouvement militant, l’événement déclencheur étant l’humiliation de Dien Bien Phu au mois de mai suivie de la capitulation en juillet de la même année du gouvernement Mendès.
Jeune nation, qui recrute alors de nombreux étudiants, tient en novembre 1955 à Paris un congrès au cours duquel la croix celtique est adoptée comme emblème.
Le 7 novembre 1956, en protestation contre la sanglante répression soviétique en Hongrie, Jeune nation prend la tête d’une manifestation qui se lance à l’attaque du siège central parisien du Parti communiste, alors situé carrefour de Châteaudun (actuelle place Kossuth). Les assaillants réussissent à occuper et incendier une partie de l’immeuble (l’émeute fera trois morts chez les rouges). Le mouvement devient, pour toute la gauche, l’ennemi public n°1.
Jeune nation s’implante aussi parmi les Français d’Afrique du Nord, devient la composante la mieux structurée du mouvement pour l’Algérie française, participe aux événements du 13 mai 1958 qui sonnent le glas de la IVe République, mais n’accorde pas la moindre confiance au général de Gaulle pour résoudre la crise algérienne dans le sens des intérêts nationaux. En réponse, le gouvernement ordonne sa dissolution le 15 mai 1958. Les dirigeants vont s’ingénier à ignorer le plus longtemps possible cette interdiction, profitant de la vacance de légalité à laquelle donne lieu la transition entre IVe et Ve République.
Le mouvement se survit à travers le journal mensuel Jeune nation, qui milite pour la création du Parti nationaliste. Celui-ci est constitué à la date symbolique du 6 février 1959 avec Pierre Sidos pour président. Lors du congrès de constitution, Pierre Sidos lance un appel resté célèbre à la « séparation de la Synagogue et de l’État ». Ce Parti nationaliste est dissous en conseil des ministres sept jours plus tard.
Inculpés pour reconstitution de ligue dissoute, Pierre Sidos plonge dans la clandestinité début 1960. Nombre de leurs partisans vont faire de même l’année suivante pour rejoindre l’OAS. Mais celle-ci est dominée par des militaires qui se méfient des militants et n’accordent leur confiance qu’à des politiciens modérés, des « nationaux » qui sont autant de planches pourries, hier comme aujourd’hui…
Le journal Jeune nation est obligé de cesser sa parution en janvier 1960. Pierre Sidos, libéré en juin 1963, prend l’année suivante la présidence d’honneur du mouvement Occident. Il lance par la suite le journal Le Soleil en 1966 et L’Œuvre française en 1968.
Voir aussi :
15 mai 1958 : dissolution du mouvement Jeune Nation
Commentaires 2
Laisser un commentaire Annuler la réponse
Articles populaires
-
Islamo-gauchisme, judéo-gauchisme
1 partages -
L’affaire Epstein et la branche française expliquées par Xavier Poussard
1 partages -
Avec ou contre le judapo !?! Avec ou contre moi !?!
1 partages -
Rassemblement pour Quentin – Entrevue d’Yvan Benedetti
1 partages -
Rassemblement pour Quentin : Oui, Yvan Benedetti avait sa place à Lyon
1 partages -
Retour sur l’hommage à Quentin à Lyon
0 partages
Lettre d’information
Rubriques
- Actualité
- Actualité française
- Actualité internationale
- Actualité nationaliste
- Agenda
- Boutique
- Cercle Drumont
- Ciné – Musique
- CLAN
- Conférences
- Culture
- Documentaires
- Economie
- Édition
- Entretiens
- Fréquence JN
- Guerre d'Algérie
- Histoire
- Idées
- Immigration
- Jeune Nation TV
- Livres
- Nationalisme
- Nature et environnement
- Nos manifestations
- Notre actu
- Presse
- Religion
- Santé-Médecine
- Science et technologie
- Seconde Guerre mondiale
- Vidéos


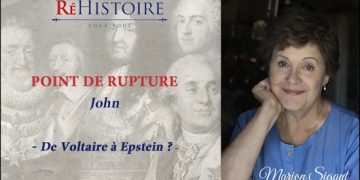



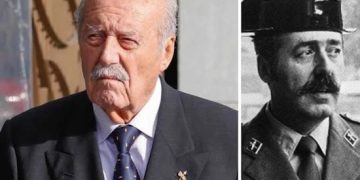





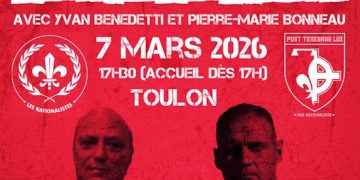



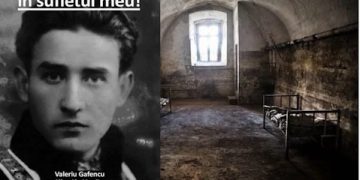



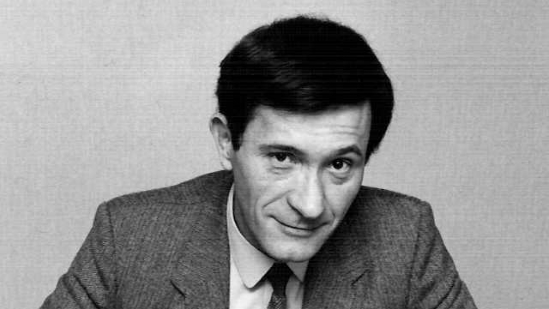
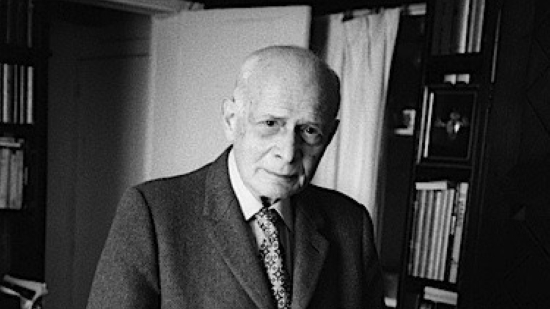







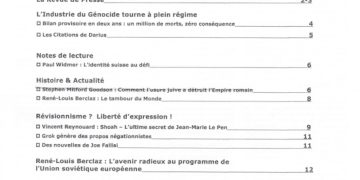
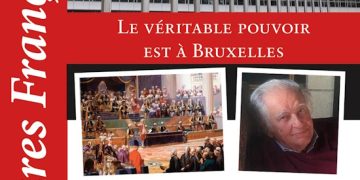






Le grand public, conditionné et tenu dans l’ignorance, retient les noms de politiciens rompus à l’art de la « communication » mais qui, pour la plupart, n’auront construit que leur « carrière » sans laisser d’empreinte dans l’histoire.
Mais il existe des hommes de l’ombre et hommes d’action dont l’empreinte sur l’histoire, bien que difficilement quantifiable, car n’étant connue que d’une minorité, aura été bien réelle.
C’est le cas des frères Sidos et cadres de « Jeune Nation, qui auront été à l’origine de nombre d’événements, notamment de ceux qui, depuis Paris et Alger, auront contribué au renversement de la IVème République.
Ils auront, par la suite, contribué à la levée de boucliers contre la trahison Gaulliste qu’ils avaient vu venir avant tout le monde, allant jusqu’à fournir des armes aux conjurés du Petit Clamart.
Embastillés par le traitre de Colombey, ils formeront, en prison des dizaines de militants, dont les beaucoup consacrerons leur vie à appliquer dans l’action ce que les Sidos leur auront enseignés !
Il furent encore à l’origine des mouvements qui allaient donner ses cadres les plus dynamiques
au Front National.
De même que beaucoup de politiques, voire de ministres, des Longuet, des Madelin, des Léotard, côtoyèrent ceux de Jeune Nation dans les luttes estudiantines… avant – hélas ! – de privilégier le « politiquement correct » et la gamelle qui en tient lieu de récompense.
Puissent les militants « Jeune Nation » d’aujourd’hui partager l’intelligence, la faculté de plonger parfois dans l’ombre, le dévouement et le sens du sacrifice de la génération qui les a précédés.
Quels sont les liens avec le Souvenir napoléonien ? Je suis curieux de cette connexion.