Comment Hitler a assis son pouvoir et lancé une révolution économique et sociale- Par Léon Degrelle – Partie I
Par Léon Degrelle
On a pu dire que le succès économique de l’Allemagne, dans l’entre-deux guerres, était dû à Hjalmar Schacht ; mais Schacht avait déjà été président de la Banque centrale allemande de 1924 à 1930. Et sans Hitler, il avait été incapable d’empêcher l’Allemagne de couler. Aux États-Unis, en 1933, la même année qu’Hitler, Franklin Delano Roosevelt arrivait au pouvoir et lançait le New Deal dont on rebat les oreilles des bacheliers. C’était à peu près le même genre de plan de relance keynésien que celui d’Adolf Hitler. Pourtant outre-Atlantique ce fut un échec et en 1940, il y avait toujours autant de chômage aux USA !
En même temps en France, on se rend compte que le Front populaire, avec ses mesures sociales présentées comme inédites et révolutionnaires, ne faisait finalement que courir derrière Hitler qui avait déjà tout, et en mieux, mis en place en 1933 ! Et on vante aujourd’hui la capacité en Allemagne du patronat et des syndicats à négocier et à s’entendre, mais c’est justement Hitler qui leur avait appris à le faire. Avant 1933, c’était la même lutte des classes, les mêmes syndicats révolutionnaires et politiques avec leur grèves insurrectionnelles et le même patronat méprisant et suffisant qu’en France !
Politiquement, alors que pour Hitler on utilise toujours l’expression de « prise de pouvoir », on parle de « l’élection » de Roosevelt pour les États-Unis. Dans les deux cas, pourtant les procédures institutionnelles « démocratiques » ont été respectées ; Hitler bénéficiant même d’une vague de soutien populaire que n’a peut-être pas connue Roosevelt.
Le redressement de l’Allemagne est-il donc le fait d’Adolf Hitler et de l’arrivée des nationaux-socialistes au pouvoir ; ou est-il dû à d’autres facteurs (contexte économique, politique européen ? mondial ? …). Pour y répondre, en complément de notre article « Comment Hitler a résorbé le chômage », nous publions, en trois parties, un texte de Léon Degrelle lui-même : « Comment Hitler a assis son pouvoir et lancé une révolution économique et sociale ».
Première partie ci-dessous.

Les premières années du Troisième Reich
I. Qui pour mettre fin à la banqueroute ?
«Nous avons le pouvoir, à présent un travail gigantesque nous attend»
C’est par ces mots qu’au soir du 30 janvier 1933 Hitler s’adressait à la foule en liesse qui défilait sans discontinuer depuis des heures sous les fenêtres de la chancellerie à Berlin.
Quatorze ans que durait son combat politique, il avait alors lui-même 43 ans, il était au faîte de ses moyens, physiquement et intellectuellement. Il avait su entraîner derrière lui des millions d’Allemands et les organiser dans le plus grand et le plus dynamique des partis du pays, un parti entouré d’un rempart humain de centaines de milliers d’hommes des Sections d’Assaut, les trois quarts en provenance des classes populaires. Déjouant tous les pièges de ses adversaires, il les avait vaincus les uns après les autres.
Il était là à la fenêtre, le bras comme soulevé par les clameurs de la foule, il aurait pu brûler d’un sentiment de triomphe, mais il avait l’air ailleurs, absorbé, comme perdu dans un autre monde.
Un monde si éloigné du vacarme assourdissant de la rue, un monde de 65 millions de citoyens qui le vénéraient ou qui le haïssaient, mais qui dès à présent étaient passés sous sa responsabilité. Une responsabilité qu’il savait, que tous les Allemands savaient en cette fin janvier 1933, être écrasante, il était l’homme de la dernière chance.
Un demi-siècle plus tard, il est difficile de comprendre l’étendue de la crise qui sévissait à l’époque, on s’imagine un peu trop facilement des Allemands bien portants, même un peu gras, mais ceux dont Hitler avait hérité étaient faméliques, des squelettes ambulants.
Les années qui avaient précédé, avaient vu une cohorte de gouvernement «démocratiques» se faire et se défaire, souvent dans la plus grande confusion. Du fait de leur instabilité chronique, au lieu de soulager la misère des gens, ils l’avaient aggravée: aucun n’avait pu durer et maintenir un cap plus d’un ou deux ans. L’Allemagne se trouvait dans une impasse, en quelques années, il y avait eu 224 000 suicides, un chiffre effroyable qui dit à lui seul toute l’horreur de la situation. État
En ce début 1933, la misère était pratiquement devenue endémique. C’est au moins six millions de chômeurs qui le ventre creux erraient dans les rues, ne disposant que d’une pitoyable indemnité, moins de 42 marks chaque mois. Et la plupart avec des familles à nourrir, c’est ainsi qu’au total, il y avait environ vingt millions d’Allemands, un tiers de la population, qui en était réduite à tenter de subsister avec 40 pfennigs par jour et par personne.
Qui plus est, ces allocations chômage étaient limitées à six mois, ensuite, c’était l’aide sociale, encore plus ténue, qui prenait le relais. Et malgré l’insuffisance criante de cette aide tout juste capable de maintenir en vie les chômeurs et leur famille, son coût suffisait à mettre l’État et les gouvernements régionaux au bord de la ruine: rien qu’en 1932, une telle aide engloutissait près de quatre milliard de marks, 57 pour cent des recettes fiscales fédérales et régionales. Nombre de communes étaient en faillite.
Ceux qui avaient la chance d’avoir un emploi, n’étaient pas beaucoup mieux lotis. Les ouvriers et les employés avaient subi une baisse de 25 pour cent de leurs salaires. Vingt et un pour cent d’entre eux gagnaient entre 100 et 250 marks par mois, 69,2 %, en janvier 1933 gagnaient moins de 1 200 marks par an. On estime qu’il ne devait pas y avoir plus de 100 000 Allemands à vivre sans inquiétude financière.
Durant les trois années qui ont précédé l’arrivée d’Hitler au pouvoir, au total, les salaires avaient chuté de plus de moitié (baisse de salaire ou perte d’emploi), passant de 23 milliards à 11. Le revenu moyen annuel par habitant était tombé de 1 187 marks en 1927 à 627 en 1932, un niveau à peine supportable. En janvier 1933, quand Hitler arrive au pouvoir, 90 pour cent de la population est dans le dénuement.
Personne n’échappait aux affres du chômage. Les professions intellectuelles étaient aussi touchées que les manuelles. Des 135 000 diplômés des universités, 60 pour cent étaient sans emploi, seule une petite minorité bénéficiant des allocations chômage.
«Les autres», écrivait un observateur étranger, (Marcel Laloire dans son livre La Nouvelle Allemagne), vivaient soit chez leurs parents, soit dans des foyers. Dans la journée, on pouvait les voir sur les boulevards de Berlin, avec des pancartes accrochées dans le dos disant «qu’ils acceptaient tout type de travail». Mais il n’y avait plus aucun type de travail.
L’artisanat, qui comptaient quatre millions d’employés, connaissait le même effondrement, son chiffre d’affaires plongeant de 55 pour cent, de 22 à 10 milliards de marks, le plus touché étant le bâtiment avec 90 pour cent de chômage.
Les agriculteurs aussi étaient ruinés, écrasés par des pertes qui s’élevaient à 12 milliards de marks, beaucoup avaient dû hypothéquer leur maison et leurs terres. En 1932, rien que les intérêts des emprunts qu’ils avaient dû contracter à cause de la crise représentaient 20 pour cent de la production agricole de tout le pays. Ceux qui ne pouvaient plus faire face aux intérêts voyaient leur exploitation mise aux enchères: au cours des années 1931 et 1932, 17 157 exploitations d’une surface totale de 462 485 hectares ont été ainsi liquidées.
Le régime «démocratique» de la République de Weimar s’avérait un fiasco total, incapable de contenir un fléau aussi dévastateur que l’appauvrissement de ces millions de paysans, les travailleurs les plus courageux et stables du pays. Pillés, dépouillés, abandonnés, pas étonnant qu’ils aient répondu à l’appel d’Hitler.
Leur situation le 30 janvier 1933 était tragique. Comme toutes les classes laborieuses d’Allemagne, ils avaient été trahi par leurs représentants politiques, n’ayant pas d’autre alternative que de se résoudre à des salaires de misère, des allocations dérisoires et hasardeuses ou, pire, de tomber dans l’humiliation pure et simple de la mendicité.
En dépit de tous les millions en dessous-de-table que ses magnats se sentaient obligés de verser avant chaque élection dans les caisses des partis politiques au pouvoir pour s’assurer de leur coopération, l »industrie allemande autrefois si renommée partout dans le monde n’était plus que l’ombre d’elle-même. Ça faisait quatorze que les conservateurs et les démocrates-chrétiens avec leurs œillères bien opportunes leur mangeaient dans la main, se gavant tout autant que leurs adversaires de gauche.
C’est ainsi qu’avant 1933, les sociaux-démocrates avaient été largement soudoyés par Friedrich Flick un richissime homme d’affaires. Pour lui comme pout tous ses semblables, il s’agissait d’un investissement bien pensé. Après 1945, son fils, fidèle à la tradition, a continué de prodiguer ses largesses à la ronde aux socialistes du Bundestag qui lui tendaient la main et à tous les partis qui étaient dans les mêmes dispositions avides y compris à l’étranger. Les bénéficiaires, il est vrai, faisaient bien en sorte que les cadeaux soient payés de retour en contrats juteux et en abattement fiscales.
On n’a rien pour rien, en politique, on menotte avec l’argent.
Même s’ils se sont assuré la coopération bienveillante de la clique de Weimar, les titans du capitalisme allemand se sont heurtés à une succession de catastrophes. Les mosaïques gouvernementales qu’ils soutenaient, fruits de compromis entre les intérêts variés étaient totalement inefficaces. Elles allaient d’échec en échec sans aucun plan à long terme ni volonté de s’atteler vraiment aux devoirs de leur fonction.
Il faut du temps pour tout ce qui est important. Ce n’est qu’avec le temps qu’on peut amener de grands projets à maturité et trouver les hommes suffisamment compétents pour les porter. Il n’y avait donc rien d’étonnant à voir tous ces plans de redressement économique battis au milieu des tractations politiques à court terme échouer les uns derrière les autres.
La corruption des parties n’était pas davantage capable de leur permettre de faire face aux outrances du Traité de Versailles. La France en 1923 avait pris l’Allemagne à la gorge avec l’occupation de la Ruhr et avait amené le gouvernement de Weimar à une piteuse capitulation. Mais comment tous ces petits merles de passage qui se chamaillaient sans cesse auraient-ils pu offrir la moindre résistance? En à peine quelques mois en 1923, sept gouvernements se sont succédé en rafale. Ils n’avaient pas d’autre choix que de se soumettre à l’humiliation du contrôle Allié et aux intrigues séparatistes fomentées par les agents stipendiés par Poincaré.
Les droits de douane imposés sur les importations en provenance d’Allemagne avaient sévèrement compromis sa capacité exportatrice. Dans l’obligation de verser des sommes astronomiques à leurs vainqueurs, les Allemands avaient dilapidé des milliards et des milliards. Saignée à blanc, l’Allemagne devait recourir à des emprunts colossaux à l’étranger, en particulier aux États-Unis.
Cet endettement avait scellé son sort, et en 1929, elle était précipitée dans une crise financière d’une ampleur terrifiante.
Les grands industriels, même avec leurs pots-de-vin aux politiciens, se trouvaient à présent impuissants: leurs usines vides, leurs ouvriers désormais des silhouettes hagardes, errant dans les sinistres cités ouvrières du voisinage.
Des milliers d’usines étaient réduites au silence, leurs cheminées comme des arbres morts, beaucoup avaient fait faillite, celles qui restaient en vie tournaient au ralenti. La production globale avait chuté de moitié, de sept milliards de marks en 1920 à trois milliards et demi en 1932.
L’industrie automobile offre un exemple particulièrement frappant, la production allemande en 1932 était proportionnellement à un douzième de celle des États -Unis, et seulement à un quart de celle de la France: 682 376 autos en Allemagne (une pour 100 habitants) contre 1 855 174 voitures en France, alors que la population de cette dernière est inférieure de 20 millions à celle de l’Allemagne.
Les exportations étaient tout aussi en berne. L’excédent de sa balance commerciale était tombé de 2 872 milliards de marks en 1931 à seulement 667 en 1932 – une chute de 75%.
Submergée par les cessations de paiements et le nombre de comptes courants dans le rouge, même la banque centrale était en voie de désagrégation. Harcelée par les exigences de remboursement des prêts étrangers, un jour après l’accession d’Hitler au pouvoir, la Reichsbank ne disposait en tout que de 83 millions de marks en devise étrangère, dont 64 millions étaient déjà prévus pour les décaissements du lendemain.
La dette étrangère astronomique, d’un montant qui excédait trois années d’exportations, était comme une chape de plomb qui pesait sur les épaules de chaque Allemand. Et il n’y avait rien à espérer du côté des ressources financières internes: les activités bancaires étaient pratiquement à l’arrêt, il ne restait plus que les impôts.
Mais les ressources fiscales avaient elles aussi sévèrement reculé, passant de neuf milliards de marks en 1930 à 7,8 milliards en 1931, puis à 6,65 milliards en 1932 (dont rien que les versements en allocation chômage absorbaient quatre milliards).
Le poids de la dette financière sur les régions s’était lui aussi aggravé à un rythme effrayant. Assaillies qu’elles étaient par les besoins de millions de citoyens, les municipalités devaient déjà 6 542 milliards en 1928, un montant qui passait à 11 195 milliards en 1932 dont 1 668 milliards de prêts à court terme.
Tout espoir de rembourser ces déficits par de nouvelles recettes fiscales était vain. Les impôts avaient déjà été augmenté de 45% entre 1925 et 1931. Durant les années 1931 – 1932, sous la direction du chancelier Brüning, une Allemagne peuplée de chômeurs et d’industriels aux usines à demi mortes subissait une rafale de 23 «décrets d’urgence». Cette enfilade de surimposition s’est avérée sans le moindre effet, tout comme l’avait prévu la «Banque des règlements internationaux», celle-ci déclarant que le fardeau fiscal de l’Allemagne était déjà bien trop lourd pour être encore augmenté.
Donc, sur un plateau de la balance, on avait 19 milliards de dettes étrangères et le même montant de dette intérieure, dans l’autre, la Reichsbank avait 83 millions en devise. C’est comme si chaque Allemand devait à son banquier 6 000 marks, tout en ayant en poche 14 marks.
L’une des conséquences inévitables de cette misère galopante et des incertitudes pesant sur l’avenir, c’était la chute de la natalité. Lorsque les économies du foyer s’évaporent sans qu’il soit possible d’apercevoir le bout du tunnel, il ne faut pas s’attendre à ce que les gens accroissent le nombre de bouches à nourrir.
À l’époque, la natalité était un baromètre fiable de la prospérité d’un pays. Un enfant est une joie, sauf si vous n’avez rien d’autre à lui offrir qu’un petit crouton de pain. Or, c’était justement la situation que connaissaient des centaines de milliers de familles allemandes en 1932.
En 1905, sous le règne de Guillaume II, la fertilité était de 33,4 pour mille habitants, en 1921, elle n’était déjà plus que de 25,9, baissant encore en 1924 à 15,1. Finalement, en 1932, il tombait à tout juste 14,7 pour mille habitants.
Encore, ce chiffre n’était-il atteint que grâce à la fécondité plus importante des zones rurales. Dans les cinquante plus grandes villes du Reich, il y avait plus de décès que de naissances. Dans 45% des familles ouvrières, il n’y avait plus aucune naissance sur les dernières années. La baisse de la natalité était la plus accentuée à Berlin où il y avait moins d’un enfant par famille et une natalité de seulement 9,1 pour mille. Les décès dépassaient les naissances de 60 pour cent.
Contrastant avec la natalité, le nombre de politiciens était lui plus florissant que jamais, c’était bien la seule catégorie qui prospérait en ces temps de calamités. De 1919 à 1932, l’Allemagne avait vu défiler pas moins de 23 gouvernements, ça faisait une moyenne d’un tous les sept mois. Comme toute personne sensée le comprenait, un tel chambardement perpétuel à la tête du pays ne pouvait que nuire à l’autorité et à l’efficacité gouvernementale. Personne n’irait imaginer qu’une entreprise industrielle pourrait être gérée avec succès si ses dirigeants, son encadrement, sa stratégie et son personnel clé étaient changés tous les huit mois, la faillite serait garantie.
Mais le Reich, ce n’était pas qu’une usine de 100 ou 200 travailleurs, c’était toute une nation de 65 millions d’âmes écrasée par le Traité de Versailles, le marasme industriel, un chômage effroyable et une misère poignante.
Tous ces cabinets qui en treize ans se sont succédé en cascade par le jeu des rivalités parlementaires, des ambitions personnelles et des revendications partisanes, ne pouvaient pas parvenir à autre chose qu’à l’effondrement de leur régime, un fatras inextricable de partis concurrents.
La confusion du pays était encore aggravée par le morcellement de la puissance publique entre les 25 États régionaux, des entités territoriales souvent en confrontation directe avec Berlin, et qui aboutissait au sabotage permanent de l’action du gouvernement central du Reich.
Ces vestiges de particularismes régionaux séculaires étaient tous farouchement jaloux de leurs privilèges. Le Traité de Westphalie en 1648 avait éclaté l’Allemagne en une myriade d’États lilliputiens, pour la plupart, des royaumes d’opérette dont les roitelets se prenaient pour le roi Soleil avec cours, apparats et force courbettes.
Même au début de la Première Guerre mondiale (1914- 1918), le Reich comprenait quatre royaumes distincts (la Prusse, la Bavière, le Wurtemberg et la Saxe), chacun avec son propre souverain, son armée, son drapeau, ses titres de noblesse et sa Grand Croix en émaux multicolore. Il y avait en outre six grands duchés, cinq petits, sept principautés et trois villes libres.
Le Bavarois s’arc-boutait à son lederhose, à sa chope de bière et à sa pipe, il a fait la guerre pour les préserver. Le Saxon aurait volontiers dit son fait au Prussien hautain, chacun était sûr de son bon droit, mais pour les deux, la lointaine Berlin était comme une épine dans le derrière.
Chacune des régions avait son gouvernement, son parlement et son Premier ministre. Au total, cela représentait un aréopage de 59 ministres, qui, ajoutés aux onze Reich ministers et aux 42 sénateurs des villes libres donnait à l’Allemagne une collection de 112 ministres, chacun d’eux observant les autres d’un œil pour le moins méfiant.
À cela s’ajoutait entre deux trois mille députés des diverses factions rivales, siégeant au Reichstag ou dans les parlements des 22 Länder et des trois villes franches.
Aux élections pour le Reichstag de novembre 1932 – quelques mois avant qu’Hitler devienne chancelier – il n’y avait pas moins de 37 partis politiques différents, et un total de 7 000 candidats (dont 14 par procuration) tous avidement à la recherche d’une part du gâteau parlementaire. Curieusement, plus le système des partis tombait dans le discrédit, plus il y avait de champions de la démocratie à se bousculer au portillon pour monter dans le wagon-restaurant.
On avait l’impression que ceux qui avaient été élus étaient là depuis toujours. Ils recevaient de gros salaires (dix fois le salaire moyen d’un ouvrier pour un député au Reichstag), et ils bénéficiaient de confortables revenus annexes sous forme d’avantages en nature de la part de leurs «clients» intéressés. À titre d’exemple, plusieurs députés socialistes de Berlin au Reichstag, se sont débrouillés pour que leurs femmes reçoivent de somptueux mentaux de fourrure de la part de financiers Juifs.

Dans une démocratie parlementaire, les mandats sont souvent courts, les nominations ministérielles encore plus, et la tentation est grande de se servir tant qu’il est temps.
Honnêtes, malhonnêtes ou pirates, ces 112 ministres et milliers de députés ont fait de l’Allemagne un pays ingouvernable. Il est incontestable qu’en janvier 1933 le «système» politicien était complètement discrédité. Ses successeurs allaient hériter d’un pays en ruine, économiquement, socialement et politiquement.
De nos jours, à une ère d’opulence pour beaucoup, il est difficile d’imaginer que l’Allemagne de janvier 1933 était tombée aussi bas. Mais pour quiconque étudie les archives et les documents appropriés de l’époque, il ne peut y avoir le moindre doute. Aucun des chiffres cités ici n’est inventé. L’Allemagne gisait en sang, exsangue.
Tous les précédents chanceliers qui avaient entrepris de remettre le pays sur pied – y compris Brüning, Papen et Schleicher – avaient échoué. Seul un génie, ou pour certains, un fou, pourrait relever une nation qui était tombée dans un tel désarroi.
Lorsque le président Franklin Roosevelt a été appelé au même moment à résoudre une crise de même ampleur aux États-Unis, il avait à sa disposition d’immenses réserves d’or. Hitler à la fenêtre de la chancellerie au soir du 30 janvier 1933, savait qu’au contraire, les caisses de son pays étaient vides. Aucun grand bienfaiteur ne viendrait à son secours. Le vieillissant président du Reich, Paul von Hindenburg, lui avait donné une feuille de route avec des chiffres d’endettement vertigineux.
Hitler savait qu’il allait partir de zéro, de moins que zéro. Mais il avait aussi conscience de la puissance de sa volonté de créer une Allemagne nouvelle, politiquement, socialement, financièrement et économiquement. Désormais légalement et officiellement au pouvoir, il était sûr qu’il pourrait rapidement changer les chiffres pour faire l’Allemagne plus puissante que jamais.
De quels soutiens disposait-il?
Tout d’abord, il pouvait compter sur le soutien indéfectible de ses millions de partisans, une foule vibrante qui en ce soir de janvier fêtait la victoire. C’est près de treize millions d’Allemands, pour beaucoup d’anciens socialistes ou communistes qui avaient voté pour son parti.
Cela faisait quand même encore des millions d’Allemands qui restaient ses adversaires, des adversaires un peu désorientés, il est vrai, que leurs propres partis avaient trahis, mais qui n’avaient pas encore été gagnés à la cause du national-socialisme.
Les deux bords – ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre Hitler – étaient quasiment égaux en nombre, mais tandis que le camp de gauche était divisé, les partisans d’Hitler étaient unis, leur conviction et leur foi dans le Führer donnaient au Parti national-socialiste un avantage incomparable. Bien organisé et discipliné, le parti avait pu venir à bout des pires obstacles.
Mais même s’il disposait d’un soutien populaire phénoménal, le mouvement national-socialiste avait grandi trop vite ce qui n’était pas sans poser des problèmes préoccupants. Des milliers d’illuminés qui entretenaient de nébuleuses rêveries de domination, auxquelles s’ajoutaient ceux qui ne pensaient qu’à la bagarre et à la révolution permanente, avaient fait leur trou dans les rangs du Parti. Il y avait les ambitieux qui voulaient gravir les marches vers le sommet le plus vite possible, nombre d’entre eux étaient mal préparés ou manquaient de moralité. D’amères déconvenues attendaient Hitler à cause de ces gens.
Hitler le sentait, il avait ordonné qu’on arrête de recruter de nouveaux membres, et même qu’on réduise les effectifs des SA, cette énorme force paramilitaire qui l’avait porté au pouvoir: en 1933, les SA comptaient 2 500 000 membres, un chiffre proprement vertigineux, c’était 25 fois l’effectif de la Reichswehr l’armée régulière.
C’est ce genre de pression qui amenait parfois Hitler à des réactions épidermiques contraires à ses désirs ou à intentions réelles. Cela pouvait signifier parfois des expulsions, l’usage de la force, une certaine intransigeance, même si son objectif général était de réconcilier la nation dans la paix et de réaliser son programme politique et social sans heurts inutiles.
Hitler savait qu’il jouait avec de la dynamite, mais il avait l’intime conviction qu’il n’était pas seulement porté par le mouvement national-socialiste, mais par une force intérieure quasi supranaturelle. Qu’on l’appelle Providence ou Destinée, c’est cette force, il en était persuadé, qu’il l’avait conduit à la victoire. Sa propre force de caractère était telle, que rien ne pouvait le faire reculer, pour lui, il allait de soi qu’il allait forger un nouveau Reich, un nouveau monde.
Il avait bien conscience que la tâche qu’il s’était assignée était immense et serait difficile à accomplir, qu’il devrait transformer l’Allemagne dans pratiquement tous ses aspects: la structure de l’État, de la société, de l’économie, la culture, l’esprit citoyen et la façon même de penser. Pour accomplir sa grande œuvre, il lui faudrait redéfinir l’équilibre des classes sociales dans le cadre d’une communauté régénérée, libérer la nation de la domination étrangère et refaire son unité territoriale.
Tâche numéro un: il lui faudrait rendre travail et dignité à six millions de chômeurs, c’était la priorité immédiate, un objectif que tout le monde pensait impossible.
Après avoir refermé les fenêtres de la chancellerie, Hitler, décidé, les poings serrés, déclarait simplement: «la grande aventure commence, le jour du Troisième Reich est arrivé».
En moins d’un an, «la grande aventure» sera mise en branle, bouleversant de fond en comble la politique, la vie économique et sociale, en fait, tout le mode de vie de l’Allemagne.
II. Réconcilier le Pays
«Ma plus grande fierté», déclarait Hitler en arrivant au pouvoir, «serait de pouvoir dire un jour que j’ai regagné l’estime du travailleur en lui rendant toute la place qu’il mérite au sein du Reich». Il voulait dire par là qu’il n’entendait pas seulement remettre les hommes au travail, pas seulement que le travailleur acquiert des droits, mais qu’il retrouve sa dignité et son prestige au sein de la communauté nationale.
Cette communauté nationale avait longtemps été une méchante mère pour le travailleur. La lutte des classes, ce n’était pas qu’une vue de l’esprit des marxistes, c’était aussi un fait pour une classe de privilégiés, les capitalistes, qui cherchaient à dominer les travailleurs. Les travailleurs se sentant traités en paria s’étaient souvent détournés d’une patrie qui avait l’air de les considérer comme de simples instruments de production.
Aux yeux des capitalistes, l’argent était le seul agent actif nécessaire à une économie florissante. Pour Hitler, cette conception était radicalement fausse: c’est le capital qui était un instrument et le travail qui était l’élément essentiel, l’homme avec sa dignité, son sang, ses muscles et son âme.
Hitler ne voulait pas seulement mettre fin à la lutte des classes, mais rétablir dans la justice et le respect la primauté de l’être humain comme principal facteur de production.
On peut se passer d’or, et c’est ce que fera Hitler. Il existe une bonne douzaine de substituts à l’or pour stimuler l’industrie et Hitler les inventera. Mais pour le travail, c’est le facteur de base, on ne peut faire sans.
Pour restaurer la confiance du travailleur dans la patrie, il fallait qu’il se sente (et qu’il soit traité) comme un égal et non comme le plus bas échelon de la société. Sous tous les gouvernements soi-disant démocratiques, aussi bien ceux de droite que ceux de gauche, il était resté cet inférieur déconsidéré, aucun parti n’étant capable de comprendre que pour la création de la richesse nationale, le travail était l’essentiel, le moteur de l’existence, tandis que la matière, que ce soit l’or ou l’acier, étaient seulement des outils.
L’objectif était donc bien plus ambitieux que de simplement remettre au travail six millions de chômeurs, il s’agissait d’accomplir une révolution globale. «Le peuple», déclarait Hitler, «n’est pas là sur Terre dans le seul but de faire tourner l’économie et l’économie n’est pas là uniquement pour servir le capital. Au contraire, c’est le capital qui doit être au service de l’économie et l’économie qui doit être au service du peuple».
Il ne suffirait donc pas de rouvrir les milliers d’usines, sans un changement de mentalité, les ouvriers ne seraient à nouveau que des machines vivantes, des individus sans visage, interchangeables.
Ce qu’il fallait, c’était rétablir l’équilibre éthique entre les travailleurs, les êtres humains qui transforment les matières premières, et un capitalisme qui soit utile et contrôlé, ramené au rang d’outil qui est le sien. Cela signifiait changer tout un monde, et cela demanderait du temps.
Une telle révolution ne pouvait s’accomplir, Hitler en avait bien conscience, tant que le gouvernement fédéral et les gouvernements régionaux continuaient à naviguer à vue chacun pour soi. Aucune révolution n’était non plus envisageable dans une société qui comptait des douzaines de partis et des milliers de députés de toutes sortes, chacun défendant un intérêt particulier dans une cacophonie d’ensemble qui durait depuis 1919.
Restaurer les capacités d’action des institutions allemandes sur une base nationale était donc un passage obligé avant de pouvoir envisager une quelconque renaissance sociale.
«Le poisson pourrit par la tête» [n°3197 des adages recueillis par Érasme, «Piscis primum a capite foetet» Les Adages sont publiés en 1500], et c’est bien la tête politique de l’Allemagne, avant l’arrivée d’Hitler, qui était complètement pourrie.
Finalement, les partis «démocratiques» ont dû abdiquer sans résistance. À partir de 1930, le vieillissant président Paul von Hindenburg faisait usage de l’article 48 de la constitution de Weimar pour instaurer un état d’urgence devant permettre à une série de semi-dictateurs de gouverner par décret, mais même eux n’ont pas été capables de faire grand-chose.
Les derniers chanceliers, – Herr Brüning, Herr von Papen, et le général Schleicher – ne gouvernaient plus que par décret, leur autorité artificiellement soutenue par un détournement abusif de l’article 48, elle ne tenait plus que par Hindenburg et la camarilla qui le conseillait. La défiance populaire était telle, qu’en 1932 au Reichstag, le gouvernement subissait une véritable humiliation lors d’un vote de confiance qui voyait 90% des députés voter contre lui.
L’accession d’Hitler au pouvoir a mis fin d’un coup à l’impuissance gouvernementale. Pourtant, Hindenburg avait posé comme condition à la nomination du nouveau chancelier qu’il soit entravé comme un prisonnier dans son propre gouvernement, Hitler avait ainsi été contraint de nommer quatre fois plus de ministres conservateurs – voire, de réactionnaire – que d’hommes à lui: seuls deux membres de son premier cabinet étaient des nationaux-socialistes.
Les représentants d’Hindenburg avaient reçu la mission de tenir Hitler en laisse. Mais dès la session du Reichstag du 24 mars, Hitler cassait cette laisse, pas par un nouveau décret (comme ses prédécesseurs immédiats) mais en obtenant une majorité parlementaire des deux tiers lors du vote de la loi d’habilitation prévue dans la constitution, un vote qui lui donnait dans la foulée les pleins pouvoirs pour une période de quatre ans.
Quatre ans pour planifier et prendre des décisions: politiquement, c’était une révolution, la première d’Hitler, entièrement démocratique comme l’avaient été toutes les étapes de sa montée au pouvoir. Son triomphe initial, c’est à l’électorat qui le lui avait apporté, de même, les pleins pouvoirs lui avaient été octroyés par plus des deux tiers des députés du Reichstag eux-mêmes élus au suffrage universel.
Cela s’accordait au principe de base d’Hitler: pas de pouvoir sans une approbation librement consentie par le peuple, il disait, « si vous ne parvenez à vous imposer au peuple que par l’autorité de l’État autant prévoir un couvre-feu à partir de neuf heures.
Nulle part dans toute l’Europe du vingtième siècle, n’y a-t-il eu un chef de gouvernement dont l’autorité était assise sur une approbation librement consentie aussi massive. Avant Hitler, de 1919 à 1932, des gouvernements qui s’affichaient pieusement démocratiques ne parvenaient à s’adjuger qu’une maigre majorité, guère plus de 51 à 52 pour cent.
«Je ne suis pas un dictateur, disait toujours Hitler, et je ne le serai jamais, la démocratie sera rigoureusement appliquée par le national-socialisme».
L’autorité ne signifie pas la tyrannie. Un tyran, c’est quelqu’un qui arrive au pouvoir sans la volonté du peuple, ou même contre sa volonté. Un démocrate est placé au pouvoir par le peuple, mais la démocratie ne se limite pas à une seule formule, elle peut être une démocratie parlementaire issue du régime des partis, ou elle peut être autoritaire, l’important, c’est que le peuple l’ait souhaité, l’ait choisi, l’ait établie dans une forme donnée.
C’était le cas pour Hitler, que ça plaise ou non, c’est un fait incontestable: il est arrivé au pouvoir d’une manière parfaitement démocratique, dans la lettre et dans l’esprit. Et par la suite, le soutien populaire ne s’est jamais démenti, au contraire, il allait croissant d’année en année dans les sondages. Ses adversaires les plus intelligents et les plus honnêtes ont dû le reconnaître, un homme qui se déclarait aussi ouvertement antinazi que l’historien et professeur Joachim Fest écrivait :
Hitler n’a jamais cherché à être un tyran, la seule soif du pouvoir ne peut rendre compte de sa personnalité et de son énergie, il n’était pas né pour n’être qu’un tyran. Il était obnubilé par la mission qu’il s’était fixée de défense de l’Europe et de la race aryenne… Jamais il ne s’est senti aussi dépendant du soutien des masses qu’à cette époque, et il guettait ses réactions avec la plus grande attention.
Ces lignes n’ont pas été écrites par le Dr. Goebbels, mais par un sévère contempteur d’Hitler et de sa carrière. (J. Fest, Hitler, New York: 1974, p. 417).
Dès le 28 février 1933, moins d’un mois après sa nomination à la chancellerie, l’incendie du Reichstag la veille avait contraint Hindenburg à desserrer l’étau autour d’Hitler en approuvant une nouvelle loi d’exception «pour la protection du peuple et de l’État» qui accroissait considérablement les pouvoirs de l’exécutif.
Mais Hitler voulait plus qu’une concession faite à contre-cœur par un vieil homme influençable, il voulait que les pleins pouvoirs lui soient légitimement octroyés par l’institution suprême de la démocratie, le Reichstag. Hitler avait préparé son coup avec toute l’habilité, la patience et l’astuce qui lui sont légendaires. «Il possédait» rapporte encore Fest, «une intelligence qui avait au plus haut point un sens infaillible du rythme à observer dans la prise de décision».
Il a d’abord commencé par travailler Hindenburg, le vénérable Feldmarschall , le vétéran de la Première Guerre mondiale si attaché aux traditions. Hitler a pris soin d’organiser une cérémonie en son honneur à Potsdam, la résidence historique des rois de Prusse. Ce moment de bravoure, de majesté, d’apparat, de tradition et de piété s’est déroulé à l’église de la garnison de Potsdam, le 21 mars 1933, quelques jours seulement avant que le Reichstag ne se réunisse de nouveau.
La carrière d’officier d’Hindenburg s’étendait sur un demi-siècle et Hitler s’était arrangé pour que des vétérans de toutes les guerres auxquelles il avait participé soient présents à cette cérémonie solennelle: des anciens de la guerre franco-prussienne de 1870 (62 ans plus tôt), de la guerre de 1866 contre l’Empire austro-hongrois (67 ans plus tôt), et même ceux de la guerre contre le Danemark (69 ans auparavant) sont venus de tout le pays. Pour quelqu’un qui aurait pu partir à la retraite en 1911, cela a dû lui faire chaud au cœur de retrouver tous ses compagnons de route après si longtemps.
Avec la déférence et l’humilité qui sied, dans un costume spécialement confectionné pour l’occasion, Hitler s’est incliné devant le vieil homme. Dans l’église majestueuse dans laquelle se déroulait la cérémonie, Hitler avait veillé à ce que le fauteuil de l’ancien Kaiser Guillaume II qui était inoccupé depuis 14 ans, reste vide, de sorte qu’Hindenburg puisse marquer une pause en passant devant et lui rendre hommage en levant son bâton de maréchal, comme si le monarque était toujours présent.
Puis Hitler conduisit Hindenburg vers la crypte pour déposer une gerbe sur la tombe de son vieux maître, le Kaiser Guillaume I, ainsi que sur celle de Frédéric le Grand. Les yeux plissés du président étaient humides de larmes.
En ce 21 mars à Potsdam, l’octogénaire ravivait la mémoire de la vieille monarchie allemande, ce sombre hommage était son heure suprême. Hindenburg avait toujours été un fidèle serviteur de l’Empereur, et cette commémoration de son ancien souverain ainsi que des jours glorieux de sa propre longue carrière le touchaient profondément. Hitler était le premier chancelier depuis la défaite de 1918 à honorer la tradition de la Prusse et de l’Allemagne, le jeune chancelier révolutionnaire l’avait ému.
Un mois et demi plus tôt, Hindenburg avait chargé Papen, Hugenberg et Neurath, entre autres ministres conservateurs, de mettre des bâtons dans les roues d’Hitler jusqu’à ce qu’il craque. Maintenant, c’était terminé, Hitler l’avait mis dans sa poche devant ce fauteuil vide et devant la tombe des plus grands rois de Prusse.
Un an et demi plus tard, alors qu’il était mourant dans son lit, le vieux Feldmarschall se croirait de nouveau revenu au temps des Hohenzollern, et dans son délire, il s’adresserait à Hitler comme «Sa Majesté».
Cette cérémonie de la «journée de Potsdam» a aussi valu à Hitler de nouveaux soutiens parmi les nombreux monarchistes du pays, ils avaient l’impression qu’il n’était pas totalement fermé à l’idée de restaurer la monarchie.
Mais la prudence toute provisoire du nouveau chancelier était pesée avec précision, «il ne sert à rien de détruire les institutions existantes» assurait-il, «tant qu’il n’y a rien de mieux à mettre à leur place».
Il avait encore besoin de quelques dinosaures de la classe dirigeante comme von Papen . Il les avait à ses côtés dans la voiture qui les conduisait à travers Potsdam en ce jour historique, la ville en fête était parée non seulement de bannières à svastikas, mais aussi du drapeau noir, blanc et rouge du Deuxième Reich, spécialement ressorti pour l’occasion. Des fanfares défilaient qui entonnaient des marches héroïques propres à gonfler leurs vieux torses. Là aussi, l’aversion à peine voilée pour le parvenu avait pu être apprivoisée, les aristocrates, de naissance ou par fortune, ne seraient plus des obstacles.
Mais c’est surtout l’armée Allemande – la Reichswehr – qui était l’objet des sollicitudes les plus empressées d’Hitler. En 1933, il avait désespérément besoin de son soutien. Tous ces généraux à monocle n’avaient toléré son arrivée au pouvoir qu’à contre-cœur: un caporal à la chancellerie, cela leur semblait totalement inconcevable. Les plus ambitieux caressaient l’espoir de prendre le contrôle des leviers de commande.
On les avait consulté avant de nommer Hitler à la chancellerie, le 30 janvier. Le vieux Feldmarschall avait même dû sèchement renvoyer le général von Hammerstein-Equord, lequel était venu lui faire part du vote négatif de l’état-major. Dans les semaines qui suivirent, les généraux ont eu les plus grandes peines à admettre le jeune impétrant.
Parfaitement conscient qu’un coup d’État militaire pourrait bien le balayer lui et son parti en un clin d’œil et ruiner au passage tous ses plans d’avenir, Hitler comprenait qu’il lui faudrait manœuvrer habilement contre la fière caste des généraux. La Reichwehr s’était en conséquence vu accorder une place d’honneur à Potsdam. Dans l’allée à l’entrée du palais royal, les soldats de la Reichswehr présentaient les armes d’un côté, tandis qu’une rangée de SA leur faisait face. L’une en face de l’autre, l’armée gardienne de la tradition de l’honneur et du devoir et les SA, la nouvelle force révolutionnaire, formaient la garde d’honneur qui symbolisait l’unité retrouvée de l’Allemagne.
Quant aux généraux, leurs uniformes scintillant de décorations et le torse bombé, ils marchaient de nouveau derrière leur vieux chef, une suite digne d’un grand chef germanique. Voilà qu’enfin, après quatorze années passées en disgrâce sous la république de Weimar, ils retrouvaient les ors de la gloire militaire. Hitler, le petit caporal, n’était peut-être pas si méprisable après tout, qui se tenait au garde-à-vous en haut de forme dans son beau costume et qui les laissait avoir leur jour de gloire à Potsdam. Il avait suffisamment le sens des convenances pour leur laisser les feux de la rampe.
Hitler avait obtenu son armistice.

Pour s’adresser au peuple, Hitler et le Dr. Goebbels s’étaient rapidement emparé du contrôle de la radio nationale dont ils avaient été si longtemps bannis (et dont leurs adversaires avaient fait un usage assez médiocre). En quelques semaines, ils en faisaient un outil des plus performants. Chaque discours important d’Hitler recevait une diffusion nationale avec une puissance jusque-là inconnue.
La radio avait aussi couvert l’événement de Potsdam, Goebbels avait placé ses micros partout: devant et derrière Hindenburg, dans la crypte royale, près des fanfares militaires, il y avait même des reporters placés sur le toit des maisons pour commenter le défilé au risque de se rompre le cou.
Toute l’Allemagne était rivée à son poste pour suivre la couverture de l’événement. Ils étaient des millions à vibrer de nouveau en entendant les vieux airs et à suivre de près chaque pas d’Hindenburg, presque comme s’ils y étaient.
Durant les jours sombres du passé récent, le vieux guerrier vénéré représentait la tradition et l’espérance. À présent, grâce à la mise en scène somptueuse d’Hitler, il incarnait la promesse d’une grande renaissance nationale. C’est en historien que Fest faisait observer : «Une fête de la réconciliation magistralement orchestrée … La journée de Potsdam aura réellement marqué un tournant de l’histoire … Ils étaient nombreux, hauts fonctionnaires ou officiers, juges ou avocats, membres de la haute bourgeoisie, à avoir abandonné leurs préventions à l’égard d’Hitler ce jour-là …» (J. Fest, Hitler, New York: 1974, p. 405.)
Potsdam était une grandiose scène théâtrale dans laquelle chacun a joué son rôle, même – ne serait-ce que par leur absence – les tièdes et les ennemis d’Hitler à sa gauche.
Collés à leurs postes radio, tous les Allemands avaient participé au spectacle, d’abord fascinés, puis emportés par l’émotion de l’événement. Le lendemain, les journaux de Berlin commentaient: «Une vague d’enthousiasme patriotique a déferlé sur l’Allemagne hier».
«Un savant mélange de tacticien et de visionnaire», dira de lui Joachim Fest pour apprécier cet extraordinaire metteur en scène. Hitler avait en effet réussi à amener sur son champ de manœuvre maréchaux et généraux – entre autres dignitaires – aucun d’entre eux n’étant dupe, et à les y manipuler comme des soldats de plomb. Mais l’objectif d’Hitler, toutefois, allait bien au-delà de la conquête de la seule vieille garde.
Il voulait à présent asseoir son autorité dans la durée et obtenir une ratification du Reichstag qui lui donnerait pour plusieurs années la capacité de gouverner virtuellement comme un dictateur. Pour se voir accorder ces pleins pouvoirs légalement, il fallait apporter un amendement à la constitution ce qui réclamait d’obtenir une approbation des deux tiers au parlement.
Le parti d’Hitler ayant recueilli 17 300 000 suffrages aux élections législatives du 5 mars 1933 avait obtenu 288 sièges – ce qui en faisait de loin le premier parti au Reichstag. Son allié de circonstance, le Parti du peuple Allemand (DNVP) de Hugenberg avait lui obtenu 4 750 000 bulletins et 52 sièges ce qui faisait un total de 340 députés pour la coalition. Abstraction faite des 81 «sièges vides» des communistes, l’opposition ne réunissait plus que 226 députés: 120 sociaux-démocrates, 92 catholiques centristes et membre du Parti bavarois (BVP) et 14 «divers». Hitler avait la majorité absolue, mais pour modifier la constitution, il lui fallait une majorité des deux tiers, il lui fallait donc trouver 36 voix supplémentaires.
À première vue, l’objectif semblait quasiment impossible. Durant les dix dernières années, les catholiques centristes et le Parti bavarois avaient ouvertement critiqué Hitler et son mouvement national-socialiste, n’hésitant pas à se servir de la religion comme d’une arme politique, déniant même des obsèques religieuses aux catholiques nationaux-socialistes qui avaient été assassinés par les communistes.
Hitler, avec l’aide de Göring (devenu le nouveau président du Reichstag), allait devoir se rallier les brebis égarées du Parti chrétien. Le chef du parti, Monseigneur Kaas, un prélat replet et trapu qui avait trouvé plus avantageux de solliciter des voix que de conduire des âmes, était courtisé par Hitler qui lui faisait miroiter la promesse d’un rapprochement entre l’État et l’Église catholique, une promesse d’ailleurs sérieuse qu’il tiendra l’été suivant. Le prélat a peut-être cru que c’était lui qui allait ramener les brebis égarées nazies au bercail, quoi qu’il en soit, Hitler réussit à convaincre et à séduire le Parti centriste, certains députés de plus petites formations de l’opposition se sont également joints à lui.
Lors du vote, Hitler s’est vu octroyer les pleins pouvoirs à une écrasante majorité: 441 voix contre 94. C’était bien au-delà des deux tiers, cela représentait 82,44% des suffrages de l’assemblée. Ce «vote de confiance» conférait à Hitler pour une durée de quatre ans un pouvoir quasi absolu aussi bien exécutif que législatif.
Les cinq paragraphes de cette «loi pour le soulagement de la misère du peuple et de la nation» étaient brefs et précis:
-
Les lois pourront être promulguées par le gouvernement du Reich en dehors des procédures prévues par la constitution.
-
Les lois promulguées par le gouvernement du Reich pourront déroger à la constitution à condition qu’elles ne remettent pas en cause l’existence du Reichstag ou du Reichsrat, les pouvoirs du président du Reichstag restent identiques.
-
Les lois promulguées par le gouvernement du Reich seront élaborées par le chancelier et promulguées au Journal Officiel. Sauf indication contraire, elles entreront en vigueur le jour suivant leur publication.
-
Les traités conclus par le Reich avec des gouvernements étrangers et qui touchent à des questions législatives intérieures ne devront pas faire l’objet d’une ratification par le corps législatif. Le gouvernement du Reich est habilité à édicter les règlements nécessaires à leur exécution.
-
Ces lois deviennent effectives le jour de leur publication et restent en vigueur jusqu’au 1er avril 1937. Elles seront aussi caduques si le présent gouvernement est remplacé par un autre.
Berlin, 24 mars, 1933
Von Hindenburg, Hitler, Frick, von Neurath, Krosigk
C’est ainsi qu’une démocratie parlementaire, dans l’exercice de ses prérogatives constitutionnelles, a légalement institué un État autoritaire. Il fallait ensuite trouver une solution au problème de la horde des États et des parlements régionaux, des instances juridictionnelles et administrations locales diverses et variées. Pour la plupart, toutes ces entités étaient virtuellement dépourvues d’intérêt et ne s’appréciaient guère entre elles, mais pendant quatorze ans, elles n’avaient pas manqué de saisir chaque occasion de s’allier qui se présentait pour contrecarrer l’action du gouvernement central de Berlin.
Il était inconcevable qu’un gouvernement fort tel que celui qui venait d’être mis en place par Hitler puisse fonctionner efficacement avec ces milliers de politiciens de second plan, ergotant et remettant en question le moindre de ses faits et gestes. De toute façon, les Allemands étaient lassés par ce gaspillage d’énergie en perpétuelles chamailleries, par toutes ces mesquineries, ces divisions et cette anarchie dont en fin de compte, c’est le peuple qui faisait les frais.
Comme le fait observer Benoist-Méchin «Il est un fait que l’unification des États au sein du Reich répondait à une des plus profondes aspirations du peuple. Les Allemands en avaient assez d’être menacés par de constantes menaces de sécession de la part de leurs gouvernements régionaux. Ils rêvaient depuis des siècles de faire partie d’une même communauté». (Histoire de l’Armée Allemande, vol. III, p. 117.)
Cela semblait une tâche facile puisque l’opinion publique exigeait qu’on mette fin à cette cacophonie administrative. Mais une telle réforme ne manquerait pas de porter ombrage à l’orgueil chatouilleux d’une floppée de petits politiciens locaux, ni de heurter bille en tête leurs intérêts particuliers.
Quelqu’un qui est président de conseil ou ministre, même d’un petit État, ne se résigne pas facilement à n’être plus qu’un simple citoyen, à redevenir, par exemple un avocat de province, se précipitant la robe au vent au tribunal. Les 2 400 députés seraient forcément réticents à renoncer aux avantages de la petite vie qu’ils s’étaient faite, fini le prestige, la déférence, les honneurs, les voyages d’agrément aux frais du contribuable, les petits pots-de-vin entre amis! Qui ne ferait pas la grimace en avalant une telle potion amère? Pourtant, il faudrait en passer par là puisque Hitler avait les yeux fixés sur son objectif primordial: la réunification de la nation.
Pour autant, se débarrasser des administrations régionales ne signifiait pas pour Hitler effacer les identités spécifiques des différentes provinces. Au contraire, il était convaincu que la vie de la nation ne devait pas être monopolisée par sa capitale, qu’elle devait en permanence se nourrir et se renouveler sur l’apport des multiples foyers de cultures aux mœurs, aux us et coutumes variés, prospérant sur l’héritage de leur passé.
Il pensait qu’une nation était un ensemble harmonieux de toutes ces particularités et qu’un État soucieux de ses responsabilités bien comprises, se devait de promouvoir cette diversité, non de l’amoindrir.
L’émiettement du pouvoir politique n’avait pas favorisé cette diversité, mais l’avait au contraire étouffée en la privant de la cohésion qu’apporte une grande communauté. Les 25 entités administratives distinctes que comptait le Reich, en rivalité ouverte avec le gouvernement central et souvent entre elles, étaient une source de désordres. Une nation doit se composer de régions qui se reconnaissent et s’estiment les unes les autres, qui doivent s’enrichir mutuellement de leurs relations et non se recroqueviller dans une culture d’un provincialisme étriqué. Seule une autorité centrale forte pouvait, dans le cadre d’une grande collectivité, assurer aux régions les conditions de leur épanouissement. En somme, ce qu’Hitler visait, c’est que chaque région puisse apporter sa contribution originale à l’ensemble du Reich sans plus être entravée par l’action intempestive de toutes ces petites administrations.
De 1871 à 1933, tous les gouvernements nationaux sans exception ont eu à faire face à l’obstacle de ces particularismes politiques. Même quelqu’un de l’envergure de Bismarck n’a pas été capable de surmonter tout à fait le problème. Et à présent, là où les dirigeants du Deuxième Reich et de la République de Weimar avaient échoué ou n’avaient même pas osé entreprendre quoi que ce soit, Hitler, en quelques mois, s’apprêtait à convertir des divisions et des discordes séculières en une puissante et efficace unité nationale.
Hitler n’avait pas plus tôt pris place dans le bureau qui dominait le jardin de la chancellerie, avec ses écureuils qui grignotaient des noisettes ou qui même parfois se faufilaient dans le bâtiment lui-même, qu’il avait rédigé la loi sur l’unification du Reich.
Le premier État qui allait être mis au pas, c’était la Bavière, un nid de séparatistes teigneux et de crypto monarchistes. Les projets d’Hitler n’étaient pas plus tôt connus, que plusieurs ministres bavarois avaient élaboré un plan pour tirer de sa retraite le fantomatique ex-prince Ruprecht, héritier du trône de Wittelsbach, qui en novembre 1923, alors en tant que simple citoyen, s’était vanté d’avoir aidé à contrecarrer le fameux putsch de Munich. Mais c’était maintenant Hitler qui avait les cartes en main, sans coup férir, il écrasait le complot et mettait à genoux l’administration bavaroise. Le lendemain, le lieutenant-général von Epp était nommé commissaire du Reich à Munich, à la suite de quoi, les autres États régionaux se sont rapidement effondré comme un château de cartes.
Le plus difficile, aura été de venir à bout de la Prusse, un bastion énorme, un tiers de l’Allemagne, s’étendant en plein cœur du pays, un véritable État dans l’État avec son propre gouvernement. En 1931, les socialistes qui la dirigeaient tenaient tête effrontément au chancelier du Reich, Heinrich Brüning, et ce, malgré l’humiliante défaite qu’ils avaient subi peu de temps auparavant aux élections en Prusse face aux candidats d’Hitler. Le chancelier von Papen s’était lui aussi trouvé aux prises avec la Prusse, presque aussi puissante que le gouvernement central.
Devenu chancelier, Hitler, pour un temps, parce que Hindenburg l’avait exigé, a été obligé de laisser von Papen commissaire du Reich en Prusse, et ce n’est qu’après de grands efforts de sa part qu’Hitler réussit à placer Göring comme ministre de l’Intérieur de la Prusse de von Papen. L’autonomie de la Prusse, plus que n’importe quelle autre, devait être liquidée, autrement le gouvernement central resterait indéfiniment sous la menace d’obstruction dans la ville qui était à la fois la capitale de la Prusse et du Reich. L’affaire était particulièrement délicate, parce que von Papen, l’aristocrate, devait rester commissaire du Reich en Prusse, son renvoi risquait d’attirer la désapprobation du président Hindenburg et même des rétorsions de sa part.
Hitler en l’occurrence a dû se surpasser en ruse et versatilité. À force de flatterie et de persuasion, en l’espace d’un mois, von Papen s’est gentiment laissé pousser vers la porte. Hitler lui avait presque dicté sa lettre de démission du 7 avril 1933, dans laquelle le vice-chancelier reconnaissait que la loi d’unification des Länder du Reich «était un édifice juridique destiné à être d’une grande importance historique dans le développement du Reich». Il reconnaissait en outre «qu’il fallait mettre un terme au dualisme existant entre le Reich et la Prusse». Dans cette lettre, il allait même jusqu’à comparer Hitler au prince Otto von Bismarck.
Même si von Papen avait été poussé du coude vers la sortie, Hitler a ménagé sa fierté en déclarant publiquement qu’il n’aurait jamais pu faire aboutir seul la politique de réunification du Reich, que le grand architecte de sa réussite aura été von Papen.
Dans la foulée, Hitler s’adressait par courrier au Feldmarschall von Hindenburg :
En assurant les fonctions de commissaire du Reich en Prusse durant la période difficile qui a suivi le 30 janvier, on doit reconnaître à Herr von Papen le plus grand mérite pour la diligence avec laquelle il a contribué à articuler la politique régionale à celle du Reich. Sa collaboration au sein du cabinet du Reich à laquelle il va désormais pouvoir se consacrer entièrement me sera d’une aide précieuse. Les sentiments que j’ai pour lui font que je me réjouis de pouvoir compter sur son inestimable coopération.
Pour sa part, le field marshal faisait suite à ce petit chef-d’œuvre d’hypocrisie en écrivant à von Papen sur le même ton :
Cher Herr von Papen,
Je viens d’accéder à votre demande de démission de vos fonctions de commissaire du Reich de Prusse. Je saisis cette occasion pour vous remercier, au nom du Reich et en mon nom propre, pour l’éminent service que vous rendez à la nation en abolissant le dualisme existant entre le Reich et la Prusse et en imposant l’idée d’une direction politique commune du Reich et des des régions. J’apprends avec satisfaction que vous allez dorénavant pouvoir consacrer toute votre énergie au gouvernement du Reich.
Avec mes sentiments de sincère camaraderie, je reste votre dévoué
von Hindenburg, Président du Reich
Von Papen, l’ex-chancelier, perdait ainsi le dernier pouvoir effectif qu’il détenait encore, même s’il restait un membre du cercle rapproché d’Hitler au gouvernement (mais pour combien de temps?) il n’était plus guère qu’un laquais aux ordres.
Hitler se nommait aussitôt Statthalter(gouverneur) de Prusse, et Göring ministre-président, s’assurant ainsi le contrôle ferme du plus grand État régional.
L’un après l’autre, les autres États régionaux étaient dépouillés de leur souveraineté, le processus était réglé comme un ballet.
Premier acte les pouvoirs législatifs régionaux étaient transférés en douceur à des hommes de confiance d’Hitler.
Deuxième acte: chaque homme déclarait l’acceptation de la «loi d’unification».
Troisième acte: chaque parlement régional proclamait la fin de la souveraineté et de l’autonomie de son propre État.
Quatrième acte: dans chaque région, Hitler nommait un commissaire du Reich ( ou Statthalter), qui était chargé d’appliquer les directives politiques de la chancellerie.
Dans le Grand-duché de Bade-Saxe il y a eu quelques escarmouches verbales, mais vite étouffées. À Hambourg, ville libre d’un million et demi d’âmes, ces chefs ont un peu regimbé pour la forme, mais il n’a pas fallu plus de quelques heures de discussion pour leur faire voir la lumière. En quelques semaines, tout le processus était achevé.
S’appuyant sur les larges compétences qui lui avaient été octroyées à une écrasante majorité au Reichstag le 23 mars 1933, en quelques mois, Hitler parvenait à transformer un gouvernement central chancelant en une formidable machine d’action. Grâce à ce mandat et à quelques décrets spéciaux signés du président, il était constitutionnellement en mesure d’éliminer toutes les autorités rivales des nombreux gouvernements et parlements locaux.
«Cela a été bien plus vite que nous ne l’avions espéré», commentait Goebbels avec une certaine malice.
Un an exactement après la prise de fonctions d’Hitler, une «loi pour la reconstruction du Reich» témoignait de l’ampleur du changement:
-
Représentation des États régionaux abolie.
-
(a) Les compétences régaliennes des États régionaux transférées au gouvernement du Reich. (b) Les gouvernements régionaux sont soumis à l’autorité du gouvernement du Reich.
-
Les gouverneurs [Statthalter] sont placés sous l’autorité du ministre de l’Intérieur du Reich.
-
Le gouvernement du Reich peut modifier les droits constitutionnels des États régionaux
-
Le ministre de l’Intérieur publiera les décrets d’application de cette loi.
-
Cette loi entre en vigueur le jour de sa publication officielle.
Berlin, le 30 janvier 1934
Von Hindenburg, Hitler, Frick
Bismarck, le «chancelier de fer», n’aurait pas pu rêver d’une réunification politique sur une base aussi autoritaire et hiérarchisée, mais Hitler l’avait fait. L’Allemagne était maintenant parvenue à un degré de centralisation comme elle n’en avait jamais connu dans son histoire, et tout cela par voie démocratique.
Après 1945, l’explication communément donnée à tout cela, c’est que les Allemands avaient perdu la tête. Quoi qu’il en soit, il est historiquement de fait qu’ils ont agi de leur propre volonté. Loin d’être résignés, ils étaient enthousiastes. «Pour la première fois depuis la fin de la monarchie», concède Joachim Fest, «la majorité des Allemands avaient le sentiment de pouvoir s’identifier à un État».
Mais qu’en était-il des partis politiques?
Même si Hitler avait réussi à transformer les dizaines de millions de Bavarois, Saxons, Prussien et habitants d’Hambourg en citoyens d’un seul et même Reich, à les placer sous une unique administration nationale, et même si la fourmilière des minuscules États plus ou moins séparatistes avait été aplatie, il restait encore tous ces partis semeurs de zizanie. Ils étaient complètement discrédités, c’est vrai, mais les ambitions personnelles pouvaient se réveiller et miner les fondations du nouvel État.
Les chefs de parti n’étaient plus guère en position de s’opposer, le 23 mars, ils avaient eux-mêmes approuvé à une écrasante majorité la fatidique «loi d’habilitation». Les mains liées et leurs prérogatives perdues, ils ne pouvaient plus servir à grand-chose, ils n’étaient pas seulement devenus superflus, ils devenaient encombrants.
Comment Hitler allait-il s’en défaire ?
(…)
À suivre
Léon Degrelle
Lire la suite :



























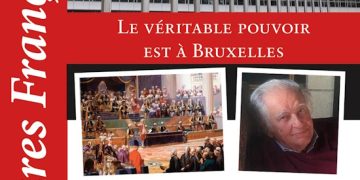



 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV









Merci de rétablir les vérités! Vive le NS
Je pensais qu’Hitler, quand il est arrivé au pouvoir, avait mis en camps de concentration
les 200 000 officiers de la noblesse monarchiste,
les six millions de communistes et de syndicalistes,
les 10 000 000 de catholiques ….
(ce qui précède est de l’ironie: Il y a vraiment des imbéciles qui ne pensent jamais à faire le total et à se rendre compte que ce n’est pas possible, on ne peut pas se mettre tout le monde à dos)
Merci à Léon Degrelle pour cet exposé sur les mérites d’Hitler à relever une Allemagne dans un tel état de décomposition. Il fut vraiment le génie envoyé par la Providence