Comment Hitler a assis son pouvoir et lancé une révolution économique et sociale- Par Léon Degrelle – Partie II
Par Léon Degrelle
En complément de notre article « Comment Hitler a résorbé le chômage », nous publions, en trois parties, un texte de Léon Degrelle lui-même : « Comment Hitler a assis son pouvoir et lancé une révolution économique et sociale » (Partie I). Deuxième partie ci-dessous.
(…)
III. La Liquidation des Partis
Le jour même où les députés de la République de Weimar ont voté au Reichstag l’abandon de leur pouvoir, Hitler, debout devant eux dans leur propre hémicycle, dans sa chemise brune impeccablement repassée, leur a lancé droit dans les yeux «c’est maintenant à vous, Messieurs, de choisir entre la paix et la guerre».
Mais comment auraient-ils pu entamer maintenant un combat auquel ils avaient renoncé depuis des années.
Au point où il en était, Hitler n’était même plus disposé à laisser les derniers députés récalcitrants du Reichstag, les sociaux-démocrates, qui ne représentaient plus que 17,55 pour cent de l’électorat national, prendre la posture des martyres persécutés.
«Vous parlez de persécution!» répliqua-t-il tonitruant à une interpellation d’un orateur social-démocrate, «je crois qu’il n’y en a pas beaucoup dans notre parti qui n’aient pas eu à souffrir de persécution en prison à cause de vous … Vous semblez avoir complètement oublié que pendant des années, vous nous arrachiez nos chemises parce que vous n’aimiez pas leur couleur … Mais vos persécutions nous ont rendus plus fort!».
«En ces temps-là,» poursuivait-il mordant, «nos journaux étaient interdits, interdits, et encore interdits, nos meetings étaient interdits, et on nous interdisait de prendre la parole, j’étais interdit de parole pendant des années et maintenant, vous venez nous dire que la critique est salutaire!».
Les cartes avaient changé de main.
« À partir de maintenant, nous, les nationaux-socialistes, ferons en sorte que le travailleur obtienne tout ce qu’il est en droit d’exiger, nous, les nationaux-socialistes, seront ses avocats mais vous Messieurs [les sociaux-démocrates] on ne vous retient pas et méfiez-vous, nous n’avons pas les manières des bons bourgeois. Vous espérez que votre étoile brillera de nouveau, Messieurs, c’est l’étoile de l’Allemagne qui va monter et la votre qui va disparaître à l’horizon … Dans le cours des nations, tout ce qui est pourri, vieux et faible disparaît à jamais».
Hitler achevait ces socialistes aux abois par ces mots: «Je ne peux que vous dire que vos votes, je n’en veux pas, l’Allemagne sera libre, mais pas grâce à vous!»
En moins de six mois, Hitler réussira à liquider tous ces partis politiques désormais dépassés et à côté de la plaque. Pas seulement les socialistes déjà rejetés par le peuple lui-même, mais aussi tous les politiciens de leur genre, les conservateurs qui avaient un siècle de retard, les nationalistes étroits, les catholiques centristes contents d’eux-mêmes, tous complices de la ruine de l’Allemagne entre 1919 et 1933.
Tous ces partis avaient perdu leur dynamisme. Les gens qui votaient encore pour eux en 1933, ou même après qu’Hitler soit devenu chancelier, ne le faisaient plus que par habitude. Leur élan disparu, les partis de Weimar avaient tout raté et laissé le pays en ruine. L’effondrement de l’Allemagne, ses six millions de chômeurs, sa famine endémique, la démoralisation de tout un peuple: tout ça était leur œuvre. Maintenant qu’un homme fort disposant d’un formidable soutien national les avait remplacé, que pouvaient-ils faire? Comme le dira Joachim Fest, «ils étaient comme une toile d’araignée avec laquelle on aurait espéré attraper des aigles».
Les millions de partisans d’Hitler avaient redécouvert en lui la force originelle, brute, sauvage des hommes du temps où ils avaient encore une colonne vertébrale. Ils avaient trouvé une puissance Dionysiaque, de celles qu’on réserve aux grands défis à venir: il n’y en aurait pas besoin contre les partis, un simple coup d’épaule suffira à les faire s’écrouler.
Il était normal que le Parti social-démocrate (SPD) s’effondre en premier, le voilà qui prenait la porte en gémissant.
Le 23 mars, ses députés au Reichstag avaient quand même fait preuve d’un certain courage en refusant de voter les pleins pouvoirs à Hitler. En 1945, le parti socialiste s’en fera une certaine gloire, omettant de préciser que moins de deux mois plus tard, le 17 mai, les sociaux-démocrates avaient choisi d’approuver un discours majeur d’Hitler au Reichstag sur la politique étrangère. Ils semblait alors qu’ils avaient été entraîné par l’irrésistible poussée du soutien populaire à Hitler qui s’étendait jusque dans les rangs de leur propre parti: tout comme leurs collègues nationaux-socialistes les députés sociaux-démocrates ont exprimé leur approbation de la politique d’Hitler. Depuis son perchoir, le président du Reichstag, Göring se tourna pour jeter un œil vers les girouettes et y aller de son petit commentaire: «le monde voit que le peuple allemand est uni quand sa destinée était en jeu».
Maintenant que la direction sociale-démocrate, qui pendant si longtemps avait dit pis que pendre d’Hitler, s’était décidé à le soutenir au Reichstag, on ne pouvait guère s’attendre à ce que la base lui fasse des histoires: pour le Parti social-démocrate, ce jour marquait la fin de sa crédibilité, suivant l’exemple des responsables de leurs partis, l’électorat SPD allait naturellement se tourner vers Hitler.
Après cet acte de capitulation, ce n’était plus qu’un jeu d’enfant pour Hitler de liquider le Parti social-démocrate. Quatre semaines plus tard, le 22 juin, il était officiellement dissous. «Personne,» faisait observer Fest, «ne s’attendait à la moindre velléité de résistance de la part du SPD». RiP aurait pu être le nouveau sigle du parti:resquiescat in pace.
La paix sera radicale. Hormis quelques membres gauchisants du Reichstag partis en exil où ils menaient dans l’isolement une existence stérile, les désormais ex-députés sociaux-démocrates continuaient chaque mois à empocher les retraites qu’Hitler leur accordait. Ils se promenaient sans être importunés dans les rues de Berlin, certains d’entre eux, parfois avec un grand succès, liant même leur sort à celui des nationaux-socialistes.
Gustav Noske (SPD), le bûcheron devenu ministre de la défense en 1919 – et le plus ardent soutien de la République de Weimar dans les mois tumultueux qui ont suivi l’effondrement de 1918 – reconnaissait en toute honnêteté en 1944, alors que le Troisième Reich était déjà en train de s’écrouler rapidement, que la grande majorité des Allemands restaient fidèles à Hitler en raison du renouveau social qu’il avait offert à la classe ouvrière.
Après les «rouges», ça allait être le tour des «blancs». Des deux douzaines de partis politiques qui existaient en Allemagne en 1932 -1933, une bonne partie des plus petits ont disparu en se dissolvant d’eux-mêmes, dans l’indifférence générale. Ils n’avaient pas d’autre raison d’être que l’ambition personnelle de leur fondateur. Mais à présent qu’il n’y avait plus de sièges en vue au Reichstag, il ne servait à rien de partir à la chasse aux électeurs.
Les partis de droite, autrefois importants mais à présent délaissés par leurs électeurs, étaient conscients de la futilité qu’il y avait à engloutir argent et efforts pour se maintenir artificiellement en vie. Ne disposant plus d’aucun soutien populaire, l’un après l’autre, ils se démantelaient eux-mêmes. Le Parti National du Peuple Allemand abandonné par son électorat bourgeois, a été le premier à jeter l’éponge. Quelques jours plus tard, le 28 juin, c’était au tour du Parti de l’État, imité le 4 juillet par le Parti Populaire Bavarois et par le Parti Populaire Allemand.
De tous les dinosaures conservateurs, le plus difficile à évacuer aura été Alfred Hugenberg, le magna de la presse qui était encore un des ministres d’Hitler. Les nazis le surnommaient sans se gêner de «vieux porc dans un champ de betteraves». Hugenberg a fini par perdre son poste parce qu’il en a fait un peu trop dans le rôle du nationaliste zélé lors d’une conférence à Londres en juin 1933, faisant une réclamation pour le moins prématurée au sujet du retour des colonies allemandes et appelant à une expansion économique allemande en Ukraine! Hitler considérait la déclaration totalement inopportune à un moment où il s’efforçait au contraire de rassurer les sceptiques et les critiques à l’étranger. Après cette belle gaffe diplomatique, Hugenberg n’avait pas d’autre choix que de démissionner. Ainsi partait le puissant capitaliste qui avait juré le 30 janvier de museler politiquement le nouveau chancelier.
Sa démission a été un succès double pour Hitler: d’un côté, en désavouant un trublion de la scène internationale, il donnait des gages à ceux qui à l’étranger s’alarmaient des déclarations intempestives d’Hugenberg, d’autre part, il se débarrassait à bon compte d’un boulet à qui sa gaffe diplomatique aura coûté tout ce qui pouvait lui rester de crédit dans l’estime de von Hindenburg.
Le dernier à abdiquer était le Parti «centriste» d’obédience bourgeoise et catholique. Son vote du 23 mars en faveur des pleins pouvoirs à Hitler lui avait ôté toute crédibilité en tant que parti d’opposition. Son audience s’est effritée dans l’indifférence générale, après tout, si le chef du Centre, Monseigneur Kaas, avait décidé de s’aligner aux côtés d’Hitler, pourquoi la base du parti n’en ferait-elle pas autant?
Du reste les négociations avec le Vatican pour la conclusion d’un concordat pour définir les relations entre l’État et l’Église en Allemagne étaient sur la bonne voie. En la circonstance, Hitler a fait preuve comme jamais d’un tact, d’une patience et d’une adresse hors du commun. Il lui fallait faire la paix avec l’Église, au moins jusqu’à ce que, avec l’aide de la hiérarchie, il puisse définitivement se gagner le soutien des nombreux catholiques du pays.
En votant pour Hitler au Reichstag, Kaas et sa suite de pieux politiciens du Centre étaient naïvement tombés dans le panneau . Le 5 juillet 1933, ils se déclaraient politiquement neutres et se sabordaient en tant que parti.
Comme le notait un contemporain: «les gens ne s’inquiétaient nullement de tout ce qui avait disparu». Au sujet de la décomposition rapide des partis aussi bien de droite que de gauche, Joachim Fest commentait fort justement: «s’il y avait bien quelque chose qui démontrait la vitalité chancelante de la République de Weimar, c’est la facilité avec laquelle le système des partis et des institutions qui l’avait portée s’est laissé abattre».(J. Fest, Hitler, New York: 1974, p. 415.)
Il n’aura pas fallu six mois pour faire disparaître les partis politiques et absorber sans heurts leur électorat. Hitler avait réussi à convaincre, ou au moins à se gagner la neutralité de ceux qui, il y a peu encore, le raillaient et le prenait de haut. Personne n’était plus étonné de la rapidité avec laquelle les partis avaient succombé qu’Hitler lui-même: «nul n’aurait pu prévoir un effondrement aussi lamentable», remarquait-il en juillet 1933 après avoir jeté la dernière pelletée sur la tombe des partis autrefois si puissants de la République de Weimar. (J. Fest, Hitler, p. 415.)
IV. Unification des Syndicats
Un seul paramètre politique restait à traiter: les syndicats marxistes. Pendant des années ils avaient représenté l’une des plus puissantes composantes politiques du pays. Bien qu’en principe apolitiques, ils avaient joué un rôle déterminant en fournissant aux communistes leurs militants et aux sociaux-démocrates le gros de leur électorat.
Pendant quinze ans, ils avaient été en permanence des agitateurs fanatiques, provoquant des troubles incessants dans les villes et formulant des exigences toujours plus extravagantes. Les syndicats avaient longtemps été la pompe à finances de la gauche, une pompe qui s’alimentait continuellement auprès de leurs millions d’adhérents.
Là-encore, bien avant l’effondrement des partis politiques de Weimar, le désenchantement à l’égard des syndicats s’était généralisé dans les masses. Alors qu’elles étaient affamées, les centaines de députés communistes ou socialistes restaient là à se tourner les pouces, parfaitement incapables de porter la moindre espèce d’assistance à un prolétariat au désespoir.
Les responsables syndicaux n’avaient rien à offrir pour remédier, même partiellement, à l’immense détresse du peuple, pas de grands travaux en perspective, pas de projet de restructuration industrielle, pas de prospective pour des débouchés à l’exportation.
De plus, ils ne faisaient rien pour se dresser contre le pillage par les pays étrangers des dernières ressources financières du Reich: une conséquence du Traité de Versailles que les socialistes allemands avaient ratifié en juin 1919 et que depuis, ils n’avaient jamais eu le courage de remettre en cause sérieusement.
Les quelques modestes concessions arrachées avec les plus grandes difficultés aux prédateurs Alliés, l’avaient été par le ministre des affaires étrangères Gustav Stresemann, un conservateur. Même s’il n’avait que peu ou pas de soutien, y compris de la part des politiques, Stresemann, en dépit d’une santé précaire, s’est battu avec obstination pour libérer le Reich. Victime d’évanouissements fréquents, avec un goître qui lui prenait le cou comme un boa, Stresemann, agonisant, restait la seule personnalité de Weimar a essayer de desserrer l’étau autour du peuple allemand.
En 1930, 1931 et 1932, les travailleurs en Allemagne voyaient s’étendre le désastre: le nombre de chômeurs passait de deux à trois millions, puis à quatre, puis à cinq puis encore à six. Dans le même temps les allocations chômage évoluaient dans l’autre sens, diminuant jusqu’à disparaître tout à fait. Partout la détresse de mères émaciées d’enfants mal portants dans des logements sordides, de files résignées de mendiants par milliers.
L’échec des dirigeants gauchistes leur impuissance qui confinait à l’insensibilité avait stupéfié la classe ouvrière.
De quelle utilité pouvaient bien être de tels dirigeants avec le cœur aussi vide que la tête, mais aux poches en revanche souvent bien remplies?
Bien avant le 30 janvier, les travailleurs par milliers avaient déjà rejoint des formations en plein essor d’Hitler, des formations toujours très actives et présentes partout où il le fallait. Beaucoup avaient adhéré au Parti national-socialiste à l’occasion d’une grève. Hitler, lui-même un ancien travailleur et un homme ordinaire comme eux, était bien décidé à éradiquer le chômage de fond en comble. Il n’entendait pas simplement défendre leur droit au travail, mais restaurer la vocation de celui-ci à leur assurer le respect et leur intégration au sein d’une communauté nationale vivante réunissant tous les Allemands qui avaient été tellement montés classe contre classe.
En janvier 1933, les troupes victorieuses d’Hitler étaient déjà largement d’origine prolétarienne et comptaient nombre d’agitateurs de rue au coup de poing facile, de chômeurs de laissés pour compte.
Dans le même temps, les adhésions aux syndicats marxistes avaient plongé vertigineusement: des treize millions d’électeurs socialistes ou communistes en 1932, à peine cinq millions étaient encore syndiqués. La désillusion et le découragement étaient tels que beaucoup d’adhérents ne payaient déjà plus leur cotisation. Beaucoup de dirigeants marxistes perplexes, commençaient à se demander si les millions de déserteurs n’étaient pas les plus lucides, bientôt, ils ne se le demanderaient plus.
Même avant qu’Hitler ait obtenu la «loi d’habilitation» au Reichstag, l’ADGB une confédération syndicale géante avait commencé à se rallier à la cause nationale-socialiste. Comme le reconnaît Joachim Fest: «Le 20 mars, le comité de direction de la fédération ouvrière adressait une sorte de déclaration d’allégeance à Hitler». (J. Fest, Hitler, p. 413.)
Hitler a alors eu un trait de génie. Les syndicats avaient toujours réclamé qu’on fasse du Premier mai un jour férié pour les travailleurs, mais sans succès du temps de la République de Weimar. Hitler, opportuniste, saisit l’occasion à deux mains et alla au-delà de cette revendication qui lui paraissait sensée et qui n’avait rien d’excessif: le Premier mai devenait un congé national.
Tout comme le Parti socialiste était passé d’un vote contre Hitler au Reichstag (le 23 mars 1933) à un vote de soutien (le 17 mai 1933), les syndicats en quelques semaines opéraient un virage à 180 degrés. D’un coup, Hitler accordait aux syndicats ce qu’ils avaient demandé en vain à tous les gouvernements précédents: un jour férié célébré par toute la nation. Il annonçait que pour rendre honneur au travail, il allait organiser pour le Premier mai à l’aéroport de Tempelhof à Berlin la plus grande fête jamais vue de toute l’histoire en Allemagne. Pris au débotté, mais malgré tout heureux d’avoir l’occasion de lier leur destinée à celui du national-socialisme, qui plus est, en prenant part à une manifestation de masse comme aucun marxiste n’aurait pu en rêver, les directions syndicales ont appelé leurs troupes gauchistes à se présenter bannières au vent partout où se tenaient à travers le pays les célébrations du Premier mai, et à y acclamer Hitler.
J’ai moi-même assisté en 1933 à celui, mémorable, de l’aérodrome de Tempelhof. Dès neuf heures le matin, des colonnes géantes, certaines de travailleurs, d’autres de groupes de jeunes, commençaient à s’ébranler en cadence dans les artères de Berlin et à converger vers l’aéroport où Hitler avait donné rendez-vous à tous les Allemands.
Toute l’Allemagne pouvait suivre les festivités retransmises par la radio nationale.
Vers midi, des milliers de travailleurs, hitlériens ou non, s’étaient massés sur le vaste terrain. Les manifestants faisaient preuve d’une discipline irréprochable. Des centaines de tréteaux montés à la hâte, alimentaient à prix coutants les vagues incessantes d’arrivants en sandwiches, saucisses et chopes de bière pour les remettre de leur marche.
Tout le monde, bien sûr, était debout, et tiendrait comme ça les quatorze heures.
Une estrade fabuleuse se dressait dans le ciel, haute de trois étages, flanquée de drapeaux démesurés, elle était aussi imposante qu’un navire en construction. Au fur et à mesure des heures qui s’écoulaient, des milliers de personnalités prenaient place, souvent des diplomates étrangers. Vers la fin de la journée, une masse d’un million et demi de spectateurs s’étendait jusqu’aux confins de l’immense plaine. Les soldats se mêlaient aux civils, les fanfares donnaient l’ambiance. Ce n’était plus un meeting politique, c’était un festival, une sorte de fantastique kermesse Breughélienne où les bourgeois de la classe moyenne, les généraux, les travailleurs fraternisaient en Allemands et en égaux.
La nuit tombée, Hitler fit son apparition. On aurait vraiment dit que la tribune était comme la proue d’un vaisseau géant. Les centaines de lampions qui avaient illuminé la marée humaine s’étaient éteints. Et soudain, Hitler jaillissait de l’obscurité, une silhouette solitaire qui se tenait là-haut dans les airs dans l’éblouissement des projecteurs.
Dans le noir, des opposants déterminés auraient facilement pu chahuter Hitler ou saboter le meeting d’une manière ou d’une autre. Parmi les spectateurs, ils pouvaient être un tiers à avoir voté socialiste ou communiste trois mois plus tôt. Mais pas une voix discordante ne s’est faite entendre de toute la cérémonie, il n’y avait que des acclamations enthousiastes.
Cérémonie était bien le terme adéquat, c’était presque un rituel magique [Dans Tempelhof, il y a Tempel, temple]. Hitler et Goebbels n’avaient pas leur pareil pour organiser ce genre de rassemblement grandiose. Pour captiver l’audience, on passait d’abord les airs populaires, puis on envoyait les grands hymnes wagnériens. La passion des Allemands pour la musique symphonique et les opéras n’est plus à démontrer, et Wagner faisait vibrer la fibre la plus secrète de l’âme germanique par son romantisme, son sens inné du puissant et du grand.
Les drapeaux par centaines continuaient de flotter au-dessus de la tribune, tirés par intermittence des ténèbres par les pinceaux lumineux des projecteurs. À présent, Hitler gagnait la tribune à grandes enjambées, pour les plus éloignés dans le public, la figure d’Hitler sur sa tribune ne devait plus être qu’un point minuscule et incertain, mais ses mots volaient par-dessus les têtes et les atteignaient instantanément. Un public latin aurait sans doute préféré une voix moins tonitruante, plus mélodieuse, mais c’était celle qui allait droit à l’âme germanique.
Les Allemands avaient rarement eu l’occasion de se laisser emporter par des discours enflammés, le ton convenu des discours était plutôt celui d’intervenants pondérés et soucieux de pédanterie éléphantine. Hitler était un orateur prodigieux, le plus grand de son siècle, il avait comme personne le don mystérieux de pouvoir irradier une énergie d’une intensité rare.
Un peu comme un médium ou un sorcier, il était possédé, presque en transe quand il s’adressait à la foule. C’est comme si toute l’énergie qu’il projetait lui revenait du public, qu’au fur et à mesure, un courant se créait qui allait et venait entre lui et l’assistance, il faut en avoir soi-même vécu l’expérience pour comprendre le phénomène.
C’est ce don unique qui était à la base de son succès auprès des masses. Son énergie projetée comme la foudre transportait et transformait tous ceux qui en étaient atteints. Par millions les gens ont été foudroyés, pétrifiés, enflammés par le rayon de sa colère, de son ironie, de sa passion.
Tandis que les clameurs de ce Premier mai s’estompaient dans la nuit, des centaines de milliers de travailleurs jusque-là indifférents ou même hostiles, qui n’étaient venus à Tempelhof qu’à l’instigation de leur fédération syndicale, étaient à présent conquis. Ils étaient devenus d’aussi chauds partisans que ces chemises brunes avec lesquelles ils avaient eu si souvent à en découdre ces dernières années.
Puis la marée humaine s’est retirée vers Berlin. Un million et demi de personnes étaient venus en bon ordre, et ils repartaient de même. Pas le moindre embouteillage de voiture ou de bus, pour ceux qui en ont été les témoins, cette discipline rigoureuse, et pourtant bon enfant d’un peuple heureux était une source d’émerveillement. Toute cette journée s’est déroulée sans le moindre accroc.
Le souvenir de cette foule énorme qui refluait vers le centre de Berlin ne me quittera jamais. Beaucoup étaient à pied, ils paraissaient transfigurés, comme imprégnés d’un esprit totalement nouveau. Les étrangers dans la foule étaient tout aussi stupéfaits et impressionnés que les compatriotes d’Hitler.
L’ambassadeur de France, André François-Poncet [le père de Jean François-Poncet qui sera ministre des Affaires étrangères sous Giscard], notait:
Les étrangers installés dans la tribune officielle n’étaient pas les seuls à repartir sous le charme d’un spectacle vraiment merveilleux et magnifique, un charme créé par le génie de l’organisation du régime, par l’étalage des uniformes la nuit, par le jeu des lumières, le rythme de la musique, par les drapeaux et les feux d’artifice multicolores; et ils n’étaient pas les seuls à penser qu’un souffle de réconciliation et d’unité passait sur le Troisième Reich.
«C’est notre vœu le plus cher», s’exclamait Hitler comme prenant le ciel à témoin, «de nous entendre et de lutter ensemble comme des frères pour pouvoir dire quand l’heure viendra devant Dieu: «voyez Seigneur comme nous avons changé, les Allemands ne sont plus un peuple honteux, vil et lâche et divisé. Non Seigneur! Le peuple allemand a retrouvé sa force de caractère, sa volonté, sa ténacité, son esprit de sacrifice. Seigneur, nous te sommes fidèles, Bénis notre combat! (A. François-Poncet, Souvenirs d’une ambassade à Berlin, p. 128.)
Qui d’autre que lui aurait pu faire une telle incantation sans se ridiculiser?
Aucun homme politique n’avait jamais parlé des droits des travailleurs avec une telle conviction et une telle force, ni exposé avec autant de clarté les termes de son plan social qu’il s’était engagé à réaliser pour le bien commun de tout le peuple.
L’ADGB, la grande confédération syndicale de gauche, faisait savoir aux lecteurs de son journal, le Gewerkschafts-Zeitung, dans l’édition du lendemain d’un rassemblement qui avait compté au moins deux tiers d’ouvriers – un million – qu’elle estimait que «La victoire du national-socialisme, était aussi notre victoire».
Avec les ouvriers ainsi acquis à Hitler, que pouvait-il rester d’utilité à ces milliers d’antennes syndicales locales qui n’avaient jamais rien fait d’autre qu’empoisonner la vie sociale sans rien apporter de durablement positif?
Dans les quelques heures qui ont suivi la conclusion du meeting «victorieux» de Tempelhof, les nationaux-socialistes ont pu prendre en douceur le contrôle de toutes les organisations syndicales d’Allemagne, y compris leurs bâtiments, leurs entreprises et leurs banques. Une ère d’obstruction marxiste venait brusquement de s’achever: dorénavant, une seule organisation syndicale nationale incarnerait la volonté collective et les intérêts de tous les travailleurs.
Bien que l’avènement de ce qui serait, comme il l’avait promis, un authentique «gouvernement du peuple» était désormais sur la bonne voie, Hitler ne perdait pas de vue qu’il restait encore des obstacles de taille, ne serait-ce que les dirigeants communistes qui à Moscou n’avaient pas baissé la garde, ni les armes. Remettre sur pied le pays exigerait autre chose que des mots et des promesses, il faudrait des résultats. Ce n’est qu’alors, que l’enthousiasme montré par la classe ouvrière lors du Premier mai serait l’expression d’une victoire durable.
Comment Hitler allait-il s’y prendre pour résoudre les grands problèmes qui avaient tenu tout le monde en échec, aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger, mettant des millions de gens au chômage?
Que ferait Hitler sur la question des salaires, de la durée du travail, des loisirs, du logement? Comment parviendrait-il enfin à gagner le respect des droits du travailleur et de sa dignité?
Comment la vie des hommes pouvait-elle être changée, matériellement, moralement, et pour ainsi dire, spirituellement? Comment allait-il procéder pour construire une nouvelle société digne des êtres humains, libérée de l’inertie, des injustices et des préjugés du passé?
«Le national-socialisme», disait Hitler à ses débuts, «à son heure et sa mission, ce n’est pas simplement un mouvement passager mais une phase de l’histoire».
Les leviers du pouvoir désormais bien en main – un État autoritaire, ses provinces assujetties mais néanmoins parties organiques d’un tout national – Hitler avait agi rapidement pour se libérer des dernières contraintes que faisait peser un système des partis impuissant et sectaire. De plus, il pouvait à présent diriger une force ouvrière cohérente qui ne coulait plus en mille ruisseaux, mais comme un seul et puissant courant.
Hitler était sûr de lui, de sa force et de ses convictions. Il n’avait ni l’intention ni le besoin de recourir à une quelconque force physique. Il espérait au contraire convaincre, un par un, les millions d’Allemands qui étaient restés ses adversaires ou même ceux qui le haïssait encore.
Sa conquête de l’Allemagne avait nécessité des années de planification minutieuse et de travail acharné, c’est avec le même soin qu’il allait mettre en œuvre ses plans longuement muris pour transformer l’État et la société. Il ne s’agissait pas de simples aménagements de l’administration ou des structures gouvernementales, mais de programme sociaux de grande envergure.
Il avait prédit que «le jour viendrait où les 15 millions de nos compatriotes qui aujourd’hui nous haïssent, seront résolument derrière nous à acclamer le renouveau que nous créerons ensemble». À la fin, il réussira même à se gagner ses adversaires les plus réfractaires et sceptiques.
Son armée de convertis formaient déjà les rangs, même Joachim Fest devait reconnaître dans un hommage qu’on n’aurait pas attendu de lui que :
Hitler était rapidement passé du statut de démagogue à celui d’un homme d’État respecté. C’était une véritable ruée pour aller rejoindre le camp des vainqueurs, ceux, de plus en plus rares, qui résistaient à la tentation de le faire, se retrouvaient dans un isolement manifeste: le passé était mort, l’avenir, semblait-il, appartenait à ce régime qui avait de plus en plus de partisans, qui était partout acclamé et qui tout d’un coup avait la lumière de la raison avec lui. Même l’éminent écrivain de gauche, Kurt Tucholsky, sentant la direction inexorable de la marée qui montait en Allemagne, commentait impressionné: «on ne va pas contre l’océan» (J. Fest, Hitler, pp. 415 s.)
«Notre puissance» devait déclarer Hitler «n’est plus l’apanage d’une des parties du Reich, ni de l’une de ses classes, mais appartient peuple dans sa totalité».
Mais il restait encore beaucoup à faire, jusqu’ici, Hitler n’avait fait que déblayer les obstacles qui barraient la route à son programme, venait maintenant le temps de la construction.
Tant d’autres avant lui n’avaient pas réussi à s’attaquer aux redoutables problèmes qui étaient maintenant sous sa responsabilité. Par-dessus tout, le pays exigeait qu’on trouve une solution au problème majeur du chômage. Hitler réussirait-il là où tous les autres avaient si lamentablement échoué?
V. Où trouver les millions?
Tandis qu’il se tenait silencieux et préoccupé à la fenêtre de la chancellerie ce soir du 30 janvier, Hitler, sous les acclamations de la foule, était gagné par l’anxiété – et il y avait de quoi.
Dans ses mémoires, Dr. Hjalmar Schacht notait: «C’était comme si pour la première fois, je pouvais voir son âme à nu, j’avais l’impression que le fardeau des nouvelles responsabilités pesait lourdement sur ses épaules … L’expression du trouble intérieur qui pouvait se lire sur son visage, n’était pas feinte le moins du monde ». (H. Schacht, Mémoires d’un magicien, 1956, p. 275.)
Mais Hitler n’était pas homme à se laisser submerger par cette anxiété. Face à la gravité de la tragédie nationale qui se jouait – chômage de masse, misère endémique, industrie quasiment au point mort – à laquelle personne avant lui n’avait su apporter le moindre soulagement, le jeune chef allait s’atteler à relever le défi avec un sens des responsabilités et une ténacité extraordinaire.
Hitler n’avait pas plutôt obtenu les pleins pouvoirs, qu’il se retroussait les manches et commençait à mettre en œuvre le plan qu’il avait si soigneusement élaboré.
Contrairement à d’autres responsables – ou irresponsables – politiques du vingtième siècle en Europe, Hitler ne croyait pas que pour rétablir la santé économique d’un pays, il suffisait d’encaisser patiemment un coup après l’autre en regardant passivement agoniser l’industrie et s’allonger les files de chômeurs dans les rues.
En ces temps-là, la seule solution retenue par les politiciens et les économistes des démocraties, c’était la réduction massive des dépenses publiques et privées. Se serrer la ceinture, c’était le remède convenu.
C’est ainsi que les prédécesseurs d’Hitler avaient réduit les salaires de 25 pour cent, limité la distribution d’allocation chômage à six mois et divisé l’investissement privé par six. Comme une roue crevée, le niveau de vie du pays était à plat. Les six mois écoulés, le chômeur n’avait bien sûr pas retrouvé d’emploi, il était au contraire rejoint par une cohorte de nouveaux compagnons d’infortune. Privés de tout moyen de subsistance, on les voyait tourner autour des bureaux d’aides sociales.
Les gens dépensaient de moins en moins, ce qui avait inévitablement pour conséquence que les industries de bien de consommation, faute de commande, mettaient la clé sous la porte les unes après les autres, leurs employés se retrouvant à la rue par milliers. En 1932, l’industrie allemande était en plein marasme, sa production réduite de moitié.
L’investissement annuel privé était tombé de trois milliards de marks à à peine 500 millions. Aucun sang frais n’avait été injecté pour rajeunir et moderniser l’outil de production, l’économie stagnait.
Non seulement le gouvernement restait paralysé, mais il était lui-même au bord de la faillite. Les recettes fiscales étaient tombées à dix milliards de marks, dont les maigres et éphémères allocations chômage absorbaient les deux tiers.
L’Allemagne ne pouvait pas se permettre d’attendre un hypothétique retournement de la conjoncture. Comme Hitler l’avait compris depuis longtemps, c’était au gouvernement de provoquer la reprise en prenant des mesures audacieuses et imaginatives.
Le chômage ne pouvait être combattu et éradiqué qu’en donnant à l’industrie les moyens financiers de prendre un nouveau départ, de se moderniser, et de créer ainsi des millions d’emplois nouveaux.
Certains auraient pu avancer que la consommation ne pourrait pas se rétablir, encore moins décoller, si on ne commençait pas avant tout par augmenter le niveau de ces allocations de misère avec lesquelles on ne pouvait pratiquement rien s’offrir. Mais au contraire, il fallait en priorité restaurer les ventes et la production pour que les six millions de chômeurs retrouvent un emploi et redeviennent des consommateurs.
[FG: Relance keynésienne, oui, mais par l’investissement et non par la consommation, pour éviter comme la peste le risque d’inflation bien connue de la république de Weimar: à quoi sert de donner de l’argent aux gens s’il n’y a rien à vendre parce que la production est à l’arrêt? Il ne peut qu’en résulter une hausse des prix. De fait, voir ici, Hitler a eu une politique de relance sans inflation. Bien remarquer aussi qu’Hitler a eu une véritable politique économique issue de la pointe, à l’époque, de la recherche économique, contrairement à ce que certains s’imaginent dans le camp nationaliste, il n’a pas eu recours à des âneries pseudo-économique comme «la valeur-travail» ou «le corporatisme»]
La grande dépression économique ne pourrait être surmontée qu’en relançant l’industrie, en la mettant en phase avec son temps et en favorisant le développement de nouveau produits. Par exemple, comme l’Allemagne ne disposait pas de ressources pétrolières, la production d’essence synthétique (à base de charbon) devait être le plus possible encouragée. [FG: procédé Fischer-Tropsch, une synthèse chimique à partir de l’hydrogène et du monoxyde de carbone lui-même obtenu du charbon dont l’Allemagne ne manquait pas, Auschwitz était un centre pétrochimique pour la fabrication de l’essence synthétique et du buna, voir ici]). Le procédé était déjà connu, il ne demandait qu’à être exploité. De la même manière, l’Allemagne était en mesure de fabriquer un substitut artificiel du caoutchouc, le «Buna», mais les plans pour l’industrialisation du procédé étaient restés dans les tiroirs, c’est souvent ce qui menace les nouvelles inventions.
Les grands chantiers de travaux publics étaient une autre façon de stimuler l’activité industrielle et de relancer l’économie. Pour ne prendre qu’un exemple, les routes du pays demandaient une remise en état urgente. De plus, l’heure était à la construction d’un réseau national d’autoroutes modernes, s’étirant sur des milliers de kilomètres, ces grandes artères de béton favoriseraient le commerce et la communication entre les diverses régions du Reich.
Les nouvelles autoroutes favoriseraient aussi la croissance de la production automobile. Le potentiel était énorme, l’Allemagne était très en retard en ce domaine, la production automobile du pays n’était qu’un cinquième de ce qu’elle était en France.

Voilà presque dix ans, alors qu’il était dans sa cellule en prison, Hitler avait déjà envisagé la construction d’un formidable réseau nationale d’autoroutes. Il avait aussi eu l’idée d’une petite voiture économique (qu’on appellera par la suite la «Volkswagen»), il en avait même suggéré les contours: elle devait ressembler à une coccinelle, c’est la nature elle-même qui devait inspirer les lignes aérodynamique de la voiture.
Avant Hitler, la voiture était un privilège de riche, financièrement hors de portée de la classe moyenne, et a fortiori de la classe ouvrière. La «Volkswagen» ne coûtait qu’un dixième d’une voiture standard des années passées. Elle était destinée à devenir un véhicule très populaire pour le travail et les loisirs, un moyen de s’évader au grand air, de découvrir, grâce au nouveau réseau autoroutier, un pays magnifique qui était alors virtuellement inconnu des travailleurs allemands.
Dès le départ, Hitler voulait que sa nouvelle voiture bon marché soit produite pour les foules. Les sites de sa fabrication allaient aussi devenir les plus importants centres industriels du pays et les plus grands employeurs.
Durant son incarcération, Hitler avait aussi projeté la construction de lotissements populaires et d’immeubles imposants, certains de ses croquis ont survécu et on peut encore les voir. On y trouve des projets de maisons ouvrières avec leur petit jardin (on devait en construire des centaines de milliers), les plans d’un stade couvert pour Berlin et d’une grande salle des congrès unique au monde qui symboliserait la grandeur de la révolution nationale-socialiste.
«Une construction avec un dôme monumental», selon l’historien Werner Maser, «dont il avait dessiné le plan en rédigeant Mein Kampf , aurait des travées de 46 mètres, serait haut de 220 mètres, un diamètre de 250 mètres et une capacité de 150 à 190 mille places debout. L’espace intérieur du bâtiment aurait été 17 fois celui de la basilique Saint-Pierre de Rome». (W. Maser, Hitler: Legend, Myth and Reality)
«Ce hall», soulignait Albert Speer, l’architecte d’Hitler, «n’était pas qu’une simple extravagance irréalisable»
On le voit, l’imagination d’Hitler regorgeait de projets ambitieux dont beaucoup allaient se concrétiser: par chance, les entrepreneurs, les ingénieurs et les techniciens requis ne manquaient pas et Hitler n’aurait pas à improviser en partant de zéro.
Werner Maser, quoique tout à fait anti-Hitler – comme tous ses collègues (comment aurait-il trouvé un éditeur sans ça?) le concédait: «Dès le début de sa carrière politique, il [Hitler] avait pris grand soin de systématiquement prévoir tout ce dont il pourrait avoir besoin pour réaliser ses projets».
«Hitler», notait également Maser, «se distinguait par une remarquable intelligence des problèmes techniques». Il avait acquis ce savoir en passant des centaines d’heures à parcourir des études techniques durant sa jeunesse.
«Il avait engrangé un savoir livresque monumental et en montrait les fruits en virtuose lors des débats ou des discours. Par certains côtés, c’était incontestablement un génie. Des idées pouvaient le frapper qui ne seraient venues à personne d’autre, le genre d’idées capables de renverser les plus grands obstacles par leur stupéfiante simplicité ou parfois leur stupéfiante brutalité». (H. Schacht, memoires d’un magicien 1956, pp. 415-416.)
Mais il faudrait des milliards de marks pour lancer la grande révolution socioéconomique destinée, comme cela avait toujours été l’intention d’Hitler, à redonner à l’Allemagne sa première place industrielle et commerciale en Europe, et dans l’immédiat, à éradiquer le chômage. Où allait-on bien pouvoir trouver l’argent? Et une fois les fonds obtenus, comment les investir avec le maximum d’efficacité?
Hitler n’était en rien un dictateur en matière économique, il était là pour aiguillonner. Son gouvernement n’entreprendrait de faire que ce qui était hors de portée de l’initiative privée. Hitler croyait en l’importance de la créativité et du dynamisme individuel, dans le besoin de chaque être supérieurement doué de prendre des responsabilités.
Il reconnaissait aussi l’importance de la recherche du profit. Sans la perspective de voir ses efforts récompensés, la personne capable devient souvent réticente à prendre des risques, la faillite économique du communisme était là pour le montrer: dépourvue d’incitations personnelles et sans réelles opportunités pour l’initiative individuelle, l’économie planifiée soviétique était à la traîne dans pratiquement tous les secteurs, son industrie des années en arrière sur celle de ses concurrents.
Le monopole étatique signait la mort de toute initiative, partant, de tout progrès: que tous les hommes mettent généreusement en commun leurs richesses serait merveilleux, mais c’est aussi contraire à la nature humaine. Chaque homme ou presque, désire que son travail améliore sa propre condition et celle de sa famille, et trouve normal que son cerveau, son imagination créative et sa ténacité trouvent leur récompense.
Parce qu’ils avaient négligé ces vérités psychologiques élémentaires, le communisme soviétique, jusqu’au bout, aura pataugé la médiocrité économique alors que son immense réservoir de main-d’œuvre, l’étendue de son savoir scientifique, l’abondance de ses ressources naturelles, auraient dû en faire un géant industriel et technologique.
Hitler a toujours été un adversaire d’une conception dirigiste de l’économie, il croyait dans les élites. «Une seule idée de génie», se plaisait-il à dire «vaut plus qu’une vie de labeur consciencieux dans un bureau».
Tout comme il y a une élite politique ou intellectuelle, il existe une élite industrielle. Un grand capitaine d’industrie ne doit pas être entravé, pourchassé comme un criminel par les services fiscaux ou être l’objet de l’opprobre public. Au contraire, il est indispensable pour le développement économique que les industriels soient moralement et matériellement soutenus dans toute la mesure du possible.
Les plus fructueuses initiatives qu’Hitler prendra à partir de 1933, concerneront l’entreprise privée. Il gardera, il est vrai, un œil sur la qualité de ses directeurs, ne manquant pas d’écarter les incompétents, assez peu dans l’ensemble, mais aussi de pousser les meilleurs, ceux à l’esprit le plus vif, les plus imaginatifs et audacieux, même si leurs opinions politiques ne rejoignaient pas toujours les siennes.
«Il n’est pas question», martelait-il fermement, «de démettre un propriétaire d’usine ou un directeur au prétexte qu’il ne serait pas un national-socialiste». Hitler exercerait la même modération, ferait preuve du même pragmatisme, aussi bien dans la sphère industrielle qu’administrative. Ce qu’il exigeait de ses collaborateurs, c’était par-dessus tout la compétence et l’efficacité. La grande majorité des fonctionnaires du Troisième Reich – 80 pour cent environ – n’avaient jamais eu leur carte du Parti national-socialiste. Plusieurs ministres, comme Konstantin von Neurath ou Schwerin von Krosigk, des ambassadeurs à des postes clés comme Prague, Vienne et Ankara n’étaient pas des adhérents du Parti, mais étaient capables.
Tout en se méfiant des opportunistes (tel Franz von Papen, à la fois intelligent et rusé), il savait en tirer le meilleur parti et reconnaître publiquement ce qu’ils avaient apporté.
De même, il n’hésitait pas à maintenir à leur poste des fonctionnaires compétents mis en place par ses prédécesseurs. Un bon exemple en est le Dr. Otto Meissner qui avait été chef de la chancellerie présidentielle, aussi bien du socialiste Ebert que du conservateur Hindenburg et qui avait fait tout ce qui était en son pouvoir jusqu’à la dernière minute pour torpiller l’accession d’Hitler au pouvoir. Mais Meissner connaissait son travail et Hitler, avec sagesse, l’avait maintenu à son poste, il le traitait avec respect et confiance et Meissner l’a servi loyalement et avec efficacité les douze ans du Reich.
Mais le cas le plus emblématique d’une telle collaboration c’est bien sûr celui du Dr. Hjalmar Schacht, l’économiste le plus compétent et avisé en Allemagne en 1933. Un partisan d’Hitler? En aucun cas! Schacht n’a jamais été et ne serait jamais partisan de personne d’autre que lui-même. Mais c’était le meilleur en affaires, pour remettre l’économie du Reich sur les rails, il n’avait pas son pareil.
Dix ans plus tôt, en 1923, Schacht avait financièrement sauvé la mise à la République de Weimar en contribuant à instaurer le « Rentenmark » [Le Retenmark mettra fin à l’hyperinflation, Keynes parlera du «miracle du Rentenmark»]. Il avait l’esprit délié et imaginatif et était donc en mesure de comprendre et de mettre en œuvre les plans les plus audacieux d’Hitler. Son ambition personnelle était sans bornes, mais pour Hitler c’était une raison de plus pour lui donner l’occasion de monter aussi haut qu’il en était capable. Dans les semaines qui ont suivi sa prise de pouvoir, Hitler le nommait président de la Reichsbank, puis, un an plus tard, également ministre de l’Économie. Schacht était comblé.
Risqué? Bien sûr! Et doublement dans la mesure où Schacht était capitaliste jusqu’au bout des ongles, avec des liens étroits avec les grands intérêts bancaires étrangers, y compris les financiers Juifs à Londres et New York. De plus, Schacht avait peu d’égards pour le programme révolutionnaire d’Hitler qui tenait le travail pour la vraie source de la richesse nationale.
Hitler avait fait appel au brillant Dr. Schacht pour envisager de nouvelles façons de se procurer les fonds nécessaires pour accomplir ce qu’il avait en tête. C’était beaucoup mais leur collaboration n’allait pas plus loin: Schacht n’a jamais pu s’immiscer dans les questions politiques. Lorsque les formules financières de Schacht eurent joué leur rôle, la collaboration cessa. Jusqu’à ce qu’il soit démis de ses fonctions de président de la Reichsbank en 1939, Hitler a fait bon usage des ses extraordinaires talents. Un renvoi que Schacht ne parviendra jamais à digérer. [En fait, Schacht, au cours des négociations avec les Anglais et les Américains au sujet du plan de financement de la réinstallation des Juifs d’Allemagne à l’étranger dont il avait la charge, avait exprimé des remarques défaitistes et déloyales envers Hitler à ses interlocuteurs étrangers, la Gestapo en avait eu vent].
Déterminé à faire surgir les milliards de marks aussi vite que possible et par tous les moyens, début février 1933, Hitler convoquait à son bureau le prédécesseur de Schacht à la Reichsbank le Dr. Hans Luther. Luther qui avait été nommé à son poste en 1930 par les gouvernements précédents, avait sur la gestion des fonds des conceptions démodées d’une extrême prudence. Comme les caisses de l’État étaient vides, il était d’autant plus prudent. Son faux col aussi rigide qu’une carte de visite, proclamait toute la rigidité de ses principes. Il appartenait à la vieille école de ces comptables qui ne dépensaient un dollar que quand ils avaient un dollar.
Hitler était bien conscient que cet homme méritant n’était pas heureux d’être à la tête d’une banque centrale qui n’avait plus de fonds. Mais ce n’était pourtant pas pour lui demander de vider encore le trésor de l’État qu’il l’avait fait venir, mais pour lui demander de nouveaux moyens de financer la reprise économique en Allemagne. C’était une question d’imagination, mais le cerveau de Luther n’était pas un volcan d’idées nouvelles, c’était un calculateur. «Combien», lui demandait Hitler, «pouvez-vous mettre à ma disposition pour créer des emplois?». Luther hésita à répondre tout de suite, sa calculatrice mentale se mit en route, après avoir fini de concaténer il répondit, comme s’il avait affaire au directeur d’une grande entreprise: «cent cinquante millions».
Une réponse des plus éloquentes, elle montrait à quel point les prédécesseurs d’Hitler et leurs collaborateurs se méprenaient sur l’ampleur des ressources requises pour sauver le Reich. Cent cinquante millions à un moment où l’État versait des milliards de marks tous les trois mois pour les seules allocations chômage! Avec 150 millions, le trésor aurait encore eu du mal à consacrer trois ou quatre marks par jour pendant une petite semaine aux cinq ou six millions de chômeurs.
Il était évident que la question n’avait jamais été posée au Dr. Luther et qu’aucun dirigeant avant Hitler ne s’était jamais enquis de lever les fonds indispensables à la réussite d’un plan d’envergure pour remettre l’Allemagne au travail.
Dès lors, il devenait évident que le Dr. Luther n’était pas l’homme qu’il fallait pour mener à bien la suite des opérations. Le nouveau chancelier pensa alors à Schacht, le vieux renard. Il était toujours partant pour un coup, et Hitler avait besoin de ses talents de magicien.
«Herr Schacht», fit-il, «nous sommes sans doutes d’accord sur un point: il n’y a pas de plus pressante tâche qui attende le gouvernement que celle de venir à bout du chômage. Il va falloir beaucoup d’argent, est-ce que vous voyez d’où on pourrait les sortir en dehors de la Reichsbank?». Et après un instant, il ajouta «combien faudrait-il? Vous en avez une idée?».
Cherchant à mettre Schacht dans sa poche en faisant appel à son ambition, Hitler, souriant, lui demanda: «Seriez-vous disposé à reprendre les rênes de la Reichsbank?». Schacht laissa entendre qu’il avait de la sympathie pour le Dr. Luther et qu’il ne voulait rien faire qui puisse le froisser. Jouant le jeu, Hitler le tranquillisa en lui assurant qu’il trouverait à Luther un poste qui pourrait lui convenir.
Schacht se fit alors tout ouïe, se redressant et fixant Hitler dans les yeux, il déclara: «Si tel est le cas, alors je suis prêt à reprendre les fonctions de président de la Reichsbank». Son grand rêve se réalisait, il avait été le président de la banque centrale du pays de 1923 à 930, mais en avait été renvoyé. Il allait pouvoir faire un retour triomphal et prendre sa revanche. En quelques semaines, il ferait jaillir de son cerveau imaginatif les solutions originales pour répondre aux maux financiers si pressants de l’Allemagne.
«Il me fallait», expliquait Schacht par la suite, «trouver une méthode qui éviterait un trop fort gonflement du portefeuille de créance de la Reichsbank qui aurait été de nature à provoquer une accélération excessive de la circulation monétaire». En conséquence, poursuivait-il, «il me fallait trouver le moyen de mobiliser l’épargne qui dormait dans les poches et les coffres-forts, sans pour autant que ce soit pour une échéance trop longue et sans risquer de lui faire perdre sa valeur … C’était là tout l’enjeu derrière le mécanisme des obligations MEFO».
En quoi consistaient ces obligations «MEFO»? Mefo était une contraction de Metallurgische Forschungsgesellschaft m.b.H. (Compagnie de prospection métallurgique, une pure société financière, une holding). Dotée d’un capital de départ d’un million de marks – dont Hitler et Schacht s’étaient arrangés pour qu’il soit apporté par les quatre géants de la métallurgie, Krupp, Siemens, Gutehoffnungshütte et Rheinmetall – cette compagnie, par l’émission de ses obligations d’entreprise, les MEFO, allait en fin de compte permettre d’assurer le financement de plusieurs milliards d’investissements.
Les entreprises, anciennes ou nouvelles, qui exécutaient les commandes publiques, n’avaient qu’à tirer des traites sur la MEFO pour les sommes dues. Ces traites, lorsqu’elles étaient présentées à la Reichsbank, étaient immédiatement convertible en liquide. Le succès du placement des MEFO dépendait entièrement de la confiance du public, mais Schacht avait bien monté son coup. Comme les obligations MEFO étaient des obligations à court terme liquidables à tout moment, il n’y avait pas de réel risque à en acheter et à en détenir. Le public a vite compris leur intérêt et s’est rué dessus.
Et tandis que la Reichsbank n’avait pu offrir sur ses propres ressources qu’un montant relativement ridicule de 150 millions de marks pour financer la guerre contre le chômage d’Hitler, en à peine quatre ans, les épargnants privés en Allemagne souscrivaient pour plus de 12 milliards de marks en obligations MEFO!
Tous ces milliards, fruits combinés de l’imagination, de l’ingéniosité et de l’astuce d’Hitler et de Schacht, ont balayé le conservatisme attentiste et timoré des banquiers. En quatre ans, cette énorme réserve de crédit allait faire des miracles. Aussitôt le premier milliard de souscription atteint, Schacht ajoutait 600 millions pour financer le démarrage du grand programme de construction d’autoroutes. Ce chantier d’ Autobahn généra immédiatement 100 000 emplois, puis ce furent finalement 500 000 travailleurs qui ont pu ainsi gagner leur vie.
Aussi importante que fût cette sortie d’argent, elle a été immédiatement compensée par une réduction correspondante des allocations chômage et par les recettes fiscales supplémentaires générées par l’augmentation du niveau de vie (et de dépenses) des nouveaux employés. En quelques mois, grâce au crédit créé par les obligations MEFO, l’industrie privée a de nouveau osé prendre des risques et se développer. Les Allemands sont retournés au travail par centaines de milliers.
Est-ce que Schacht était le seul auteur de cet extraordinaire retournement? Après la guerre, il donnait lui-même la réponse en tant qu’accusé devant un tribunal de «dénazification». Lorsque le procureur lui reprocha d’avoir rendu possible les efforts d’Hitler, il répliqua: «Je ne crois pas qu’Hitler dépendait uniquement de moi. Il aurait trouvé d’autres moyens et d’autres soutiens, il n’était pas homme à laisser tomber. Vous auriez voulu, Monsieur, qu’Hitler périsse sans mon aide, mais c’est alors toute la classe ouvrière qui aurait péri avec lui».
Même des marxistes ont reconnu le succès d’Hitler et leur propre défaillance. Dans le numéro de juin 1934 du Zeitschrift für Sozialismus, le journal des sociaux-démocrates en exil, on trouve cette franche confession:
… L’ascension et la victoire finale d’Hitler reposent en définitive sur la crise économique mondiale, sur la détresse du prolétariat au chômage, sur l’absence d’avenir pour les jeunes diplômés, sur les artisans et commerçants de la classe moyenne entraînés vers la faillite et sur les fermiers aux prises avec la chute du cours des denrées agricoles. Et contre tout cela, nous avons été impuissants … Nous n’avons pas été capables d’offrir aux masses autre chose que de la pure rhétorique socialiste.
(…)
À suivre
Léon Degrelle
Retrouvez la première partie :
Lire la suite :
























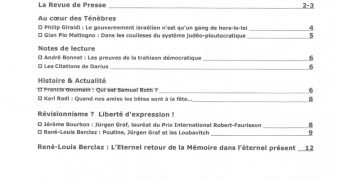


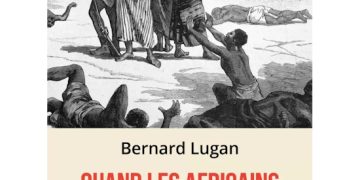
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV







Dans la deuxième partie – économique, on peut enfin savoir comment Schacht s’y est pris.
Schacht et Hitler, car c’est Hitler qui veut un plan de relance de plusieurs milliards, jusqu’ici, personne n’était venu voir les banquiers centraux en demandant des milliards, tout simplement parce que l’Allemagne était réputée en faillite.
Pour arriver à placer les obligations MEFO, nécessaires au financement de la relance, il fallait que l’Allemagne ait un avenir, et cet avenir, c’est Adolf Hitler qui le lui avait apporté.
Voilà pourquoi la manœuvre financière de Schacht, si brillante soit-elle, n’aurait pas suffit à tirer l’Allemagne d’affaires.
Sans l’unification territoriale de l’Allemagne, sans la mise aux chiottes des partis politiques, sans la réconciliation de toutes les classes du peuple allemand et la coopération ouvrier – patronat, sans surtout la confiance dans l’avenir apportée par Hitler, les obligations MEFO n’auraient été que du papier sans valeur.