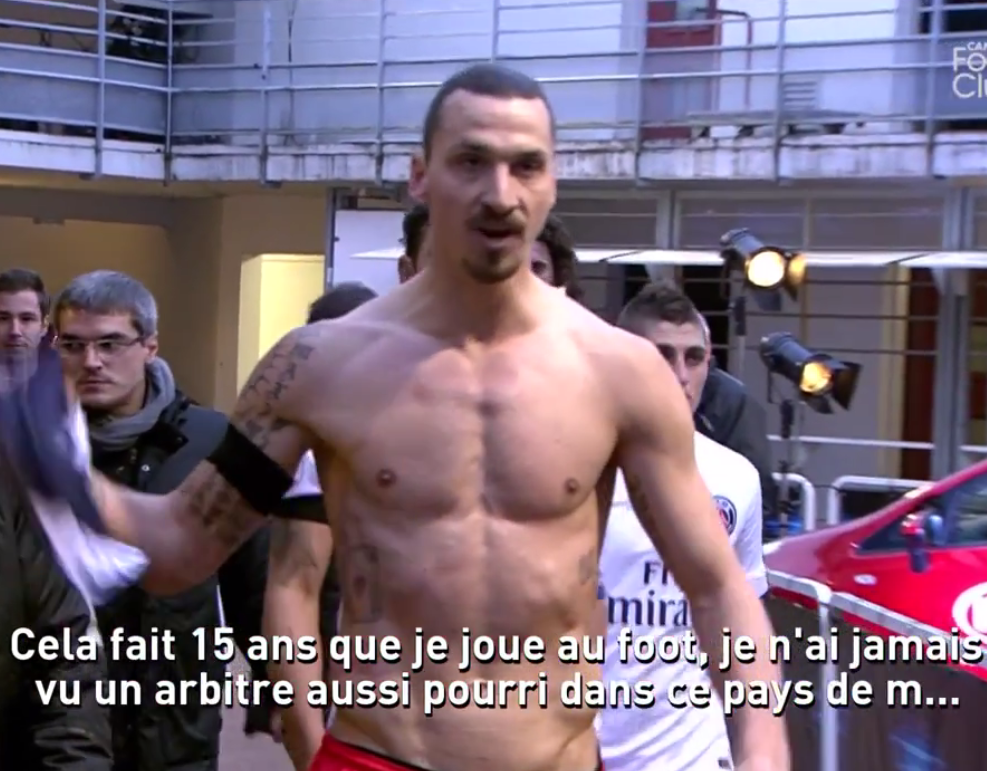Panorama de la vie et de la pensée de Drieu (par Pierre Andreu)
Cet article a été rédigé à partir du canevas d’une conférence prononcée par Pierre Andreu lors de la détention au Stalag IV B durant la Seconde Guerre mondiale et publié dans la revue Idées n° 32 de juin 1944. Nous le publions en cette année où nous commémorons le 70e anniversaire de la mort de Pierre Drieu la Rochelle, le 15 mars 1945.
« Après tout, je ne suis pas qu’un écrivain, je suis un homme en proie au problème total. »
Drieu la Rochelle, in Le Jeune Européen (1927).
Pierre Drieu la Rochelle est né en 1893, d’une famille de petite noblesse normande1. En 1934, il commençait, avec un peu de coquetterie et un peu d’amertume, quelques jours avant le 6 février, un article par ces mots : « Je suis quadragénaire » (on trouvait déjà là, chez Drieu, qui avait été et qui restait – à mon goût plus que Montherlant – un des princes de notre jeunesse, un peu de cette cruelle et lucide ironie qu’il a appliquée à tous et à lui-même). En 1934, quand je l’ai connu dans les bureaux de La Lutte des Jeunes de Bertrand de Jouvenel, il était grand, mince, blond, élégant (terriblement séduisant), avec le petit nez rond qu’il a décrit dans Gilles, un sourire bref et fin, le regard perçant et direct, le cheveu rare. Quinquagénaire en 1944, il a très peu changé, l’éternel Drieu « tel qu’en lui-même enfin, l’éternité le change ».
On peut suivre sa vie à travers ses livres, qui renferment presque tous des éléments autobiographiques plus ou moins fidèles, plus ou moins tronqués, qui s’appellent et qui se complètent : l’enfance dans État civil ; l’adolescence dans Rêveuse Bourgeoisie ; la guerre dans La Comédie de Charleroi, et dans Gilles – avec son admirable première partie : La Permission ; l’après-guerre dans ses nombreux romans de la période 1925-1930 et, enfin, toujours dans Gilles, couronnement romanesque de l’œuvre de Drieu – « ce livre sinistre » m’a-t-il dit un jour.
 En 1914, Drieu est étudiant en droit – je crois – et aux Sciences politiques. Plus exactement, il n’est plus étudiant depuis quelque temps ; il est militaire, il s’abrutit dans une caserne : « ma force commençait à se consumer dans une bibliothèque, une caserne quand la guerre éclata » (Mesure de la France)2. Dans La Comédie de Charleroi, il a décrit cette affreuse période d’incertitudes, de dégoût et de doutes. Le jeune héros de Rêveuse Bourgeoisie part au Maroc, qui se conquérait alors si dignement, et y meurt. Aux Sciences politiques, Drieu connaît Raymond Lefebvre, le Debrye de Gilles, jeune bourgeois comme Drieu en 1914, jeune chef communiste en 1919, duquel il devait tracer un portrait magnifique dans les dernières pages de Mesure de la France. Raymond Lefebvre, un des premiers morts mystérieux de Moscou, qui devait disparaître une nuit de 1920, dans l’Océan Glacial, après avoir refusé la guerre de 14, ce qui choquait profondément Drieu qui l’avait acceptée : « Le 23 août et le 29 octobre 1914, au cours de deux charges à la baïonnette, j’ai connu une extase que, tranquillement, je prétends égale à celle de Sainte-Thérèse et de n’importe qui s’est élancé à la pointe mystique de la vie »… Mais s’il accepte la guerre, il l’accepte avec nuances, tantôt à l’avant, tantôt à l’arrière, six mois héros, six mois planqué. Dès avant la guerre, un trait de caractère de Drieu, qui ne se démentira jamais, est apparu : il s’intéresse à la politique ; la vie des peuples, le sort des civilisations le passionnent. En 1914, il est, comme Montherlant, nationaliste : « Nous étions d’accord aussi sur un nationalisme irréfléchi. En 1911, Caillaux nous inquiétait fort et le discours de Monsieur de Mun sur la cession du Congo, c’était pour nous, enfants : ces enfants de la famille, par ici… ».
En 1914, Drieu est étudiant en droit – je crois – et aux Sciences politiques. Plus exactement, il n’est plus étudiant depuis quelque temps ; il est militaire, il s’abrutit dans une caserne : « ma force commençait à se consumer dans une bibliothèque, une caserne quand la guerre éclata » (Mesure de la France)2. Dans La Comédie de Charleroi, il a décrit cette affreuse période d’incertitudes, de dégoût et de doutes. Le jeune héros de Rêveuse Bourgeoisie part au Maroc, qui se conquérait alors si dignement, et y meurt. Aux Sciences politiques, Drieu connaît Raymond Lefebvre, le Debrye de Gilles, jeune bourgeois comme Drieu en 1914, jeune chef communiste en 1919, duquel il devait tracer un portrait magnifique dans les dernières pages de Mesure de la France. Raymond Lefebvre, un des premiers morts mystérieux de Moscou, qui devait disparaître une nuit de 1920, dans l’Océan Glacial, après avoir refusé la guerre de 14, ce qui choquait profondément Drieu qui l’avait acceptée : « Le 23 août et le 29 octobre 1914, au cours de deux charges à la baïonnette, j’ai connu une extase que, tranquillement, je prétends égale à celle de Sainte-Thérèse et de n’importe qui s’est élancé à la pointe mystique de la vie »… Mais s’il accepte la guerre, il l’accepte avec nuances, tantôt à l’avant, tantôt à l’arrière, six mois héros, six mois planqué. Dès avant la guerre, un trait de caractère de Drieu, qui ne se démentira jamais, est apparu : il s’intéresse à la politique ; la vie des peuples, le sort des civilisations le passionnent. En 1914, il est, comme Montherlant, nationaliste : « Nous étions d’accord aussi sur un nationalisme irréfléchi. En 1911, Caillaux nous inquiétait fort et le discours de Monsieur de Mun sur la cession du Congo, c’était pour nous, enfants : ces enfants de la famille, par ici… ».
(Il ne s’est d’ailleurs pas encore dégagé de son éducation. Comme il le dit dans Gilles : il est né à droite, il a été élevé à droite.)
En août, Drieu part pour la Belgique avec son régiment. Il est blessé légèrement à Charleroi (pour connaître les sentiments de Drieu, dans ces premières semaines de la guerre de 14 qui se cherchait entre les souvenirs de 1870 et les horreurs de Verdun, il suffit de lire La Comédie de Charleroi). Le rôle de deuxième classe dans ces gigantesques batailles modernes lui agrée peu. Drieu philosophe sous le tir précis et meurtrier des mitrailleuses allemandes de Charleroi. Deux solutions semblent possibles à son esprit de jeune chef : commander ou s’en aller, colonel ou spectateur ! Pourtant il rejoint son régiment, est de nouveau blessé, est nommé sous-officier, tire quelques mois d’hôpital et de dépôt jusqu’à son départ pour Salonique, en 1915, d’où il est évacué pour une dysenterie grave (lire l’admirable nouvelle Le Voyage des Dardanelles dans La Comédie). Il refait un tour au front, en 1916, à l’occasion de Verdun, où il est grièvement blessé et où la stupidité de la guerre moderne, au milieu des éclatements d’enfer de Thiaumont, lui apparaît pleinement. Il n’y reparaîtra plus guère jusqu’à la fin. Toutefois, il était remonté en ligne, sur sa demande, avec les troupes américaines, dans les derniers mois de 1918. De la guerre, Drieu rapporte deux volumes de vers, vers libres, de cadence (sinon d’inspiration) assez claudélienne. Interrogation et Fond de Cantine, son unique production poétique, d’ailleurs. Et c’est 1920, l’après-guerre qui s’ouvre…
Drieu n’adhère pas au parti communiste. Il est trop bourgeois et il a trop d’argent pour être alors communiste.
Dans l’Itinéraire personnel qui clôt Socialisme fasciste, Drieu écrit – et il n’y a que les imbéciles et les hypocrites qui s’en indigneront – : « Il est certain que l’évolution de ma vie idéologique semble vivre la courbe de ma fortune matérielle. Quand je penchais à droite, j’avais de l’argent ; quand je penchais à gauche, je n’en avais plus. Et jamais tout à fait à gauche ni tout à fait à droite : n’en ayant jamais beaucoup, ni pas du tout ». Un de ses héros dans cette étonnante nouvelle, La Valise vide, qu’on trouvera dans Plainte contre Inconnu – la scène se passe au moment des grandes grèves de 1920-21 – déclare (je cite ici de mémoire) : « Nous hésitions, nous attendions la dernière minute pour nous prononcer entre l’Ordre et la Révolution ». Mais Drieu avait, dans le fond, une position politique déjà plus arrêtée. Il hésitait beaucoup moins que ses héros et des raisons intellectuelles et morales, fortement motivées, l’empêchaient encore plus que sa « bourgeoisie » et son argent d’adhérer à Moscou. Tout en lorgnant du côté de l’Action française (« autour du génie séduisant, il y avait là des hommes éduqués, instruits, courageux et bien serrés ensemble… »), il préparait un des livres les plus intéressants de l’après-guerre passé d’ailleurs complètement inaperçu, dont Drieu lui-même n’a pas mesuré l’importance, et qu’un de nos devoirs sera de mettre au premier rang : Mesure de la France.
Mesure de la France – qui n’a jamais été rééditée – parut en 1922, dans la première série des Cahiers verts de Grasset (celle de Maria Chapdelaine, des Olympiques, de Ramuz, des premiers Giraudoux) avec une courte préface de Daniel Halévy, auquel l’importance de cet essai avait également complètement échappé. Mesure de la France ne constitue évidemment pas une somme politique, une œuvre de l’importance intellectuelle et morale du Capital, des Réflexions sur la Violence ou de L’Enquête sur la Monarchie, mais elle indiquait aux jeunes Français et aux rescapés de la guerre la voie à suivre pour sauver leur pays, faire la révolution de l’ordre et, au bout de tout cela, éviter la guerre et la défaite.
Drieu parlait de cette constatation qui paraissait simple – et que pourtant très peu ont faite – que pour battre l’Allemagne, il nous a fallu liguer contre elle toute la terre, tous les peuples, toutes les races, toutes les couleurs : « Nous n’avons pas couché seuls avec la victoire ». Il examine si, une seule fois, dans un combat singulier comme les Grecs contre les Perses à Marathon, nous avons vaincu l’Allemagne : « Si je peux répondre oui, alors je respire, alors la chair plus subtile a vaincu la chair la plus épaisse, alors un homme en a battu deux et trois », et il se rassure en évoquant la Marne et le terrible tête-à-tête de Verdun… « mais il y avait déjà tant d’Anglais en France et même, ô soldats de l’An II, tant de nègres. Et la flotte anglaise gardait nos côtes, si Douaumont était la Tour de Londres. »
Mais Drieu ne pense pas que les miracles se reproduisent. Il souligne combien la France est petite en Europe et dans le monde. (Maurras, pendant son voyage en Grèce vingt-cinq ans auparavant, avait déjà eu cette illumination. La France, au bout de l’Europe, lui avait semblé bien petite, bien menacée, et il avait écrit : « Non, la France n’est pas éternelle ! ») Vingt ans avant 1940, Drieu a déjà une conception impériale de la politique. Il écrit : « Peuples d’Europe réduits et exténués, nous sommes entre ces deux masses, Amérique et Russie, ces deux moitiés immenses d’un horizon d’airain ». Et poursuivi déjà, là aussi, par le souci de sauver à la fois l’Europe et les Patries, il invite les nations sorties épuisées de la guerre à se fédérer : « Il ne s’agit pas là d’une rêverie cosmopolite, d’une imagination de luxe, mais d’une nécessité pressante, d’une misérable question de vie ou de mort. L’Europe se fédérera, ou elle se dévorera, ou elle sera dévorée ».
Drieu pose d’autre part en 1920 le problème de la natalité française comme nous le posons maintenant, crûment, violemment – non comme toutes les ligues « bien pensantes » l’ont posé vainement depuis quarante ans :
« Sur la terre, notre chair ne tient plus sa place. L’espace abandonné a été rempli par la chair produite par les mères d’autres contrées. Derrière nous, dam chaque maison, à la place de celui qui n’était pas né, il y avait un étranger. Il était seul avec les femmes…
Honte à ceux qui se plaignent de leur destin. Les Français ont souffert moins qu’ils ne devaient attendre de leurs crimes.
Quel goût ignoble j’avais dans la bouche quand les territoriaux se lamentaient de l’injustice de leur sort, aux soirs où ils nous relevaient. Selon la loi qui règne sur les choses, ils montaient remplacer les enfants qui n’étaient pas venus parce qu’ils les avaient noyés ou poignardés avant leur naissance.
Relève ! Rencontre des générations !
Jugement à la croisée des chemins qui mènent à la vie et à la mort.
… Nous avons besogné excessivement parce que nous n’avions pas de frères pour nous aider. »
Cette France menacée dans sa substance par la stérilité volontaire de ses enfants l’est également de l’extérieur. La démocratie et le « productivisme » capitaliste (Drieu n’écrit pas le capitalisme, il voit alors surtout les dangers d’un machinisme incontrôlé, et il croit que c’est de l’intérieur que le système capitaliste doit être transformé) l’épuisent conjointement. Et, en 1920, après avoir constaté qu’après le grand nivellement du XXe siècle, il n’y aurait plus ni partis (au sens où le XIXe siècle l’entendait) ni classes, il affirme : « Il n’y aura plus que des catégories économiques, sans distinction spirituelle, sans différence de mœurs… Il n’y a que des modernes, des gens dans les affaires, des gens à bénéfices ou à salaires. Ils sont tous sans passion, ils sont la proie de vices correspondants (alcools, drogues, union libre et stérile, homosexualité, courses et cinéma en commun) ». Puis il trace prophétiquement les lignes et définit les buts du parti nouveau. Il faut créer un parti entièrement neuf, et Drieu marque, terriblement en avance sur son temps, que ce nouveau parti n’aura de commun avec les anciens partis que le nom : « Il faudrait remuer les cendres des catégories sociales. Rassemblement des restes indépendants de la bourgeoisie, voire de la classe ouvrière et des paysans, ce serait l’institution d’un Tiers-Parti, d’un Entre-Deux qui relèverait les intérêts spirituels entre la masse dominante par l’argent et la masse dominée par l’argent. Il faudrait faire appel à tous les isolés qui sont beaucoup, en dépit du développement rapide de ce caractère moyenâgeux que prend notre temps. L’exemple du Fascio mérite d’être médité ». Et il ajoutait : « Et surtout il faudrait renoncer à être nombreux ». Il faudrait engager, concluait Drieu, une lutte patiente, séculaire, discrète, contre la folie matérialiste qui entraîne les classes dites productrices, brutales et orgueilleuses, à se ruiner les unes les autres, que ce soit par les grèves ou par les guerres, par les trusts ou par les spéculations.
Ailleurs, faisant l’éloge du sport (À propos d’une Saison de Football) comme Montherlant allait le faire dans Les Olympiques, Drieu montrait la nécessité pour la France de refaire sa stature physique, de refaire les corps avachis et dédaignés de ses enfants : « Je souffre pour le corps des hommes, écrira-t-il quelque dix ans plus tard. Le corps des hommes est ignoble, en France du moins. Horrible de se promener dans les rues et de rencontrer tant de déchéances, de laideurs ou d’inachèvement. Ces dos voûtés, ces épaules tombantes, ces ventres gonflés, ces petites cuisses, ces fasses veules… Non, je souffre trop, moi l’élite, il faut que je réagisse contre cela »3. Montherlant a écrit la même chose dans Les Célibataires.
Mais ce n’était qu’un cri dans la nuit moderne. Drieu lui- même ne le renouvelle pas. Il semble au contraire s’éloigner de cette source pure. Drieu vit de toutes ses fibres l’après-guerre. Il côtoie le mouvement surréaliste, la drogue, l’inversion. Il est l’ami d’André Breton et surtout d’Aragon « à une époque où la seule politique littéraire l’occupait et ne suffisait pas à le distraire d’un certain approfondissement de lui-même », et dont on retrouvera deux terribles portraits dans Gilles. Mais entre lui et les surréalistes, il n’y a pas grand’chose de commun, humainement, littérairement (il n’a jamais écrit de textes « surréalistes »), politiquement, si ce n’est un immense esprit de négation et de révolte commun. Son originalité définitive se dégage peu à peu. Il publie en 1924 Plainte contre Inconnu, puis une série de romans où l’image classique du Drieu donjuanesque commence à se fixer – et des essais aussi. Il a alors pour amis Emmanuel Berl, « Juif libéral », et surtout Gaston Bergery, « grand batteur d’estrades » (dont on retrouvera aussi les portraits – et quels portraits ! – dans Gilles. Il y joindra bientôt André Malraux, « archange de la révolution permanente ».
Toujours intéressé par la politique, il compose en 1924 le programme d’une Jeune droite ou Paul Souday notait que toutes les idées y étaient « de gauche ». En 1927, il s’intéresse très vaguement aux débuts du Rassemblement français de M. Mercier et, paradoxalement, face à ses amis surréalistes qui ont tourné au communisme, il se vante de se « situer entre M. François- Poncet et M. Caillaux ». Mais, dans ces années-là, c’est avant tout le Drieu européen, le Drieu qui écrit Genève ou Moscou, L’Europe contre les Patries. Beaucoup plus que le fait français, c’est le fait européen qui maintenant l’occupe. Il s’intéresse plus à l’Europe qu’à la France ; en 1928, il n’écrirait plus ce qu’il écrivait en 1920 :
« Ma France, je te vois, tu occupes l’air comme la jeune femme que je désire. Et comme elle, je te presse sur mon cœur ». Il dénonce les nationalismes anti-européens : « J’esquissais un patriotisme européen sur trois maximes promptes : nécessité de passer outre à l’épuisement spirituel des patries, nécessité de créer une vaste autarchie économique à la mesure d’un continent, nécessité d’éviter le suicide par les gaz ».
Vers les années 1930, Drieu, surtout sous l’influence de ses jeunes amis radicaux – Bertrand de Jouvenel et Bergery – amorce un rapprochement très net vers la gauche. Se déclarant socialiste et européen, et ne voyant pas d’autres moyens de réaliser son socialisme et ses désirs de fédération européenne que dans les vieux partis de gauche, Drieu hésite, malgré toutes ses répugnances et son mépris, à se faire inscrire au parti socialiste, Bergery, parce qu’il fut son ami le plus intime, l’entraîne aussi le plus loin dans la voie de l’adhésion politique. Mais pas très loin… Drieu assiste plus au moins à deux ou trois meetings du Front commun. L’impuissance et la malfaisance de la gauche lui apparaissent à l’usage aussi évidentes que l’impuissance et la malfaisance de la droite. « Droite et gauche se tiennent » écrit-il dans Socialisme fasciste. « Les uns et les autres dans le cadre national, les uns et les autres à cheval sur toutes les classes, ils participent au système économico-politique de la démocratie capitaliste. Le monde radical et socialiste est surtout attaché au côté démocratique du capitalisme, mais en défendant la démocratie, il défend le capitalisme qui en profite. Le monde nationaliste est plutôt attaché au côté capitaliste de la démocratie, mais il est emmêlé dans les affaires avec le monde de la démocratie, et il a besoin de la démocratie pour garder les aises qu’elle lui procure. » Une conception de plus en plus désolée et pessimiste du monde l’habite4. Les partis de droite et les partis de gauche qui avaient vainement espéré s’emparer de la force de Drieu le criblent de sarcasmes. Ils créent la légende du Drieu « oscillant entre vingt partis », popularisée par l’affreux petit Canard enchaîné. Drieu, dans Socialisme fasciste, constatait : « Dans l’AF, on me considère plutôt comme un avorté que comme un sournois ; dans Commune, comme un sournois plutôt que comme un avorté ».
L’idée fasciste mûrit peu à peu en lui, « cette envie de faire une politique de gauche avec des gens de droite et de voir ces hommes de droite amendés, élargis, par cette politique… cette envie de redresser les hommes de gauche en les reprenant dans une discipline, en leur redonnant le sens du prestige, de l’élégance (l’élégance, rien de plus populaire), cette passion de révolutionner et de pourtant continuer ». La conjonction du socialisme et du fascisme lui apparaît : socialisme fasciste. Il retrouve la source pure et nationale de Mesure de la France ! Le cycle est bouclé. Son fascisme éclatera le 6 février, où Drieu courut sous les balles avec les manifestants, aux abords immédiats de la place de la Concorde : « En un instant il fut transfiguré. Regardant à sa droite et à sa gauche, il se vit entouré par le couple divin, la Peur et le Courage, qui préside à la guerre ». On sait la suite et comment il adhéra en juin 1936 au PPF. Il y défendit pendant deux ans les grandes lignes d’un fascisme idéal : « Le fascisme n’est pas une doctrine, c’est une méthode, c’est la direction du siècle. À nous de lier ces trois forces éparses : le socialisme, la religion, l’esprit viril. Le fascisme sera une véritable révolution, c’est-à-dire un tour complet de l’Europe sur elle-même, par le mélange du plus ancien et du plus nouveau » (Gilles)5.
Arrivé au terme de ce bref coup d’œil sur la pensée et la vie de Drieu, il ne nous reste plus qu’à tenter d’en dégager les constantes. Il semble que ce soit Drieu lui-même qui s’en soit le mieux chargé. Dans la préface de Chronique politique, recueil de ses articles entre 1934 et 1943, à l’exception de ceux, publiés dans L’Émancipation nationale, qu’il avait déjà réunis dans le volume Avec Doriot, Drieu a écrit :
« Au milieu du fatras des personnalités changeantes, des idéologies incomplètes, des actions tronquées, je crois être toujours resté sauvagement fidèle à deux ou trois points principaux qui s’étaient de bonne heure fixés en moi et que j’étais prêt à servir n’importe où et n’importe comment :
1°) Dès mes premiers poèmes, en 1917, j’ai voulu conjuguer l’amour de la France et l’amour de l’Europe ;
2°) J’ai vu des mérites et des nécessités aussi bien dans le capitalisme finissant que dans le socialisme naissant ;
3°) J’ai cherché la renaissance des valeurs d’aristocratie et d’autorité en dehors de tous les prestiges du passé et sous tous les masques où elle pouvait se dissimuler pour s’assurer l’avenir. »
Il n’y a sans doute pas grand-chose à ajouter à ce bilan personnel6. Saluons en Drieu qui, pendant vingt-cinq ans a appliqué toute sa lucidité, sa curiosité et son honnêteté à l’examen des étranges bouleversements de notre siècle, un des prophètes de notre temps7.
____________________________________
1 La famille de Drieu n’appartenait pas à l’aristocratie. Pierre Andreu rectifiera lui-même cette erreur dans une passionnante biographie de l’écrivain normand : Drieu, Témoin et Visionnaire, Grasset, 1952.
2 Dans son premier livre de poèmes, Interrogation, Drieu a écrit :
« Caserne, si nous te retrouvons au bout de notre retour, nous crèverons ta. façade et extirperons tes fondements.
Caserne, tu es la mort, mais nous rapporterons de la tranchée franche ouverte au ciel la vie !
Caserne, nous te rebâtirons. […]
Nous avons agonisé et haï là-dedans.
Nous avons clouté et désespéré.
Nous avons gâché notre belle jeunesse.
Nous nous sommes ennuyés. »
3 On trouvera ces idées précisées dans Notes pour comprendre le Siècle.
4 Au fond, elle a toujours été la sienne. Dans la préface de ses Écrits de Jeunesse, Drieu écrit : « Après le bref mouvement de joie et de satisfaction de la guerre, dès que mes yeux se tournent vers la paix, avant même que la guerre ne soit finie, je deviens sombre. Allant tout droit aux ressorts fatigués de la civilisation, je m’effraie. Un jugement sévère, puis désespéré, se forme en moi. Dès lors seul l’amour pourra parfois me délivrer de la colère et de la malédiction. J’ai cherché aussi quelquefois un refuge dans l’humour ».
5 « De même que vis-à-vis de l’Église, vous ne confondez pas ses directives politiques et ses directives spirituelles, vis-à-vis du fascisme vous n’accorderez pas la même considération à son principe universel et aux puissances qui l’incarnent et à l’occasion en abusent » (Gilles).
6 Il faut ajouter pourtant que sur un autre plan, l’œuvre de Drieu se situe dans la ligne philosophique de la pensée antirationaliste française de la fin du XIXe siècle et du XXe siècle. Vingt ans après Péguy et Sorel, avec d’autres moyens et par d’autres voies, il a repris le combat contre le rationalisme. Pour lui, la décadence irrémédiable de l’humanité, jusqu’au sursaut du XXe siècle, a été consommée par la Renaissance et la Réforme (cf. sur ce point Notes pour comprendre le Siècle).
7 « Je suis d’abord un écrivain prophétique. Et ma seule façon de défendre mon œuvre, c’est de mettre bien en vue ce caractère insolite » a écrit Drieu dans la préface de ses Écrits de Jeunesse.
























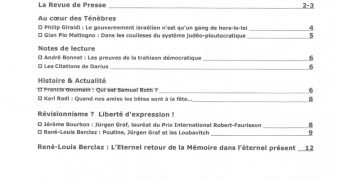


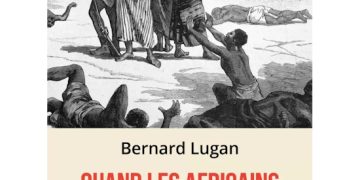



 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV