Tradition et intervention (par Enzo Erra)
Traduction du texte d’Enzo Erra « Tradition et intervention » publié dans le n° 17 de Tabou, aux Éditions Akribeia, 2010, par Philippe Baillet. L’article original, « Tradizione e intervento » a été publié dans Julius Évola, Orientamenti, Edizioni di Ar, Padoue, 2000, p. 73-80.
 Quand Mussolini fit demander un avis à Vilfredo Pareto sur ce qu’il s’apprêtait à faire mais qu’il était encore temps de ne pas faire, la réponse fut brève et précise : « Maintenant ou plus jamais ».
Quand Mussolini fit demander un avis à Vilfredo Pareto sur ce qu’il s’apprêtait à faire mais qu’il était encore temps de ne pas faire, la réponse fut brève et précise : « Maintenant ou plus jamais ».
Cette réponse laconique qui contribua à pousser le fascisme vers le pouvoir, mais aussi vers une série de contradictions et de compromis qui dura plus de deux décennies, revient à l’esprit lorsqu’on relit les pages d’Orientations à un demi-siècle de distance de la première édition. Certes, il n’est pas permis de se demander quel conseil Julius Évola aurait donné s’il avait été interpellé dans cette circonstance ou dans une circonstance analogue, car nul ne peut ni ne doit se risquer à parler à sa place. Toutefois, le contraste entre le brusque changement de cap qui fut imprimé en octobre 1922 à un mouvement si différent des milieux avec lesquels il était conduit à signer un pacte, et la ligne inviolable et absolue tracée dans sa brochure, est tellement net que la réponse semble venir toute seule sur les lèvres. Du reste, ce dont on ne peut pas douter c’est du genre de pensées qu’Orientations fit naître chez bon nombre de ceux qui, au début des années cinquante, en connurent et en partagèrent les thèses. Ce texte les poussa à un réexamen critique, et parfois drastique, non seulement des modalités et des formes sous lesquelles l’idée fasciste s’était imposée et réalisée comme motif inspirateur d’un régime, mais du régime lui-même, enfin du caractère de cette idée et du rôle particulier qu’elle avait joué dans le cadre général du XXe siècle.
Cela ne se fit pas sans de bonnes raisons, d’ailleurs, même abstraction faite de la rigueur évolienne. L’histoire même du fascisme, en effet, soulevait des problèmes et autorisait des doutes. Dès le début, la tentative menée par Mussolini s’était présentée avec une grande part de risque et une issue incertaine, au point que Pareto, tout en incitant à l’action, avait exprimé en ces mêmes jours de veille, dans une lettre à l’écrivain Vian parue dans la revue Gerarchia, la crainte que Mussolini n’eût pas vraiment l’intention ou la capacité de détruire – comme avaient fait avant lui Auguste, Cromwell et Napoléon – les formes dans lesquelles il s’apprêtait à « s’abandonner ». Plus tard, l’assise même du régime, avec sa charge novatrice toujours bloquée à mi-chemin, avec ses défauts et ses lacunes, devait justifier la perplexité – manifestée par Pareto, mais nourrie par d’autres également – sur les réelles perspectives de l’entreprise. Enfin, la conclusion dramatique de l’aventure, avec les déchirements internes qui, en juillet 1943, atteignirent la direction du fascisme, et avec l’attaque traîtresse déclenchée par les forces auxquelles le fascisme s’était allié vingt ans plus tôt et avec lesquelles il avait constitué et guidé le régime, semblait avoir fourni la démonstration pratique et la preuve irréfutable de ce qui arrive lorsqu’on se détache d’une attitude de cohérence limpide pour se hâter de saisir, dans leur précarité inévitable, les fruits immédiats offerts par les circonstances.
Les thèses d’Orientations, bien que ne contenant pas de références directes et spécifiques à tout ce processus, en suggéraient avec une clarté transparente l’interprétation et les causes ; dans le même temps, elles fournissaient les instructions et la méthode pour ne pas retomber dans une involution analogue. De l’implacable logique évolienne naissaient donc un jugement très dur, bien que seulement implicite, sur les modalités d’existence et de comportement du fascisme « historique », et une incitation – explicite – à ne plus jamais s’écarter, même avec une déviation apparemment innocente, d’un ferme et sûr ancrage idéal, pour s’abandonner aux attraits et aux pièges du pragmatisme. L’effet fut très fort sur les jeunes qui dans les années cinquante se réclamaient de l’expérience fasciste, et en particulier de celle de la République sociale italienne, et qui furent les premiers à lire ce texte. Mais cet effet s’exerça dans plusieurs directions et sous différents aspects. Bon nombre de ces jeunes étaient revenus depuis peu de la guerre ; d’ailleurs, contrairement à ce qui fut parfois écrit et qui a été répété récemment, cette guerre ils avaient « eu le temps »1 de la faire. Mais non de la « perdre », car, dans leur vocabulaire et leur façon de penser, ces mots n’existaient pas. Pour eux, avril 1945 n’avait été qu’un coup d’arrêt. Cette date n’avait pas impliqué une solution de continuité, encore moins un changement d’état d’esprit ou de résolutions. Dans la plupart des cas, ils étaient passés directement des opérations militaires ou du camp de concentration à l’activité clandestine puis à l’activité politique. Ils se sentaient, et étaient bel et bien, des « combattants », non des « anciens combattants ». Ils ne regrettaient rien, car ils estimaient n’avoir rien perdu ; ils n’étaient pas tournés vers le passé parce que ce qui avait été se continuait dans le présent. Pour eux, les termes « nostalgiques » et « néofascistes » – qualificatifs dont se servaient leurs ennemis pour les diffamer et les tourner en dérision – n’avaient pas de sens.
Autour d’eux, naturellement, se rassemblaient d’autres jeunes du même âge, qui, surtout dans le sud du pays, s’étaient retrouvés coupés du cours des opérations, et les très jeunes qui – pour quelques années, parfois quelques mois de différence – n’avaient, eux, « pas eu le temps » de participer à la guerre. Mais pour ces garçons également la guerre n’avait été que la phase militaire d’une lutte dont le décor avait maintenant changé, non le sens ni l’enjeu. Pour eux aussi, par conséquent, le combat n’était pas, ou pas encore, perdu. Pour ceux, à peine plus âgés, qui avaient eu la « chance » (car c’était ainsi que l’on pensait et sentait, même si c’est difficile à croire dans le climat d’aujourd’hui) de combattre les armes à la main, ils éprouvaient de l’admiration, de l’« envie », un sentiment d’émulation, assurément pas de rivalité et encore moins d’hostilité. Les uns et les autres constituaient un seul milieu humain, où avaient cours des vues et des tendances variées, nées de mentalités ou d’exigences spirituelles différentes, et non d’une fracture générationnelle qui ne pouvait pas se manifester entre ceux qui avaient vingt ans et ceux qui en avaient dix- huit.
Ce fut à cette mouvance dans son ensemble et sans y chercher un sillon qui n’existait pas qu’Évola s’adressa avec ses premiers articles écrits pour La Sfida et pour Imperium, puis avec la conception plus complexe bien que toujours synthétique tracée dans Orientations. De ses lignes transparaissait le diagnostic qu’il avait prophétiquement posé dans les années vingt et trente, diagnostic désormais dramatiquement confirmé par la victoire militaire de la coalition américano-soviétique, expression concrète de ce monde libéral-marxiste né de la double Révolution française et russe dont il avait sondé jusqu’au plus profond l’unité essentielle dans Révolte contre le monde moderne, et qui lui apparaissait encore uni, y compris à travers la fallacieuse opposition postérieure à 1945 entre l’Est et l’Ouest. Dans Orientations, l’enquête historico-philosophique, sans quitter son niveau supérieur et même en accentuant sa radicalité, était immédiatement transposée du plan de la doctrine à celui de l’actualité ; l’enseignement théorique devenait avertissement impérieux, directive pratique. Dans les premières années de la « guerre froide », et alors que planait la menace imminente d’un troisième conflit « chaud », il était bien difficile de voir au-delà des apparences, de découvrir le lien essentiel entre les deux camps, et d’échapper à la tentation de choisir, de « prendre parti ». En désignant la cible non pas dans l’un ou l’autre camp, mais dans leur matrice commune, Orientations fit sur bon nombre de ses lecteurs l’effet d’un vaccin salutaire.
La conscience d’avoir en face de soi non pas des sujets politiques ou des modèles idéologiques différenciés, mais un seul (bien que multiforme) adversaire, que l’on ne pouvait affronter dans ses diverses et ultimes déterminations sans en définir et en garder toujours à l’esprit l’essence originelle, devint ainsi une lucide orientation de pensée et un guide ferme et catégorique de l’action. Dans le climat confus de l’après-guerre, il y avait prolifération des déviations incohérentes, démocratiques ou socialistes, libre-échangistes ou dirigistes, étatistes ou libertaires, modérées ou progressistes. Elles étaient favorisées par les séquelles de l’expérience historique dont on a parlé, expérience complexe et très discutable, mais aussi par le caractère anti-idéologique du fascisme, qui en raison de sa nature même n’avait jamais formulé – et n’aurait jamais supporté – une structure rigide de règles obligatoires, et n’avait donc pas pu projeter au-delà de sa chute institutionnelle et politique une référence conceptuelle sûre et univoque, capable de fonctionner comme centre ordonnateur et force d’attraction après la disparition du Chef et la dispersion de la classe dirigeante. Envers ces tendances disparates, dont certaines en particulier la tendance socialiste – avaient dangereusement pris racine, les inflexibles préceptes évoliens eurent un véritable effet thérapeutique, tout à la fois chirurgical et immunitaire.
Comme l’onde concentrique provoquée dans l’eau par une pierre dure et compacte, l’influence de cette forte charge de pensée s’étendit très au-delà du noyau, qui était et resta toujours restreint par nature, de ceux qui acceptaient et suivaient in toto l’enseignement d’Évola, y compris sur le plan métaphysique et ésotérique. Il n’était pas nécessaire d’être « évolien » au sens strict ou – comme l’on commença à dire en reprenant là encore en bonne part un sobriquet forgé par les adversaires – un « fils du soleil », pour se sentir membre d’un monde opposé à un autre monde, porteur d’une conception spirituelle et morale en opposition totale et déclarée au matérialisme et à l’hédonisme qui triomphaient partout après la victoire obtenue par les puissances démocratiques de l’Ouest et communistes de l’Est. D’autres tendances et poussées qui allaient dans la même direction coïncidaient avec ce choix idéal et civil. Elles venaient de différentes sources, dont certaines affichaient un fier désaccord avec le cœur même des théories évoliennes et avec la structure plus générale du système d’Évola.
L’idée d’une chute de l’humanité dans la dégénérescence matérialiste, et d’un dangereux glissement supplémentaire vers un niveau infra-humain, avait été formulée dès le début du siècle par la Science de l’Esprit de Rudolf Steiner – nettement rejetée par Évola –, puis avait été vigoureusement reprise et développée, dans les années dont nous parlons, par Massimo Scaligero2. Ami personnel et fraternel d’Évola lui-même, comme lui collaborateur de La Sfida et d’Imperium, Scaligero était le guide spirituel d’un groupe nombreux et croissant de jeunes et de moins jeunes. Mais d’autres secteurs plus différents et plus éloignés ressentaient eux aussi la fascination de l’appel évolien à l’opposition intégrale et à l’intransigeance. Le renvoi à la Tradition, par exemple, résonnait avec force dans des milieux monarchistes et légitimistes (milieux cependant en lien avec des dynasties différentes) qui désapprouvaient, pour plusieurs raisons historico-institutionnelles, ceux qui se réclamaient directement de la RSI. Mais ce renvoi influençait également les secteurs catholiques les plus liés à l’orthodoxie et les moins exposés aux tentations modernistes, au point que plus tard, dans les années soixante et soixante-dix, une forme de traditionalisme catholique née de cette poussée se développa, jusqu’à exercer une véritable fonction hégémonique sur toute la pensée de cette mouvance. Enfin, l’aspiration spiritualiste de la brochure évolienne et l’interprétation, dans ces termes supérieurs, de l’affrontement général et universel en cours intéressaient aussi des penseurs et groupes idéalistes, gentiliens et même hégéliens, lesquels se heurtaient pourtant à Évola sur le plan différent du débat philosophique.
Ainsi, sur ce terrain où se mêlaient la conception du monde, la doctrine politique et la méthodologie pratique, s’était formée ce que l’on pourrait appeler la « mentalité évolienne ». Elle débordait son milieu d’origine et finissait par s’imposer à ceux qui se référaient à d’autres courants de pensée, ou bien à ceux qui n’en suivaient aucun, ou encore à ceux qui, de manière pragmatique, les jugeaient tous superflus ou dommageables. Cette mentalité eut pour effet immédiat et visible de préserver de quelques vilaines dégringolades la mouvance qui avait survécu au cyclone de la guerre, et qui maintenant cherchait à se donner une assise et une raison d’être dans la situation nouvelle. Dans le même temps, cependant, elle fit aussi beaucoup pour la rigidifier. Tandis qu’elle aidait cette mouvance à se définir avec des contours plus nets, elle la coupait d’une réalité complexe – nationale et internationale – qui était observée et appréciée non plus dans une perspective de participation et d’innovation, mais avec mépris et rejet, non plus comme un parcours de lutte et un champ d’action, mais comme un marécage insidieux à éviter pour ne pas s’y enfoncer, non plus comme une substance malléable à modeler et à transformer, mais comme une carcasse putride à ne pas toucher pour se garder de tout risque de contamination.
Ce qui disparaissait ainsi, même s’il était difficile de s’en rendre compte à l’époque, c’était précisément la nature particulière du fascisme, qui s’était identifié dès sa première origine à l’interventionnisme, donc à la capacité d’agresser le réel pour le modifier, pour en renverser les règles, pour en détourner le cours. Tel avait été le point de départ pour Mussolini, quand, en 1914, il était sorti du Parti socialiste non seulement et non pas tant pour entraîner l’Italie dans la guerre, que pour affirmer la faculté humaine de susciter et de hâter les événements, de ne pas subir le destin mais de le forger et de le guider. La confiance dans l’intervention de l’homme comme générateur de la société et facteur de propulsion de l’histoire avait défini le caractère et même, est-on tenté de dire, la physiologie du type humain fasciste, l’opposant au type libéral-marxiste qui, lui, succombait passivement au « progrès » et aux « lois objectives », considérées comme des forces impersonnelles que l’on peut soutenir mais non pas combattre, auxquelles on peut participer mais auxquelles on ne peut pas se substituer. C’était l’opposition entre interventionnisme et déterminisme qui avait fait du fascisme le phénomène nouveau du XXe siècle, qui lui avait conféré le rôle d’ennemi unique et légitime des idéologies et des forces politiques du XIXe siècle.
Or l’on voyait naître, précisément dans le noyau le plus authentique et le plus vivant de la renaissance fasciste, une façon de penser qui de nouveau considérait le monde et les vicissitudes terrestres comme des faits objectifs, doués d’un mouvement autonome et de règles propres, et dont l’homme ne peut se préserver qu’en se soustrayant à leur pression, en faisant appel aux valeurs supérieures de l’Être.
« Il est inutile de se faire des illusions avec les chimères d’un quelconque optimisme : nous nous trouvons aujourd’hui à la fin d’un cycle ». Orientations s’ouvrait sur ce préambule significatif, et ceux qui connaissaient d’autres ouvrages d’Évola y découvraient un clair renvoi à la cosmologie indoaryenne, qui scande le cours de l’univers et l’existence de l’humanité à travers une succession de cycles, dont chacun est subdivisé dans la série descendante des quatre âges, après le dernier desquels un nouveau cycle commence. Dans cette perspective, la décadence du monde moderne est le signe de la dernière phase du cycle, de l’« âge sombre », contre lequel il faut assurément combattre, non pour tenter de le modifier en entretenant l’illusion de pouvoir en inverser ou en détourner le cours, mais pour rassembler des forces et les maintenir pures et invaincues, dans l’attente de les transmettre au-delà du point où le processus de chute s’épuise, quand la roue cosmique se remet à tourner.
Les diagnostics limpides et les normes rigoureuses posés dans la brochure découlaient, avec une logique implacable, de ce préambule, à la lumière duquel ils devaient être compris et expliqués. Ainsi s’affirmait une nouvelle forme de déterminisme, non plus matérialiste mais spiritualiste, mais qui n’en divergeait pas moins de la poussée originelle qui avait engendré le fascisme puis en avait marqué et caractérisé la trajectoire. Aujourd’hui, lorsqu’on reconsidère à plusieurs décennies de distance tout le problème dans ses différents moments, il n’est pas difficile de voir que c’était précisément son tempérament interventionniste qui avait conduit Mussolini à choisir, dans le conseil de Pareto, le « maintenant » et non pas le « plus jamais ». En d’autres termes, le fascisme avait pris le pouvoir de façon insatisfaisante, compromettante et risquée, précisément parce qu’il était le fascisme, parce que sa nature immédiatement reconnaissable l’avait poussé à agresser les événements, à forcer la main à l’« histoire », à courir le risque, à tenter le tout contre le tout. Il est difficile de dire ce qui serait survenu si le fascisme, renonçant à être lui-même, n’avait pas osé. Mais tout laisse à penser qu’au lieu du « maintenant » on aurait vraiment eu le « plus jamais », que l’instant fatal serait passé et ne serait jamais revenu. Tant mieux ? Plutôt ne pas « pourrir » que de tomber dans les pièges d’un jeu trompeur et contraignant ? Plutôt ne pas créer un régime que d’accepter de le créer en le grevant dès le départ d’hypothèques dont il ne se libérerait pas, en lui inoculant le germe fatal qui le rongerait de l’intérieur, le prédisposant ainsi à la crise finale ?
Au début des années cinquante, quand tout apparaissait encore en suspens, que rien n’était décidé, ces problèmes ne se posaient pas abstraitement de manière académique, mais nourrissaient les états d’âme, précédaient les attitudes et les décisions. Que faire ? Fallait-il se précipiter de nouveau dans le tourbillon d’événements dont on ne pouvait pas forcer le cours fatal, comme on l’avait déjà vu une fois ? Devait-on se mêler encore aux ferments de la décomposition, non plus avec le danger mais désormais avec la certitude, qui venait de l’expérience déjà faite, de devoir se résigner aux demi-mesures, aux entreprises inachevées, aux déceptions chroniques, et en dernier lieu à l’échec final ? Fallait-il, enfin, s’apprêter à parcourir à nouveau, et cette fois avec les yeux ouverts, un itinéraire qui, « à la fin d’un cycle », ne pouvait pas avoir d’autre cours ni d’autre débouché ?
On comprend aisément que lorsqu’on répond négativement à ces questions, on risque de jeter tout ce que le fascisme a été, et qu’il n’aurait pas été s’il avait renoncé à être pour se garder les mains propres. Si aujourd’hui le fascisme est considéré, y compris par les plus acharnés de ses critiques, comme l’une des réalités du XXe siècle et comme l’une des clés pour en comprendre le sens, c’est parce qu’il a gouverné pendant vingt ans une grande nation, qu’il l’a guidée dans de vastes entreprises civiles et dans des aventures militaires épiques, qu’il l’a transformée, fût-ce pour une brève période, en un Empire, qu’il en a fait l’artisan et le porte-drapeau d’une idée universelle qui a longtemps tenu le choc face aux idéologies matérialistes et aux puissances supranationales et extra-européennes qui les soutenaient. Sans le régime fasciste avec toutes ses carences et les compromis qui ont été le prix de son existence, l’Europe n’aurait pas mené le dernier combat pour se soustraire à l’asservissement, une chape de plomb aurait étouffé le monde avec vingt ans d’avance, l’extrême tentative de le sauver dans un affrontement gigantesque et apocalyptique n’aurait pas eu lieu. Et il n’y aurait pas eu la République sociale italienne, qui, en le rachetant ou en tentant de le racheter partiellement de ses erreurs, succéda au régime fasciste, cette RSI qui n’aurait certainement pas pu naître à partir de rien.
Par ailleurs, et en mettant tout cela de côté, ne devait-on pas également apurer les comptes avec les milieux humains et avec les courants artistiques et de pensée qui, hier, avaient accompagné l’entreprise ? Comment conduire sur le plan supérieur d’une aristocratie olympienne et ascétique les squadristes expéditifs et insolents de Balbo et Farinacci, les dockers de Padovani3, les ouvriers de Rossoni4, les colons des Marais Pontins, les foules acclamantes et hurlantes, les chansons paillardes et les poignards entre les dents ? Et que faire du patriotisme déclamatoire, typique du Risorgimento, de D’Annunzio, que faire de Gentile avec son « État éthique » et son « humanisme du travail », de Marinetti et de ses invectives contre la tradition ? Faire place nette de tout cela ? Certes, on pouvait et peut-être l’on devait faire un fascisme totalement neuf, différent du premier non seulement dans les propositions et les objectifs, mais aussi dans l’aspect, dans la « coupe », dans le comportement, dans les ressources humaines. Mais ce nouveau fascisme – que déjà, comme par hasard, on préférait appeler « traditionalisme » dans certains groupes plus hardis, plus conséquents et plus radicaux –, n’aurait-il pas perdu, avec ce que l’on considérait comme des scories et des déformations, la charge puissante et explosive qui avait conduit le fascisme au succès et au consensus, qui avait fait de lui l’interprète d’un peuple et le protagoniste d’un bon morceau d’histoire ? Ce « traditionalisme » n’aurait-il pas été semblable aux autres traditionalismes, ceux qui en France, en Espagne, en Allemagne, en Autriche et ailleurs, avaient empêché qu’un idéal élevé et noble disparût, mais qui n’étaient jamais sortis de leurs limites, n’étaient jamais arrivés à autre chose et, peut-être, n’y avaient jamais aspiré ?
Tel était le problème que le poids du passé, d’un côté, l’urgence de l’avenir, de l’autre, posaient aux jeunes des années cinquante. Orientations les préserva du danger de tomber dans l’un des prolongements des idéologies socialistes ou libérales-démocratiques (comme cela est advenu au gros de la mouvance il y a quelques années), et dans le même temps les plaça face au second terme du choix entre deux manières d’être, terme qu’il eût été, autrement, difficile d’apercevoir. Ceux qui lurent la brochure ressentirent clairement le dilemme. Ceux qui la relisent maintenant le voient revenir devant eux. Car un demi-siècle a passé, mais le dilemme n’a pas été tranché.
Enzo Erra5.
____________________________________























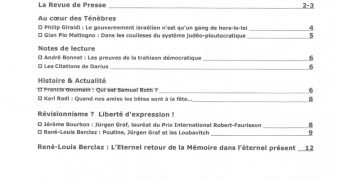


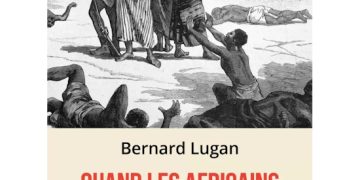



 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV




