Tocqueville et/ou Hitler ?
Petit test : de qui sont les citations suivantes, d’Alexis de Tocqueville, le grand observateur de la démocratie américaine, ou d’Adolf Hitler, le dictateur allemand :
« Il n’y a, en général, que les conceptions simples qui s’emparent de l’esprit du peuple. Une idée fausse, mais claire et précise, aura toujours plus de puissance dans le monde qu’une idée vraie, mais complexe. »
« Or, il n’y a au monde que le patriotisme, ou la religion, qui puisse faire marcher pendant longtemps vers un même but l’universalité des citoyens. »
« Le plus redoutable de tous les maux qui menacent l’avenir des États-Unis naît de la présence des noirs sur leur sol. »
« Aussi longtemps qu’une religion trouve sa force dans des sentiments, des instincts, des passions qu’on voit se reproduire de la même manière à toutes les époques de l’histoire, elle brave l’effort du temps, ou du moins elle ne saurait être détruite que par une autre religion. »
« La force est donc souvent pour les nations une des premières conditions du bonheur et même de l’existence. [. . .] Je ne sache pas de condition plus déplorable que celle d’un peuple qui ne peut se défendre ni se suffire. »
« On [les colons américains] transportait ainsi la législation d’un peuple rude et à demi civilisé [les israélites] au sein d’une société dont l’esprit était éclairé et les mœurs douces ».
« Voyez-vous cet opulent citoyen ? ne dirait-on pas un Juif du moyen Âge qui craint de laisser soupçonner ses richesses ? »
 C’est bien entendu Tocqueville l’auteur de toutes ces considérations [1], mais vous êtes excusable si vous pensiez qu’elles étaient d’Hitler étant donné qu’il a lui-même fait plus ou moins les mêmes observations. Je ne sais pas si ces similitudes m’ont frappé parce que j’ai lu De la démocratie en Amérique à peu près dans le même temps que je m’aventurais pour la première fois dans Mein Kampf. J’ai en tout cas eu la nette impression qu’Hitler avait lu la célèbre grand œuvre de Tocqueville avant de s’atteler à l’écriture (la dictée) de sa propre célèbre grande œuvre. Mais qui sait, après tout, les grands esprits se rencontrent. [2]
C’est bien entendu Tocqueville l’auteur de toutes ces considérations [1], mais vous êtes excusable si vous pensiez qu’elles étaient d’Hitler étant donné qu’il a lui-même fait plus ou moins les mêmes observations. Je ne sais pas si ces similitudes m’ont frappé parce que j’ai lu De la démocratie en Amérique à peu près dans le même temps que je m’aventurais pour la première fois dans Mein Kampf. J’ai en tout cas eu la nette impression qu’Hitler avait lu la célèbre grand œuvre de Tocqueville avant de s’atteler à l’écriture (la dictée) de sa propre célèbre grande œuvre. Mais qui sait, après tout, les grands esprits se rencontrent. [2]
Je ne prétends pas que Tocqueville aurait approuvé le national-socialisme. Il y a bien sûr des différences d’accentuation : Tocqueville note l’importance de la puissance nationale et de la souveraineté, Hitler y réduit pratiquement la notion de « liberté ». Pour Tocqueville, la liberté individuelle (en particulier la liberté de la presse) et un gouvernement aux pouvoirs limités sont des garde-fous, même imparfaits, contre la tyrannie démocratique, tandis que Hitler défendait le principe d’un pouvoir ouvertement autoritaire entre les mains d’une élite pour assurer à l’Allemagne une liberté – comprise en termes de souveraineté nationale et de puissance – la plus grande possible.
Tocqueville est aussi particulièrement bien placé, avec l’exemple Napoléonien, pour considérer avec méfiance les hommes soi-disant providentiels et les États aux pouvoirs un peu trop étendus. Il se plaît à décrire la vanité du pouvoir Napoléonien comparée à l’inexorable montée en puissance de la démocratie américaine qui préfigurait déjà sa victoire sur la Prusse militariste.
Je suis néanmoins frappé par le nombre d’arguments que les deux, Tocqueville et Hitler mettent en avant :
- Que l’égalité est un mensonge et que le public doit être éclairé par une élite.
- Que l’homogénéité ethnoculturelle est la vertu cardinale de toutes les nations et même la condition préalable de leur existence.
- Que l’égoïsme individuel peut être atténué ou même sublimé en vue de la défense d’un bien commun par l’appel au patriotisme, substitut civil de la religion.
- Qu’on peut amener les citoyens à s’investir dans bien commun et à s’y identifier en les impliquant dans la vie de l’État. (Chez Tocqueville par la démocratie locale, chez Hitler par la participation aux diverses activités du parti.)
- Que le maintien de distinction de classe est stérile et voué à disparaître. Pour Tocqueville, à l’époque moderne, il est impossible de maintenir des « ordres » sociaux face à la montée en puissance d’une méritocratie bourgeoise intelligente et disciplinée. Hitler en fait une vertu et voue un culte absolu à la méritocratie en faisant la chasse aux préjugés de classe. En un certain sens, je ne pense pas qu’il soit exagéré de dire que Hitler est une sorte démocrate d’inspiration Tocquevillienne.
- Les deux ont vu venir l’émergence de l’Amérique et de la Russie comme deux nations continent contigües destinées à dominer l’Europe. Un cauchemar pour Hitler qui cherchait à l’éviter par tous les moyens.
 Bien sûr, lorsque c’est Hitler qui formule ces observations, elles sont preuves de son cynisme haineux le plus sombre (c’est ce qu’on nous enseignait à l’école), tandis que dans la bouche de Tocqueville, elles sont le signe d’un esprit lumineux tout en finesse dans son éloge de la démocratie.
Bien sûr, lorsque c’est Hitler qui formule ces observations, elles sont preuves de son cynisme haineux le plus sombre (c’est ce qu’on nous enseignait à l’école), tandis que dans la bouche de Tocqueville, elles sont le signe d’un esprit lumineux tout en finesse dans son éloge de la démocratie.
Tocqueville, en aristocrate fier de ses origines, parlait de « nos ancêtres germaniques », ces conquérants Francs dont descendait l’aristocratie française et qui ont fondé la monarchie en donnant, au passage, leur nom au pays. À cet égard, la germanophobie de la république française – avec un Sieyès appelant à renverser une aristocratie « étrangère » parce que d’ascendance germanique et le couplet de la troisième république sur « nos ancêtres les Gaulois » pour renier la composante allemande de la France – constituait une énorme régression qui n’a pas peu contribué à la guerre fratricide de 14 -18.
Je ne suis pas le seul à avoir fait ces parallèles entre la pensée d’Hitler et celle de Tocqueville même si le sujet semble encore insuffisamment exploré.
Le démographe judéo-français Emmanuel Todd a ainsi pu soutenir qu’en s’affranchissant des distinctions de classe, la révolution d’Hitler « a représenté pour l’Allemagne un moment critique de démocratisation » [3]. Léon Degrelle, le général SS Belge à qui Hitler aurait dit que « s’il avait eu un fils, il aurait voulu qu’il soit comme lui » a écrit après la guerre un ouvrage volumineux intitulé Hitler démocrate.
L’éminent historien de la Guerre Froide, l’Américain John Lewis Gaddis, a été assez frappé des prédictions de Tocqueville et d’Hitler sur la domination de la Russie et de l’Amérique. (Gaddis, bien que lui-même un très conventionnel antihitlérien a quand même déclaré en passant que Staline était plus autoritaire et meurtrier.)
L’historien John Lukacs, également antihitlérien, observe que : « Permettez-moi de revenir à Tocqueville (qu’Hitler n’a sûrement pas lu et qui aurait été un anathème pour lui). […] La majorité dans le troisième Reich, n’accordait pas un soutien passif mais actif au Führer. Hitler était plus populaire (et plus démocrate au sens large du terme) que Napoléon III, plus même que d’autres dictateurs d’Amérique du Sud ou que Mussolini ou que Kemal. En fait (comme il le disait lui-même) Hitler n’était pas vraiment un dictateur ou alors, un dictateur atypique, mais pas, comme le soutiennent certains historiens fonctionnalistes, parce qu’il aurait été hésitant, bridé par sa bureaucratie ou faible : parce qu’il était plus et autre chose qu’un dictateur. « Les tyrans d’autrefois » disait Chesterton, « évoquaient le passé, ceux d’aujourd’hui évoquent le futur » [4].
Aussi étrange que cela puisse paraître, Hitler et les nationaux-socialistes proclamaient – tout comme on le faisait aux États-Unis, en France ou en Union Soviétique – que c’était « le peuple » qui dirigeait le troisième Reich. La propagande et la rhétorique nationale-socialiste s’accordaient tout à fait sur la forme, si ce n’est sur le fond, à la fameuse devise d’Abraham Lincoln « gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». Pour les nationaux-socialistes, le troisième Reich – ainsi qu’en témoigne l’usage prolifique du préfix Volks– dans d’innombrables concepts et institutions – était un régime démocratique dans le sens le plus plein du terme.
Je ne vais pas me lancer dans une présentation de l’alpha et de l’Omega des conceptions nationales-socialistes du gouvernement populaire. Qu’il me suffise de dire que les fascistes considéraient que la démocratie libérale était au mieux une erreur, au pire une mystification : les individus ne sont pas égaux par conséquent « un homme égale une voix » ne peut pas être un principe de légitimation valide. Et de toute façon, les « démocraties libérales » sont en réalité dominées par une oligarchie qui corrompt les politiques et une élite médiatique qui forme l’opinion publique.

De plus, comme le note Carl Schmitt, les « démocraties libérales » sont trop heureuses de se changer en dictatures le temps d’une guerre, guerres qu’elles ont par ailleurs la fâcheuse tendance à déclarer sans le consentement du peuple : deux caractéristiques qui me semblent avoir particulièrement joué dans la si décisive première moitié du XXe siècle.
Pour les nationaux-socialistes, le seul régime de gouvernement populaire qui vaille, c’est lorsque les éléments les plus patriotiques et les plus éclairés de la nation dirigent. Ce n’est que lorsque ce sont ceux des Allemands qui ont le plus sens d’être Allemands qui commandent qu’on peut dire que l’Allemagne se commande elle-même. (Par opposition à ce qui se passe quand c’est une bande de politiciens internationalistes liés à des puissances étrangères et à une ploutocratie mondiale qui dirigent.)
Le fascisme, aussi bien dans sa version italienne qu’allemande, était une tentative sincère de concilier une incontournable démocratie Tocquevillienne basée sur le suffrage universel avec un régime à la fois résolument populiste et résolument aristocratique.
De nos jours, à l’ère de la prospérité et de l’internet sans frontières, c’est d’autres formes démocratiques et aristocratiques qui doivent voir le jour.
Guillaume Durocher
Source : Counter-currents
Traduction : Francis Goumain
Notes :
1.Alexis de Tocqueville, De la Démocratie en Amérique (Paris : Gallimard, 1986), volume
2.Schopenhauer, Tous les hommes qui pensent par eux-mêmes sont fondamentalement en accord
3.Emmanuel Todd, Après la démocratie (Paris : Gallimard, 2008), 140
4.John Lukacs, The Hitler of History (New York: Knopf, 2011), 111

























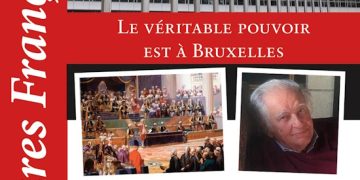





 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV







