J’ai vu brûler Tokyo
Par Robert Guillain
Voici, écrit par l’un des plus grands journalistes de son temps, un témoignage hors du commun que même les Anglo-Saxons sont obligés de traduire et de citer en entier. Robert Guillain, en effet, fut un des très rares Occidentaux à pouvoir suivre de bout en bout – et de l’intérieur – la guerre menée par le Japon allié aux puissances de l’Axe.
Présent à Tokyo en décembre 1941, au moment de l’attaque aérienne contre Pearl Harbor, il restera bloqué au Japon jusqu’en 1946. C’est donc en témoin direct qu’il a vécu toutes les étapes de cette terrifiante épopée consommée dans l’horreur d’Hiroshima dont il découvrit, parmi les premiers, les ruines vitrifiées. Au début, Tokyo s’amuse, écrit-il. On fait la fête dans les maisons de thé et les Japonais suivent, avec passion, les victoires de leurs armes dans le Pacifique. Mais rapidement vient le temps des revers et l’irrésistible reconquête des archipels océaniens par le général MacArthur. Le Japon se raidit, Tokyo s’installe dans une terrible austérité. C’est sur cette capitale exténuée, d’où partent néanmoins sans relâche les escadrilles des kamikaze, que vont s’abattre, en 1944, les terrifiants bombardements incendiaires des superforteresses américaines. Guillain est présent dans la ville en flammes où les civils meurent, ébouillantés jusque dans les canaux et châteaux d’eau où ils avaient cherché refuge : c’est ce passage du livre consacré au grand bombardement du 9 au 10 mars que nous donnons ici, le paradoxe, c’est que les tragédies d’Hiroshima et de Nagasaki ont effacé une tragédie encore plus terrible, si tant est qu’on puisse encore établir des hiérarchies à ce niveau d’horreur. Il utilise lui-même le terme d’Holocauste à deux reprises, peut-être une façon d’inverser les rôles victimes / agresseurs.
![]()
« 9 mars 1945 : une date que Tokyo se rappellera comme il se rappelle le 1er septembre 1923, date du grand tremblement de terre. Ce 9 mars, le printemps a fait irruption par surprise, comme font au Japon les saisons. Mais le beau temps, en cette époque de raids, loin de réjouir, apporte l’anxiété. Plus inquiétant encore est le vent, un vent qui a pris dans la soirée la violence d’un typhon de printemps. Le drame qui se prépare sera dû à cet ouragan. Dans toute la ville, c’est une même pensée : s’ils venaient avec un pareil vent, cela pourrait être terrible.
Avant minuit, ils sont là, et tout de suite ils travaillent à semer le ciel. Des éclairs s’allument partout dans les ténèbres, des arbres de Noël fleurissent de feu les hauteurs de la nuit, puis s’abattent en bouquets de flammes zigzagantes qui descendent en sifflant. Un quart d’heure à peine après le début de l’attaque, l’incendie fouetté par le vent commence à moissonner dans l’épaisseur de la ville de bois.
Une fois de plus, la chance, ou plutôt le plan méthodique du commandement américain, veut que mon quartier ne se trouve pas directement sous l’attaque. Une immense aurore naît au-dessus des quartiers plus au centre, que le bombardement en tapis, descendant de raid en raid, commence évidemment à gagner. La grande lueur chasse la nuit et dans le ciel apparaissent ici et là les B-29. Pour la première fois, ils volent à basse ou moyenne altitude, et à des hauteurs différentes. Dans les colonnes de fumée oblique qui commencent à monter de la ville, on voit leurs longues ailes de métal, aiguës comme des lames, briller brusquement au reflet de la fournaise, passer en silhouettes noires sur le ciel de feu, reparaître plus loin dorées sur des pans sombres de ciel, ou bleues comme des météores dans les rayons des projecteurs dont les compas s’ouvrent et se ferment sur l’horizon. Il ne sied pas sous un pareil raid de rester sans rien voir sous terre, car on pourrait se trouver rôti avant d’avoir eu le temps de comprendre ce qui se passe. Tous les Japonais dans les jardins proches du mien, sont dehors, ou à l’orifice de leurs trous, et l’on entend – la chose est bien japonaise – leurs cris d’admiration devant le spectacle grandiose, presque théâtral.
Le bombardement continue à frapper plus loin, par-delà la colline qui fait mon horizon. Mais le vent toujours aussi violent commence à charrier des débris calcinés rabattus par le ciel incendié. Les étincelles encore brûlantes se font plus nombreuses; puis des morceaux de papier ou de bois enflammés, et cela devient peu à peu une pluie de feu. Il faut sans cesse aller et venir, sur la terrasse, dans le jardin, autour de la maison, pour veiller au danger et éteindre les tisons. Dans le ciel, des grappes de torches éclatent au loin et retombent sur la ville en ondulant. Les bombes ressemblent parfois, sans doute par l’effet du liquide enflammé, à des chevelures de flammes. Ici et là s’allument, en brusques éclairs qui se poursuivent dans le ciel, les corolles rouges des tirs antiaériens, mais la défense est médiocre, et les grands B-29, volant sans ordre, paraissent travailler en liberté. Par intervalle, le ciel se vide, ils sont repartis; mais de nouvelles formations, annoncées à l’avance par la voix rauque mais toujours assurée de la radio, viennent occuper la nuit, et l’effrayante Pentecôte recommence. Des flammes ont jailli assez près, à une distance imprécise, vers la hauteur où s’achève mon quartier. On les voit se tordre sous le vent au ras des toits silhouettés en noir; des débris sombres tourbillonnent au-dessus de la tourmente. L’incendie se rapproche, il a gagné – les gens d’alentour se repassent déjà l’information – le faubourg voisin de Saramuchi, dont le nom veut dire « village de singes ». Des gens redescendent en courant la rue voisine; on entend maintenant le craquement des grands brasiers; Il paraît que c’est le bruit des maisons qui s’effondrent. Un large boulevard, là-haut, s’étend en travers de la route du feu, et plus près encore celui-ci sera arrêté par les parcs et les jardins. Le village des singes sera en partie brûlé mais, mais une fois de plus l’incendie épargne le flanc de ma colline. Et la course anxieuse des flammèches continue, tandis que la nuit fait peu à peu place à un jour noir et rose où toute la ville fume obliquement vers le ciel.

«Et l’enfer commence»
Mais tout cela n’était que l’effrayant éclairage du drame, et celui-ci s’est passé plus loin dans le nord-est et l’est de la capitale. J’en rapporterai les récits tels que je les ai recueillis dans les jours suivants et plus tard. La région visée est le plat pays de Tokyo, la zone indéfiniment étendue du Tokyo populaire, ouvrier et usinier. Là se trouvent non seulement les grandes usines et les habitations de tous ceux qui y ont leur emploi, mais aussi les innombrables ateliers où les artisans et les familles travaillent, souvent à domicile, pour la défense nationale. C’est ce qu’on appelle le « côté de la plaine », par opposition au « côté de la montagne » dont les quartiers résidentiels sont clairsemés par les collines de l’Ouest et du Sud. C’est bien une plaine en effet, où les faubourgs serrés comme une jungle tassent l’épaisseur compacte de leurs quartiers surpeuplés, agglutinés en une seule masse dans le quadrillage des ruelles étroites. À part quelques avenues rectilignes et un lacis de canaux croupissants, la rivière Sumida fraie seule une large voie à travers cette agglomération aux milliers de logis en bois. Sur la rive gauche, Fukagawa avec ses docks en façade sur la baie de Tokyo, Honjo et Mukojima peuplés d’usines ; sur la rive droite, Asaxa, Shitaya et les parages de Kanda et de Nihombashi : ce sont les principaux morceaux de ville marqués pour l’holocauste. Les premières superforteresses, vers minuit, lâchant par centaines les faisceaux de cylindres incendiaires que le populaire a baptisé « panier de fleurs de Molotov », délimitent par quatre ou cinq grands incendies le pourtour de la zone à détruire. D’autres vagues viennent bientôt semer les bombes incendiaires à l’intérieur des cercles flamboyants. Et l’enfer commence.
Les habitants restent héroïquement sur place, sous les bombes, fidèles aux ordres qui prescrivent à chaque famille de défendre soi-même son logis. Mais comment maîtriser l’incendie par un vent pareil et quand une maison reçoit jusqu’à dix bombes ou bien davantage ? Car ces engins ne pèsent pas plus de trois kilos chacun et tombent par milliers en une véritable pluie. Leurs cylindres de métal lâchent d’ailleurs en plein vol une rosée incendiaire qui glisse le long des toits, enflamme tout ce qu’elle éclabousse, et répand partout une coulée de flammes dansantes. C’est la première version du tristement célèbre napalm. Les pauvres défenses des milliers de pompiers amateurs, maigres jets d’eau des pompes à main, nattes mouillées ou sable qu’on jette sur l’engin quand on peut approcher d’assez près sa terrible chaleur, se montrent complètement impuissants. Les toits crèvent souvent sous l’impact des bombes et, en quelques minutes, la frêle maison de bois et de paille flambe, toute illuminée de l’intérieur comme une lanterne de papier. Le vent en ouragan s’enfle encore des grands souffles de l’incendie, rabattant horizontalement des planches en feu qui blessent les gens et allument les choses. Le feu d’un pâté de maison distant rejaillit brusquement tout proche, avançant avec la vitesse d’un incendie de forêt. Les familles hurlantes décident de tout abandonner, parfois les femmes sont déjà parties, emmenant des bébés, traînant des caisses ou des matelas. Trop tard : au bout de la route, le cercle de feu a fermé la route. Partout c’est tôt ou tard l’encerclement.
La police est là et les pompiers impuissants, qui tentent encore un moment de contrôler les foules en fuite, les dirigeants vers les trouées noircies par lesquelles des incendies antérieurs ont parfois ménagé une issue. Dans les rares endroits où fonctionnent des lances d’incendie – car l’eau manque ou est sans pression dans la plupart des canalisations – les pompiers inondent les fuyards sous leurs jets d’eau afin de leur permettre de franchir sans prendre feu les passages les plus brûlants. Ailleurs, les gens se trempent dans les baquets d’eau qui sont devant chaque logis, avant de reprendre la fuite. Mais la fuite est entravée par d’innombrables obstacles; les poteaux électriques et les fils, dont un épais réseau enserre Tokyo, s’abattent en travers de la rue. Dans la fumée épaisse, où le vent et si brûlant qu’il rôtit les poumons, les fugitifs s’abattent, avant de brûler bientôt sur place. L’air incendié est rabattu par le vent au niveau du sol, et c’est souvent par les pieds que les fuyards commencent à brûler: les bandes molletières des hommes ou les jambes de pantalon des femmes flambent en premier, et le reste du vêtement suit.
La tenue de raid, dont le gouvernement a répandu le modèle dans la population civile, comporte d’épais capuchons ouatés qui couvrent la tête et les épaules. Ils sont censés protéger surtout les oreilles contre le souffle des bombes … explosives, alors que depuis des mois Tokyo reçoit surtout des bombes incendiaires. Les capuchons s’enflamment sous la pluie de flammèches, et les gens qui ne prennent pas feu par en bas brûlent par la tête. Les mères qui portent leur bébé sur le dos, selon la coutume japonaise, s’aperçoivent souvent trop tard que les vêtements capitonnés qui enveloppent l’enfant ont pris feu. Les fuyards s’entassent avec leurs paquets dans les rares espaces libres, carrefours, jardins et parcs: mais les bagages prennent feu plus vite encore que les vêtements, et la foule flambe de l’intérieur.
Des centaines de gens renonçant à fuir, s’enfouissent dans les trous qui leur servent d’abri, avec ou sans leurs précieux bagages: on les retrouvera carbonisés. Des familles entières périssent dans les cavités qu’elles ont établies… sous leurs maisons de bois, tant est limité l’espace disponible pour creuser le moindre abri dans la ruche surpeuplée de ces quartiers pauvres: la maison s’écroule sur eux et brûle, les cuisant dans leur trou, à l’étouffée.
Les fronts d’incendie avancent avec une telle rapidité qu’en beaucoup d’endroits la police n’a pas le temps de faire évacuer les îlots menacés, à supposer qu’une retraite soit libre. Et l’incendie renaît sous le vent en des endroits inattendus, semé au loin par les débris volants. Les pompiers de toute l’autre moitié de la ville essaient de pénétrer dans l’enfer ou de l’attaquer sur son pourtour, mais ils ne peuvent guère aborder l’incendie qu’en le contournant pour se trouver sur le vent, là où leur action est inefficace et où le sinistre a déjà tout emporté. On voit se reproduire un phénomène qui avait terrorisé Tokyo au grand incendie de 1923 : par l’effet du vent et du formidable souffle de l’incendie, se créent en plusieurs endroits d’immenses tourbillons ardents qui tournoient en abattant tout et en aspirant des pâtés entiers de maisons dans leur maelstrom de feu.

Partout où passent des canaux, les foules se jettent à l’eau; là où la fosse verticale en est peu profonde, les gens attendent, à moitié enfoncés dans une vase immonde, la bouche au ras du flot; on les retrouvera morts par centaines, non pas noyés, mais étouffés par l’air brûlant et les fumées d’alentour. En d’autres endroits, la température de l’eau monte rapidement, devient intolérable, et les malheureux baigneurs périssent; on retrouvera des cadavres bouillis. Certains canaux communiquent directement avec la Sumida : à la montée de la marée, les occupants perdent pied et se noient. À Asaxa et Honjo, les foules se réfugient sur les ponts: mais ceux-ci sont en métal et peu à peu s’échauffent : des grappes humaines accrochées aux rambardes devenues brûlantes finissent par lâcher prise et tomber à l’eau qui les emporte. Sur les deux rives de la Sumida, des milliers de réfugiés refluent dans les parcs et les jardins qui s’allongent au bord du fleuve. La panique rabattant une multitude toujours plus pressée sur l’étroite bande de terrain, la poussée irrésistible refoule progressivement les gens vers la rivière, et les pans successifs d’une humanité hurlante s’abattent et s’engloutissent dans l’eau profonde. On retrouvera dans l’estuaire de la Sumida des milliers de noyés.
À Asaxa, la foule s’est réfugiée autour du vieux temple bouddhiste, un des plus beaux de Tokyo. C’est le sanctuaire de Kwannon, la déesse de la Pitié, qui attirait de cinquante à soixante mille visiteurs par jour, en temps de paix. L’asile est réputé sûr, car le temple qui date du XVIIe siècle, a survécu à tous les grands incendies de Tokyo, y compris celui tremblement de terre de 1923, du fait que les bonzes n’avaient admis dans le parc d’alentour que les réfugiés sans leurs paquets. Le populaire attribue le salut du temple à la protection de la déesse. Hélas! cette fois-ci Kwannon n’a pas sauvé son peuple : allumé par les tisons volants ou par les bombes, l’énorme charpente de bois brûle, et l’immense toit de tuiles grises s’abat. Les grands arbres ginkgo du parc flambent avec les jardins et les gens. Partout où s’ouvrent dans la masse de la ville quelques rares oasis, des scènes affreuses se reproduisent, les fuyards périssent par centaines: au jardin des Cent Pierres, cher aux poètes japonais, au parc de Kiyozumi dans Fukagawa, etc. Dans les cours intérieures du temple de Kameido, aux célèbres glycines, les gens sont pris dans le cercle des bâtiments en feu ; c’est là, ou bien dans leurs petites maisons toutes proches, que périssent les filles du quartier de plaisir voisin, dont j’ai décrit plus haut l’extraordinaire aspect nocturne. Au célèbre Yoshiwara, près d’Asaxa, se renouvelle un drame qui est pour ainsi dire classique dans les grands incendies de l’histoire de Tokyo: les tenanciers, avant que le raid n’ait pris sa violence, ont hâtivement fermé les hautes portes de métal qui isolent le quartier, afin que le précieux troupeau de filles ne puisse pas s’évader.
À Nihombashi, la police dirige les fuyards vers des buildings modernes et bien construits, le Meijiza ou théâtre de Meiji. Les incendies se rapprochant, envoient dans le vent une terrible fumée: les réfugiés suffoqués font abaisser les grands rideaux de fer du théâtre qui sont mus électriquement. Mais le sinistre gagnant le quartier voisin, l’air brûlant envahit l’intérieur du bâtiment, dont les occupants meurent tous rôtis, car lorsqu’ils veulent fuir, les rideaux sont bloqués et ne se relèvent pas… Mais à quoi bon continuer le récit de ces horreurs ?
L’alerte est levée vers cinq heures du matin. Celles des sirènes qui fonctionnent, dans la moitié épargnée de la ville, sonnent la fin du raid; mais l’autre moitié achèvera de brûler pendant plus de douze heures encore. Je me suis entretenu avec quelqu’un qui parcourut les lieux du châtiment, dans la journée du 11 mars. Le plus épouvantable, m’a dit ce témoin, c’était d’être obligé, à chaque pas, de descendre de bicyclette, pour passer sur les innombrables qui gisaient en travers de toutes les rues. Il faisait encore un vent léger, et comme certains corps carbonisés n’étaient plus que de la cendre, on les voyait achever de s’effriter sous le vent qui les dispersait comme du sable. En beaucoup d’endroits, une foule rôtie barrait le passage.
J’ai eu connaissance, quelques mois plus tard, du premier chiffre officiel des victimes, chiffre supposé confidentiel, mais que la rumeur publique allait répandre dans tout le Japon: cent vingt mille morts. Et j’ai appris après la guerre que des documents officiels japonais, saisis par le commandement américain – documents secrets qui n’étaient pas rédigés à l’intention des Américains mais du gouvernement japonais pendant la guerre – fixaient le chiffre du recensement définitif à 197 000 morts (cent quatre-vingt-dix-sept mille). Encore une fois, l’énormité de l’holocauste, bien plus grave que celui de la bombe atomique (environ cent trente mille morts à Hiroshima, dont la moitié sur le coup, et le reste des suites de leurs blessures) a été due au terrible vent de la nuit du 9 au 10 mars. Tokyo va subir des raids encore plus violents par le nombre de bombardiers et des bombes qui achèveront de raser la ville; mais il semble qu’aucun des raids postérieurs ne fera jamais plus de quelque vingt mille victimes maximum.
D’après les renseignements publiés par les Américains, trois cents super forteresses – dont deux seulement ne sont pas revenues – ont participé au raid du 9 mars. Elles portaient chacune un poids jusqu’alors inusité de bombes, sept à huit tonnes par appareil; et ces bombes étaient d’un nouveau type, les M.29, contenant dans leurs cylindres un mélange de gelée incendiaire et d’essence. La ville a reçu cette seule nuit, entre minuit et trois heures du matin environ, 700 000 bombes (sept cents mille). Le poids total en était dix fois supérieur à celui des bombes déversées par la Luftwaffe lors du «Grand Incendie de Londres» en septembre 1940 ; et la superficie rasée de Tokyo, le 9 mars, est quinze fois la superficie détruite à la même occasion dans la capitale anglaise.
Robert Guillain
References : Robert Guillain | Le peuple japonais et la guerre. Choses vues 1939-1946., Paris: Julliard, 1947. Revu et réédité sous le titre Le Japon en guerre (Stock, 1979) puis J’ai vu brûler Tokyo (Arlea, 1990).
Transcription : Francis Goumain























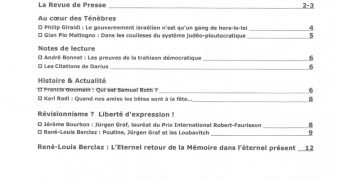


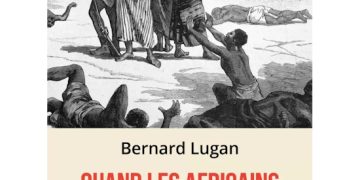

 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV







Voilà, Tokyo c’est 200 fois Oradour, mais les Japonais ne font pas visiter les ruines, comme les Allemands, ils ont reconstruit toutes leurs villes et tourné la page.
(cela dit, à la moindre occasion favorable, ils sauront s’en souvenir)
Très intéressant. Cet autre article qui vient de paraitre peut compléter les connaissances : « Le bombardement judéo-allié du Japon » – http://frontnationalsuisse.hautetfort.com/archive/2021/11/01/le-bombardement-judeo-allie-du-japon-6347209.html
« 9 mars 1949 : une date que Tokyo »
« 9 mars 1945 : une date que Tokyo »
Corrigé. Merci.