Le franquisme ne fut jamais un fascisme (par Maurice Bardèche)
À l’heure où l’Espagne connaît une importante crise politique, nous publions un article paru dans l’hebdomadaire Rivarol le 27 novembre 1975 sous la plume de Maurice Bardèche. L’auteur de Sparte et les Sudistes revient sur le bilan et la nature du franquisme ; il s’interrogeait, à l’époque, sur la destinée future de la monarchie espagnole.
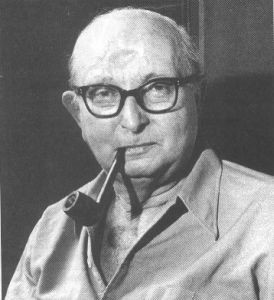 Les cris de haine qui avaient accueilli l’annonce de l’agonie de Franco se sont apaisés. La grande presse de notre pays avait été ignoble, on se croyait revenu à 1945 : maintenant, elle est seulement sournoise.
Les cris de haine qui avaient accueilli l’annonce de l’agonie de Franco se sont apaisés. La grande presse de notre pays avait été ignoble, on se croyait revenu à 1945 : maintenant, elle est seulement sournoise.
L’immense cortège muet des Espagnols saluant une dernière fois le sauveur de l’Espagne, cette messe des morts célébrée en silence par toute l’Espagne debout a été un hommage si unanime et si impressionnant que les aboyeurs de la haine n’avaient plus de voix.
L’Espagne a mis déjà Franco à sa place dans l’Histoire. Avec Charles-Quint et Philippe II, il restera son plus grand souverain.
Ce règne de quarante ans, qui a fait passer l’Espagne sans catastrophe à travers les défilés tragiques de notre temps, qui a fait d’un pays exsangue et pauvre un des grands États modernes de l’Europe, il est impossible de ne pas reconnaître aujourd’hui qu’il fut, après deux siècles de sommeil et de cauchemars, une résurrection inespérée et unique.
Les adversaires de Franco eux-mêmes ne parviennent pas à nier cette évidence.
Quand on compare Franco à nos faux grands hommes, sa prudence et son génie éclatent : De Gaulle a fait de la France une puissance de troisième ordre, Churchill a ruiné un empire qui reposait sur deux siècles de splendeur, Roosevelt a laissé s’établir une puissance mondiale qui menace les États-Unis.
Franco, lui, pendant le même temps, a fait de son pays, qui naguère n’était qu’un appoint quand les nations voisines jouaient orgueilleusement leurs folles destinées, un partenaire indispensable.
Ce qui alimente la fureur de ses adversaires, c’est que Franco n’a pas été seulement le sauveur de l’Espagne, il a été aussi le nôtre.
Si nos pays d’Europe sont encore des pays libres, c’est parce que le communisme soviétique n’a pas pu s’installer sur le flanc méditerranéen de l’Europe. C’est la victoire franquiste qui nous a conservés pendant quarante ans cette position stratégique capitale.
Cela, c’est l’œuvre, c’est-à-dire le passé.
Mais cette œuvre contient une leçon politique, et c’est cette leçon qu’il serait utile de recevoir. Le régime franquiste n’était pas, n’a jamais été, comme on a voulu nous le faire croire, un régime fasciste.

Choisi par accident pour diriger l’Espagne à la suite d’un soulèvement que d’autres que lui avaient préparé et orienté, Franco ne fut d’abord que le représentant d’une coalition qui comprenait des monarchistes, des conservateurs, des catholiques, des modérés et des phalangistes, qui furent les combattants les plus ardents et les plus énergiques, mais qui n’étaient pas majoritaires dans cette association.
Il s’est conduit pendant tout son règne comme le représentant loyal de ces groupes très différents qui l’avaient installé au pouvoir. Dans ce régime composite, la Phalange a eu sa part, mais d’autres aussi avaient droit à leur part. Et ce qu’on a appelé l’« habileté » du général Franco ne fut peut-être, en réalité, que sa loyauté à l’égard de ses mandataires très divers qui lui avaient fait confiance.
Dès le début du régime, cette plateforme composite avait pu être un sujet d’inquiétude. Et il est certain que la politique du général Franco a souvent déçu ceux qui souhaitaient en Espagne l’avènement d’un régime « fasciste » fondé sur la justice et sur le socialisme national qu’avait souhaité José-Antonio Primo de Rivera.
Franco n’a jamais eu ni les réactions, ni les choix, ni les aspirations, ni les manifestations spectaculaires d’un dictateur plébiscité par un immense élan populaire. Il a eu la prudence d’un grand gestionnaire et le style d’un souverain, non celui d’un Führer. Le régime que Franco a inventé pour l’Espagne n’est ni un régime fasciste ni un régime démocratique. Il a évité à l’Espagne l’influence dissolvante et paralysante des factions politiques, qui n’est rien d’autre en réalité que l’injection dans l’organisme national d’idéologies élaborées à l’étranger.
En ce sens, le franquisme est un régime immunitaire qui préserve l’indépendance et l’instinct national. Il a cela en commun avec les régimes fascistes. Mais il est établi aussi sur une large assise nationale représentant des éléments très différents de la population, en raison même des conditions particulières de sa naissance.
Il n’est donc pas paralysé fonctionnellement par l’ankylose bureaucratique qui menace toujours les États qui n’ont pour courroie de transmission que le parti unique. Sans rien avoir de « maurrassien », le franquisme est un exemple typique d’« empirisme organisateur », si cette expression, passablement obscure désigne l’association progressive au pouvoir des diverses stratifications naturelles de l’activité nationale.
En somme, Franco a réussi ce que De Gaulle a manqué : une adhésion complète et naturelle à un chef soucieux du bien de l’État, s’y consacrant entièrement, loyalement, à l’égard de tous, équitablement, sans morgue, sans haine, sans hystérie. C’est ainsi qu’on devrait définir en toute monarchie le mariage d’un peuple avec celui qu’il a accepté pour roi. Et avec celui qu’on lui propose ensuite comme roi.
On se demande ce que fera Juan Carlos. Il n’a pas connu la tragédie de la guerre d’Espagne. Saura-t-il protéger son pays des poisons qu’on lui propose de tous côtés, des breuvages maléfiques qu’on lui offre dans des coupes ornées de fleurs ? Saura-t-il repousser les marchands cyniques qui insultent l’Espagne en lui imposant un choix entre une prospérité fallacieuse et sa santé morale ? Saura-t-il incarner la nation comme l’a fait Franco ou acceptera-t-il d’être un de ces rois de carton qui président comme croupiers tristes la table où sont assis les prévaricateurs et les faussaires ?
Il a reçu en héritage une Espagne propre, une Espagne saine, une Espagne forte, il a dit les mots qui furent inscrits sur les bannières : España una, España libre, España grande.
Que son règne soit conforme, non aux espoirs des marchands du temple, mais au serment qu’il a prononcé, comme gentilhomme et comme soldat.
Maurice Bardèche
























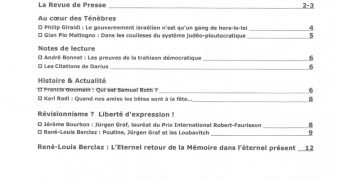


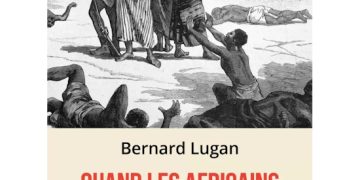
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV






Malheureusement pour l’Espagne, Juan-Carlos a trahi et renié, sans vergogne, l’héritage que lui laissait Franco.C’est un nul et un lâche, qui a entériné toutes les dérives socialo-mondialistes que les gouvernements libéraux ou PSOE ont impos& à l’Espagne. On voit le résultat aujourd’hui !
Exact et le « fiston » de Juan Carlos qui a épousé une petite journaliste divorcée anorexique sans classe prolétaire avec mauvais caractère n’a rien dit sur la déménagement de la dépouille du Caudillo par le gouvernement socialo pourri de Sanchez….
Ce n’est plus ni Carlos Quinto tampoco Felipe Segundo !
Lastima