Entrevue exclusive avec Vincent Reynouard
Une vie au service du révisionnisme historique
Vincent Reynouard est emprisonné en Écosse depuis son arrestation le 10 novembre 2022 dans la petite ville d’Anstruther, près d’Édimbourg. Cette arrestation faisait suite à une demande d’extradition formulée par la France. Un second mandat a été présenté à la justice Écossaise par les autorités françaises, ces dernières ayant pris conscience de la faiblesse de leur dossier.
Aujourd’hui, jeudi 12 octobre 2023, la justice écossaise a validé la demande d’extradition de la France, créant sans aucun doute un précédent sur le territoire britannique. Nous lirons avec attention les attendus de cette décision. Pour l’heure, il est bien évident que Vincent et ses avocats vont faire appel de cette décision. Il reste donc incarcéré jusqu’au jugement d’appel.
Depuis son arrestation, nous avons débuté, Vincent et moi, une correspondance soit par mail, soit par voie postale. Une amitié est ainsi née et l’idée d’un entretien-portrait a fait son chemin. Pendant plusieurs semaines, Vincent s’est ainsi livré par écrit (environ 60 pages manuscrites). Nous avons construit ensemble la structure de l’entretien, sans aucun tabou, en toute franchise. Il nous parle de son enfance, de ses études, de ses premières années de militant, de son engagement politique, de son combat pour le révisionnisme, de l’acharnement dont les autorités ont toujours fait preuve à son encontre, de sa première incarcération, de ses amitiés, de sa famille, de l’avenir…
Il a donné à Jeune Nation l’exclusivité de la publication de cet entretien, et nous tenons à l’en remercier très sincèrement. Vous découvrirez avant tout un homme généreux, sensible, à l’opposé du portrait haineux que ses adversaires veulent présenter. Un homme qui n’impose rien mais qui propose. Un homme dont la vie est dédiée à un combat dont il n’a jamais dévié, malgré les obstacles et les vicissitudes qui se sont dressés sur son chemin. Un homme de conviction, confiant en la Providence.
Ulex : Bonjour Vincent. Je tiens tout d’abord à te remercier, au nom de tous nos camarades nationalistes, pour les longs échanges que nous avons eu tous les deux et qui ont abouti à ce portrait de toi, et ce, malgré les conditions d’incarcération que tu subis depuis plusieurs mois.
Vincent Reynouard : Bonjour à tous, et merci à toi, pour le travail que tu accomplis.
Je suis né le 18 février 1969 à Boulogne-Billancourt. Trois ans plus tard, nous avons déménagé à Caumont- l’Éventé, dans le Calvados. Mon père y avait trouvé un poste de médecin généraliste, en remplacement du précédent qui partait en retraite. Ma mère, avait elle aussi suivi des études de médecine, car elle souhaitait devenir pédiatre, mais mon père a toujours refusé qu’elle travaille.

La Normandie n’est donc pas la région de tes ancêtres ?
Non. La famille paternelle vivait en Algérie. Ils étaient pieds-noirs. Les parents de ma mère venaient de Suisse et de l’Hérault. Je n’ai donc aucune racine et j’en remercie la Providence, car si j’avais été attaché à une région, alors j’aurais énormément souffert de mes déménagements puis de mon exil en Grande-Bretagne.
Pourtant, tu as toujours milité dans un milieu qui promeut l’enracinement .
Oui, mais je fais une différence entre les gens ordinaires, destinés à mener une vie ordinaire, et le militant qui, de par son combat, devra mener une existence plus particulière. Tout en ayant conscience qu’une vie ordinaire implique l’enracinement, ce militant doit pouvoir assumer son existence particulière, faite de séparations, de déplacements, voire d’exils. J’ai donc bien conscience que mon détachement extrême des choses matérielles, y compris lorsqu’il s’agit d’enracinement, est « anormal ». mais il était nécessaire et ne concerne que moi. Ainsi n’existe-t-il aucune contradiction entre ce que je dis et ce que je fais. Si j’avais pu mener une vie ordinaire, j’aurais aimé être attaché à la région de mes ancêtres et à y vivre pour la préserver.
As-tu des frères et sœurs ?
J’ai une sœur, un peu plus âgée que moi, puisque née en décembre 1967. Elle exerce actuellement la profession de clerc de notaire.
Parle-nous de ton enfance.
En tant que médecin libéral, mon père gagnait très bien sa vie . De plus, il fraudait le fisc et ne payait pas ses taxes professionnelles (ou très incomplètement). Sa devise était : « Mieux vaut dépenser sans compter que compter sans dépenser ». Nous vivions dans un grand confort, voire dans le luxe : télévision en couleur, magnétoscope, four micro-ondes, grenier aménagé en dancing avec flipper et baby-foot, repas pris tous les jours avec des couverts en argent massif, quatre voitures (dont une Citroën « traction avant » remise à neuf et une Dauphine), sorties au restaurant… Nous partions trois fois en vacances chaque année : en février au ski, en juillet en Vendée (dans une maison à la mer appartenant à la famille) et en septembre sur la Côte d’azur, à l’hôtel. Sur le plan matériel, je n’ai manqué de rien.

On peut donc dire que tu as bénéficié d’une enfance heureuse.
J’ai vécu de très nombreux moments agréables, entre un père très cultivé et qui pouvait être très drôle, et une mère qui fit de son mieux pour nous donner une bonne éducation. Toutefois, des aspects sombres étaient à déplorer. Mes parents ne s’entendaient guère et s’entredéchiraient souvent. Mon père s’emportait et pouvait devenir violent. Ma mère ne tenait guère compte de nos goûts et de nos aspirations : elle nous éduquait dans la direction qu’elle souhaitait, même si cela nous déplaisait, avec toujours la même justification : « Plus tard, tu nous remercieras ». Je voulais pratiquer le rugby, j’ai dû jouer au tennis ; j’ai également dû apprendre la musique (solfège et piano), alors que cela m’ennuyait énormément. Mais surtout, alors que je voulais travailler dans le cinéma, j’ai été « convaincu » de suivre des études scientifiques. À cela s’ajoutait, sur le plan spirituel, un manque terrible.
Avant d’y venir, parle-nous de ta scolarité.
J’en garde de mauvais souvenirs. L’école ne m’intéressait pas. Je trouvais les cours ennuyeux. Jusqu’en classe de seconde, je n’ai d’ailleurs guère travaillé. Mes résultats étaient bien en dessous de ce qu’ils auraient pu être, connaissant mes capacités. Mes parents en éprouvaient une colère profonde : j’ai été puni, privé d’anniversaire même. Je me suis mis à travailler en seconde, par amour pour une fille que je pouvais approcher en lui expliquant les maths. Il m’a donc fallu devenir bon en math et en sciences. Ayant débuté l’année avec un 2,5/20 en math, je l’ai finie avec un 16/20 accompagné de l’appréciation suivante : « Enfin de vrais progrès ! ».
As-tu pu séduire la demoiselle ?
Non, mais je ne regrette rien : je me suis mis à travailler – au moins dans les matières scientifiques – et j’en ai pris l’habitude. Cela me servirait plus tard, pour mon combat révisionniste. La Providence s’est donc servi d’une fille pour m’orienter ; preuve qu’elle se sert de tout, y compris des vanités humaines.
Un premier évènement allait orienter ta vie. Peux-tu le rappeler brièvement ?
Après le primaire, mes parents m’inscrivirent dans un collège privé à Caen. C’est dans cette ville que je rencontrais pour la première fois la pauvreté, à l’occasion des achats que nous allions faire avec ma mère. À Paris également, lorsque nous allions rendre visite aux oncles et aux tantes maternels, je voyais des mendiants partout. Cette pauvreté, comparée à notre propre aisance, me touchait énormément. J’en souffrais. Un fait en particulier me chamboula. Je devais avoir une dizaine d’années. La veille de Noël, nous étions avec ma famille devant les vitrines illuminées de La Samaritaine. Les automates, les lumières, quel spectacle féérique ! Et puis soudain, en tournant la tête, je vis, assise sur le trottoir, une vieille femme enveloppée dans un manteau gris, un fichu sur la tête. Devant elle un petit morceau de carton sur lequel avec quelques pièces jaunes. À cet instant, toute la magie de Noël s’évanouit pour laisser place à une grande détresse. Mon cœur se déchira. Ce soir-là, je devins socialiste bien que j’ignorais alors jusqu’à l’existence du mot « socialisme ». Je ne voulais plus vivre indifférent à la pauvreté de mes concitoyens ; je voulais contribuer à bâtir une société où régnerait la justice sociale. D’où mon attirance, plus tard, pour le national-socialisme.
Revenons un instant, si tu le veux bien, sur ce que tu nommes « manque spirituel ». Peux-tu préciser pour nos lecteurs ?
Ma grand-mère maternelle est morte quand j’avais trois ans. Son mari la suivit quatre ans plus tard. Je les ai vu décliner. Dès l’âge de sept ans, je me suis interrogé sur le sens de la Vie. Pourquoi existions-nous ? Y avait-il quelque chose après la mort ?
Dans ma famille, toutefois, personne ne parlait d’éternité. Croyants et incroyants se ressemblaient totalement. Pour eux, la vie c’était ici et maintenant, et cela consistait à jouir matériellement d’une réussite sociale. Il fallait dépenser sans compter et profiter. Ce que nous faisions. Ce vide spirituel me hantait. Je voulais savoir si nous avions une âme éternelle. Vers l’âge de 12 ans, j’ai découvert l’ouvrage du Docteur Raymond Moody, La Vie après la vie. Parlant d’expérience de mort imminente, ce livre fut pour moi une révélation. Je ne voulais pas de cette existence qui m’était offerte : « profite de tout jusqu’à ta mort ! Car après, cela sera terminé ». J’en arrivais à comprendre certains jeunes, qui, ne voyant pas d’autres issues à cette destinée, se suicidaient. Parfois, j’avoue avoir été tenté de les imiter. Mais une petite voix intérieure me rappelait que j’étais né pour une raison précise, comme chaque être humain, et qu’il fallait me fallait accomplir mon destin.
Un autre évènement a marqué ton enfance. Une interview radiodiffusée.
« Marqué » est un mot trop fort. J’y vois plutôt un clin d’œil de la Providence. Je devais avoir entre 11 et 12 ans. J’étais dans ma chambre, occupé à jouer, avec la radio allumée sur RTL ou Europe 1. J’écoutais le Top 50 ou une émission similaire. Au moment du journal, qui interrompait les chansons à la mode, un homme fut interrogé. J’ignore son identité et le sujet abordé. Seule sa réponse m’est restée en mémoire. « Je ne crois pas aux chambres à gaz. Je n’y crois absolument pas ». À l’époque j’ignorais tout des chambres à gaz. Je n’avais pas regardé la série « Holocauste » diffusée en 1989 à la télévision, et ma famille non plus. Une camarade de classe en avait parlé à l’école, évoquant des gens qu’on brûlait vivant dans des fours. Mais il n’était pas question de juifs en particulier. Mon père ne lisant pas le journal « Le Monde », je n’avais pas eu connaissance de l’affaire Faurisson. J’étais donc totalement ignorant en la matière. Malgré cela, la réponse de la personne interrogée se grava dans ma mémoire, sans pour autant provoquer une curiosité quelconque à propos des « chambres à gaz ». Toutefois, c’était là, dans mon esprit, et cela jouerait un rôle plus tard.
Comment expliques-tu que cette réponse t’ait frappé, alors que tu ignorais tout du « problème des chambres à gaz » ?
J’y vois ce que le physicien Philippe Guillemant appelle un « écho du futur ». Pour lui, le futur est déjà réalisé (ce qui ne compromet pas notre libre arbitre, mais c’est une autre histoire). Il peut émettre des messages qui remontent le temps pour nous parvenir. Ainsi s’expliqueraient les prémonitions et les « flashs » que certains peuvent avoir. Sachant que j’allais dédier ma vie au révisionnisme, la réplique de l’homme interrogé me frappa comme si j’étais déjà révisionniste. Telle est mon explication.
Quelques années plus tard, alors collégien, tu t’intéressas au national-socialisme.
Oui. Je précise que ma famille n’éprouvait aucune sympathie pour cette doctrine. J’abordai le national- socialisme seul, par la lecture d’encyclopédies, que je feuilletais dans la maison parentale. Je fus frappé non seulement par les photos des foules enthousiastes, mais aussi et surtout, par le relèvement spectaculaire de l’Allemagne qui avait suivi l’arrivée au pouvoir des nationaux-socialistes. À mes yeux, ce régime avait réalisé l’idéal de justice sociale auquel j’aspirais. Je me disais : « Voilà la solution ».
Le racisme et l’antijudaïsme qui existaient sous le IIIe reich ne t’ont-ils pas gêné ? Ton adhésion au national-socialisme t’a-t-elle fait devenir raciste et antijuif ?
Non, le racisme, j’y étais indifférent, n’ayant pas connu dans mon cocon bourgeois les affres vécues dans certaines banlieues. La « question juive » était totalement absente de mes réflexions. Je considérais l’antijudaïsme, les camps de concentrations et l’Holocauste, auquel je croyais alors, comme des contingences du national-socialisme allemand, c’est-à-dire de l’hitlérisme. Pour moi, le national-socialisme, en tant que doctrine atemporelle, pouvait exister sans les camps. Mais il m’était difficile de faire admettre mes idées car pour mon entourage, le national-socialisme quelque qu’il fut, menait aux camps et aux « chambres à gaz ».
En 1986, tu es reçu au baccalauréat, série C, avec mention « assez bien » ?
Oui, mention « assez bien » car j’ai eu 14 en maths et en physique, 13 en philo et en français, les autres matières tournant plutôt autour de 9 et 11 sur 20. De plus je n’avais aucune option.
Quelle fut ta note en histoire-géographie ?
9/20. Le sujet de géographie portait sur le Japon. Il fallait remplir une carte qui valait plusieurs points. Le soir de l’épreuve, en rangeant mes affaires, j’ai trouvé la carte parmi les brouillons : j’avais oublié de la rendre ! Mon Bac a été à l’image de ma scolarité : rien de mirobolant. Je n’ai vraiment travaillé que les matières scientifiques. L’École m’ennuyait.
Pourtant, tu as intégré maths-sup au Lycée Saint-Louis à Paris. Tu semblais donc intéressé par les études.
Disons que ma mère « m’a convaincu » de faire maths-sup (« Plus tard, tu me remercieras »). Moi, je me voyais travailler dans le milieu du cinéma. Cela me passionnait. Depuis 1984, je réalisais des courts- métrages l’été, avec des camarades de classe. Tout mon argent passait dans l’équipement cinématographique : caméra, projecteur, luminaires, matériel de montage. J’écrivais le scénario moi-même et je fabriquais le story-board. Cela me prenait toute l’année scolaire : je choisissais le lieu, je m’y rendais pour imaginer les scènes, le jeu des acteurs et les mouvements de la caméra. Préparer un film était pour moi, le bonheur intégral. Je me sentais dans mon élément.
Quel genre de film réalisais-tu ?
Des films d’épouvante. J’aimais énormément ce genre. Mon réalisateur préféré était Lucio Fulci (mort en 1986 je crois). C’est en voyant « Frayeurs », en 1982 (le film datait de 1980), que j’ai décidé de devenir cinéaste. Mes films préférés restent La Galaxie de la Terreur, Dark City, L’Armée des morts, La Horde, Messe Noire, Carrie (le premier, celui de Brian de Palma), Martyrs, Passé Virtuel… Dans mon premier court-métrage, le père d’une des actrices avait travaillé un temps dans le cinéma. Après avoir vu le film, il déclara à mes parents que j’étais doué ; je savais composer des plans.
À l’été 1985, j’ai annoncé à mon père que je voulais travailler dans le cinéma, comme réalisateur d’effets spéciaux par exemple. Il me répondit : « Eh bien, tu feras l’IDHEC » (Institut des Hautes Études Cinématographiques). Mais ma mère me destinait à un autre avenir : devenir polytechnicien et embrasser une carrière en rapport (chef de recherche chez Elf par exemple). En 1986, elle me « convainquit » donc de faire maths-sup à Paris, dans un Lycée renommé : « Quand on est doué, on ne gâche pas ses potentialités. Tu feras du cinéma pendant tes vacances. Plus tard, tu me remercieras ».
Elle me fit donc déposer des dossiers de candidature à Henri IV, Sainte-Geneviève, Chaptal et Saint-Louis. J’ai été rejeté partout, sauf à Saint-Louis.
L’année de maths-sup fut horrible. Sur 45 élèves, je me classais entre la 35e et la 46e place. Sachant que les 4 ou 5 derniers seraient exclus, j’étais souvent dans la zone rouge. De plus, la prof de maths m’avait pris comme tête de Turc, car au début de l’année, j’avais bruyamment soupiré lorsqu’elle nous avait donné une information qui m’avait déplu. Elle m’avait fusillé du regard, bien résolue à se venger. Lorsqu’elle en avait assez de donner cours (on avait parfois 3 heures ou 4 heures de maths d’affilée), 45 minutes avant la fin, elle donnait un exercice. Puis elle me convoquait au tableau pour le réaliser. Bien entendu, j’en était incapable. Elle me laissait planté là. Elle s’affalait sur son bureau et, toutes les 3 ou 4 minutes, elle relevait la tête, regardait le tableau vierge, poussait un soupir bruyant et replongeait sa tête dans ses bras. C’était sa vengeance. Mes camarades me plaignaient mais ne pouvaient rien faire. Quand, 45 minutes avant la fin d’un cours, elle donnait un exercice, tout le monde se détendait : « Ah ! C’est fini…Cela va être à Vincent ». Moi, j’avais des sueurs froides. J’aurais voulu disparaître… Puis venait la sentence de mort : « Reynouard, au tableau ! ». Je me levais résigné, comme un condamné qui va au poteau.
Malgré tout, j’ai réussi à passer en maths-spé, option P (la moins bonne).
Cela ne m’empêcha pas d’intégrer Maths-sup au Lycée Saint-Louis à Paris, en 1986. Cette année fut particulièrement difficile. Mais je passais cependant en Maths-spé option P (la moins bonne).
Et c’est à ce moment que tu découvres le révisionnisme n’est-ce pas ?
Exact. Au printemps 1988, je lus le tome 5 des « Annales d’Histoire Révisionniste » qui présentait les conclusions du Rapport Leuchter. L’exemplaire m’avait été proposé par le gérant de La Librairie Française à Paris. Sachant que je poursuivais un cursus scientifique, il me dit que cela devrait m’intéresser. Et en effet, la lecture me passionna. Le révisionnisme prit une place de plus en plus importante dans ma vie.
Après une année scolaire 1987-1988 difficile, j’aurais pu redoubler ma Maths-spé. J’ai refusé. Ayant passé plusieurs concours, j’ai pris le premier pour lequel j’avais été accepté. Je savais déjà que je ne serais jamais ingénieur. Mes projets se dirigeaient toujours vers le cinéma.
J’ai donc intégré l’ISMRA de Caen (Institut des Sciences de la Matière et du Rayonnement).
Fin 1988 ou début 1989, j’ai adhéré à la section locale du Parti nationaliste Français et Européen (PNFE). Je m’y suis inscrit après avoir été abordé à Caen par le responsable local qui arborait un bomber et une croix celtique. Il était à la gare et moi aussi. Je n’ai donc effectué aucune démarche : c’est la Providence qui m’a guidé. Le PNFE m’a appris le militantisme politique : il a été une excellente école que je ne regrette pas d’avoir fréquentée. Quand on me demande s’il s’agit d’une « erreur de jeunesse », je réponds par la négative. Il n’y a pas d’erreurs de jeunesse, il n’y a que des décisions et des actes destinés à vous apprendre la vie. Mettant à profit ce que j’avais appris au PNFE, en 1989, avec mon ami Rémi Pontier, j’ai créé l’ANEC, Association normande pour l’Éveil du Citoyen. Nous avons publié notre premier bulletin, Nouvelle Vision, en juin 1990. Cette année-là, une commission de discipline m’exclut temporairement de l’ISMRa, pour avoir distribué des tracts révisionnistes, sur le campus universitaire.
En 1991, j’ai quitté l’ISMRA avec mon diplôme d’ingénieur en poche.
As-tu tenu un carnet de bord ou un journal dans lequel tu aurais consigné les évènements de ta vie ?
Non, pour une raison très simple : quand j’ai découvert le révisionnisme, l’importance de l’enjeu me fit croire qu’il y avait de nombreux chercheurs et pléthore de diffuseurs. Je croyais donc que je serais un simple diffuseur parmi tant d’autres. Or, la vie d’un militant de base n’a rien qui vaille la peine d’être raconté. Par conséquent, je n’ai jamais tenu de journal.
Et par la suite ?
Avec la loi Gayssot et tout ce qui m’est arrivé à partir de la fin 1991, je n’ai plus eu le temps de tenir un journal. Je me disais qu’il y avait toujours plus important à faire : m’occuper de faire vivre ma famille qui s’agrandissait et diffuser le révisionnisme. Si un jour, quelqu’un veut écrire ma vie, il devra s’aider de documents , je ne pourrai lui fournir aucune note personnelle.
Parmi les documents, figure ton premier tract révisionniste. Tu l’as créé toi-même en 1990. Il était intitulé : « Testez-vous ». Comment l’idée t’en est-elle venue ?
Je voulais confectionner un tract que les gens liraient. J’avais pu remarquer que les tests éveillaient toujours la curiosité. J’ai donc rédigé ce tract comme un test de connaissances historiques, avec deux questions. Pour le confectionner, j’ai utilisé une machine à écrire mécanique.
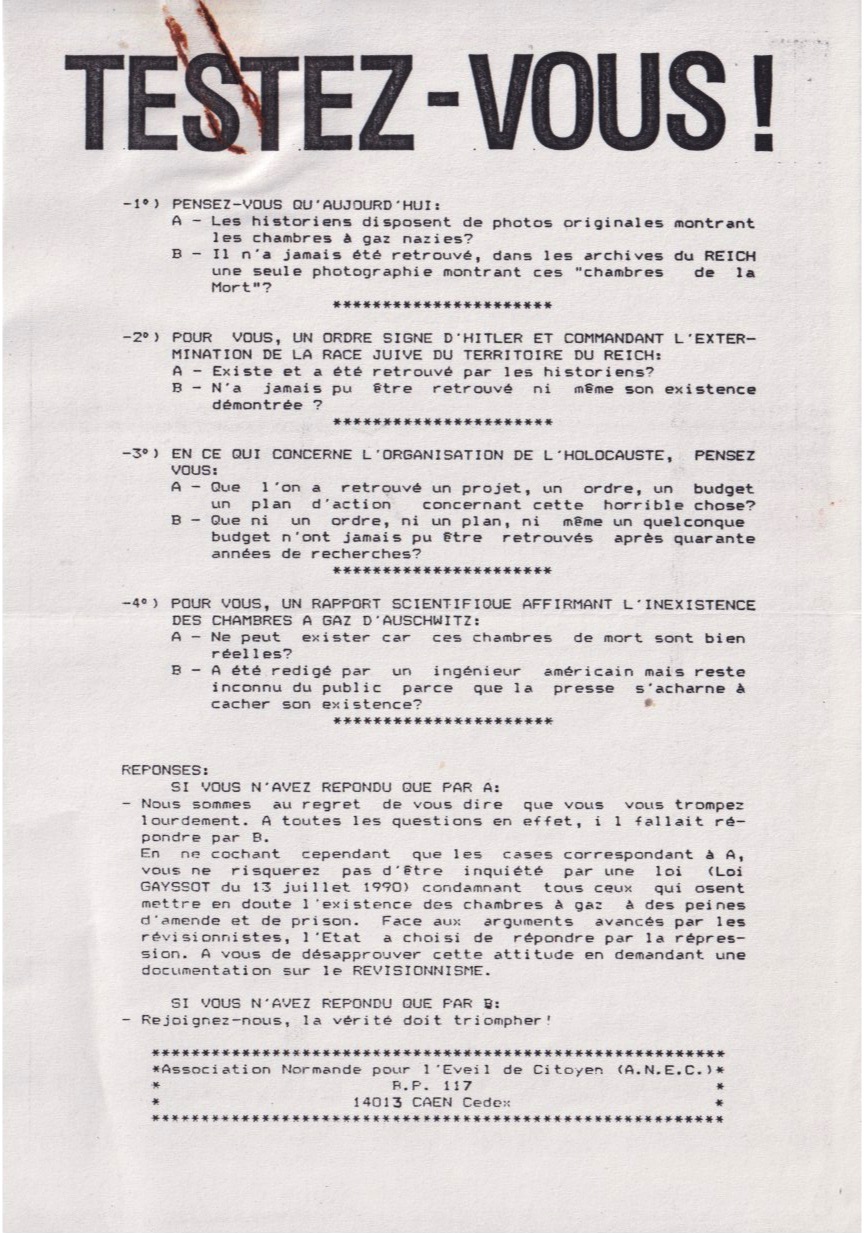
Avais-tu les moyens financiers de l’imprimer ou t’a-t-on aidé ?
Je ne disposais que de l’argent gagné en donnant des cours particuliers. J’ai tout simplement acheté une carte d’abonnement dans un magasin de photocopies. Le tract étant au format A5 (une demie grande feuille), j’en photocopiais deux par feuille A4. Arrivé chez moi, je les découpais avec un cutter. 500 photocopies me permettaient d’avoir mille tracts. Quand on veut vraiment, on peut, même avec des moyens dérisoires.
Ces tracts, comment les as-tu diffusés ?
Là encore, très simplement. Seul ou avec deux amis, je sortais le soir et glissais les tracts dans les boîtes aux lettres. À cette époque, nous sommes alors au début des années 1990, les entrées d’immeubles étaient bien plus accessibles. Seul, je pouvais distribuer 500 tracts en deux ou trois heures. Nous avons également tenté une distribution en journée, dans la rue, en tendant les tracts aux passants. Mais après dix minutes, un jeune nous a agressés. Nous étions deux à distribuer. Un camarade bien plus costaud surveillait la scène. Il est immédiatement intervenu. Toutefois nous avons dû quitter les lieux. L’expérience démontre qu’une distribution publique était risquée, car il va de soi qu’en cas de violences graves, nous aurions été vus comme les provocateurs qui portaient toutes les responsabilités
Ce tract t’a-t-il valu des ennuis judiciaires ?
Pas au début car c’était avant la promulgation de la loi Gayssot, le 13 juillet 1990. Mais il m’a tout de même créé des ennuis. En effet, avec un camarade, nous l’avons distribué sur le campus universitaire quelques jours seulement avant la profanation du cimetière de Carpentras, dans la nuit du 8 au 9 mai 1990. Bien que la distribution ait été faite à Caen, ville où j’étais étudiant, l’affaire de Carpentras ayant secoué la France entière, mon tract provoqua le scandale. J’étudiais alors à l’ISMRa, qui se trouvait sur le campus universitaire. Le tract étant signé de l’ANEC, un journaliste qui souhaitait m’interroger pour un reportage dont la diffusion était prévue au journal régional du soir, trouva mes coordonnées à la préfecture où j’avais déposé les statuts. À la rubrique « emploi», j’avais précisé « élève de l’ISMRa ». Ne m’ayant pas trouvé chez moi, le journaliste, accompagné de son cameraman, se rendit à l’école pour m’interroger. J’étais alors en cours de chimie. Soudain, le délégué des élèves frappa et demanda à me parler. Il m’informa que deux journalistes m’attendaient dehors et qu’ils souhaitaient m’interroger à propos d’un tract révisionniste. Le Directeur étant absent, ses adjoints avaient exigé qu’en cas d’acceptation de ma part, l’école ne soit pas mentionnée ni filmée. La France étant en ébullition à cause de Carpentras, au sein de l’école, c’était la panique : un élève était impliqué dans des affaires qui déplaisaient aux Juifs. Malheur !
J’ai accepté de répondre à ses questions, car refuser aurait été interprété – à raison – comme une lâcheté : « Il n’ose pas soutenir publiquement ce qu’il prétend », aurait-on pensé.
Comme convenu, l’école ne fut ni mentionnée, ni filmée durant l’interview. Mais une fois le Directeur revenu, il décida que Rémi et moi passerions en Commission de discipline, afin de disculper l’école de toute complaisance avec le démon.
Tu as donc pu tenir des propos révisionnistes à la télévision ?
Face à la caméra, j’ai parlé du Rapport Leuchter qui avait été produit deux ans auparavant, lors du procès d’Ernst Zündel, à Toronto. J’ignore ce que j’ai pu expliquer, mais j’ai commis une erreur de débutant – ce que j’étais. J’ai développé de longues explications pendant plusieurs minutes. Le journaliste en a extrait quelques passages de quelques secondes seulement, faisant perdre à mon exposé toute sa force. De plus, alors que je parlais, des images du film réalisé en 1945 par les Britanniques au camp de Bergen-Belsen apparaissaient à l’écran. On y voyait les fameuses fosses avec ces centaines de cadavres de déportés squelettiques, car morts du typhus. Pour un spectateur moyen (comprenez 95 % du public), mon exposé semblait ridicule. Bref, j’avais été piégé. Cette mésaventure m’a toutefois appris une chose : face à un journaliste, il faut répondre avec des phrases courtes et incisives, qui ne peuvent être ni tronquées, ni extraites de leur contexte. Depuis, j’ai toujours agi ainsi.
Tu as donc été renvoyé trois mois de ton école. Mais pour quel motif, sachant qu’à l’époque, le révisionnisme n’était pas illégal ?
Pour « salissure » de la réputation de l’établissement. Naturellement, rien dans le règlement de l’école, ne laissait entrevoir que pour des activités menées hors de l’établissement, un membre pourrait être sanctionné.
Dans le cadre de mon militantisme, je n’avais jamais impliqué l’IRMRa. Par conséquent, aucune faute ne pouvait m’être imputée. Aussi, ai-je attaqué la décision devant le tribunal administratif.
Ici se place une anecdote importante. Quelques heures après avoir déposé mon mémoire devant le Tribunal administratif, le téléphone sonna. Une voix me dit que mon recours serait rejeté pour défaut de formulation. Elle me précisa ensuite la formulation à employer. Puis mon interlocuteur raccrocha. J’ai suivi ses instructions et dès le lendemain, j’ai déposé un nouveau recours. Le premier fut effectivement rejeté, le second fut accepté et reçu. Le Tribunal administratif ordonna ma réintégration immédiate.
As-tu appris l’identité de ton interlocuteur anonyme ?
Non. Mais cette anecdote me convainquit que, dans la vie, la Providence pouvait vous envoyer des aides de façon inattendue.
Tu as donc pu reprendre ta place parmi les élèves de l’établissement ?
Oui. Toutefois, la procédure avait duré trois mois. Dans les faits, cela n’a donc servi à rien. Je me suis attiré la haine du directeur qui a tout tenté pour m’empêcher d’être diplômé de l’IRMRa. Mais je suis tout de même parvenu à obtenir mon titre d’ingénieur chimiste. Je le dois à deux professeurs qui m’appréciaient beaucoup, hors de toute considération idéologique.
Ces mésaventures ne t’ont pas découragé ?
Non, pas du tout. À plusieurs reprises, le Professeur Faurisson m’avait prévenu : « Vous compromettez gravement votre avenir ». Mais j’étais résolu à 100 %! Plus tard, sa sœur déclara à ma compagne qui se plaignait d’être un peu délaissée : « Avant d’être marié avec vous, Vincent est marié avec le révisionnisme ». C’était vrai ! Je n’ai pas toujours été fidèle en amour, mais je suis toujours resté fidèle au révisionnisme.
La promulgation de la loi Gayssot en juillet 1990, ne t’a-t-elle pas effrayé ?
Non, bien au contraire ! Parce que, dans ma naïveté juvénile (j’avais 21 ans), je croyais que :
- les gens réagiraient face à cette atteinte à la liberté d’expression ;
- les révisionnistes bénéficieraient de procès équitables durant lesquels ils auraient tout le loisir d’exposer publiquement leurs thèses.
Par conséquent, je voyais dans la loi Gayssot, un outil que l’on pourrait utiliser pour promouvoir le révisionnisme. Voilà pourquoi j’ai continué à diffuser des tracts à Caen. J’espérais que des plaintes seraient déposées afin de provoquer des procès.
Ton premier procès a eu lieu le 6 novembre 1991 à Caen. Tu as cité Robert Faurisson et Henri Roques comme témoins. Était-ce conforme à ta stratégie ?
Oui ! Le procès dura un jour entier. J’avais préparé une argumentation très large, traitant du révisionnisme et de la question juive, car déjà on nous accusait d’être mus par le seul antijudaïsme. J’espérais que ce procès serait une réplique, en miniature, du procès Zündel.
Il n’en a rien été ?
Robert Faurisson et Henri Roques ont pu librement s’exprimer. La télévision était présente et, la veille, un ou deux articles étaient parus dans la presse régionale. Tout s’était donc déroulé comme prévu. Le public allait découvrir les révisionnistes que l’on souhaitait bâillonner. J’attendais la réaction, à commencer par de nombreuses demandes qui parviendraient à la boîte postale de l’ANEC. Mais aucune demande n’est parvenue. Rien. Pas une !
La seule réaction a été la perte d’une élève à laquelle je donnais des cours particuliers. Très riches, ses parents lui avaient acheté un bel appartement à Caen, car elle était en première année d’université. Je l’aidais parfois pendant quatre heures d’affilée, de 19h à 23h. Sa mère venait pour faire les courses, le m »nage et la cuisine. Elle nous apportait à chacun un plateau repas. Pour cette élève, j’étais toujours disponible, car la demoiselle était vraiment anxieuse. Sa mère me remerciait toujours et me payait bien, car je rassurais sa fille et la faisais progresser. Mais après mon procès, elle me congédia d’un seul coup de téléphone : « Inutile que vous veniez encore… ». bien qu’elle ne m’ait donné aucune explication, je compris…
Cela ne t’a-t-il pas découragé ? Parce que tu as été condamné.
Certes, mais au début, les condamnations étaient légères. Quelques mois de prison avec sursis et des amendes modiques, que je ne payais pas, étant sans ressources. Je me suis dit que d’autres procès seraient nécessaires afin d’éveiller l’attention du public. J’ai donc repris la distribution de tracts.
Tu as obtenu ton diplôme d’ingénieur chimiste en juillet 1991. Ne cherchais-tu pas du travail ?
Non. La chimie ne m’intéressait pas. Je voulais encore travailler dans le cinéma comme metteur en scène ou réalisateur d’effets spéciaux. Mon diplôme d’ingénieur, je m’en moquais. Je ne suis même pas allé le chercher, me contentant d’une simple attestation de réussite ! En 1991 encore, j’ai réalisé un court-métrage. Toutefois, il était bien moins ambitieux que les précédents. Le révisionnisme prenait le pas sur le cinéma.
De quoi vivais-tu?
De cours particuliers, car depuis 1989, mes parents ne pouvaient guère m’aider financièrement, mon père ayant vu sa fortune brisée par un redressement fiscal et des déboires conjugaux. Je vivais dans un petit studio à Caen, ne pensant qu’au révisionnisme. J’étais bien décidé à lui consacrer ma vie, toute ma vie !
Pourtant tu as fondé une famille et tu es devenu professeur de mathématiques et sciences.
Oui, mais je n’ai rien planifié. En août 1991, une demoiselle a frappé à ma porte, à l’improviste. Elle avait entendu parler de moi par mon chef de section du PNFE. Elle voulait faire ma connaissance.
Était-elle une militante politique ?
Non, pas du tout ! Elle ignorait même le terme de révisionnisme. Mon chef la connaissait par un autre biais. Il lui avait parlé de moi à propos de spiritualité, car je m’intéressais alors à René Guénon.
Lui as-tu parlé du révisionnisme ?
Oui, dès notre première rencontre. Cela ne l’a pas fait fuir. Cette demoiselle était si jolie, avec une voix si douce ! Ça a été le coup de foudre. Nous avons parlé toute la soirée. Vers minuit, je l’ai raccompagnée à son foyer d’étudiante. Puis elle a décidé de me raccompagner chez moi ! Je l’ai de nouveau raccompagnée à son foyer. Elle est rentrée et m’a salué de sa fenêtre. Je suis reparti des étoiles dans les yeux et des sons de clochettes dans les oreilles ! Chaque semaine, elle venait m’apporter du boudin blanc et des yaourts aux fruits des bois. Nous mangions et nous discutions. Le 6 novembre 1991, elle est venue assister à mon procès, alors que je ne lui avais rien demandé. Lors d’une suspension d’audience, elle est venue me voir et m’a gratifié de son plus beau sourire. J’ai compris ses sentiments. Peu après, je l’ai invitée à Paris. C’était une lune de miel avant le mariage.
N’as-tu pas été tenté de tout arrêter ?
En effet. J’ai décidé de me ranger et de trouver du travail comme ingénieur chimiste. Mais je n’ai rien trouvé car j’ai cherché assez mollement, comme si je voulais essuyer des refus. Et au bout de deux mois, le naturel est revenu au galop : j’ai repris le militantisme révisionniste.
Tu as donc été poursuivi puis condamné à plusieurs reprises, sans réaction du public. Pourtant, tu as continué. Pourquoi ?
Tout d’abord, j’ai longtemps espéré retourner la loi Gayssot contre ses auteurs. Au moment de sa promulgation, le professeur Faurisson avait souligné qu’elle punissait la contestation de crimes contre l’humanité « qui ont été commis ». Il en déduisait que pour entrer en voie de condamnation, les juges devraient démontrer que les crimes contestés avaient bel et bien été perpétrés, donc que les « chambres à gaz » avaient existé. Telle a donc été ma stratégie de défense. Je disais aux juges : « Pour me condamner, vous devez apporter la preuve de l’existence des chambres à gaz ». Un avocat commis d’office adopta la même argumentation. J’en fus surpris et très satisfait. Mais en 1996 je crois, dans un arrêt, la Cour d’appel de Caen affirma que pour entrer en voie de condamnation, il suffisait que le crime contesté ait été défini et qu’une personne en ait été reconnue coupable par une juridiction nationale ou internationale. Les magistrats lançaient donc : « Si un nazi a été déclaré coupable, cela démontre que le crime a bien été commis ». Je me souviens qu’ils invoquaient ensuite Ernst Kaltenbrunner, l’ancien chef du Bureau de la sécurité du Reich (RSHA), condamné à Nuremberg pour le massacre de plusieurs millions de Juifs, dont certains en « chambres à gaz ». L’argument était d’autant plus malhonnête que, d’après les statuts du Tribunal militaire international, le jugement de Nuremberg serait sans appel ni révision possible. Les juges considéraient donc des condamnations arbitrairement définitives comme une « preuve » de culpabilité. J’étais bien décidé à soumettre cet arrêt ubuesque à la Cour de Cassation, mais, faute de moyens, j’ai dû y renoncer. Ainsi, la jurisprudence au sujet de la loi Gayssot a-t-elle neutralisé l’argument du professeur Faurisson.
On pourrait dire que les magistrats ont eux-mêmes comblé les failles que la loi présentait afin de tout cadenasser ?
Exactement. Par exemple, la loi punissait la contestation de crimes. Une stratégie adaptée consista donc à ne pas contester , mais à s’interroger : « Si Auschwitz était un camp d’extermination, alors pourquoi comprenait-il un secteur hôpital ? Pourquoi des enfants y sont-ils nés ? Pourquoi les Soviétiques en ont-ils découverts des bien vivants à la libération du camp ? ». Toutefois les magistrats ont jugé que la contestation comprenait aussi l’interrogation, sous couvert de liberté de recherche. Voilà comment en quelques années, les « chambres à gaz » sont devenues, au regard de la loi républicaine, un véritable tabou d’essence religieuse. Il faut croire sur la foi de jugements déclarés sans appel ni révision possibles, et il est interdit de s’interroger publiquement, donc d’émettre des doutes.
Pourquoi donc, as-tu continué, alors que tu avais trouvé un emploi de professeur dans l’Éducation nationale ?
Je le dis aujourd’hui : parce que c’était ma mission de vie. Je pense qu’on arrive tous sur Terre – et peut-être ailleurs – avec une mission particulière à réaliser. Elle dépend de notre karma et de notre stade d’évolution. Moi, c’était le révisionnisme historique. D’autres, c’est être médecin, cordonnier, mère de famille…
Pourquoi as-tu choisi l’Éducation nationale ? Car tu devais savoir que c’était incompatible avec ton engagement révisionniste ?
Je n’ai jamais planifié ma vie. J’ai toujours saisi les opportunités qui s’offraient. En septembre 1992, quand celle qui allait devenir mon épouse s’est trouvée enceinte, j’ai promis à mes futurs beaux-parents de trouver un travail stable. Chaque jour, je me rendais le matin à la bibliothèque municipale de Caen pour y mener des recherches historiques. En face, il y avait l’Agence Nationale pour l’Emploi (ANPE). J’y allais pour consulter les petites annonces, assez rapidement. Un jour, en sortant de la bibliothèque, j’ai constaté qu’il y avait foule. Je me suis dit : « Tant pis, j’irai demain ». Mais une petite voix m’a répondu : « Non, vas-y maintenant ! » J’y suis allé, et j’ai trouvé l’annonce d’un Lycée qui recherchait un aide-laborantin. L’établissement se trouvait à cinq minutes à pied de chez nous. Je n’ai pas hésité. J’ai saisi l’occasion et j’ai été engagé. Mon travail consistait à préparer les travaux pratiques des élèves en installant le matériel de chimie demandé par le professeur. Ensuite, je devais laver la verrerie, ranger le tout, et le tenir à disposition pour le prochain TP.
Était-ce un emploi stable avec un contrat à durée indéterminée ?
Non, il s’agissait d’un contrat emploi-solidarité, d’une durée de neuf mois (de septembre 1993 à juin 1994), le temps d’une année scolaire.
Puis tu as intégré l’Éducation nationale. Dans quelles circonstances ?
Courant 1994, le responsable du laboratoire où je travaillais, m’a proposé de passer le concours de professeur de lycée professionnel (PLP). Connaissant mon niveau d’études et ma situation de père de famille, il me dit :
« Tu le réussiras certainement, ce qui te permettra d’avoir un emploi rapidement ». Il m’a donc autorisé à passer chaque jour une heure pour réviser mes connaissances afin de préparer le concours. En juin 1994, je l’ai passé et j’ai été reçu.
En septembre 1994, tu es donc entré à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) pour y apprendre ton métier de professeur.
Oui, et parallèlement à des cours théoriques, j’ai dû effectuer un stage de professeur. On m’avait affecté au Lycée Victor Lépine de Caen. Ma responsable de stage y travaillait comme professeur de maths-sciences. Après quelques semaines passées au fond de la classe, à observer, je devais progressivement prendre sa place. Mais elle m’a tout de suite proposé de faire cours, pour voir comment je me débrouillais. Rapidement, elle a constaté que j’avais la fibre du professeur. Elle m’a donc laissé ses classes, et, pendant que je dispensais mon enseignement, elle allait siroter un café en salle des professeurs. Les élèves m’appréciaient énormément. Quand j’ai dû m’absenter un court mois pour retourner à l’IUFM, ils étaient très déçus :
« Revenez-nous vite, Monsieur », m’ont-ils dit. Puis deux membres de l’IUFM sont venus, un jour, suivre quelques heures de cours que je donnais. À l’issue, ils m’ont déclaré : « On n’a rien à te dire. On dirait que tu as fait cela toute ta vie… » En juin 1995, mon responsable de stage a rendu un rapport élogieux. Ainsi ai-je obtenu mon diplôme de professeur de maths-sciences dans les lycées professionnels.
Petite anecdote : la personne qui a porté plainte contre moi en 2014, ce qui m’a valu d’être condamné en 2015 et de me retrouver en prison à Edinburgh, était alors professeur au lycée Victor Lépine. Vingt ans après que j’y sois passé pour mon stage. La providence est vraiment coquine !
En juin 1995, tu étais déjà connu, du moins à Caen, comme révisionniste actif. Comment expliques-tu que l’on t’ait laissé intégrer l’Éducation nationale ?
On m’a affirmé par la suite que le recteur de l’Académie, Monsieur Lucas (décédé depuis), était révisionniste en secret. Lors de « l’affaire Faurisson », il était en poste à Lyon. Il aurait refusé de signer une pétition contre le Professeur. J’ignore si cela est vrai, car je n’ai jamais pris la peine de vérifier. Suis-je tout simplement passé entre les mailles du filet par défaut de vigilance des autorités ? C’est possible, du moins à mes yeux. Mais les deux hypothèses sont peut-être vraies.
En 1995, tu as publié à compte d’auteur, un premier livre : Les crimes « libérateurs » contre la Paix. Tu y dévoilais les causes véritables de la seconde guerre mondiale. Il ne s’agissait donc pas des « chambres à gaz ».
L’explication est simple. Lorsque je suis devenu révisionniste, j’ai cru que tout avait été dit et exposé à propos du prétendu « Holocauste ». Je n’ai donc entrepris aucune recherche personnelle qui aurait prétendu à l’originalité. Mais curieux de nature, je m’interrogeais : « Que disait-on, et que publiait-on sous l’Occupation ? ». La bibliothèque municipale de Caen disposait alors de nombreux livres et brochures parus entre 1940 et 1944. Je les ai empruntés systématiquement, lorsqu’il s’agissait de politique de collaboration ou d’idéologie, afin de découvrir leur contenu. Ainsi ai-je pu apprendre que sous l’Occupation, des auteurs avaient dénoncé le rôle des Britanniques dans le déclenchement du conflit. La responsabilité de Londres semblait écrasante. J’ai donc entrepris des recherches qui m’ont amené à remonter en 1918, avec les traités de « paix » imposés aux vaincus. L’enquête m’a passionné, car elle complétait adéquatement le révisionnisme des « chambres à gaz ». En effet, ses conclusions balayaient une autre accusation très lourde portée contre Hitler : celle d’avoir voulu et provoquer la deuxième guerre mondiale.
En définitive, tu as attaqué les trois principales accusations portées contre le national-socialisme allemand : le déclenchement de la guerre, l’Holocauste et Oradour. Évoquons Oradour, car tes recherches sur ce drame sont liées à ta révocation de l’Éducation nationale en 1997.
En effet. J’étais alors professeur au lycée professionnel de Honfleur, dans le Calvados. Mon ordinateur personnel étant vieux et peu puissant, j’utilisais un ordinateur de l’établissement, mis à disposition dans une annexe, pour dactylographier mon futur livre sur Oradour et confectionner des tracts révisionnistes. L’appareil était peu utilisé, et je prenais soins de cacher mes fichiers dans un dossier créé par un professeur parti depuis plusieurs années. Le matin, j’arrivais à l’ouverture de l’établissement, vers 7 heures, et je travaillais jusqu’à 8h15 environ, lorsque les cours commençaient . Je n’ai jamais été surpris.
On t’a également reconnu coupable d’avoir donné des exercices « indélicats » à tes élèves, qui évoquaient le camp de Dachau. N’est-ce pas cela qui a provoqué le scandale, suscitant une enquête contre toi ?
Non. J’ai été suspendu en décembre 1996. Or, ces exercices sur la mortalité à Dachau – exercices donnés à l’occasion du chapitre consacré aux statistiques – je les avais proposés l’année scolaire précédente, sans qu’ils ne provoquent le moindre remous. Il n’y était pas question de « chambres à gaz ». Les élèves étaient invités à comparer les photos montrant des tas de cadavres prises à la libération du camp et les statistiques officielles de la mortalité à Dachau, mois après mois, de 1940 à 1945. L’augmentation effroyable du nombre de décès à partir de la fin 1944, démontrait que les tas de corps découverts en 1945 ne reflétaient pas la situation du camp entre 1940 et 1944. Les élèves l’ont bien compris. Cet exercice a été donné à une seule classe, en cours de travaux pratiques, afin de faire prendre conscience aux élèves que, parfois, des statistiques permettent de déjouer les pièges de l’image. Le travail terminé, personne n’en a jamais plus parlé et aucun scandale ne fut à déplorer.
S’il en est ainsi, alors comment le scandale a-t-il débuté ?
J’ai été dénoncé. Quelqu’un a révélé que j’utilisais l’ordinateur du lycée pour mes travaux révisionnistes.
Connais-tu le nom de celui , ou de celle, qui t’aurait dénoncé ?
Les dossiers constitués contre moi ne donnaient aucun nom. Le proviseur du lycée aurait été informé de mes activités lors d’une réunion avec des professeurs. Mais la secrétaire de la direction m’a confirmé qu’une telle réunion n’avait jamais eu lieu. D’ailleurs, je le répète, aucun collègue ne m’a jamais surpris ni même posé des questions. Pendant près de quinze ans, je me suis parfois demandé : « Mais qui m’a dénoncé ? » Il a fallu attendre 2011 pour que, soudain, les éléments du puzzle se mettent en place, me permettant de soupçonner une personne en particulier. Je suis certain de sa culpabilité à… disons… 90 %, car outre les éléments de l’affaire, j’ai pu la contacter et ses réponses maladroites l’ont trahie, du moins à mes yeux. Mais je ne révèlerai pas son identité. Cette personne a agi par vengeance personnelle, pas pour des motifs anti- révisionnistes. Cela seul importe. J’ajoute qu’un jour ou l’autre, j’airais été révoqué de l’Éducation nationale, déjà à cause de mes condamnations en justice. Le dénonciateur a précipité les choses, c’est tout, me libérant plus vite pour me consacrer à la cause révisionniste.
Tu es donc passé en commission de discipline ministérielle, à Paris. Comment cela s’est-il déroulé ?
Comme un procès de l’Épuration : le jury (des membres de l’administration et des collègues professeurs) m’ont entendu sans m ‘écouter, le verdict étant rendu d’avance. À la radio, les journalistes ont prétendu que les délibérations avaient duré plusieurs heures. C’est faux ! Une fois sorti du ministère, j’ai mangé dans un restaurant qui se trouvait à côté, avec Pierre Guillaume et quelques amis révisionnistes. Au bout de dix à quinze minutes, j’ai vu les membres de la commission de discipline sortir. Le verdict était rendu ! J’en serais informé peu après.
Tu as donc été révoqué en avril 1997, sans indemnités, devant même rembourser la moitié d’un salaire, puisqu’on t’avait exclu en milieu de mois. Qu’as-tu fait ?
Un élève et un ami m’avait aidé à déménager l’appartement que je louais à Honfleur. Nos meubles furent entreposés chez mon père, dans une remise. Avec mon épouse et nos deux enfants (le dernier était né en juin 1996), nous avons occupé temporairement la maison de vacances appartenant à ma famille, en Vendée. Nous avions été autorisés à y demeurer jusqu’au début du mois de juillet, lorsque les premiers vacanciers arriveraient.
De quoi vivais-tu alors ?
Des avances sur les ventes de mon premier livre consacré au drame d’ Oradour, paru fin mai 1997. Les mois de mai et de juin furent merveilleux ! L’été arrivait et la station balnéaire était encore peu peuplée. Nous avons vécu dans l’insouciance. Mon épouse s’est trouvée enceinte au mois de mai 1997.
Pourtant, ton premier livre sur Oradour avait créé le scandale dès sa parution. Cela n’a-t-il pas gêné ta vie ?
Non. Outre le scandale médiatique, un ami avait diffusé le bon de commande dans la région d’Oradour. Mon numéro de téléphone en Vendée y figurait. Nous avons donc reçu de nombreux appels téléphoniques anonymes, dont la plupart étaient injurieux. Mais cela n’a pas suffi à nous gâcher le bonheur de ces deux mois. D’ailleurs les appels ont vite cessé.
Aucun journaliste ne t’a contacté ?
Aucun. Il ne fallait pas donner la parole à l’auteur. Quel aveu !
Tes adversaires ont-ils porté plainte ?
Non, car contestant un crime de guerre, le livre était inattaquable en justice. Les gardiens de la Mémoire en ont donc appelé au ministère de l’Intérieur pour qu’il interdise l’ouvrage. Le décret parut début septembre 1997.
Si ton numéro de téléphone était connu, ton adresse devait l’être aussi. As-tu été menacé par des gens qui seraient venus à ton domicile ?
Personne ne s’est présenté. Nous avons vécu tout à fait tranquillement, sans nous cacher ni prendre la moindre précaution.
Mais savais-tu où tu irais habiter à partir de juillet ?
Non. Toutefois, je faisais confiance en la providence et elle m’a répondu. Au mois de juin, un ami révisionniste nous a offert d’habiter une maison en Loire-Atlantique, près de Pontchâteau, dans un petit hameau de 200 à 300 habitants, avec pour seul commerce un café.
La maison, vieille de plus d’un siècle, avait été habitée par un couple de personnes âgées. Elle était restée comme elle devait l’être dans les années 50. Pas de chauffage central, une grande cheminée dans le séjour, une salle de bain rudimentaire aménagée sous l’escalier, pas de tout-à-l’égout, pas d’isolation et un toit en mauvais état.
Pour un couple avec bientôt trois enfants en bas âge, ce n’était pas l’idéal. Mais au moins tu avais un toit.
Oui, et surtout, pas de loyer à payer. Notre ami nous a vraiment sauvés. Je l’en remercie encore, ainsi que la Providence qui l’a envoyé. En juin, j’ai rendu la maison habitable, repeignant les murs et posant de la moquette dans les chambres. Avec Pierre Guillaume (l’éditeur du Professeur Faurisson), nous avons ramené nos meubles dans une camionnette louée. J’ai installé la machine à laver le linge dans une buanderie attenante à un grand hangar. Fin juin, tout était prêt. Certes, c’était loin d’être le grand luxe ! Je dirais même que cela restait très rudimentaire. Pour le chauffage, j’avais acheté quatre poêles fonctionnant au pétrole lampant.
Tu as vécu là jusqu’en 1998. Militais-tu toujours pour le révisionnisme ?
Oui, mais je ne me souviens plus trop ce que j’ai publié. Ma vie était très agitée. J’ai répondu aux critiques parues à propos de mon premier livre sur Oradour. J’avais alors créé un bulletin, Le Nouveau Messager. Deux numéros sont parus, consacrés à la défense de mes conclusions sur la tragédie. Je diffusais également des ouvrages révisionnistes par le biais d’un catalogue au format papier.
Tu as donc connu de nouveaux ennuis avec la justice ?
Oui ; mais pas seulement. Les premiers ennuis survinrent avec l’arrivée de l’automne. Les jours diminuant, le froid et l’humidité apparaissant, la vie dans cette vieille maison aménagée de façon rudimentaire, devint très difficile. Mon épouse souffrait d’engelures aux mains ; le jardin était boueux, et lorsqu’elle se rendait à la buanderie, elle revenait crottée; les enfants jouaient dehors, se salissant et salissant tout à l’intérieur. Le pire était la pluie. Elle traversait le toit en mauvais état puis le plancher du grenier. Des gouttes tombaient dans notre chambre, y compris sur notre lit. Lorsque, l’hiver étant venu, un froid intense s’installa, le matin, la température dans la maison descendit jusqu’à 8 degrés. Je craignais pour les tuyauteries. J’ai acheté en urgence de la laine de verre que j’ai déposée sur le plancher du grenier. Mais l’isolation restait très défectueuse. La chaleur s’échappait par les portes et les fenêtres vétustes.
À cette situation déjà difficile, sont venus s’ajouter de nouveaux ennuis avec la justice.
Oui, car je diffusais le Rapport Rudolf qui était interdit en France. Pour cela, j’ai été poursuivi, mon ordinateur a été saisi et on m’a condamné à un an de prison ferme.
La répression s’aggravait donc ?
Il n’y a là rien de surprenant. C’est le phénomène d’accoutumance. Au départ, les juges n’ont pas osé infliger des peines de prison ferme, car la France se présentait comme le pays de la liberté de recherche et d’expression. Ils condamnaient donc à de la prison avec sursis. C’était un peu comme un avertissement. Mais le principe était posé. On pouvait condamner un citoyen reconnu coupable de diffuser publiquement des thèses déplaisantes. Viendrait alors le problème des récidivistes. Si les avertissements ne suffisaient pas, il faudrait sévir, avec de la prison ferme. C’était fatal. D’où cette condamnation infligée en 1997.
Pourtant, tu n’es pas allé en prison. Pourquoi ?
J’ai évité la prison car mon avocat, Maître Eric Delcroix, fit appel du jugement. Les mois passèrent et un jour, il m’avertit que le délai de prescription était atteint. À l’audience, le procureur l’admit. La justice avait commis une négligence. Par conséquent, il plaida ma relaxe pour cause de prescription.
Comment expliques-tu cette « négligence » ?
En sortant du tribunal, Me Delcroix me dit d’un air malicieux : « Je crois qu’une main secourable a placé votre dossier au bas de la pile ». C’est très possible. Ma vie de militant m’a confirmé que l’on dispose d’alliés secrets placés aux endroits les plus inattendus. J’y vois des envoyés de la Providence. Il ne faut donc jamais désespérer.
Malgré cette excellente nouvelle, ta situation familiale restait difficile.
En effet, mon épouse donna naissance à notre troisième enfant – un troisième garçon – le 9 février 1998, en plein hiver. À son retour à la maison, dans le froid et l’humidité, la vie fut très difficile. Je travaillais toute la journée au révisionnisme afin de gagner ma vie. J’imprimais des petites brochures moi-même, avec un recopieur à encre. Je m’occupais de tout : la rédaction, la mise en page, l’impression, l’assemblage, la publicité, la vente, les envois. C’était exténuant. Je donnais également des conférences privées au terme desquelles je vendais mes œuvres. Mais mon épouse était fatiguée et déprimée. Nous avons bénéficié d’aide-ménagères subventionnées par l’État. Toutefois, c’était notoirement insuffisant. J’ai donc trouvé des jeunes filles qui venaient s’occuper des deux aînés. Il fallait les payer, sans compter le reste. Nous avons alors connu une relative pauvreté. Nous devions économiser pour tout. J’ai appris à acheter dans les magasins d’occasion pour l’habillement, les jouets, les livres, le matériel informatique et électrique. Le matin, dans la cuisine, j’allumais le poêle à pétrole et je chauffais le lait dessus, à l’aide d’une casserole. J’en suis venu à cuisiner sur ce poêle. Parfois, les plats avaient un arrière-goût de fumée noire !
Ta famille t’a-t-elle soutenu ?
Sur le plan des idées, non, pas du tout. Mais nous n’en parlions pas, point final. Je ne parlais jamais de ma vie professionnelle et on évitait de m’interroger à ce propos.
Pourtant, tu étais l’auteur d’un ouvrage sur Oradour qui avait défrayé la chronique. Cela n’a-t-il pas éveillé la curiosité ?
Nullement. En juin 1997, j’ai présenté mon ouvrage à un oncle maternel. Il l’a feuilleté puis l’a reposé en déclarant : « Peut-être…mais les SS restent des criminels ». J’ai ensuite offert cet exemplaire à ma mère. Des années plus tard, je l’ai retrouvé déposé au-dessus d’une armoire à vêtements, tout poussiéreux. Il avait été dissimulé là sans avoir été ouvert. Le reste de ma famille ne m’a jamais interrogé sur mes travaux et mes conclusions. Rien, pas un mot. C’était tabou. On acceptait de recevoir le « blasphémateur », mais on ne parlait de rien avec lui… Ma famille est à l’image de 95 % des gens. Ils ne veulent rien savoir du révisionnisme car ils soupçonnent d’instinct que la vérité les dérangerait. Malgré cela, sauf exception, mes proches ne m’ont pas rejeté, non. Ma famille m’a nié. Le Vincent révisionniste n’existe pas. Est-ce mieux que d’être rejeté ? Je le crois…
Tu as quitté cette maison en 1998. Dans quelles circonstances ?
La vie devenait de plus en plus difficile dans ce hameau perdu. Nous n’avions aucune relation de voisinage. Mon épouse sombrait dans la dépression. Je n’ai pas su faire face. Je voulais voir des gens qui me souriaient et avec lesquels je pourrais parler normalement. Le vendredi soir, je partais donc avec mes deux aînés rendre visite à mon père ou à ma mère (ils vivaient séparés). Quand j’allais voir ma mère, j’en profitais toujours pour passer un après-midi et une soirée avec mes beaux-parents qui habitaient non loin. Je disais à mon épouse : « J’emmène les deux grands pour que tu puisses te reposer avec le bébé ». Mais c’était une excuse. Je voulais fuir cette atmosphère étouffante pour respirer un bol d’oxygène le samedi et le dimanche. Je revenais le dimanche dans la nuit.
Laisser ton épouse seule, ce n’était pas une bonne solution !
Non, bien évidemment. Certes, je lui téléphonais le samedi matin, le dimanche matin et le dimanche soir ;. Toutefois, cela ne réparait rien. Ici se place un évènement très mystérieux. Un dimanche matin – c’était fin février 1998, je crois – mon épouse me dit que des milliers de grosses mouches avaient envahi le couloir de l’étage. Elle me raconta que, seule dans sa chambre, elle avait soudain entendu un gros bourdonnement dans le couloir. Ayant ouvert la porte, elle vit un nuage de mouches qui obscurcissait l’atmosphère. Les mouches apparaissaient, volaient quelques secondes et tombaient au sol. D’autres surgissaient alors, venues de nulle part. La couche de mouches mortes s’épaississait. Terrifiée, elle ferma la porte. Peu après, le bourdonnement diminua puis cessa complètement. Quand elle eut le courage de regarder, le sol était recouvert d’une couche de deux à trois centimètres de mouches. Elle prit l’aspirateur et remplit tous les sacs disponibles (une dizaine peut-être). Mais des cadavres jonchaient encore le sol. Je lui ai demandé de ne rien toucher, je voulais voir. Le soir, dès mon retour, j’ai pu constater de moi-même. Une dizaine de sacs d’aspirateur remplis de mouches et des centaines de mouches mortes gisaient encore sur le sol. C’était digne d’un film d’épouvante.
Des mouches…normales ?
Oui, comme on peut en voir l’été : des drosophiles. Il n’y en avait que dans le couloir. Rien dans les autres pièces, ni même dans les escaliers. J’ai inspecté le grenier, rien. Il faisait froid, la maison était froide. Le couloir n’était pas chauffé et nous fermions les portes des pièces. Je ne puis croire que ces milliers de mouches seraient subitement sorties de leur hibernation à la faveur de la chaleur. Mon épouse m’a confirmé qu’elles semblaient venir de nulle part.
Comment l’expliques-tu ?
Je n’ai aucune explication rationnelle. Je pense que mon épouse, totalement seule et déprimée, a songé sérieusement à mettre fin à ses jours. La Providence l’en a empêchée, en particulier pour le bébé qui était avec elle. Cet évènement m’a ébranlé. J’étais bien décidé à trouver une solution pour déménager au plus vite.
L’occasion s’est-elle présentée rapidement ?
Durant l’été 1998 d’après mes souvenirs. Je dois vous dire que les années 1998-2010 ont été les plus agitées de ma vie. Bien des évènements sont survenus. Sans documents pour les situer dans le temps, je ne pourrai les raconter par ordre chronologique. Si, un jour, je suis libéré et suffisamment en forme, alors je m’aiderai de mes revues et des papiers qui me restent pour rédiger mes mémoires. Dans le cadre de cet entretien, je raconterai certains faits sans prétendre respecter scrupuleusement leur succession.
Durant l’été 1998, une amie m’a informé qu’une école hors contrat cherchait un professeur d’Histoire. Situé dans les Alpes, l’établissement était dirigé par le Père Avril. Il scolarisait des collégiens et des lycéens libanais. Quelques dizaines tout au plus. Je m’y suis présenté, et j’ai été engagé.
Mais tu n’es pas professeur d’Histoire ?
S’agissant d’enseigner à des collégiens ou des lycéens, j’avais la culture suffisante et les manuels adéquats. Toutefois, vous avez raison. Une telle situation aurait dû m’alerter. Cependant, je voulais quitter la maison au plus vite, donc j’ai omis de m’informer davantage. Avec un ami, nous avons loué deux camionnettes et avons emporté ce que nous avons pu dans les Alpes. Le Père Avril avait mis gracieusement à ma disposition une petite maison inoccupée dans l’établissement. La rentrée approchait et il fallait faire vite. Je reviendrais chercher le reste plus tard, ce qui me permettrait de nettoyer la maison.
Te voilà donc dans les Alpes, enseignant l’Histoire à de jeunes libanais. Devais-tu également leur enseigner la Shoah ?
La question ne s’est pas posée, car quelques semaines après la rentrée, un couple d’amis m’a raconté ses mésaventures dans cette école, des années auparavant. Ce qu’ils avaient vu et vécu qui avait provoqué leur départ . Encore avaient-ils eu de la chance. Ils avaient quitté les lieux dans des conditions décentes. Mais certaines personnes et certaines familles avaient perdu beaucoup.
Que t’a-t-il raconté ?
Des affaires de mœurs et des indélicatesses dans le domaine financier. Je n’en dirai rien ici, mais j’ai pu découvrir des éléments qui confirmaient ses dires dans deux cas précis.
Tu as donc choisi de partir ?
Non, pas tout de suite. Vers novembre, toutefois, alors que j’attendais en vain le versement de mes salaires, le Père Avril m’a fait comprendre que je devrais payer un loyer pour la petite maison. Il a en outre refusé de financer le remplissage de la cuve de fioul pour le chauffage, arguant que l’on chauffait trop. Enfin, il a tenté de couvrir une affaire de mœurs : un élève qui couchait avec la surveillante en chef ! Les avertissements de mon ami ayant été confirmés, j’ai compris qu’il fallait quitter les lieux au plus vite si je ne voulais pas finir ruiné, car j’épuisais mes dernières réserves. Un militant nationaliste qui habitait la région accepta de m’aider. Mais ce fut le déménagement le plus éprouvant de ma vie.
Où es-tu allé ? Car je suppose que tu n’es pas revenu où tu habitais auparavant ?
Il n’en était pas question, par ma propre faute. Embarqué dans le tourbillon d’une vie agitée et anxiogène, j’avais laissé sans nouvelles l’ami qui me l’avait prêtée. Un jour, j’étais revenu prendre les dernières affaires et nettoyer la maison. La porte était fermée et la serrure changée. Je lui ai téléphoné. Il m’a sermonné, ajoutant qu’il avait vidé la maison et changé toutes les serrures. Je suis reparti les mains vides, et sans avoir pu plaider ma cause.
Tu avais donc fait tout ce trajet pour rien ?
Effectivement. Certes, cela était ma faute. Mais dans de tels moments, on se sent vraiment seul. J’avais laissé un beau berceau en bois auquel mon épouse tenait, ainsi que des jouets, des habits…Tout était perdu, et la situation dans les Alpes était mauvaise. Il y avait de quoi désespérer.
Qu’as-tu donc fait ?
Lorsque nous avons décidé de quitter l’établissement du Père Avril, j’ai téléphoné à un ami belge révisionniste que je connaissais depuis 1992. Il vivait à Bruxelles, dans une grande maison à trois étages, les deux derniers étant inoccupés depuis des années. Il a accepté de nous loger gratuitement.
Si je comprends bien, en moins d’une année, tu étais parti de la Vendée pour les Alpes, et tu allais déménager des Alpes pour la Belgique ?
Exactement. C’était une vie de fou.
Mais n’avais-tu pas signé un contrat de travail et d’habitation avec le Père Avril ? Était-il impossible de te défendre ?
Non, car je pensais que la parole donnée suffisait. J’évoluais dans un milieu qui se prétend l’ultime refuge de la noblesse. J’y avais certes côtoyé des gens nobles. Mais j’étais très naïf. J’ajoute que les révélations faites par différentes personnes à propos de faits inavouables survenus dans l’établissement du Père Avril, étaient insupportables à mon épouse. Elle vivait dans le dégoût et dans la peur. J’ignore si tout ce que l’on nous racontait discrètement était vrai. Il était même question d’une religieuse qui, s’étant disputée avec une autre, aurait planté de rage une paire de ciseaux pointus dans… un Christ en croix ! Fausse rumeur ? Exagération ? Peut-être. Mais mon épouse voulait quitter ces lieux. Elle en était malade, au premier sens du terme. Un soir, probablement un vendredi, j’ai assis les trois enfants dans la voiture et nous sommes partis pour la Normandie, chez mes beaux-parents. Mon épouse était sur le siège passager, avec une fièvre approchant les 40°C.
Tu as entrepris un voyage des Alpes vers la Normandie en catastrophe ?
Pas en catastrophe. Le départ était prévu. Depuis une semaine, nous préparions secrètement le déménagement en disposant nos affaires dans des cartons.
Pourquoi secrètement ?
Car je craignais la réaction du Père Avril. Quoi qu’il en soit, je suis parti pour la Normandie au volant d’une vieille BX14 à quatre vitesses. J’ai roulé toute la nuit, observant des pauses régulières durant lesquelles je dormais une vingtaine de minutes sur le siège conducteur. Je pensais alors à l’Exode…
Tu es donc arrivé chez tes beaux-parents. Que pensaient-ils de ta situation ? Soutenaient-ils le révisionnisme ? Dans le cas contraire, ils devaient être très mécontents.
Ils ne soutenaient pas le révisionnisme. On n’en parlait pas, c’était comme un tabou. Et s’ils étaient mécontents, ils ne l’ont pas montré. Non, ma belle-mère m’a dit sur un ton neutre : « Tu as fait un essai, ça a raté ». Elle évoquait mon travail dans les Alpes.
Comment expliques-tu cette réaction pour le moins surprenante ? Car beaucoup de beaux-parents auraient exigé de leur gendre qu’il cesse le militantisme révisionniste, faute de quoi leur fille le quitterait.
Ils savaient que je ne cesserais jamais le combat. Quant à leur fille, j’ignore ce qu’ils ont pu lui dire, mais leurs rapports n’avaient jamais été très harmonieux, et je pense qu’ils n’avaient guère d’emprise sur elle.
Malgré cela, ils ont accepté de te recevoir ?
Oui. Marina – mon épouse – était leur fille unique et ils aimaient leurs petits-enfants. Quant à moi ; j’avais toujours eu des rapports cordiaux avec eux. Sans me soutenir, ils nous ont aidé. Aujourd’hui encore, je les en remercie.
Après m’être reposé une demi-journée, je suis reparti pour les Alpes. Je me souviens qu’en route, vers Paris, je me suis arrêté dans une brocante ouverte. Là, j’ai acheté un château-fort en plastique pour mes enfants. Nous l’avons gardé des années. Une telle initiative peut surprendre, mais je pense que c’est une façon de dédramatiser. Faire comme si tout était normal. Un peu comme Hitler qui, en 1945, discuta avec Albert Speer des plans de Berlin pour l’après-guerre.
Tu craignais la réaction du Père Avril. Comment as-tu donc déménagé. De nuit ?
Oui, mon ami avait loué un petit camion. Il est arrivé un soir avec une demi-douzaine de jeunes militants et sympathisants nationalistes. Nous avons chargé le plus vite possible, non par crainte du Père Avril – car il s’était absenté – mais parce qu’il fallait rendre le véhicule avant le surlendemain à 8 heures du matin. Les jeunes ont bien travaillé ; ils devaient en outre suivre le camion avec ma voiture jusqu’à Bruxelles afin de nous aider à décharger. Mais deux ou trois ont renoncé. Puis, lors du trajet, la police nous a arrêtés. Le camion était surchargé. Il a fallu louer une camionnette ! Mon ami s’en est occupé, à ses frais. Je conduirais le second véhicule. Mais les jeunes ont abandonné la partie. Il faudrait donc rouler toute la nuit sans pouvoir se relayer au volant. C’était mission impossible. Aussi avons-nous pris du retard en observant régulièrement des pauses pour dormir un peu.
C’était plus prudent, car un accident aurait été catastrophique !
En effet. Arrivés à Bruxelles, la femme a engagé deux étudiants pour nous aider à monter nos affaires au deuxième étage, sans ascenseur, puisqu’il s’agissait d’une maison individuelle. Pressés par le temps, nous avons tout entassé pêle-mêle dans une pièce, sans aucun ordre. On aurait dit qu’une tornade était passée. Puis, après un petit repos, nous sommes repartis pour les Alpes. C’était alors la fin de l’après-midi. Théoriquement, nous aurions pu revenir à temps. Mais c’était sans compter la fatigue et la neige qui tombait depuis plusieurs heures. Le retour fut un véritable calvaire. Mon ami s’est ruiné en essence et en frais supplémentaires, car nous avons rendu les véhicules en retard. Je l’en remercie du fond du cœur. Des Alpes, je suis revenu en Normandie où j’ai pris mon épouse et mes enfants afin que nous aménagions dans notre nouveau logement. Lorsqu’elle vit le tas d’affaires, elle fondit en larmes. Mais nous nous sommes mis au travail et en quelques jours, nous avons aménagé le deuxième étage, mon bureau ayant été installé au troisième.
Contrairement donc à une légende qui a couru, tu n’as pas quitté la France pour fuir la justice ? Tu l’as quittée, car tu avais trouvé un ami à Bruxelles pour vous offrir un logement ? Il fallait faire vite.
Effectivement. Je n’ai pas fui la justice française, mais l’établissement du Père Avril. Si l’on m’avait offert un logement en France, je n’aurais pas quitté le pays. Je note que 25 ans après, la légende court toujours ! Dans un livre paru en 2023, un auteur parle de ma condamnation, en 2008, à un an de prison ferme, par la justice française. Il ajoute : « C’est ce qui le conduit en Belgique pour se cacher »1. C’est entièrement faux ! Arrivés en Belgique début 1999, nous avons effectué toutes les démarches légales, parmi lesquelles une [1 KRUG François, Réactions françaises. Enquête sur l’extrême droite littéraire. Seuil, Paris, 2023, p.140.] inscription au Consulat de France. J’y ai donné ma véritable identité ainsi que mon adresse à Bruxelles. Je ne suis donc pas allé me cacher en Belgique.
Vous avez emménagé au deuxième et au troisième étages d’une maison individuelle. Vous n’aviez donc pas de cuisine ?
En effet. Nous disposions d’une salle de bain (avec deux lavabos, une douche et une baignoire) et de quatre grandes pièces. Nous y avons aménagé notre chambre, celle des enfants, mon bureau et une salle à manger avec le réfrigérateur. Dans cette salle à manger, j’ai posé du carrelage au-dessus du buffet où la vaisselle était rangée. Deux plaques chauffantes nous ont permis de cuisiner. Peu après, j’ai acheté un petit four que nous avons placé sur le réfrigérateur. Nous lavions la vaisselle dans les lavabos de la salle de bains : un pour le lavage, un pour le rinçage. La machine à laver le linge se trouvait à la cave , dans une buanderie. Pour mon épouse, c’était assez difficile car elle devait descendre et remonter trois étages à chaque fois.
C’était en quelque sorte de l’improvisation ?
Oui, mais nous avions un toit où nous pouvions loger gratuitement. Étant ruinés financièrement, c’était merveilleux !
Qu’as-tu fait pour survivre ? As-tu donné des cours particuliers ?
Non, car une nouvelle opportunité s’est offerte. Sur les conseils d’un ami belge, nous avions scolarisé notre fils aîné dans une école de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie X, à Bruxelles. C’est ainsi que nous sommes entrés dans le monde des catholiques traditionalistes, dont nous ne connaissions rien. Une fois notre fils inscrit, on nous a invités à suivre la Messe tous les dimanches. Les fidèles ayant appris à nous connaître, ils ont su que j’avais été professeur de maths-sciences dans un établissement public. J’ai alors été informé qu’un établissement de la FSSPX recherchait un professeur de physique-chimie. Il était situé à Camblain-l’Abbée, près d’Arras, dans le Pas-de-Calais. Je m’y suis présenté.
On t’a engagé malgré ton passé…disons sulfureux ?
Eh bien oui ! Le directeur était l’abbé Berteaux. Quand il a su que j’étais l’auteur du livre sur Oradour, il en a été ravi. Il m’a tout de suite engagé, me demandant juste d’être discret sur mes activités révisionnistes.
C’était donc un sympathisant révisionniste ?
Un ardent sympathisant, politique également ! J’ai pris mes fonctions en septembre 1999, si je me souviens bien. Je logeais dans une chambre de l’établissement, non loin des dortoirs. Naturellement, je suis resté très discret. À l ‘époque, j’étais encore assez peu connu.
L’expérience a-t-elle été heureuse ?
Tout à fait ! J’étais très apprécié des élèves pour mes compétences pédagogiques et aussi pour ma gentillesse et mon sens de l’humour. Un soir, lors d’une messe, une panne de courant survint dans la chapelle. Nous nous retrouvâmes plongés dans la pénombre. Soudain, au bout de cinq minutes, une grande lumière se fit : l’homme à tout faire de l’établissement venait d’apporter une lampe de chantier qu’il avait branchée ailleurs. Arrivé par la porte du fond, personne ne l’avait vu faire. Tout le monde ayant été surpris, j’ai dit aux lycéens auprès desquels j’étais assis sur les bancs du fond : « Oh ! Une apparition ! » Pendant au moins cinq minute, nous avons dû faire tous nos efforts pour étouffer nos fou-rires. Nous nous amusions beaucoup.
Un autre jour, une nouvelle panne de courant survint cette fois-ci dans les classes, dont le laboratoire de physique. Les installations souffraient d’un manque d’étanchéité du toit. Quand il pleuvait, l’eau provoquait des courts-circuits, donc des pannes. J’avais programmé un cours sur…l’électricité, avec une expérience pour faire comprendre la différence entre tension électrique et intensité du courant. Cette expérience, j’ai dû la mener dans le hall de l’établissement, épargné par la panne. Outre ma classe, d’autres élèves l’ont suivie, ainsi que l’abbé Berteaux. Plus tard, il m’a félicité pour la clarté de mes explications. « J’ai trouvé la perle rare », m’a-t-il confié.
Tu avais donc enfin trouvé un poste fixe ?
C’est ce que j’ai cru. Mais j’ai rapidement appris qu’être révisionniste vous transformait en paria, même dans les milieux plutôt amicaux.
Que s’est-il passé ? La Police est-elle venue t’arrêter dans les locaux ?
Même pas. Vers le mois de novembre eut lieu la réunion entre les parents et les professeurs de l’établissement. Le père d’un élève a glissé à l’un de mes collègues : « Alors, ça fait quoi de travailler avec Vincent Reynouard ? » Le collègue ayant manifesté son incompréhension, le père lui a révélé que j’étais un révisionniste, auteur du livre sur Oradour qui avait été interdit sur tout le territoire. Pour lui, c’était l’horreur.
Une gaffe, en quelque sorte ?
Oh oui ! Le collègue a prévenu les autres professeurs. Tous ont craint qu’un journaliste ne découvre ma présence comme enseignant et ne provoque ainsi un scandale, qui entrainerait la fermeture de l’établissement. Ils sont allés voir l’abbé Berteaux et l’ont supplié de me congédier sur le champ.
L’abbé a-t-il cédé ?
J’ignore s’il a reçu d’autres pressions. Mais peu après, c’était un mercredi je crois, il m’a convoqué dans son bureau. Là, il m’a raconté ce qu’il s’était passé et m’a demandé de quitter l’établissement le jour même. Il avait les larmes aux yeux. Je lui ai répondu que j’acceptais de partir, mais que je souhaitais rester jusqu’au vendredi soir, le temps de dire au revoir aux élèves et de finir mes cours. Il a accepté. De façon évidente, mon départ le consternait.
As-tu été dédommagé ?
Rien n’y obligeait l’établissement. Mais jusqu’à la fin de l’année scolaire, l’abbé Berteaux m’a donné sa paie mensuelle. Un seigneur ! Je l’en remercie.
Tu as donc quitté l’établissement après avoir dit adieu aux élèves ?
Oui, c’était la deuxième fois. Et tout comme la première, les élèves étaient dépités. Cela m’arrivera encore quatre fois, en 2009, 2014, 2015 et 2016 (ou 2017), comme professeur particulier. Quoi qu’il en soit, lorsque je suis parti de Camblain, j’ai compris que je ne pourrais plus jamais trouver un poste fixe d’enseignant dans un établissement, quel qu’il fut. Un révisionniste déclaré devient un paria. Pour des raisons différentes certes, mais le résultat reste le même.
Qu’en fut-il du militantisme révisionniste ? Car étant ruiné, tu ne pouvais plus continuer, même avec un maigre salaire de professeur dans une école hors contrat. Cette paie servait juste pour vos besoins familiaux.
J’ai été secouru par deux amis.
Tout d’abord un Français qui m’a prêté la somme de quinze mille francs. Je lui rembourserais quand cela me serait possible, sans intérêts. Je l’ai partiellement remboursé, en donnant des cours particuliers à ses enfants. Ensuite un flamand, Siegfried Verbeke, animateur de la Fondation pour la libre recherche historique (Vrij Historisch Onderzoek, VHO). En 1997 , il avait publié mon ouvrage sur Oradour. À Anvers et à Gand, il possédait plusieurs magasins de photocopies. Il m’a offert cinq mille francs de photocopies, afin de réimprimer des brochures révisionnistes ainsi qu’un catalogue. Ayant pu sauver mes fichiers, je suis parvenu à reprendre mes activités. J’en ai profité pour créer un bulletin d’informations révisionnistes qui aurait le même titre que mon tout premier bulletin, Nouvelle Vision. Sur le papier, j’avais créé une annexe du VHO pour la France . VHO signifiait alors Vision Historique Objective. Ainsi pouvais-je bénéficier de la boîte postale et du compte en banque de la fondation créée par Siegfried Verbeke.
Cette reprise des activités a dû enrager tes adversaires ?
En effet. Alors que le second numéro de Nouvelle Vision venait d’être imprimé, nous avons reçu, de la France, un arrêté ministériel qui interdisait la revue. Dès le premier numéro, donc, l’organe avait subi les foudres des autorités.
Pour quels motifs ?
Je ne m’en souviens plus. À vrai dire, je m’en moquais. Après avoir envoyé le second numéro aux abonnés, j’ai décidé de publier ensuite des livrets à intervalles réguliers, au format A5 (Nouvelle Vision était en A4). Chacun aurait un titre différent – celui de l’étude principale qui y serait publiée – ainsi la France ne pourrait- elle pas nous accuser de violer l’arrêté d’interdiction. Elle devrait en outre interdire les livrets l’un après l’autre, ce qui paraissait impossible. Et en effet, j’ai pu en éditer un certain nombre, dont l’un circule encore sous le titre : Julius Streicher à Nuremberg. À la source de l’imposture « antiraciste ».
Toutefois tes adversaires ne se sont pas avoués vaincus ?
Non, naturellement. Pour encaisser les chèques français, le VHO avait ouvert un compte dans une banque lilloise. Un jour, Siegfried Verbeke m’informa qu’il allait le clôturer, l’établissement refusant désormais de nous compter parmi ses clients.
La banque en avait-elle le droit ?
Je pensais que non, mais une étude des textes me détrompa. J’ai tout de même téléphoné au responsable pour connaître les raisons de cette décision, car la lettre reçue par Siegfried Verbeke ne les mentionnait pas. Visiblement déstabilisé mais soucieux de se justifier, il improvisa et me lança : « On ignore la nature de votre commerce. Qui sait si vous ne diffusez pas…euh…du…de la pornographie ! ». Comme si le porno était interdit ! C’était vraiment pitoyable. Le banquier jouant les pères-la-pudeur. Mais sachant qu’une banque n’avait pas à se justifier, je n’ai pas insisté. J’ai mis fin à la conversation.
Comment as-tu fait pour encaisser les chèques français ?
Un de mes amis s’appelait Roger H… J’ai demandé aux gens de libeller leurs chèques à VR « sans mention ni trait ensuite, nous complèterons ». Le V devenait un M, le R devenait Roger puis j’ajoutais le nom de mon ami. Les chèques étaient ensuite ventilés sur plusieurs comptes que mon ami possédait du fait de ses activités professionnelles. Je me suis acheté une collection de stylos feutre pour pouvoir modifier l’ordre sans que cela ne se voit. C’était très drôle, à chaque fois, de trouver le bon, celui avec l’encre la plus proche. Cela devenait un jeu.
Les autorités belges t’ont-elles créé des ennuis ?
Non, du moins pas au début. Sans surprise, la tempête répressive vint de France. Fin 2000, j’ai publié une cassette vidéo intitulée Oradour, 50 ans de mensonges officiels. Un de mes amis en fit la promotion dans la région d’Oradour ; il envoya même quelques bons de commande à un habitant du village reconstruit.
C’était vraiment provoquer. Avait-il agi sur ta demande ?
Non, je ne lui avais rien demandé et s’il m’avait proposé de le faire, j’aurais refusé. Après ce qui s’était passé en 1997, j’avais toutes les raisons de craindre une nouvelle interdiction, ce qui ne m’arrangeait pas.
Et en effet, la cassette a été interdite assez rapidement.
Le 8 février 2001 pour être précis ; un arrêté préfectoral prohiba sa diffusion dans tout le département de la Haute-Vienne (le département d’Oradour-sur-Glane). Mais des élus locaux alertèrent le Premier ministre, et je savais que tôt ou tard, l’interdiction s’étendrait à tout le territoire français.
Pour ton livre, la répression s’était bornée à une interdiction. Mais cette fois, tes adversaires décidèrent d’aller plus loin en portant plainte.
Oui, et pour mettre en branle la justice quand l’affaire semble mal engagée, ils utilisent toujours la même méthode. Ils multiplient les plaintes, pour attaquer sous différents angles. On se souvient du cas de Paul Touvier, cet ancien Milicien, traqué au début des années 90. Son avocat, Maître Tremollet de Villers, a fort bien dévoilé cette stratégie dans son livre Paul Touvier est innocent. Dans mon affaire, outre la directrice du Centre de la Mémoire d’Oradour, la réceptionniste de cet établissement porta plainte. J’ai pu le découvrir en consultant le dossier. Pour réaliser le documentaire, nous avions filmé le hall du mémorial. Dans les dernières secondes, on voyait le bureau de l’entrée avec la réceptionniste qui accueillait les visiteurs. Pas en gros plan, mais dans une vue d’ensemble. Pour ces quelques secondes, la réceptionniste porta plainte, nous accusant d’avoir utilisé son image de façon abusive.
La plainte a-t-elle été reçue ?
Non, bien entendu, c’était trop ridicule. Mais cette initiative démontre l’état d’esprit de nos adversaires. Quand ils veulent faire taire une voix qui les dérange, ils font flèche de tout bois, saisissant tous les prétextes possibles. Leur raisonnement est le suivant : « Il faut porter plainte coûte que coûte. Donc trouvons toutes les raisons possibles, en espérant qu’une d’entre elles sera reçue ».
C’est vraiment une utilisation abusive de la Justice, car normalement, le raisonnement est le suivant : « Je me sens lésé pour telle raison valable, donc je porterai plainte pour cette raison ». Ici, c’est : « Il faut faire taire cette voix qui énonce des vérités dérangeantes, mais sachant que la Justice ne peut agir pour cette raison, alors on cherchera des prétextes ».
Exactement ! La suite l’a d’ailleurs démontré. Le juge d’instruction désigné, Christine Fourel, me poursuivit tout d’abord pour « négation d’un crime de guerre ». Mais à l’époque, la loi réprimait uniquement la contestation de l’existence de crimes contre l’humanité (commis par les vaincus de 1945). Quand elle s’en aperçut, Madame Fourel changea le chef d’accusation. Elle m’inculpa « d’apologie de crime de guerre ». Or, je ne pouvais faire l’apologie de ce que, précisément, je contestais. Mais qu’importe, il fallait me poursuivre coûte que coûte. Si ce ne pouvait être pour négation, alors ce serait pour…apologie ! Ubuesque !
Notons tout de même que l’affaire s’est mal terminée pour tes adversaires. Car si tu as été reconnu coupable d’apologie en première instance et en appel, la Cour de Cassation a finalement annulé les condamnations. Tout cela, tu l’as expliqué dans ton dernier livre paru en 2022 « Oradour, le cri des victimes ». Pour toi – et ton avocat – le combat judiciaire s’acheva par une victoire éclatante !
Certes, mais il existe une réalité bien sombre que trop de gens ignorent. Ils s’imaginent qu’en cas de victoire judiciaire, c’est comme si rien ne s’était rien passé. Grave erreur ! On peut comparer une plainte déposée contre vous à un incendie allumé dans votre habitation : même si vous parvenez à en réchapper et à l’éteindre , vous avez beaucoup perdu en temps, en énergie et en matériel .
Le 16 mars 2001, sur demande de la France, les autorités belges perquisitionnèrent mon domicile. J’étais alors absent, car je donnais des cours particuliers dans une famille nombreuse en France. Quand je revins, je trouvai mon bureau presque totalement vidé. Les policiers belges avaient emporté mon ordinateur, mes stocks de livres et de brochures révisionnistes que je vendais, des papiers divers et des cartons d’archives. Un recours me permit de récupérer une boîte où je classais tous mes contrats, mes factures (électricité, téléphone, travail,…) et mes fiches de paie. Le reste partit en France, au tribunal de Limoges où travaillait Christine Fourel. En juin 2001, je fus convoqué pour le tri de ce qui avait été saisi. Madame Fourel garda la plupart des affaires, y compris des chèques de clients qui m’avaient acheté des livres. Ces chèques furent perforés, liés ensemble et mis sous scellé. Le tout devait se monter à environ 3000 €. Pour moi, c’était une perte énorme !
Ont-ils servi lors du procès ?
Non, je n’en ai plus jamais entendu parler, y compris lors de l’instruction. De façon évidente, le juge les saisit pour me porter un coup financier très dur. À cela s’ajoutait mon matériel informatique et les ouvrages qu’il me faudrait réimprimer. La perte dépassait largement les 6000 €. Mais le plus grave était les archives d’Oradour ! Christine Fourel saisit notamment mon cahier dans lequel j’avais consigné tous mes constats effectués dans les ruines ainsi que toutes mes conversations avec les survivants rencontrés. La perte était immense. En revanche, j’ai pu sauver un document capital : le fax de l’aviateur britannique Len Cotton qui avait été caché par la Résistance dans l’église d’Oradour. Christine Fourel me l’a présenté en disant : « c’est quoi ça ? ». Je me suis dit : « Mon Dieu, je dois sauver ce fax ! ». J’ai alors pris un air détaché en disant :
« Oh ! C’est une piste qui n’a rien donné ! ». Elle l’a déposé dans la (petite) pile des papiers que je pourrais reprendre. Deo Gratias !
Mais n’as-tu pas tout récupérer après ta victoire en cassation ?
J’ai voulu, naturellement. Toutefois, on m’a appris qu’il me faudrait payer un huissier chargé d’entreprendre des démarches, et que je devrais tout venir reprendre à mes frais. J’étais abasourdi. La Justice m’avait poursuivi illégitimement et m’avait saisi énormément d’affaires. La moindre des choses aurait été de venir me les rendre. Mais non ! C’était à moi d’accomplir toutes les démarches à mes frais ! À l’époque, cela m’était impossible, faute de temps et d’argent. Je n’ai donc rien récupéré.
D’où une perte d’au moins 6000 €, que personne n’a vue !
Sans compter les déplacements et les frais divers. En effet, pour les besoins de l’instruction, le juge m’a convoqué quatre fois. Quatre fois, j’ai donc dû effectuer le trajet Bruxelles-Limoges aller-retour à mes frais. Pour éviter de perdre trop de temps et de payer l’hôtel, je partais le soir, je roulais de 22h à 3h du matin environ. Je dormais dans ma voiture de 3h à 6h et je repartais pour arriver à l’heure chez le juge d’instruction. Le pire est que souvent, le juge me faisait attendre puis m’interrogeais 2h au maximum. En moi-même, je me disais : « C’est tout ? Tout ça pour ça ! ». Exténué, je dormais dans ma voiture puis je repartais en fin d’après-midi pour Bruxelles. Une fois, un ami limougeaud me paya une chambre d’hôtel. Après l’interrogatoire, je pus prendre un bain, me reposer dans un vrai lit et repartir le soir vers 22h. Sans même compter les frais d’essence, tout cela représente une énergie folle et un stress considérable. Il faut être à l’heure, conduire en état de fatigue, faire face à un juge qui n’instruit qu’à charge. C’est exténuant. Cet aspect du combat révisionniste, le public l’ignore bien souvent. Nos adversaires, eux, disposent de leurs avocats, de moyens financiers et d’une « justice » en leur faveur. Le déséquilibre des forces est total. Voilà pourquoi un combattant révisionniste doit être un convaincu absolu. Sans cela, il abandonnera, car je le répète, même une victoire judiciaire vous use et vous fait perdre beaucoup. Sous nos latitudes, un révisionniste peut uniquement remporter des victoires intellectuelles. Sur le plan matériel, il perd toujours.
Tu évoques un déséquilibre des forces. Dans ton affaire, c’était poussé à l’extrême. La juge avait même fait décoller les timbres qui figuraient sur les enveloppes envoyées aux habitants d’Oradour. L’objectif était d’analyser l’ADN afin d’identifier l’expéditeur. C’est ainsi que ton ami limougeaud a été découvert.
Mais il y a plus. En consultant le dossier d’instruction, je me suis aperçu qu’une certaine madame Marina Godefroy avait été mise sur écoute. Elle avait signé un contrat avec un opérateur de téléphonie mobile dont une agence se trouvait à Lille. Godefroy est le nom de jeune fille de mon épouse. Avait-elle utilisé cette identité pour signer ce contrat ? Si oui, elle ne m’en avait rien dit. Maître Delcroix me tendit son téléphone et me conseilla : « Téléphonez à cette personne, son numéro figure dans le dossier » . J’ai composé le numéro et je me souviens encore du dialogue :
« – Bonjour, Vincent Reynouard à l’appareil. Êtes-vous Marina Godefroy ?
– Oui (ce n’était pas la voix de mon épouse).
– Êtes-vous mariée à Vincent Reynouard ?
– Non…
– Mon épouse est un homonyme. Elle s’appelle aussi Marina Godefroy. J’ai trouvé votre numéro dans un dossier d’instruction qui me concerne. Je suis poursuivi en justice. Dans le cadre de cette affaire, le juge vous a mise sur écoute. Il a cru que vous étiez ma femme. Donc voilà, vous êtes sur écoute. Je tenais à vous le dire. Bonne journée ».
Avec Maître Delcroix, nous avons bien ri en pensant à cette pauvre femme mise sur écoute alors qu’elle était totalement étrangère à l’affaire. Cela m’a fait penser au film Terminator, quand le terminator tue toutes les femmes qui s’appellent Sarah Connor !
Tous ces moyens déployés pour une cassette révisionniste sur Oradour ? Cela démontre la peur de tes adversaires !
La peur et aussi le fait que les mythes issus de la Seconde guerre mondiale sont d’une importance capitale pour le Système, car ils fondent sa morale mondialiste et « antiraciste ». Jérôme Bourbon parle de la contre- religion de la Shoah. Il a raison. J’ai d’ailleurs consacré deux études à ce sujet. Mais il n’y a pas que la Shoah ! Oradour est une autre facette de cette contre-religion : cérémonies, pèlerinages, reliques… Tout y est. Par conséquent, Christine Fourel se sentait investie d’une mission sacrée : faire taire le blasphémateur ! Dans le cadre d’une telle mission, tout doit être mis en œuvre, et tout l’a été. Je l’explique dans mon nouveau livre sur Oradour (Oradour, le cri des victimes), donc je n’y reviendrai pas ici.
En 2002, un évènement survint, qui allait te donner l’occasion d’écrire un livre mêlant histoire et politique : la qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième tour de l’élection présidentielle. Comment l’idée t’en est-elle venue ?
Pour le comprendre, il faut revenir en arrière. Adolescent, j’avais remarqué l’impossibilité de discuter le bilan du national-socialisme. Dès que l’on invoquait les réussites sociales constatées sous Hitler, les gens coupaient court en lançant : « Peut-être, mais on sait où tout cela mené ! » (aux camps, à la guerre mondiale et aux chambres à gaz). D’où l’importance que je conférais au révisionnisme historique, car il permettait de neutraliser cette objection. Cependant, j’ignorais pourquoi le « on sait où cela a mené » était si efficace dans l’esprit de mes interlocuteurs. Par conséquent, je n’avais jamais rien écrit sur le sujet.
La solution me fut apportée en 1991, lors d’un cours de programmation suivi à l’ISRMa. Le professeur nous expliqua que le cerveau fonctionnait par analogie-déduction. Face à un nouveau problème, plutôt que de l’analyser dans toutes ses dimensions pour espérer élaborer une solution, il recherchait dans la mémoire un problème similaire afin de s’inspirer de la solution déjà trouvée. Le professeur nous avait donné l’exemple suivant : si, dans un pays inconnu, un explorateur se retrouve face à un animal qui émet un son en montrant ce qui lui sert de dentition, plutôt que d’analyser la situation, l’explorateur se dira que, chez lui, un chien qui grogne en montrant les dents est prêt à l’attaque. Il se préparera donc à fuir ou à se défendre.
À peine ai-je entendu cela, que je me dis : il en va de même avec Le Pen. On nous déclare : « Il est raciste, nationaliste et anti-juif ; cela ne vous rappelle rien ? Si, cela vous rappelle Hitler. Or Hitler, on sait où ça a mené. Donc, Le Pen on sait où ça va mener ! ». En un instant, je compris pourquoi cet argument était si fort. Il s’appuyait sur un fonctionnement habituel du cerveau. En juin 1991, j’écrivis un article qui expliquait cela. Il parut dans le bulletin de l’ANEC. Dès qu’elle en eut connaissance, la sœur du Professeur Faurisson fut enthousiasmée. Elle me dit que mes réflexions sur l’analogie-déduction étaient essentielles afin de faire comprendre l’importance du combat révisionniste.
Pendant des années, dans des articles et des conférences, j’ai développé ma thèse. L’ennui est qu’elle restait théorique. Pour l’appuyer, j’invoquais des sondages, des réactions individuelles et quelques scrutins locaux, mais c’était insuffisant. Le 21 avril 2002, quand j’appris les résultats du premier tour de l’élection présidentielle et quand j’entendis les premières réactions (par exemple cette jeune femme qui lança : « J’ai honte que cinquante ans après un génocide, il y a un Le Pen au deuxième tour… »), je réalisais que j’allais enfin pouvoir bénéficier d’une expérience grandeur nature : un scrutin national avec Jean-Marie Le Pen en première ligne, opposé à un candidat sortant très discrédité.
À partir du lundi, j’ai acheté quotidiennement la presse française et étrangère. Les journaux et les revues s’entassaient dans mon bureau. Le mercredi 24 avril, j’ai publié et envoyé à mes lecteurs le « tract jaune » (car il était imprimé sur du papier jaune). J’annonçais que si, au deuxième tour, Jean-Marie Le Pen dépassait les 40 %, alors on pourrait dire que l’analogie-déduction n’avait qu’un impact très limité en politique. Avec un score compris entre 30 et 40 %, cet impact devrait être reconnu comme plus important. Enfin, un score inférieur à 30 % des voix, apporterait la preuve que, depuis des années, j’avais raison en soulignant l’importance capitale de l’analogie-déduction pour paralyser la droite nationale. Le 26 avril au soir, je donnais une conférence prévue depuis longtemps dans la banlieue parisienne. J’étais l’invité d’une association nationaliste, Au fond du jardin. Outre ma production révisionniste, j’apportai le tract jaune et je consacrais mon exposé à l’analogie-déduction. Lorsque j’annonçais qu’à cause du « on sait où ça a mené » Jean-Marie Le Pen obtiendrait 22 à 25 % des voix, des cris d’indignation retentirent : je me trompais du tout au tout ; la France s’était réveillée ; le peuple allait enfin se libérer ; des rapports des Renseignements généraux créditaient Jean-Marie Le Pen de 45 % des voix au minium. J’objectai les immenses manifestations qui se déroulaient quotidiennement dans tout le pays, avec des slogans du genre : « Souviens-toi janvier 1933 ». J’invoquais en outre les sondages qui annonçaient une défaite cuisante du président du FN. La réponse fusa : j’étais naïf ; les sondages étaient truqués et les manifestations orchestrées par l’extrême- gauche qui manipulait une fraction non représentative du peuple français.
Je ressortis de cette conférence abasourdi par la crédulité de ceux qui me traitaient de naïf. « On croit si volontiers ce que l’on espère », disait Philippe Henriot. Ce soir-là, la pertinence ce cette réflexion m’apparut en pleine lumière !
Et en effet, l’avenir te donna raison. Jean-Marie Le Pen obtint 18 % des suffrages exprimés. Encore moins que tu ne l’annonçais! L’analogie-déduction avait fonctionné à merveille. « Super menteur » réélu avec 82 % des voix !
Oui, la veste infligée à Jean-Marie Le Pen me convainquit d’écrire un livre sur ces élections. Après avoir minutieusement épluché la presse, j’ai souligné combien Jacques Chirac était discrédité à la veille du scrutin. Puis j’ai exposé comment l’analogie-déduction avait permis de laminer Jean-Marie Le Pen. J’ai mis en lumière les mécanismes les plus inattendus de la propagande qui exploitent la Shoah. J’ai démontré que loin d’être un combat d’arrière-garde, le révisionnisme était au contraire essentiel aujourd’hui. Le Professeur Faurisson m’a félicité pour cet ouvrage. Il m’a dit qu’il s’agissait d’une véritable thèse universitaire.
Pourtant, ce livre n’a guère eu de succès ?
Le titre était mal choisi : « Les raisons de l’échec électoral de Jean-Marie Le Pen. Manifeste pour le salut de la vraie droite ». C’était trop négatif. Pour beaucoup de gens, le président du FN avait au contraire remporté un grand succès en se hissant au deuxième tour de l’élection présidentielle.
Sur le plan électoral toutefois, Jean-Marie Le Pen n’avait pas progressé. Il avait juste profité de la contre- performance de Lionel Jospin victime de l’éparpillement des voix de gauches sur plusieurs candidats.
C’est exact. De plus, s’étant hissé par surprise au second tour, Jean-Marie Le Pen n’avait pas pu convaincre les électeurs, alors qu’il avait bénéficié d’un grand accès aux médias et de la « déballonnade » d’un Jacques Chirac refusant le débat de l’entre-deux tours. C’était donc clairement un échec électoral. Mais ses électeurs ne voulaient pas le reconnaître, car ils auraient alors dû prendre conscience de la nécessité du combat révisionniste. Et ça, ils le refusaient catégoriquement.
Tout comme Marine Le Pen. Son raisonnement fut le suivant : la campagne lisse de 2002 a permis à mon père de se qualifier pour le deuxième tour ; cinq années supplémentaires de lissage lui permettront de remporter le scrutin. D’où cette politique de dédiabolisation pratiquée à partir de 2002.
Vingt ans plus tard, cette stratégie n’a rien donné. En tout cas, elle n’a rien empêché. La France n’a cessé de se déliter. Quant au Front National, il est devenu le Rassemblement National, un changement de nom qui trahit l’abandon des fondamentaux de la droite nationale. Bref, pour avoir refusé de mener le combat révisionniste, la droite nationale s’est sabordée.
Mais n’aurait-ce pas été pire si elle avait enfourché le cheval révisionniste ?
Quand je mesure combien le système craint la vérité en histoire, j’en conclus que le combat en valait la peine. Certes, lorsque vous vous attaquez au cœur, alors l’adversaire vous assène des coups redoutables ; mais la seule façon de le terrasser est de l’atteindre au cœur…
Justement, parlons-en de ces coups redoutables. Le 12 décembre 2003, tu as été condamné lourdement pour ta cassette video sur Oradour : un an de prison, dont trois mois fermes, 10000€ d’amende et indemnisation des victimes.
Oui, l’audience – surréaliste – avait eu lieu le 18 novembre précédent. J’étais arrivé la veille avec Jérôme Bourbon. Nous avions dormi à l’hôtel. Je ne vous cache pas que ma nuit avait été très mauvaise. Je savais que ce procès serait une exécution. Je me réveillais toutes les heures comme – je pense – un condamné à mort, en disant : « plus que (x) heures… ».
La haine était palpable. Je me souviens être arrivé le matin dans la salle des pas perdus du tribunal. Les gardiens de la Mémoire étaient là, groupés. Ils me fusillèrent du regard. Pour détendre l’atmosphère, je leur dis bonjour. Pas de réponse. J’insistais : « Vous pouvez tout de même me dire bonjour, nous sommes des êtres humains ». Camille Senon secoua alors la tête pour dire : « Non ! Pas de bonjour ». Je n’étais pas un être humain, mais un monstre.
N’aurait-il pas été possible de demander à être jugé ailleurs, en territoire plus neutre ?
Je l’ignore. Mais une chose est certaine : dans cette ambiance – la presse écrite et télévisuelle avaient annoncé le procès – l’impartialité de la Justice était impossible. Même s’ils avaient été idéologiquement neutres, les juges subissaient des pressions terribles. Ils ne pouvaient que me condamner, faute de quoi ils auraient été désignés à la vindicte en étant qualifiés de complices du monstre. Rappelez-vous le non-lieu accordé à Paul Touvier. Les magistrats impliqués furent victimes d’une campagne nationale de dénigrement. L’un d’entre eux, Jean-Pierre Henne, le raconte dans un livre : Un étrange combat. C’est impressionnant.
On mesure encore une fois le fossé qui sépare la théorie de la réalité. En théorie, tout citoyen bénéficie d’un procès équitable. Dans la pratique, il n’en est rien, surtout quand l’idéologie est présente en toile de fond.
Oui. Je me souviens d’un procès que nous évoquerons plus tard. Le matin, je me rendais au tribunal accompagné de mon avocat Maître Delcroix. En chemin, je lui ai demandé s’il avait un quelconque espoir. Il me répondit : « C’est un procès en idéologie ». Sous-entendu : je ne pouvais qu’être condamné. À son procès en octobre 1944, Pierre Laval, qui constatait la haine à son encontre s’écria : « Condamnez-moi tout de suite, ce sera plus clair ! ». Il fut alors expulsé, preuve qu’il avait visé juste. Il était déjà condamné. Un des jurés le lui confirma ensuite en lui lançant : « On vous a déjà jugé et la France aussi ». Son « procès » n’était qu’une parodie de justice. Soixante ans plus tard, il en allait de même au tribunal de Limoges.
Après avoir été condamné, j’ai accordé un entretien à Jérôme Bourbon. Il parut dans le premier numéro d’une revue que je créais, Le Révisionniste. C’était en janvier 2004. J’en ai rappelé les points principaux dans mon livre Oradour, le cri des victimes, paru fin 2022.
Six mois plus tard, la Cour d’appel de Limoges alourdit la peine de prison : deux ans dont six mois fermes. La répression s’aggravait donc ?
Oui. En appel, les formes furent davantage respectées. Le Président évita de manifester la même partialité que son collègue de première instance. Mais le respect des apparences ne doit pas nous abuser. La salle bien propre, les robes impeccables et les mines avenantes, tout cela, c’est le décor. L’important est ce qui se joue quand le Tribunal se retire, c’est-à-dire en coulisse, quand le Président dit aux assesseurs : « Bien, nous n’avons pas le choix, il faut le condamner ».
Certains t’accusent d’exagérer. Mais je souligne qu’en 2005, la cour de Cassation annula le jugement de la Cour d’appel de Limoges. En trois lignes, les magistrats expliquèrent que la Cour d ‘appel avait « faussement apprécié le sens et la portée » de ta vidéo, y voyant une « apologie » là où il y avait en réalité « une contestation d’un crime de guerre ».
C’est exact. Or, devant le juge d’instruction, j’avais bien précisé que je ne pouvais faire l’apologie d’un crime que je contestais. Dès le début de la procédure, donc, j’aurais dû bénéficier d’un non-lieu. Mais je le répète, il fallait à tout prix me condamner. Voilà pourquoi pendant trois ans (de 2001 à 2004), les juges ont déraisonné en me déclarant coupable d’apologie. Trois ans de lutte, de fatigue, d’argent dilapidé…
Comment expliques-tu l’honnêteté de la Cour de Cassation ?
Trois raisons principales l’expliquent. L’affaire a été examinée longtemps après l’appel, une fois les passions retombées. De plus, elle a été examinée sans public, entre magistrats et avocats de cassation. Enfin, la Cour ne jugeait pas le fond, mais la forme. Elle examinait si la loi avait bien été interprétée. Les magistrats pouvaient donc se retrancher derrière l’objectivité : « Nous n’avons fait que confronter l’arrêt à la loi, sans juger le fond ».
Dans ce cas, pourquoi les révisionnistes omettent-ils parfois de se pourvoir en cassation ?
Parce qu’un avocat de cassation est très onéreux. Dans l’affaire d’Oradour, sans l’aide des révisionnistes, je n’aurais jamais pu en payer un.
Mais ne pouvais-tu pas bénéficier de l’aide juridique ?
Une fois, j’ai effectué une demande. L’aide a été refusée au motif qu’une commission avait jugé l’absence de motifs sérieux de cassation.
N’est-ce pas précisément à la Cour de Cassation de juger cela ?
En effet. Quand j’ai prévenu le Professeur Faurisson, il déclara, surpris, que ce n’était pas à une commission de juger si mes motifs étaient valables. Mais que pouvais-je faire ? Rien. Je n’ai donc pu me pourvoir en cassation. Encore une fois, théoriquement, tout citoyen peut demander justice, à tous les niveaux. Toutefois, mon expérience pratique a démontré le contraire.
C’est d’autant plus regrettable qu’à partir des années 2000, la répression anti-révisionniste connut une aggravation. Le procès de Jean-Louis Berger en témoigne. Tu l’as suivi en tant qu’envoyé spécial des révisionnistes. Peux-tu nous en parler ?
Je le dis aujourd’hui, ce procès a été un ratage. J’en garde un souvenir amer. Jean-Louis était professeur de français et de latin dans un collège de Lemberg. Il avait en outre milité au Front National, étant candidat lors de scrutins locaux. À l’origine de l’affaire, l’ouvrage de Hans-Peter Richter, Mon ami Frédéric, donné aux élèves comme objet d’étude. Il racontait l’histoire d’un jeune garçon juif dans l’Allemagne de Hitler. Jean- Louis avait critiqué ce choix, arguant qu’il s’agissait d’un livre sans intérêt, traduit de l’allemand, alors qu’il existait des auteurs français bien plus profitables pour les élèves.
Le choix était bien entendu idéologique !
Oui . La meilleure des propagandes est celle qui se glisse partout : la Shoah en Histoire, la Shoah en Français, la Shoah en Éducation à la citoyenneté… À l’École, on appelle cela « l’enseignement transversal ».
Au collège de Lemberg, le roman « Mon ami Frédéric », fut même adapté au théâtre par les élèves. La propagande était complète.
Jean-Louis en avait été d’autant plus touché que pendant la représentation, quand les acteurs récitaient des textes fustigeant l’antisémitisme et l’hitlérisme, des spectateurs se tournaient ostensiblement vers lui comme pour lancer : « Tu vois… ». Il réagit en profitant d’un cours sur l’argumentation pour évoquer les « alignements de Nordhausen ».
De quoi s’agit-il exactement ?
D’une photo largement utilisée depuis 1945. On y voit des cadavres de déportés avec quelques soldats américains qui marchent le long. La scène se passe au camp de Nordhausen. Ce cliché est utilisé pour illustrer la « barbarie nazie ». On accuse les Allemands d’avoir massacré ces gens. Or, Nordhausen était un camp hôpital. En 1945, dans cette Allemagne totalement laminée, les détenus malades y étaient déposés sur de la paille, dans de grands bâtiments. Faute de médicaments, les Allemands ne pouvaient guère les soigner. Du moins étaient-ils exemptés de travail et de marches lors d’évacuations. Ils recevaient en outre quelque nourriture. Non loin du camp, toutefois, se trouvait une caserne dans laquelle la Waffen SS avait installé une station radio. Les Américains la bombardèrent. Les bâtiments hôpitaux furent touchés. Un millier de déportés trépassèrent.
Dès le début, la vérité sur la mort de ces gens était connue. Mais la propagande alliée diffusa cette photo sans l’expliquer. Ces cadavres furent ainsi mis sur le compte de la « barbarie nazie ».
Dans le bulletin que je publiais à l’époque et que j’envoyais à la famille Berger, j’avais consacré un article à cette photo. Jean-Louis le reprit – sans mentionner la source – comme support pour un cours consacré à l’argumentation.
Le choix était judicieux, mais dans le contexte, c’était imprudent.
En effet. Sans surprise, la réaction de nombreux élèves fut très forte. Jean-Louis ne put canaliser les échanges qui en vinrent à porter sur les chambres à gaz. Pressé de questions, il finit par dire qu’il ne croyait pas en leur existence. Des élèves rapportèrent l’information, dont un était juif si je me souviens bien. L’administration prévenue, la machine disciplinaire et judiciaire se mit en branle. Jean-Louis fut suspendu de ses fonctions et une plainte fut déposée, pour « contestation de crime contre l’humanité ». Face au juge d’instruction, il nia avoir contesté en classe l’existence des chambres à gaz. Mais cela ne l’empêcha pas d’être renvoyé devant le tribunal.
Un candidat du Front National accusé de propagande « négationniste » auprès de ses élèves, les adversaires ne pouvaient rêver mieux !
Oui . Les syndicats d’enseignants se fendirent de communiqués. La presse s’empara de l’affaire. Le procès promettait d’être retentissant, car de nombreuses associations se constituèrent parties civiles.
D’où ta venue au tribunal.
Jean-Louis m’avait informé de ses déboires. Je lui avais promis de suivre son procès pour en faire un compte-rendu dans mon bulletin. Il me demanda si le Professeur Faurisson pourrait venir témoigner en sa faveur, ce qui donnerait un certain écho aux thèses révisionnistes. J’objectai que si, en face, on ne convoquait aucun témoin, le tribunal refuserait d’entendre Faurisson. Mais quarante-huit heures avant l’audience, Jean- Louis m’apprit la venue d’un témoin : l’Accusation produirait un historien local, Pierre Ayçoberry. Sans attendre, j’invitais le professeur à venir déposer pour la défense. Il me répondit que c’était impossible, pour des raisons de santé. Je suggérai donc à Jean-Louis de comparaître à sa place. Il en fut ravi. Restait à joindre Maître Delcroix, qui avait accepté de défendre l’accusé. Hélas, malgré des dizaines d’appels téléphoniques, celui-ci ne répondit pas. J’en fus très chagriné. Déjà parce que le procès fut retentissant. Lorsque, le matin, j’arrivai au tribunal, je vis plusieurs bus (une demi-douzaine) garés non loin. Des adversaires en étaient descendus – anciens déportés, membres d’associations, militants de la Mémoire – et se pressaient à l’entrée du palais de justice. Je n’avais jamais vu cela ! Sans compter la presse avec crayons, micros et caméras !
La salle fut donc trop petite ?
Oh oui ! Une foule compacte ne put suivre le procès. Elle se groupa dans le couloir, les portes de la salle restant ouvertes.
Et toi ? As-tu pu entrer ?
Oui, je m’étais confectionné une fausse carte de presse belge. J’ai donc pu entrer et, dans la cohue, je me suis fondu dans la foule. J’ai rejoint Madame Berger et l’une de ses filles, Thérèse, qui se tenaient non loin de Maître Delcroix.
As-tu demandé à Maître Delcroix pourquoi il n’avait pas répondu à tes appels téléphoniques ?
Non. Quand une bataille est sur le point de s’engager, on ne demande pas de comptes au capitaine, on l’épaule dans sa mission. C’était ce que je souhaitais faire.
Comment ?
J’attendais le témoignage de Pierre Ayçoberry. Je prendrais des notes et au moment du contre-interrogatoire par la Défense, j’espérais soumettre au témoin des questions par l’intermédiaire de Maître Delcroix.
Un peu comme Robert Faurisson avait soumis des questions à Raul Hilberg lors du procès d’Etnst Zündel, par le biais de son avocat !
Exactement ! Certes, je n’étais pas Robert Faurisson, mais lors du procès Berger, la tâche serait bien plus aisée. En effet, Pierre Ayçoberry se présenta comme un historien de la déportation. Or, au début de son exposé, il affirma que le Génocide avait été perpétré dans six camps d’extermination. Il voulut donner leur nom, mais en fut incapable ! Après en avoir mentionné deux ou trois, il hésita et déclara ne pas se souvenir du nom des autres.
Incroyable ! On imagine sans peine le ridicule de la situation.
Oui, et je jubilai. Par la suite, Pierre Ayçoberry servit au tribunal les poncifs de la propagande. Il déclara par exemple qu’à Birkenau, les SS avaient brûlé les corps des gazés dans d’immenses fosses communes. Or, les photos prises par les avions de reconnaissance alliés démentaient cette allégation.
Que dit-il à propos des « alignements de Nordhausen » ?
Il ne put nier que les déportés avaient péri lors d’un bombardement américain. Mais il ajouta que les Allemands les laissaient mourir, donc que les bombes américaines avaient uniquement hâté leur décès (imputable aux SS). Si j’avais pu témoigner, j’aurais répondu qu’il y avait une différence essentielle entre laisser quelqu’un mourir faute de médicaments et l’assassiner pour s’en débarrasser. J’espérais toutefois le suggérer à Maître Delcroix.
Tu as pu lui transmettre des questions ?
Peu avant que Pierre Ayçoberry ait fini de déposer, donc au moment où le Président du tribunal allait demander à la Défense si elle souhaitait contre-interroger le témoin, je suis parvenu à passer à Maître Delcroix un petit papier sur lequel j’avais écrit : « Connaît-il les photos aériennes de Birkenau prises par les avions de reconnaissance alliés ? » Maître Delcroix le lut puis se tourna vers moi tout sourire en me disant :
« Bien évidemment, non ! ». Je pensais qu’il allait lui poser la question. Mais lorsque le Président l’invita à interroger le témoin, Maître Delcroix déclina. J’en fus consterné. Dans ce procès retentissant, Pierre Ayçoberry avait pu débiter des âneries sans qu’une réplique y ait été apportée.
J’imagine sans peine ton accablement. Pour le camp révisionniste, c’était catastrophique. Or, tu aurais pu aisément ridiculiser Monsieur Ayçoberry.
Oui, et ce n’était pas fini. Interrogé par le Tribunal, Jean-Louis maintint qu’il n’avait rien dit aux élèves sur les chambres à gaz. Le Président répondit : « Je vais donc lire les témoignages des élèves ». Il les lut un par un. Cela prit une heure je pense. Certes, quelques dépositions étaient fantaisistes. D’autres comportaient des erreurs. Mais je dois le dire, la lecture de l’ensemble donnait une forte impression de cohérence. Il en ressortait que Jean-louis avait bien affirmé aux élèves l’inexistence des chambres à gaz.
Mais dans un pays où dire la vérité peut ruiner votre carrière et vous conduire en prison, peut-on reprocher à quelqu’un de contester l’avoir dite ?
Je peux certes le comprendre. Toutefois, cette stratégie de défense vous fait apparaître comme un individu qui n’ose pas prendre la responsabilité de ses propos. Les adversaires peuvent alors lancer : « Il ment aux élèves et il le sait, donc il n’ose pas assumer ». Vous apparaissez comme un enfant qui nie avoir mangé de la confiture alors qu’il en a tout autour des lèvres. Quand on se présente en défenseur de la vérité, c’est désastreux. La vérité est une maîtresse exigeante. Il faut la servir jusqu’au bout, faute de quoi on la trahit. Si encore cette stratégie avait été efficace sur le plan judiciaire… mais même pas. Malgré une plaidoirie admirable de Maître Delcroix, très bien construite et dite avec une rare éloquence, Jean-Louis fut très lourdement condamné. Outre l’amende, il devrait payer une somme faramineuse à toutes les associations parties civiles.
Fort heureusement, le condamné gagna en cassation !
Oui, mais là encore, il faut préciser. En matière d’amendes et de dommages et intérêts, la cassation n’est pas suspensive. Autrement dit, vous devez payer avant même que la Cour n’ait rendu sa décision. Les sommes étant très élevées, pour éviter que sa maison ne soit saisie, Jean-Louis demanda à sa mère de lui donner par avance une part de son héritage. Sa mère accepta et dut vendre un bien immobilier. Lorsque Jean-Louis gagna en cassation, l’argent lui fut rendu. Mais le bien immobilier – qui représentait la vraie valeur – était irrémédiablement perdu.
L’affaire Berger t’a donc laissé un goût amer.
Pour le révisionnisme, ce fut effectivement un ratage. Toutefois, sur le plan humain, j’en garde des souvenirs émus. Jean-Louis était un homme exquis, doux, intelligent, sensible. Avec son épouse et sa fille Thérèse – ils avaient d’autres enfants que je n’ai pas connus, ou très peu – ils étaient très proches de la nature. Ils vivaient à la campagne, à l’heure solaire, de façon très simple et très écologique. Jean-Louis s’occupait de ses ruches ; il produisait son miel et avait fondé au collège un club d’apiculture. Le soir, ils chantaient ensemble, car ils n’avaient pas de télévision. On discutait aussi beaucoup de sujets intéressants.
Lorsque je venais suivre l’affaire, j’allais dans le village voisin acheter la presse locale. J’étais discret et ne disais rien . Un jour, toutefois, la vendeuse me dit : « Les journaux parlent encore de votre copain ». Jean- Louis était en première page. J’ignore comment elle avait appris que je venais pour soutenir un ami.
À la campagne tout se sait. Tu en as fait l’expérience !
Oui. Mon plus beau souvenir de cette affaire est sans rapport avec le révisionnisme. Un jour, sachant que j’aimais les ruines, Thérèse m’emmena dans une forêt voisine pour y voir les restes d’un vieux château. Seuls quelques remparts et une tour subsistaient. Ensemble, nous sommes montés au haut de la tour. Nous avions beaucoup marché pour venir et tout autour de nous, la forêt s’étendait à perte de vue. On ne voyait ni n’entendait rien qui aurait trahi l’existence de la civilisation moderne. Il n’y avait que les arbres et les bruits des oiseaux. Avec ses cheveux longs ondulés et sa robe mauve, Thérèse paraissait sortie du Moyen-âge. Nous sommes restés là, dix minutes peut-être, sans rien dire, à contempler le paysage. Je me croyais vraiment revenu au XIIe siècle. Ce souvenir restera gravé dans ma mémoire, c’était merveilleux.
Le combat laisse donc de beaux souvenirs ?
Oui, des drôles également. Le jour de l’appel, dans l’affaire Berger, j’attendais dans une annexe de l’entrée du tribunal afin de rester à l’écart de la foule qui, comme en première instance, se pressait. Soudain, une vieille femme arriva. Elle se déplaçait difficilement, appuyée sur une canne. Je compris qu’il s’agissait d’une juive venue suivre l’audience. M’ayant vu, elle me prit pour un membre de l’équipe administrative du tribunal. Elle m’expliqua que, marchant difficilement, elle ne pouvait emprunter le grand escalier pour gagner le premier étage, là où se déroulait l’audience. Je lui dis très poliment d’attendre le temps que je me renseigne. Averti par mes soins, un membre du tribunal nous indiqua un ascenseur de service. J’offrais mon bras à la vieille juive pour lui faciliter la marche. « Jeune homme, dit-elle, vous êtes adorable ». En moi- même, je riais : « Si vous saviez à qui vous parlez ». Nous avons pris l’ascenseur et je l’ai conduite jusqu’à un groupe de militants de la Mémoire. Je pus tout naturellement rester parmi eux, la vieille femme toujours appuyée à mon bras !
Personne ne t’a reconnu ?
Non, à l’époque, mon visage était peu connu. J’ai donc pu librement parler à ces gens. L’un d’eux m’a dit : « Eux {les révisionnistes}, ils ont un très bon avocat. Les nôtres sont nuls à côté ». Après cinq ou dix minutes, je les ai quittés. La vieille femme m’a remercié une nouvelle fois avec effusion. En moi-même, j’éclatais de rire. Muni de ma fausse carte de presse belge, je me suis assis auprès de mes « confrères », sur le banc réservé. Malgré le ratage, l’affaire Berger m’a donc laissé de très bons souvenirs.
Monsieur Berger est mort quelques années après, encore jeune, d’un cancer il me semble ?
Je crois que cette affaire l’avait profondément affecté car on l’avait dans la boue. Pour mon article sur les « alignements de Nordhausen », j’avais reproduit la page d’une revue grand public (genre Le Point ou l’Express) qui persistait à utiliser le cliché de façon malhonnête.
Pour son cours, Jean-Louis avait tout simplement repris la page. Or dans le dossier de l’instruction, le juge avait utilisé non pas la version papier de la revue, mais la version numérique. La mise en page était différente, mais le contenu était identique. Malgré cela, Jean-Louis fut accusé d’avoir falsifié le document. Il expliqua la raison des différences, insistant sur le fait qu’il avait utilisé la version papier. Rien n’y fit. À l’audience, le Président du tribunal l’accusa plusieurs fois d’avoir falsifié la page. Jean-Louis finit par s’énerver. Lui qui était si doux, je ne l’avais jamais vu ainsi. Excédé, il lança « : « Mais je n’ai rien falsifié du tout, j’ai utilisé la version papier ! ». On le sentait prêt à craquer.
Ce qui se comprend. Ni le juge d’instruction, ni le tribunal ne s’étaient donc procurés la version papier afin de vérifier.
Visiblement, non. De toutes façons, le contenu des deux versions était identique. Seule la présentation était différente.
Il fallait vraiment le traiter de « falsificateur » !
En effet. J’ajoute qu’un jour, un journal local évoqua l’affaire dans la rubrique « pédophilie ». Jean-Louis en fut révolté. Oui, vraiment, on l’a traîné dans la boue. Il ne s’en est jamais remis. Je dirais même qu’il en est mort. Il a laissé son témoignage que l’on peut se procurer.
Revenons à toi. En 2005, la Cour de cassation annula l’arrêt qui te condamnait lourdement dans l’affaire d’Oradour. Toutefois, tes ennuis judiciaires allaient s’aggraver.
Oui, car à partir de cette époque, les autorités belges se liguèrent avec les autorités françaises pour m’attaquer judiciairement et m’étrangler financièrement. Ma vie devint petit à petit si chaotique que je ne saurais plus vous la raconter dans le détail et de façon chronologique. Je mentionnerai des faits dans un ordre approximatif.
Par exemple, j’avais ouvert une boîte postale près de mon domicile bruxellois. Le préposé se révéla être un sympathisant. Un jour, il tenta même de protéger ma boîte contre l’autorité judiciaire. Deux inspecteurs étaient venus le voir avec le mandat d’un juge qui leur commandait de saisir le contenu de la boîte appartenant à Vincent Reynouard. Il leur répondit qu’il ne connaissait pas de Vincent Reynouard et que la boîte avait été ouverte au nom de « Sans Concession ». Leur déclarant que le mandat n’était pas valable, il refusa d’obtempérer. Les inspecteurs durent repartir demander au juge un nouveau mandat et revenir. Cette fois, le proposé dut leur donner le contenu… enfin… ce qu’il en restait.
En effet, c’était assez inattendu !
Certes, mais malgré cela, un jour, je m’aperçus que la serrure de la boîte avait été changée. Ma clé ne rentrait plus. La boîte avait été fermée sur décision judiciaire. Ce fut le premier acte d’une série destinée à me faire cesser le combat.
As-tu tenté un recours ?
Non, c’eut été inutile. À la place, j’ai ouvert une « boîte à lettres cimetière ».
De quoi s’agit-il ?
J’ai parcouru le quartier à la recherche d’une maison inhabitée. Sur la boîte aux lettres, j’ai mis un nom et j’ai demandé à mes lecteurs d’écrire désormais à cette adresse.
Ça a marché ?
Oui, car le facteur a cru que la maison avait été rachetée, qu’elle serait donc de nouveau habitée et que quelqu’un y avait déjà élu domicile ici.
C’est du temporaire !
Certes, mais dans le combat révisionniste, les plans à long terme sont illusoires. Quand les autorités étatiques se promettent de vous neutraliser, la vie devient une improvisation permanente. À chaque coup porté, il faut trouver une solution de remplacement.
Quel nom as-tu mis sur la boîte ? « Sans Concession » ?
Non, j’ai mis Marie Pererou !
Son nom apparaissait depuis quelque temps dans ta revue ainsi que sur des brochures que tu diffusais. Était- ce une révisionniste ?
Non, Marie Pererou n’existe pas. C’est un anagramme de Pierre Moreau, un ancien Waffen SS belge devenu révisionniste. Il était l’auteur de la brochure consacrée au drame d’Oradour et intitulée En écoutant crier les pierres. C’est à elle, principalement, que l’on doit mon travail sur ce drame. Pierre Moreau avait rédigé une étude sur Monte Cassino, en Italie. Dans ce monastère, les Allemands avaient sauvé des œuvres d’art et des trésors historiques avant que les Américains ne le bombardent, ce qui aurait provoqué la perte irrémédiable de tous ces objets. Monsieur Moreau souhaitait que je publie son étude mais sans mentionner son nom. J’ai donc formé un anagramme. Par la suite, je l’ai utilisé pour d’autres textes. Marie Pererou est ainsi devenue membre de l’équipe de « Sans Concession » !
Pourtant on voit sa photo dans ta revue. On en voit même plusieurs !
Ces photos, je les ai trouvées sur un site érotique (jeunes-chipies.com, si je me souviens bien). Je crois qu’il n’existe plus. Je me suis dit que si cette jeune femme montrait ses fesses au public, elle pourrait montrer son joli minois pour le révisionnisme.
La femme n’a-t-elle pas eu des ennuis ?
Non, déjà parce que les inspecteurs n’ont jamais cru en son existence en tant que Marie Pererou. Un jour, l’un d’entre eux m’a demandé, avec un sourire en coin, si cette collaboratrice existait vraiment. J’ai ri, il a bien compris…
Mais tes lecteurs y ont cru !
Oui . Certains ont même éprouvé un faible pour elle. L’un d’entre eux lui écrivait de gentilles lettres. Je répondais comme si j’étais Marie. Ses lettres sont devenues de plus en plus enflammées. J’ai donc dû mettre un terme à ma comédie en lui révélant la vérité. Il l’a bien pris en m’écrivant que tout cela était trop beau pour être vrai. Monseigneur Williamson aussi y a cru. Je lui envoyais ma revue. Un jour, il m’a écrit pour me mettre en garde contre une proximité trop grande avec cette jeune femme. J’ai pu le rassurer en lui révélant, à lui aussi, la vérité.
Tu avais donc ouvert une boîte aux lettres cimetière au nom de Marie Pererou. Cela t’a permis de continuer à diffuser le révisionnisme ?
Oui, mais ces changements d’adresse étaient nuisibles. Seuls les lecteurs très fidèles pouvaient me suivre. Les autres écrivaient le plus souvent à des adresses périmées qu’ils avaient trouvées sur des brochures anciennes.
Arrivais-tu à vivre du révisionnisme ?
Si je n’avais pas subi la répression, j’aurais peut-être pu. Car je minimisais les frais en faisant tout moi- même, de la rédaction aux envois en passant par l’impression. C’était exténuant, je me levais chaque jour à 4 heures du matin pour travailler, mais cela aurait sans doute suffit pour en vivre. Hélas, la répression venait tout compromettre.
Pour vivre, tu as donc donné des cours particuliers.
Oui, je suis revenu au temps de mes jeunes années. J’ai acheté un vélo et j’ai publié une annonce dans un journal spécialisé, le Vlan. Une de mes premières élèves habitait à cinq minutes à pied de chez moi. Elle était en classe de seconde et s’appelait Sarah. Ayant été très satisfaite de mes services, elle me recommanda auprès de plusieurs amies , dont une certaine Olivia, qui était dans la même classe qu’elle. La demoiselle voulait faire médecine, mais elle rencontrait de grosses difficultés en maths notamment. Sa moyenne se situait alors autour de 7/20. Très volontaire et très travailleuse, mes cours lui permirent de progresser. Quatre mois plus tard, elle atteignait une moyenne de 15 à 17/20. Ses parents étaient ravis. Lorsque j’arrivais, son père m’accueillait en me qualifiant de « sauveur » ! Or cette famille appartenait à la noblesse belge. Le père était Baron. Ses parents me recommandèrent partout autour d’eux, aux cousins, aux cousines et aux amis. En quelques semaines, je devins le professeur particulier d’une partie de la noblesse belge qui habitait Bruxelles. Je donnais même des cours dans une grande famille dont le blason figurait à l’intérieur d’une église du quartier des Sablons !
Ces gens ne savaient pas qui tu étais?
Non, naturellement. Je me présentais sous le nom de Monsieur Vincent.
Étaient-ils sympathiques ?
À une exception près, ils étaient adorables, d’une simplicité et d’une gentillesse remarquables. L’exception était une famille dont le père était Arménien et la mère issue – m’a-t-on dit – de la grande noblesse polonaise. Je m’occupais des deux aînés : un garçon et une fille d’environ 17 et 19 ans. Ils étaient très riches. Un jour, ils venaient d’acheter une antiquité chinoise, une table basse noire. La facture était posée dessus : 40 000€ . J’étais le larbin. Je devais être disponible quand ils le voulaient. Si je ne pouvais déplacer des cours, alors ils me demandaient de venir le samedi ou le dimanche à l’heure du repas de midi. Mais ils ne me proposaient rien. Un dimanche midi, je suis arrivé pour le cours au moment du dessert. La mère a apporté au fils un très bel éclair au chocolat. Je me suis dit : « Elle va me proposer quelque chose ». Non, elle ne me proposa rien.
Mais c’était l’exception. Nouvelle preuve qu’il ne faut jamais se contenter d’un seul exemple !
Oui, les autres étaient très différents. Ayant su que j’avais une famille nombreuse – sept enfants alors – ils me donnaient les jouets dont ils se débarrassaient et qui étaient toujours en bon état. Une mère me téléphonait parfois en disant : « Monsieur Vincent, venez avec votre voiture samedi prochain, car j’ai fait du clair au grenier ». Je repartais le coffre rempli de jouets, car la famille avait eu quatre enfants devenus grands, sauf la petite dernière dont je m’occupais. Ils habitaient une maison luxueuse où rien n’était apparent. Fils, tuyaux, interrupteurs, tout était invisible, caché dans les murs. Les interrupteurs étaient tactiles. Une autre famille avait deux garçons un peu plus âgés que mes deux aînés. La mère me disait : « Venez avec un grand sac à dos la semaine prochaine ». Je repartais avec mon sac rempli d’habits de marque et d’un goût exquis pour adolescents.
Un jour – cela devait être début janvier – une maman m’appela et me dit : « Monsieur Vincent, vu votre disponibilité, votre gentillesse et la qualité de vos services, nous avons décidé de vous augmenter : de 20€ nous passons à 25€ de l’heure, voire 30€ l’heure ».
C’était donc les clients qui avaient décidé d’augmenter le prix du service ?
En effet. Plus tard, ils apprirent que nous ne possédions pas de machine à laver la vaisselle. Ils se cotisèrent pour nous en offrir une (une Bosch) et la firent installer à leurs frais chez nous.
Incroyable ! Tu étais vraiment gâté !
Certes, mais je me dépensais sans compter pour leurs enfants. Parfois, Olivia m’appelait paniquée, le vendredi soir. Elle avait un examen le lundi et s’inquiétait (pour rien). Elle voulait deux cours, le samedi et le dimanche, afin de réviser avec moi. Mais tout était déjà plein. Je venais donc les deux jours à 7 heures du matin jusqu’à 8h45, afin de la faire travailler. À 8 heures, sa mère descendait et nous apportait un petit- déjeuner royal. À chaque fois, je disais en riant : « Depuis 1789, ce sont les nobles qui servent les roturiers ! » Ces années – 2006 à 2009 – ont été les plus belles de ma vie. Je m’occupais de mes enfants et de ceux des autres.
Mais dans l’ombre, tes adversaires fourbissaient leurs armes, car tu n’avais pas cessé le militantisme révisionniste ?
Effectivement. J’avais alors conçu une brochure abondamment illustrée de 16 pages intitulée Holocauste, ce que l’on vous cache. Elle était destinée à une large diffusion. Un militant révisionniste belge en acheta 300 exemplaires qu’il envoya en France à des adresses ciblées : commerces, entreprises, musées, syndicats d’initiative, etc. C’était en 2006 je crois. L’envoi mit le feu aux poudres. La justice française se mit en branle.
À la même époque, en Belgique, une plainte fut déposée contre Siegfried Verbeke et moi pour « contestation de crime contre l’humanité ». Je ne me souviens plus le document qui était poursuivi – j’en diffusais tellement !
Les perquisitions et les garde-à-vue se multiplièrent, le plus souvent avec saisie du matériel (ordinateur, stocks de livres, papiers divers).
Combien d’ordinateurs t’a-t-on saisi depuis le début ?
Cinq je pense, peut-être six. Je ne tiens pas de compte.
T’ont-ils été rendus ?
Aucun.
Les personnes chargées de perquisitionner étaient-elles désagréables ?
Non, pour deux raisons principales selon moi. À leurs yeux, les poursuites à mon encontre étaient sinon injustes, du moins inutiles. Ils savaient que, physiquement, je ne représentais aucun danger. Ces hommes de terrain connaissaient les menaces qui pèsent sur la société : terrorisme idéologique ou religieux, trafics d’armes, mafias, guerre de gangs. Ils savaient que je me tenais à dix mille lieues de tout cela. Certes, je diffusais des thèses qui dérangeaient, mais elles n’appelaient ni à la haine ni à la violence. Un jour, un inspecteur qui m’interrogeait au 36 quai des Orfèvres me dit : « Je préfèrerais avoir un barbu devant moi ». Comprenez : je préfèrerais être envoyé traquer les fondamentalistes islamiques plutôt qu’un révisionniste. Une autre fois, un inspecteur belge soupira au terme de mon audition : « Pendant ce temps, les malfrats courent ». Bref, ils avaient vraiment l’impression de perdre leur temps en poursuivant un citoyen tranquille. De plus, j’ai toujours été très aimable avec eux. Et très honnête aussi. J’assumais mes actes. Quand ils me présentaient le document poursuivi, je ne niais pas. Je reconnaissais que j’en étais l’auteur et j’en assumais l’entière responsabilité. Une fois, l’inspecteur Cornelis – qui s’occupait du révisionnisme en Belgique – me demanda, dans le cadre de mes interrogatoires : « Savez-vous ou estimez-vous que vous violez la loi ? » Je lui répondis que je le savais. Il cessa de dactylographier et se tourna vers moi, en me regardant droit dans les yeux. Intimidé, je lui demandai si j’avais dit quelque chose qu’il ne fallait pas. Il me sourit et dit : « Non, mais c’est si rare de voir quelqu’un qui avoue violer la loi ! ».
Cette honnêteté me servit quelques fois. Un matin, l’inspecteur se présenta chez moi. Des anciens déportés avaient porté plainte après avoir reçu, sans le demander, l’ouvrage de Jürgen Graf L’Holocauste au scanner. Il me demanda si j’étais impliqué dans ces envois. Je répondis par la négative ajoutant que j’ignorais tout de cette action. L’inspecteur nota mes propos sur son petit calepin et me dit : « Je sais que vous ne mentez pas. De plus, je sais que ce genre de provocation n’est pas dans vos manières ». Je n’ai plus jamais entendu parler de cette affaire.
Tu as donc noué de bonnes relations avec cet inspecteur ?
Oui, effectivement. Un jour, il se présenta à 6 heures du matin avec une jeune collègue que je ne connaissais pas. J’ai dit bonjour à l’inspecteur en lui serrant la main. Puis j’ai tendu la main à la femme qui l’accompagnait. La jeune inspectrice me regarda surprise et n’osa pas présenter sa main. L’inspecteur lui affirma qu’elle pouvait me serrer la main, car je ne présentais aucun danger.
Un autre jour, il se présenta vers 7h30 du matin. Je partais emmener mes enfants à l’école. Nous avions tous notre trottinette. « Commencez sans moi la perquisition, lui dis-je, j’emmène les enfants à l’école et je reviens ». « Non, je ne peux pas, me répondit-il, ce serait illégal ». Face à mon insistance, il prit un temps de réflexion puis dit à son collègue : « Prend la voiture et conduis-les à l’école ». Le soir, les enfants revinrent tout excités : « On est montés dans la voiture de Police ! Il y avait des boutons partout ! ».
Une autre fois, il arriva vers 10h du matin, alors que j’allais emmener mon épouse et nos deux filles chez l’ostéopathe. Là encore, il demanda à son collègue de la conduire. Une fois sur les lieux, le collègue lui demanda à quelle heure elle devrait venir la chercher. Mon épouse lui répondit qu’elle rentrerait en bus.
Les relations étaient quasiment cordiales donc ?
Pourquoi en aurait-il été autrement ? J’étais poli, coopératif et honnête avec eux. J’assume mes thèses, voilà tout. Cela ne m’empêchait pas de me protéger et, parfois, de riposter.
Après qu’un ordinateur m’ait été saisi, j’ai acheté – enfin – un portable et j’ai récupéré chez un commerçant un ordinateur qui ne fonctionnait plus. J’ai mis ce dernier sur un coin de mon bureau. Quand j’avais fini de travailler, je cachais le portable ailleurs. Peu après, une nouvelle perquisition eut lieu, avec saisie de l’ordinateur leurre. Trois jours plus tard, l’inspecteur Cornelis me téléphona : « Monsieur Reynouard, me dit- il d’un ton amusé, je pense que je peux jeter l’ordinateur ? » Je répondis que oui en affirmant que je n’avais rien contre lui, que je l’estimais mais qu’il fallait aussi que je me défende. Il comprit parfaitement et raccrocha. Je craignais une nouvelle intrusion, mais rien ne vint. Pour une fois, j’avais trompé les forces de l’ordre ; l’inspecteur ne m’en a jamais tenu rigueur. C’était de bonne guerre. Notre petite guerre à nous deux. J’aimerais tant revoir l’inspecteur Cornelis et l’inviter à manger. Nous pourrions rire en reparlant de ce bon vieux temps…
Je lui révèlerais alors le coup le plus pendable que j’ai fait à ses hommes. Ils avaient posé des scellés sur la porte de mon bureau pour venir ensuite saisir les stocks de livres qui se trouvaient dans des cartons. Avec une perceuse à percussion, j’ai percé un trou dans le mur d’une pièce qui donnait dans mon bureau . D’un côté et de l’autre, il y avait une bibliothèque. J’ai ainsi pu vider tous les cartons aux 3/4 ou au 4/5, sauvant la majeure partie de mes stocks. J’ai également remplacé l’imprimante par une autre, achetée d’occasion à 10€ et repeinte en noir. Puis, d’un côté et de l’autre du mur, j’ai replacé les livres des deux bibliothèques. Lorsque les inspecteurs sont revenus, il n’y ont vu que du feu.
Si les hommes de terrain étaient corrects avec toi, il n’en allait pas de même avec les juges.
Oui, à commencer par les juges d’instruction. Un jour, le professeur Faurisson me dit : « Un juge doit instruire une affaire à charge et à décharge. Avez-vous déjà rencontré un juge qui ; dans une affaire de révisionnisme, instruit à décharge ? » Je n’y avais jamais pensé, car depuis le début, j’avais fait face à des magistrats instructeurs qui ne cherchaient qu’une chose : prouver ma culpabilité et me charger le plus possible. Lorsque dans une affaire, j’étais innocent – cela m’est arrivé parfois – ils ne me croyaient pas et faisaient tout pour tenter de me coincer.
À Bruxelles, la juge d’instruction chargée de m’interroger s’appelait Gruwez. Elle ne cachait pas sa haine à mon encontre. Un jour, les inspecteurs qui m’avaient arrêté me dirent : « On vous emmène directement à son bureau. Vous n’aurez donc pas à attendre dans une cellule lugubre du palais de justice ». La juge était dans son bureau, seule avec sa secrétaire. Mais quand elle me vit, elle dit d’un air narquois : « Mettez-le en cellule ! » Elle m’y laissa quatre heures environ, jusque vers 17h. Lorsqu’elle m’interrogeait, si je baissais la voix, elle me lançait : « Parlez plus fort, je n’entends rien ! » Si, dans un moment d’hésitation, je passais ma main sur mon visage, elle lâchait : « Otez la main de votre bouche ! ». Les interrogatoires étaient très éprouvants. Pour elle, j’étais un monstre qu’il fallait à tout prix renvoyer devant le tribunal pour être condamné.
Pouvais-tu demander l’assistance d’un avocat ?
Elle ne me l’a jamais proposé et j’avoue n’y avoir jamais pensé. Dans ces moments-là, on ne songe pas à tout. Le cerveau se concentre sur les questions que l’on vous pose. Mais il est vrai qu’un avocat m’aurait été utile. Je me souviens par exemple que dans une affaire, j’étais accusé, entre autres, de violer un décret d’interdiction de ma revue Le Révisionniste, je crois. Elle était interdite de vente, de distribution et de circulation en Belgique. De façon évidente, « circulation » signifiait que je n’avais pas le droit de la donner, chez moi, à des gens en leur disant : « Quand vous aurez terminé de la lire, passez-la à quelqu’un d’autre ». La brochure aurait donc circulé de main en main, ce qui n’aurait été ni une vente, ni une distribution proprement dite. J’ai donc expliqué honnêtement à la juge Gruwez que j’imprimais la revue en Belgique et qu’une fois l’impression achevée, je la transportais dans mon coffre pour la France. Les exemplaires restaient dans les cartons et personne ne pouvait ni les voir, ni en prendre. La juge réfléchit quelques instants et me dit que de l’atelier d’impression à la frontière, la revue circulait en Belgique, dans ma voiture.
C’était vraiment abusif !
À mes yeux, oui. D’ailleurs, je n’ai pas été condamné pour cela. Je l’ai été pour « contestation de crime contre l’humanité ».
Quoi qu’il en soit, cette juge était vraiment venimeuse.
Oui, et pas qu’avec moi ! Un dimanche après-midi, deux inspecteurs se sont présentés à mon domicile. Ils m’ont appris que la veille au soir, le bureau de la juge Gruwez avait été ravagé par un incendie criminel. Un ou plusieurs individus avaient dû se cacher dans l’annexe du palais de justice. Une fois tout le monde parti, ils avaient incendié la pièce avec du liquide inflammable. Quand ils m’ont dit cela, je n’ai pu m’empêcher d’afficher un sourire très satisfait. En moi-même je pensais : « Bien fait ! ». Les inspecteurs m’ont alors précisé que je figurais sur la liste des suspects établie par la juge Gruwez.
C’était inepte ! Tu n’aurais jamais fait cela !
Bien sûr, et les inspecteurs le savaient. Quand ils ont visité l’habitation, dans la cave, ils ont vu cinq ou six bidons de vingt litres vides. L’un d’entre eux m’a dit : « Rassurez-moi, ils ne contenaient pas de l’essence ? » J’ai répondu par la négative, précisant qu’il s’agissait du bidon de pétrole lampant destiné aux poêles à pétrole. J’en possédais trois, car certaines pièces étaient dénuées de radiateur. Ces bidons devant être déposés dans un centre de recyclage, j’attendais d’en avoir vidé un certain nombre. Les inspecteurs m’ont fait confiance. Ils n’ont même pas vérifié si un bidon dégageait une odeur d’essence. Ils m’ont demandé si j’acceptais qu’un médecin me fasse une prise de sang afin de vérifier la présence ou l’absence de résidus chimiques prouvant que j’aurais respiré de la fumée. J’ai accepté. Un médecin a été appelé et m’a prélevé du sang. Lorsqu’ils sont partis, j’ai dit : « Vous savez très bien que je serais incapable de faire cela ». Le supérieur a haussé les épaules pour signifier que c’était évident. J’ai ajouté : « Mais je crois que la juge ne m’aime pas beaucoup ». Il a alors soupiré en disant : « Ça oui ! ». Je n’ai plus jamais entendu parler de cette affaire.
Ne peut-on pas récuser un juge d’instruction visiblement haineux ?
Je l’ignore, mais à quoi bon ? Il serait remplacé par un autre qui cacherait sans doute mieux son antipathie, sans pour autant instruire à décharge. Quand vous êtes connu comme le « nazi révisionniste », un palais de justice devient peuplé d’ennemis. N’allez pas espérer y trouver un allié, ni même un juge bienveillant. Si cela vous arrive, empressez-vous de jouer au loto ! C’est un jour de chance qui ne se renouvellera sans doute jamais !
C’est à un juge d’instruction français que tu devais d’avoir connu la prison fameuse de Fleury-Mérogis ?
Oui. Il m’avait convoqué dans le cadre des poursuites intentées suite à la diffusion de la brochure Holocauste, ce que l’on vous cache. Je lui avais répondu par lettre que j’endossais l’entière responsabilité de toute l’action, donc que je n’allais pas me déplacer à Saverne – où la plainte était instruite – pour lui dire cela et pour répondre à d’autres questions qui, de toutes façons, me conduiraient devant un tribunal. Il n’avait qu’à me renvoyer directement devant ses confrères.
Hélas, la procédure prévoyait ta comparution physique devant ce juge.
En effet. Il a donc lancé un mandat d’arrêt. Peu après, trois inspecteurs m’ont appréhendé dans la région parisienne. J’arrivais sur le lieu d’une conférence que je devais donner et qui avait été annoncée publiquement, dans différents organes de l’ultra-droite. J’ai été conduit à Fleury-Mérogis le temps qu’un bus de police m’emmène à Saverne. J’ai raconté tout cela dans un petit livre intitulé En passant par Fleury- Mérogis. Je n’y reviendrai donc pas.
Dans ce livre, tu racontes les choses avec beaucoup d’humour. Tu cites d’ailleurs la chanson du groupe O.T.H. qui disait : « Il y a toujours une issue quelque part, une issue de secours quand on prend tout avec humour ».
Oui, j’essaie souvent de prendre les choses avec humour. Cela m’a permis d’obtenir ma petite revanche face au juge Gruwez. Un jour, elle m’interrogeait en présence d’élèves qui apprenaient le Droit. Avec son mépris habituel, elle me plaça sous contrôle judiciaire. Je devais trouver un vrai travail et il m’était interdit de donner des cours particuliers à des mineurs. Je lui répondis tout sourire : « Des mineurs d’âge ou de profession ? » « Monsieur Reynouard ! », s’exclama-t-elle sur le ton de l’exaspération. J’étais très fier de mon trait d’humour, surtout devant ce petit public.
Pourtant, ces affaires t’ont conduit en prison ?
Oui. À partir de 2006, les autorités se sont vraiment mobilisées contre moi. Un jour, j’ai appris que mon compte en banque belge avait été placé sous surveillance. Je ne pouvais plus effectuer d’opérations. Or, quelques donateurs y transféraient des sommes destinées à ma famille. J’ai donc averti mes lecteurs qu’ils devaient cesser d’utiliser ce compte. Je leur ai indiqué les coordonnées d’un autre compte qu’un sympathisant belge avait ouvert à son nom, en me fournissant une carte de retrait. Depuis plusieurs mois, ce compte fonctionnait. Il permettait aux donateurs de me soutenir sans virer sur mon propre compte. Un matin, j’ai voulu retirer de l’argent. La carte était désactivée. Peu après, le sympathisant s’est présenté chez moi affolé : « La police est passée me voir. On m’a dit que je risquais des ennuis en vous ayant ouvert un compte. Des policiers m’ont précisé qu’ils allaient maintenant utiliser l’artillerie lourde contre vous ! » Paniqué, l’homme avait immédiatement fermé le compte.
Ce n’était vraiment pas de bon augure. La suite l’a d’ailleurs confirmé !
En effet. Le procès à Saverne fut surréaliste. Pierre Guillaume avait invité les révisionnistes à venir me soutenir. Les sympathisants étaient, pour la plupart, arrivés la veille. Ils avaient dormi dans des hôtels locaux. Une indiscrétion permit d’apprendre que la Police avait demandé les listes des clients.
Quant au procès, il ressembla à celui de Limoges. L’avocat de la LICRA, Maître Raphaël Nisan, me demanda si je connaissais la chambre à gaz du Struthof. À peine avais-je commencé à répondre que le procureur se leva. C’était une femme. Elle lança : « Le tribunal n’est pas une tribune. L’accusé ne peut s’en servir pour exposer ses thèses ». Je pensais que le Président allait invoquer mon droit de me défendre. On m’avait posé une question, je pouvais y répondre comme bon me semblait. Mais non. Il soutint le procureur. Face à mes protestations, il me dit : « Je vous autorise à parler, mais si vous enfreignez le loi {Gayssot}, je vous demanderai de vous rasseoir ». Sans surprise, au bout de deux minutes, il m’interrompit et me demanda de rejoindre le banc des accusés. Révolté, je me suis tourné vers Maître Delcroix et lui ai soufflé que nous devions nous en aller . Il me répondit que par respect pour le Tribunal et pour lui nous devions rester. Je suis donc resté, mais aujourd’hui je le regrette.
Tu as dû sortir de la salle d’audience très dépité ?
Oh ! Une fois franchi le seuil, je n’ai guère eu le temps de penser. Deux inspecteurs m’ont arrêté pour m’interroger dans le cadre d’une nouvelle affaire. Je suis resté en garde-à-vue jusqu’au lendemain.
Effectivement, c’était vraiment « l’artillerie lourde » qui pilonnait ! De quoi s’agissait-il maintenant ?
Je ne me souviens plus. Je me rappelle seulement qu’ils cherchaient à identifier l’auteur d’une action révisionniste. Je le connaissais, mais je l’ai protégé en les conduisant sur une fausse piste que j’ai eu le temps d’inventer et de structurer pendant la nuit. J’ai inventé un ami qui se serait fait appeler « Flip » et qui serait venu me voir, de façon anonyme, à intervalles réguliers. De façon assez surprenante, ils ont semblé y croire… Mais peut-être voulaient-ils clore l’interrogatoire au plus vite, car l’affaire en question n’était pas importante (du moins dans mes souvenirs). Ils avaient donc fait semblant d’y croire.
Quand on est pilonné, on ne note pas chaque obus qui tombe ! On cherche à se protéger. Une fois ressorti de ma garde-à-vue, tous mes amis étaient partis. Or j’étais venu avec Jérôme Bourbon. Je me suis donc retrouvé seul, dans Saverne, sans argent. Je ne sais plus comment j’ai pu prendre le train pour revenir à Paris. Restait à attendre le verdict. Toutefois, je n’avais aucune illusion. Ce serait de la prison ferme.
Tu es finalement revenu à Bruxelles où un procès t’attendait et où tu étais sous contrôle judiciaire. As-tu cessé de donner des cours à des mineurs et as-tu cherché un « vrai » travail ?
Ni l’un ni l’autre. Chaque mois, je devais répondre à une jeune auxiliaire de justice qui vérifiait mes démarches pour trouver un travail.
Le premier mois, j’ai écrit à plusieurs établissements scolaires bruxellois pour me proposer comme remplaçant. J’avais deux CV, un « gonflé » par un ami spécialiste en la matière, au cas où je chercherais vraiment du travail, et un autre, plus réaliste, avec toutes les longues périodes où je n’avais pas travaillé officiellement, c’est-à-dire avec une fiche de paie. Ce deuxième CV ferait fuir tous les employeurs potentiels, car il me montrait comme quelqu’un d’instable. À l’auxiliaire de justice, j’avais apporté mon CV « gonflé ». Aux établissements scolaires j’envoyais mon CV réaliste. Je ne trouvais donc aucun remplacement.
Et qu’as-tu fait pour les mois suivants ?
J’ai cherché sur internet des logos de firmes liées à la chimie. Je rédigeais deux lettres : ma demande d’emploi et la réponse négative de l’entreprise. J’y insérais le logo et je signais d’un responsable des RH totalement bidon. Cela me prenait une soirée par mois.
Cela a-t-il marché ?
Oui, totalement. L’auxiliaire n’y a vu que du feu.
Combien de temps cela a-t-il duré ?
Pas très longtemps, car un jour, un lycée privé m’a contacté pour un remplacement. Le Proviseur ne m’a pas caché que j’étais le septième candidat auquel il téléphonait et que je représentais son dernier espoir. De façon évidente, ils avaient placé mon CV au bas de la pile. Je me suis dit qu’ils ne devaient vraiment trouver personne pour se tourner vers un « tocard » comme moi ! Quoi qu’il en soit, j’ai accepté. Je devais remplacer pendant six semaines un professeur de maths-sciences parti en lune de miel ! En pleine année scolaire !
Là encore , l’humour m’a bien aidé. Au premier cours avec une classe, j’ai voulu connaître le sujet de sciences les élèves venaient d’étudier. Ils me répondirent qu’il s’agissait de la digestion. Je leur demandais alors si le sujet les avait intéressés. Ils me répondirent à l’unisson que pas vraiment. Soudain, une blague me vint à l’esprit. Je leur dis : « Cela est normal ! La digestion ça fait chier ! » La classe éclata de rire. Je m’étais en quelques secondes attiré la sympathie des élèves.
Mais le lycée ne t’a-t-il rien demandé excepté ton CV ?
On m’a demandé une attestation de l’Éducation nationale française d’après laquelle j’avais passé le concours d’enseignant. J’ai pris un air détaché et j’ai promis de la demander au plus vite. Sachant que j’étais le dernier espoir de l’établissement, je me doutais que l’administration serait patiente. J’ai ainsi pu finir mon remplacement. Mais je n’ai pas tété payé. L’établissement avait dû se rendre compte qui j’étais…
N’as-tu pas intenté un recours ?
Non, car cela aurait créé le scandale et j’étais dans mon tort. J’avais menti en promettant de fournir une attestation que je ne pouvais obtenir. Certes, le lycée avait fait preuve d’imprudence, mais si l’affaire venait à se savoir, ce serait évidemment moi le coupable. Or, quand j’avais annoncé à l’auxiliaire de justice que j’avais trouvé un remplacement, elle m’avait dit que ce serait positif dans le procès en cours. Je ne voulais pas tout compromettre pour une somme dont, finalement, je n’avais pas besoin. Je gagnais suffisamment avec mes cours particuliers. De plus, aimant enseigner, j’avais vraiment apprécié ces six semaines avec ces classes très sympathiques.
La promesse de l’auxiliaire de justice s’est-elle réalisée ? Les juges belges ont-ils été cléments ?
Le procès s’est très bien déroulé. Contrairement à ce qui m’arrivait en France, j’ai eu toute la liberté d’expliquer la pertinence des thèses révisionnistes. Le président prenait consciencieusement des notes. Un ami allemand assistait à l’audience. Nous sommes sortis très optimistes. « Tu as fait mouche ! » m’a-t-il dit dans son très bon français.
J’étais heureux, car bien auparavant, j’avais appris sans surprise ma condamnation par le tribunal de Saverne à un an de prison ferme, sans compter les sommes à payer. Maître Delcroix avait fait appel. Je pensais m’en sortir bien mieux en Belgique. J’étais naïf. Le jour du verdict, mon ami allemand me déconseilla d’apparaître à l’audience. Il se rendit donc seul dans la salle alors que je patientais dans le grand hall du Palais de justice. Après une attente qui me parut interminable, je le vis descendre les escaliers rapidement. « Partons vite ! », me souffla-t-il, « tu es condamné à un an de prison ferme avec un mandat pour une arrestation immédiate ». Nous avons filé vers la sortie. Un policier nous regarda d’un air suspicieux. Mais il ne fit rien et mon ami allemand put me ramener chez moi. C’était au mois de juillet 2008, vers 14 heures. J’ai pris quelques affaires, des livres, mon ordinateur portable et je suis parti immédiatement vers la France. À cette époque de l’année, je ne donnais plus de cours particuliers.
En chemin, j’ai allumé la radio. Chose incroyable, j’ai appris par les informations que la Cour d’appel de Colmar avait confirmé le jugement rendu par le tribunal de Saverne. Je ne m’étais pas présenté à l’audience et la Cour avait immédiatement rendu son verdict.
Mais as-tu été prévenu du jour de l’audience ?
Sans doute. Toutefois, depuis des mois, je n’allais plus chercher mes recommandés, car il s’agissait à chaque fois de mauvaises nouvelles que l’on me signifiait. Dans mon esprit, tant que je n’aurais pas signé la convocation pour l’appel, l’audience serait repoussée. J’étais naïf !
Effectivement, car dans ce cas, personne ne signerait la convocation en cas de mauvais procès. En fuyant la Belgique pour la France afin d’éviter une peine de prison, tu avais donc appris par la radio que la France venait de confirmer une autre peine de prison.
C’était vraiment surréaliste ! Dans un film, le spectateur aurait soupiré : « Le scénario n’est pas crédible. C’est exagéré ! » Mais non. La réalité dépasse parfois la fiction. J’étais vraiment cerné, la radio venait de m’en avertir.
Que ressent-on dans de tels moments ? Parce qu’être cerné se révèle très inconfortable.
Moi, j’avoue que cela m’excite. Cet après-midi-là, je me suis arrêté dans une station service pour faire le plein. Un camion de police était garé sur le parking. Au moment d’entrer dans la boutique pour payer, j’ai vu une demi-douzaine de policiers qui prenaient un café. J’aurais pu me presser de payer et partir. Mais non. J’ai pris moi aussi un café en m’asseyant près d’eux. C’était stupide, mais je voulais rire – en moi-même – de cette situation : un gars avec un mandat d’arrêt qui sirote son café à côté des flics.
Où es-tu allé ?
Je me suis rendu chez un ami qui habitait une grande maison, dans la campagne, et qui pourrait cacher mon véhicule. Je me suis présenté à l’improviste, expliquant la raison de ma venue. Il m’a accueilli et j’ai passé l’été dans une chambre, à travailler sur le révisionnisme. Vers la fin août, mon épouse jointe par un ami l’informa que personne n’était venu pour m’arrêter. Je décidai donc de revenir à Bruxelles afin de retrouver mes élèves auxquels je donnais des cours particuliers.
Afin de brouiller les pistes, j’ai annoncé que je m’étais réfugié en Suisse. Pour rendre la rumeur plus crédible, j’ai écrit une lettre à un ami Suisse. Dans l’enveloppe, il y avait une carte postale que j’adressais à ma femme et à mes enfants. Je leur disais que j’étais bien arrivé en Suisse. Mon ami la posterait de chez lui. Ainsi mon épouse pourrait-elle la montrer aux inspecteurs s’ils venaient. La rumeur s’est répandue.
Un journaliste demanda même aux autorités helvétiques ce qu’elles comptaient faire de moi. Elles répondirent que si je ne violais pas les lois du pays, je pourrais rester. Était-ce vrai ? Qu’importe ! Je n’étais pas en Suisse mais tranquillement chez moi.
La boîte aux lettres « cimetière » fonctionnait-elle toujours ?
Je ne m’en souviens plus. Je sais qu’à une époque, craignant qu’on ne m’y attende, je n’y allais jamais à la même heure et toujours de nuit. Parfois, je me réveillais spécialement pour m’y rendre. J’utilisais mon vélo. Mais un jour, la maison fut rénovée et la boîte changée. J’ai dû alors m’arranger avec Siegfried Verbeke et prendre l’adresse d’un petit magasin qu’il avait ouvert à Anvers.
Pendant plusieurs mois, j’ai vécu tranquille, presque normalement. La maison que nous occupions comportait trois sonnettes, datant de l’époque où trois couples y vivaient en communauté. Sur celle qui était inutilisée, j’ai décidé de mettre un nom et de me faire une fausse carte d’identité américaine à ce nom. Elle me servirait à recevoir discrètement du courrier recommandé que certains amis m’enverraient avec de l’argent à l’intérieur.
Comme fausse identité, j’ai choisi le nom du procureur américain à Nuremberg : Jackson. Pour le prénom, j’ai demandé à mon épouse de choisir. Elle me suggéra Mickael ! C’état vraiment très discret ! J’ai donc opté pour une autre identité.
Comment ton épouse vivait-elle tout cela ? Et tes enfants ?
Si j’excepte mes deux mois d’absence, jusqu’à cette époque, je vivais en bon père de famille. Je m’occupais beaucoup de mes enfants, les emmenant au parc, jouant avec eux, leur lisant les histoires du soir ; je rapportais de l’argent à la maison, laissant mon épouse (et les aînés) l’utiliser à bon escient. Quand je quittais mon bureau, je ne parlais quasiment jamais de révisionnisme. Je n’ennuyais pas mes enfants avec cela. Bref, j’étais présent et personne n’aurait pu soupçonner, en me voyant hors de mon bureau, que j’étais un militant révisionniste très actif.
Dès lors, mon épouse supportait bien la situation. Mes enfants aussi. Parfois, Marina me disait : « Mais espères-tu tenir longtemps ainsi, sans te faire arrêter et neutraliser ? » Je lui répondais que chaque jour passé était un jour gagné pour la cause et pour nous tous.
Naturellement, je parle de ce que j’ai ressenti et de ce que les miens m’ont montré. Peut-être vivaient-ils dans l’angoisse permanente. Mais si ce fut le cas, alors ils me l’auront bien caché.
Je note d’ailleurs que les baby-sitter employées chez nous n’ont jamais rien soupçonné, sauf deux qui, ayant découvert mes activités, nous ont quittés. La première était une jeune Bretonne : elle suivait des études à Bruxelles. Très appréciée auprès des enfants, elle était devenue une sorte de grande sœur. Mais parfois, mes enfants utilisaient le verso vierge de pages sur lesquelles j’imprimais des brouillons d’articles. Ils s’en servaient pour dessiner. C’est ainsi que la baby-sitter a tout découvert. Un jour, elle a annoncé à mon épouse qu’elle ne pouvait plus travailler pour nous à cause de mes activités. Marina lui demanda si je l’avais importunée ou menacée d’une façon quelconque. Elle lui répondit que non , mais ses parents auraient dit que cela pourrait lui nuire si, plus tard, on découvrait qu’elle avait travaillé pour un « négationniste ». De façon évidente, ses parents faisaient pression pour qu’elle nous quitte. Marina n’a donc pas tenté de la raisonner. Elle l’a laissé partir. Elle m’a dit qu’en quittant la maison, la jeune fille semblait pleurer de peine. La pauvre. L’autre était une Polonaise, une jeune fille au pair qui vivait chez nous. Issue d’une famille pauvre , elle était arrivée vêtue très simplement, à la limite du ringard. Nous la payions bien, car elle était très gentille et très courageuse. Après deux mois de présence, je me suis permis d’entrer dans sa chambre pour lui apporter un petit cadeau. Sur le lit, j’ai vu ses achats récents : des habits à la pointe de la mode pour les jeunes, des dessous affriolants, des petits bijoux fantaisie. Je me suis dit qu’il n’avait pas fallu longtemps pour qu’elle change de goûts. J’aurais bien voulu la voir le samedi soir, quand, ayant quartier libre, elle sortait.
Un samedi, si mes souvenirs sont bons, elle a dit à Marina : « Vincent pas mathématiques ! Vincent politique ! ». Elle venait donc de découvrir ma deuxième vie. J’ignore comment. Quoi qu’il en soit, elle a fait comprendre qu’elle ne souhaitait plus travailler chez nous. Le dimanche soir, elle est venue avec une amie polonaise chercher ses affaires. Arrivée en Belgique avec quasiment rien, elle n’en avait pas beaucoup. L’amie l’accompagnait donc, car elle n’avait pas osé revenir seule. J’étais alors dans mon bureau. Marina me prévint qu’elle partait. Sachant que je lui devais 700€, je pensais qu’elle viendrait frapper à ma porte pour recevoir son dû. Mais non. Je l’ai entendue descendre avec son amie pour rejoindre le hall d’entrée. J’ai alors pris l’argent et je suis descendu à mon tour. Elles allaient franchir la porte quand elles m’ont vu au haut de l’escalier. Leur regard était terrifié. Je leur ai dit : « Mademoiselle, je vous dois de l’argent ! ». Descendu, je lui ai donné une liasse de billets. Elle m’a remercié en chuchotant et a vite franchi la porte de la maison, totalement apeurée.
Pendant des semaines, elle t’avait vu vivre. Elle avait dû s’apercevoir que tu n’étais pas un monstre ?
Mon expérience m’a prouvé que cela ne change rien. Quand les gens découvrent qui je suis, la plupart oublient totalement ce qu’ils ont pu voir. Je deviens instantanément un monstre.
En fait, ils n’oublient pas ce qu’ils ont vu, mais ils ont l’image hollywoodienne du « nazi » qui, dans la journée, massacre des gens et qui, le soir venu, revient chez lui embrasser ses enfants tendrement.
C’est tout à fait cela. L’image du « nazi » barbare mais en même temps mélomane, du « nazi » qui gaze dix mille juifs mais sauve un oisillon tombé du nid. Cela permet de dire : « Jusqu’à présent, Reynouard ne nous avait montré que sa face humaine, mais ne soyons pas dupes ». On le verra lors de l’affaire Williamson, début 2009.
Justement, avançons dans le temps. À la fin de l’été 2008, tu es revenu chez toi. As-tu pu vivre normalement ?
Oui . J’ai repris ma vie de famille, mes cours particuliers et mes activités révisionnistes. Tout se déroulait sans problème lorsque en janvier 2009 éclata l’affaire Williamson. À l’heure où des pourparlers entre Rome et la Fraternité Sacerdotale Saint-Pie X avaient permis des avancées notables, des journalistes ressortirent un entretien où Monseigneur Williamson affichait des positions révisionnistes. Or, à l’époque, j’étais un catholique traditionaliste. Certes, ayant évolué vers le sédévacantisme, j’avais quitté la Fraternité Saint-Pie X, mais pour les gens extérieurs, c’était soit ignoré, soit perçu comme sans importance. J’étais un « catho tradi ».
Que s’est-il donc passé ?
Un soir, revenant des cours, mon épouse me déclara qu’un journaliste avait téléphoné. Il voulait me parler. Elle l’avait invité à rappeler le lendemain matin.
Mais, n’étais-tu pas réputé vivre en Suisse ?
En effet. Lorsque le lendemain, le journaliste m’a contacté, je lui ai déclaré être de passage seulement. Il s’est présenté comme travaillant pour Paris Match Belgique. Il souhaitait me parler dans le cadre d’une enquête qu’il menait sur les milieux traditionalistes.
As-tu accepté de lui répondre ?
Oui, car je souhaitais lui donner des informations exactes, plutôt qu’il raconte des sornettes. Je n’avais rien à cacher. Je pensais qu’il les utiliserait dans le cadre d’une enquête plus large. Toujours est-il qu’il enregistrait notre entretien sans m’en avoir informé. Fort heureusement, je ne mens jamais pour charger autrui ou pour me donner le beau rôle. Il m’a questionné sur mes liens avec la Fraternité Saint-Pie X. Je lui ai répondu qu’étant un devenu militant sédévacantiste, la Fraternité me détestait.
Pourtant, j’ai lu à plusieurs reprises qu’en Belgique, tu étais logé par la Fraternité ?
C’est une information erronée. Nous vivions chez un ami révisionniste qui se disait prêtre mais qui ne dépendait d’aucune organisation. Il avait aménagé une chapelle dans une pièce de sa maison. Il y disait la Messe tous les dimanches. Je l’avais connu en 1992, lors d’une conférence à laquelle des révisionnistes belges m’avaient invité pour que j’intervienne au moment où la parole serait donnée au public. Il s’agissait d’une conférence organisée par la « Ligue pour l’abolition des lois réprimant le blasphème ». J’étais intervenu pour mettre en garde contre d’autres lois qui réprimaient un autre genre de blasphème : un blasphème historique… À cette époque, la loi Gayssot avait deux ans et l’on savait que la Belgique préparait une loi similaire.
Tu n’avais donc jamais été ni logé, ni caché par la Fraternité Saint-Pie X ?
Jamais.
Revenons à cet entretien accordé au journaliste de Paris-Match Belgique. Que s’est-il passé ensuite ?
Le journaliste m’a révélé que son enquête paraîtrait dans le prochain numéro. L’affaire Williamson défrayant la chronique, je n’en fus pas surpris. La veille du jour de parution, je suis allé avec un ami aux ateliers d’Anvers afin d’imprimer ma revue. Nous avons achevé le travail vers trois heures du matin. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans une station-service qui disposait d’un rayon presse. Paris Match était là. Nous l’avons feuilleté. Mon entretien était reproduit en intégralité. L’enquête portait davantage sur moi que sur Monseigneur Williamson. J’apparaissais en photo. L’une récente, une autre plus ancienne, en uniforme du PNFE (Parti Nationaliste Français et Européen), effectuant le salut hitlérien. Le journaliste montrait également la couverture de mon étude Hitler, homme de la Providence. Trois ou quatre pages entières m’étaient consacrées. On m’accusait de narguer les autorités belges malgré mes condamnations.
Si, dans le cadre de l’affaire Williamson, le journaliste avait voulu impliquer la Fraternité dans ton combat, c’était raté, puisque tu avais bien précisé que tes rapports étaient très mauvais. Mais pour toi, c’était catastrophique, car les autorités allaient agir !
Avant même cela, l’entretien dans Paris-Match eut des effets désastreux. En effet, la noblesse belge lisait ce magazine. En un jour, j’ai perdu la moitié de mes élèves. Je me souviens d’une anecdote digne d’un film comique. Chez un élève dont les parents ne m’avaient pas congédié, je donnais cours dans la cuisine (très luxueuse). C’était le surlendemain de la parution de l’article. Sur la table, à côté de nous, Paris-Match était posée. Je me suis dit que les parents ne l’avaient certainement pas encore lue. La mère était à la maison. Pendant l’heure et demie du cours, j’ai prié pour qu’elle ne vienne pas prendre l’exemplaire et le feuilleter. J’ai été exaucé. Mais peu après, j’ai aussi perdu cet élève.
C’était digne d’un film !
Oui . Le plus drôle était qu’au premier cours avec cet élève, la mère m’avait demandé si j’étais capable de corriger une copie de français. Le jeune étant au collège, j’avais répondu positivement. Son texte était un commentaire d’un film sur la Shoah ! L’élève se lamentait en écrivant qu’il ne comprenait pas pourquoi les nazis avaient exterminé six millions de Juifs. J’avais envie d’ajouter en commentaire : « Mais, les ont-ils exterminés ? ». Je me suis abstenu. J’ignore si, quand la mère m’a congédié, elle s’est souvenue de cette anecdote.
Parlais-tu de révisionnisme à tes élèves ?
Non, surtout pas ! Je note d’ailleurs que dans une famille, après que les parents m’eurent congédié, ils essayèrent plusieurs professeurs particuliers. Mais les deux garçons se déclarèrent insatisfaits et me réclamèrent. Les parents durent donc me reprendre. Un des enfants me raconta qu’après avoir lu Paris- Match, les parents leur demandèrent si j’avais « fait de la propagande ». Ils avaient assuré que non, jamais. Ils me reprirent donc mais le père ne put s’empêcher de me dire d’un ton sévère de « mettre de l’ordre dans ma tête ». Je lui répondis évasivement.
Combien d’élèves as-tu perdus ?
Environ 80 %.
Cela a dû être douloureux, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement ?
Financièrement, j’ai pu tenir grâce à des donations et en retrouvant quelques élèves dont les parents ne lisaient pas Paris Match. Émotionnellement, cela a été très dur. Je me souviens du dernier cours avec Olivia. Son père avait voulu me congédier sur le champ, mais elle l’avait supplié de me garder pour une dernière leçon. L’ambiance fut lugubre – le père n’était pas venu me saluer comme il faisait toujours, m’appelant leur « sauveur ». Au moment de partir, nous nous sommes regardés sans rien dire avec Olivia. Puis j’ai soufflé : « Heu… au revoir… peut-être ». Elle a tristement souri en disant : « Au revoir ! » J’ai cru qu’on allait fondre en larmes tous les deux. J’ai enfourché mon vélo et je suis parti. À plusieurs reprises, j’ai dû m’essuyer les yeux.
Une copine de classe m’avait gardé – sa mère était Bulgare, son père Japonais. Elle me raconta que le lendemain, elles avaient parlé entre elles. Olivia avait pleuré en disant : « Mr Vincent…comment est-ce possible ? ».
Ta gentillesse, ta disponibilité et ta compétence ne t’avaient pas sauvé.
Non. Mais nous avons gardé la machine à laver. C’est déjà ça…
À partir de ce moment, les autorités belges ont dû te traquer ?
Pas vraiment. Je pense qu’elles me croyaient en Suisse, ne revenant que rarement à Bruxelles. Ne voyant rien venir, j’ai continué à vivre normalement. Je ne prenais qu’une seule précaution : quand on sonnait à la porte, je courais me cacher à la cave. Marina répondait que je n’étais pas là. Une fois les inspecteurs repartis, elle venait me chercher.
Est-ce arrivé souvent, du moins à cette période ?
Justement, non. Peut-être une fois. D’où ma vie normale. Mais le 17 février – soit la veille de mon anniversaire – au moment d’aller me coucher (je dormais sur un lit pliant dans mon bureau pour ne pas déranger mon épouse avec mes ronflements), une petite voix me dit : « Va dormir ailleurs ! » J’ai hésité. Puis je suis finalement allé dormir dans mon break Citroën, après l’avoir garé dans une rue adjacente. Le lendemain vers 7 heures, mon fils aîné est venu me réveiller. Il me dit que la police avait fait irruption dans la maison à 6 heures. Les inspecteurs avaient cherché partout, allant même jusqu’à tâter le lit où dormait mon épouse afin de vérifier si ma place était encore chaude. J’ai remercié la Providence qui m’avait prévenu.
La police croyait donc vraiment que tu vivais ailleurs et que tu ne revenais que pour les dates importantes ?
Sans doute. À partir de ce jour, j’ai déménagé mon bureau à la cave. Ce lieu comportait beaucoup de pièces et il était difficile de se rendre compte si l’entrée de l’une d’entre elles était condamnée. J’ai donc fabriqué une sorte de faux mur que je plaçais derrière moi une fois entrée dans la pièce. Il s’agissait d’une planche de bois sur laquelle j’avais vissé des crochets. J’y avais pendu une roue de vélo, deux ou trois chambres à air, un ou deux outils. De l’extérieur, on croyait qu’une planche avait été fixée au mur et servait pour suspendre des objets destinés à l’entretien des vélos.
Tu as vraiment vécu dans cette pièce ?
Oui, j’y travaillais et j’y dormais. Mais je montais au moment des repas et pour m’occuper de mes enfants. De plus, je sortais donner mes cours et promener mes filles.
Cette cache t’a-t-elle servi à échapper à une perquisition ou à une nouvelle intrusion de la police ?
Non. Jusqu’à l’été 2009, il ne s’est rien passé. L’été, je suis parti en vacances chez ma mère dans le Calvados, avec mes enfants.
Alors, comment t’a-t-on arrêté ?
C’était pendant l’hiver 2009-2010 je crois. Ou peut-être à l’automne 2009. Un matin, je suis sorti promener mes deux filles avec la poussette double. Arrivé au bas de la rue, un passant m’a tapé sur l’épaule. Je me suis retourné. « Mr Reynouard ? » – « Oui ! ». Il a sorti une carte avec sa photo et me dit : « Police. Vous êtes en état d’arrestation ». Il m’a proposé de revenir chez moi déposer mes deux filles et de monter dans une voiture banalisée afin que cette arrestation reste discrète. J’ai donné les filles à mon épouse qui a bien compris que j’étais arrêté.
Ils avaient dû t’observer ?
Sans doute avaient-ils mis notre téléphone sur écoute et avaient-ils observé mes habitudes. Que de moyens et de temps perdus pendant que les vrais malfrats couraient ! Les inspecteurs m’ont produit le mandat d’arrêt belge. Puis ils m’ont conduit à la prison de Forest.
C’était la première fois que tu franchissais les portes d’une prison ?
Oui, et je dois avouer que c’est impressionnant. En entrant dans la cour intérieure, je me suis dit : « Là, ce n’est pas le Monopoly ! On ne joue pas ».
J’ai attendu une partie de l’après-midi dans une cellule collective, avec d’autres personnes arrêtées. Puis un gardien m’a demandé à quoi j’étais condamné. Je lui répondis : « À un an de prison ». En haussant les épaules, il ajouta : « Oh, tu auras un bracelet électronique ! » En fin d’après-midi, je fus introduit dans le bureau d’une femme ; je crois que c’était la directrice. Elle m’informa que je bénéficierai d’un bracelet électronique et que je serai convoqué pour la pose. Par défi, je lui demandai si je pouvais être emprisonné, mais elle me confirma qu’elle me « mettait dehors ».
Le condamné qui demande à être emprisonné et la directrice qui le fiche dehors ! Nos sociétés marchent véritablement sur la tête !
Je suis donc revenu chez moi. J’ai jusque fin février 2010 il me semble. Des gens sont alors venus à la maison pour me poser le bracelet électronique à la cheville et pour fixer la boîte de contrôle. C’était un bracelet sans GPS. Si je quittais le périmètre autorisé, la police était prévenue, mais elle ne pouvait savoir où j’étais.
Tu ne pouvais donc plus donner de cours particuliers ?
Détrompe-toi ! J’ai été convoqué chez une auxiliaire de justice chargée d’établir mes heures de sortie. Je lui ai montré mon emploi du temps. Elle ne m’a rien demandé – aucun justificatif – et m’a accordé des heures libres qui me permettaient d’aller et venir chaque jour. Puis elle a ajouté que j’avais également droit à un jour de liberté par semaine, de 8h à 20h, pour promener mes enfants, et une matinée par semaine pour faire les courses. J’étais donc libre tout le dimanche et le mardi matin, en plus de mes quinze heures de cours particuliers.
Et pour imprimer ta revue ?
J’avais droit à quatre jours – je crois – tous les trois mois en guise de « vacances ». Quatre jours d’affilée. Sachant que ma revue paraissait tous les trois mois, je profiterai de ces jours pour l’imprimer et l’envoyer.
Bref, le bracelet électronique ne changea guère ta vie.
En effet. Mais il changea mes horaires de bain, car quand je m’allongeais dans la baignoire en métal, le signal du bracelet ne parvenait plus à la boîte de contrôle. Or, je prenais une fois par semaine un bain afin de me détendre. C’était en général vers 22h. Sachant que je lisais dans l’eau, cela pouvait durer 30 à 40 minutes. La première fois, des policiers m’ont téléphoné le lendemain, ayant constaté que j’avais sans doute quitté mon domicile entre 22h et 22h30. Malgré les explications que je leur ai fournies, ils ne m’ont pas cru. L’affaire s’est répétée la semaine suivante. Cette fois-là, les policiers se sont interrogés. Ils ont envoyé des collègues à eux pour vérifier. En effet, quand j’étais allongé dans ma baignoire, c’était comme si j’étais sorti du périmètre. Il n’existait aucune solution pour remédier à ce problème. Les policiers m’ont donc demandé de modifier mes horaires de bain ! J’ai cessé de prendre mon bain hebdomadaire, me contentant de douches. Ce fut le principal changement dû au bracelet !
Combien de temps devais-tu le garder ?
Six mois, car en Belgique, un condamné effectue la moitié de sa peine. Je devais donc le garder jusqu’à la fin du mois de juillet. J’avais promis à mes enfants de bonnes vacances en août, à la mer. Mais le 9 juillet, des inspecteurs vinrent m’arrêter en vertu d’un mandat d’arrêt lancé par la France. Je devais effectuer la peine à laquelle j’avais été condamné en 2008 par la Cour d’appel de Colmar.
As-tu tenté de t’opposer à l’extradition ?
Oui, deux avocats ont lutté contre. En vain. Le 17 août, j’ai été extradé vers la France. Deux policiers (un homme et une femme) m’ont conduit, menotté dans le dos, jusqu’à la frontière française.
Ils t’ont laissé les menottes ?
Oui, j’étais assis comme je le pouvais à l’arrière de la voiture, avec la ceinture de sécurité et les menottes. Un trajet très inconfortable.
Tu étais traité comme un terroriste !
Je ne portais pas de tunique orange et je n’avais pas un masque sur les yeux. C’était le bon côté de la chose. Arrivé à la frontière, j’ai été livré aux autorités françaises. Deux inspecteurs en civil m’ont conduit au palais de justice. Ils ont garé leur voiture devant, dans la rue, et m’ont fait sortir à la vue de tous les passants. Une jeune fille m’a regardé avec de grands yeux effarés. Je lu ai souri en lui faisant un clin d’œil. Un inspecteur m’a dit que j’avais le sens de l’humour ! Une fois dans le palais de justice, il a ajouté que la juge devant laquelle j’allais être déféré se nommait Emilie Joly ; elle détestait la plaisanterie à propos de son identité. Il me conseilla donc d’éviter toute drôlerie à son encontre. Effectivement, être mis en prison par Emilie Joly, cela ne manquait pas de piquant ! S’il ne m’avait pas prévenu, je l’aurais révélé. Le soir, je passais ma première nuit à la maison d’arrêt de Valenciennes.
Être arraché assez soudainement à ta famille, cela ne t’a-t-il pas anéanti ?
J’avais laissé derrière moi une femme en pleurs. Elle pleurait lors de sa dernière visite à la prison de Forest, une fois la décision d’extradition devenue définitive. Dieu sait si nous avions eu de graves différents – en matière religieuse notamment. Dieu sait si nous nous étions bien souvent querellés. Mais dans ces moments, on oublie tout. Je crois que je n’ai jamais tant aimé mon épouse que lors de cette visite. Quant à mes enfants, j’avais toujours affirmé que je deviendrais fou si l’on m’en séparait. Je craignais donc beaucoup. Allais-je craquer ? À ma grande surprise, non. Aussi choquant que cela puisse paraître, j’ai placé ma mission révisionniste (un peu) au-dessus d’eux.
N’était-ce pas un réflexe de survie ?
Sans doute. Mais malgré cela, je leur écrivais beaucoup. À mes deux filles aînées, j’envoyais des cartes sur lesquelles je dessinais des cœurs. Elles avaient alors trois et cinq ans je pense. Marina m’a raconté qu’elles comparaient leurs cartes pour savoir si l’une n’avait pas plus de cœurs que l’autre. Elles aimaient énormément leur papa, jusqu’à la jalousie.
Ta détention s’est-elle bien déroulée ?
Oui. En tant que condamné en vertu du droit de la presse, j’étais seul en cellule. Je recevais Le Monde et Libération, ainsi qu’un abondant courrier. Le matin, je lisais la presse et je répondais au courrier. L’après- midi, je lisais, je méditais et j’apprenais le dessin, notamment la peinture. Au bout de deux ou trois mois, j’ai commencé une bande dessinée dont j’avais imaginé l’histoire. Je ne l’ai jamais terminée. Elle a été publiée sur Internet. J’ignore si elle est encore consultable. Cette BD m’a vraiment permis de m’évader pendant toute la durée de ma détention.
Les gardiens étaient-ils aimables avec toi ?
Très. Ils me rendaient mon amabilité à leur égard.
Qu’en était-il des autres détenus ?
Sachant qu’il y avait beaucoup de Maghrébins, quand on me demandait le motif de ma condamnation, je répondais que j’écrivais des trucs qui « déplaisaient aux Juifs ». J’étais alors leur ami. Ils ne cherchaient pas à en savoir davantage.
Dans plusieurs vidéos, tu avais raconté tes souvenirs de détention. Nous n’y reviendrons pas ici. Quelque chose, en revanche, m’intéresse, dont, je crois, il faut parler. À ta sortie de prison, en 2011, tu as abandonné ta femme et tes huit enfants. Pour beaucoup, cela reste une tache extrêmement grave sur ta vie. Que s’est-il passé ? Peux-tu expliquer cela ?
Au début de ma détention, mon épouse m’a soutenu à 100 %. Voilà pourquoi dans mes messages publics, je soulignais que le héros dans cette affaire, c’était tout d’abord elle. C’était sincère. Mais soudainement, au bout de quelques mois, ses lettres sont devenues très amères. Marina m’accablait de reproches sur mon comportement depuis des années.
Ces reproches étaient-ils justifiés ?
Pour beaucoup, oui. Si je pense avoir été un très bon père, je n’avais pas été un très bon époux. J’étais d’abord marié avec le révisionnisme. J’ai délaissé Marina.
Pourtant, tu as eu huit enfants !
Oui, mais il faut se méfier des conclusions hâtives. Un jour, Marina a dit à ma mère : « Je ne me sens bien que quand j’ai un bébé ». Sans doute reportait-elle l’affection qu’elle pouvait donner sur un nouveau-né qui le lui rendait. Or, quand une femme veut un enfant, elle sait comment faire !
Si ces reproches étaient justifiés, pourquoi ne pas les avoir acceptés ?
Je les ai acceptés ! J’ai demandé pardon et j’ai promis qu’à ma libération, certaines choses changeraient.
Ton épouse t’a-t-elle demandé de cesser le combat révisionniste qui commençait à vous coûter très cher ?
Non, jamais. Ses reproches concernaient la vie familiale, mais j’aurais sans doute pu corriger les choses sans abandonner le révisionnisme. Voilà pourquoi j’avais promis des changements. Marina s’est alors montrée conciliante et nos rapports se sont apaisés. Puis, dans une lettre, j’ai souligné que certaines de ses critiques m’étaient apparues exagérées. Je voulais juste mettre les choses au point, sans nier le moins du monde mes responsabilités. Ma remarque fut fatale ! Les lettres de Marina devinrent si acerbes qu’à la fin, je ne les lisais même plus. Je les jetais à la corbeille directement. J’en ai transmis une à un ami pour qu’il constate par lui- même. Il m’a répondu qu’en effet, le ton des lettres était très violent.
Comment expliques-tu ce revirement ?
Aujourd’hui encore, je n’en ai aucune explication. Mais j’ai alors appris par des amis que depuis plusieurs années, Marina leur téléphonait parfois très longtemps pour se plaindre de mon comportement. Aucun ne me l’avait révélé, afin de ne pas aggraver la situation qui leur semblait déjà assez grave.
Depuis des années donc, votre couple battait de l’aile ?
Oui, et j’en porte une part de responsabilités. Je l’ai dit, je délaissais Marina. Par exemple, je discutais avec mes amis et mes aînés, pas avec elle. Un jour, elle me lança qu’elle n’était sans doute pas assez intelligente pour moi ! Pire, quand elle éternuait, je souriais d’un air de dire : « Ah ! C’est la fin! » Elle me répondait alors sur un ton sec que non, elle n’allait pas encore trépasser et que donc, je ne serai pas encore débarrassé d’elle. Je l’avoue aujourd’hui, j’ai été parfois très maladroit avec elle ; je m’en rends compte désormais et j’aimerais réparer.
On peut donc comprendre les lettres acerbes de ton épouse.
Oui, mais ce que je ne comprends pas, c’est pourquoi les premiers mois, elle m’a soutenu et pourquoi soudainement, elle a fait volte-face. Quoi qu’il en soit, au moment où ses lettres devenaient si acerbes que je ne les lisais plus, j’ai reçu une carte anonyme. Elle émanait d’une jeune femme qui avait découvert mes travaux grâce à Alain Soral et qui admirait mes analyses, notamment les conséquences sociologiques de la croyance en la Shoah. Elle avait particulièrement apprécié le sixième épisode de ma série sur l’Holocauste, qui abordait la spiritualité. La jeune femme m’expliquait qu’elle était vacataire dans une bibliothèque et que sa vie était très morne.
Cette carte m’a profondément touché. Normalement, je jetais ces lettres auxquelles je ne pouvais pas répondre. Mais celle-ci, je l’ai gardée. Je la relisais parfois.
Plus tard, une seconde carte anonyme me fut envoyée. Le style et l’écriture me convainquirent qu’il s’agissait de la même personne. Elle me déclarait son soutien. Le ton était si doux que j’en fus troublé. Je voulais connaître cette jeune femme, mais rien ne pouvait me le permettre.
As-tu alors décidé de quitter Marina ?
Non, pas du tout. Je tenais à revoir mes enfants. Si à ma libération, j’avais pu revenir à Bruxelles, rien ne se serait passé. J’aurais repris ma vie de famille. Mais avant même ma libération, j’avais été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une nouvelle affaire de révisionnisme. Je devais rester en France. Aussi avais-je élu domicile chez ma mère. Je devrais pointer toutes les semaines au commissariat du village, prévenir si je changeais d’adresse ou si je m’absentais plus de trois jours.
Le jour de ma libération, le 5 avril 2011, Marina m’accueillit avec les enfants. Étaient également présents Siegfried Verbeke et sa femme ainsi que Jérôme Bourbon. Nous nous sommes promenés dans Valenciennes. Je portais ma dernière fille sur mes épaules. Nous avons mangé ensemble dans un salon de thé. Puis, Marina est repartie à Bruxelles avec les enfants. Jérôme Bourbon m’a conduit à Paris où il m’a logé quelques jours, le temps que j’aille chez ma mère.
Ta femme et tes enfants ne sont donc pas restés quelques jours avec toi ?
Non, les enfants avaient école. Mais je pensais en effet que Marina me laisserait les plus petits auxquels j’avais beaucoup manqué. Plus tard, une lectrice âgée m’écrivit : « Quand j’ai appris qu’à votre sortie, vous n’aviez pas passé votre première nuit avec votre épouse, j’ai compris qu’il n’y avait plus aucun amour entre vous. Un homme qui sort de prison passe toujours sa première nuit avec sa femme ». Elle avait raison. Mais c’est surtout le départ des enfants qui m’a chagriné.
Tu t’es donc installé chez ta mère et tu as repris tes activités révisionnistes ?
Oui, je me suis immédiatement remis au travail . Je voulais terminer la BD que j’avais commencée en prison, ainsi que rédiger mes souvenirs de détention. Mais le révisionnisme stricto sensu m’en a empêché. J’avais encore beaucoup à dire !
Tu n’avais pas encore choisi de quitter votre famille ?
Non. Certes, mes rapports avec Marina étaient devenus très froids, mais je comptais bien rentrer à Bruxelles dès la fin du contrôle judiciaire. Un jour toutefois, je reçus un mail de la jeune femme qui m’avait écrit en prison. À force de recherches, elle avait trouvé une adresse, priant pour que ce fût la bonne. C’était la bonne !
Elle s’appelait Marie ! Comme Marie Pererou ! Je lui ai répondu sans attendre. Plus tard, elle me raconta que quand elle vit ma réponse, elle sauta de joie !
Elle m’apprit qu’elle vivait une relation toxique avec un homme assez déséquilibré . Elle avait une formation de correctrice et de métiers du livre. Je lui ai répondu que j’avais besoin d’une correctrice, donc que je pourrais l’employer. Nous nous sommes rencontrés à Paris, avec son compagnon. Pendant toute la soirée, il a monopolisé la parole, Marie ne disait rien. Quand je lui posais une question, il répondait à sa place. À un moment, il s’est absenté pour aller aux toilettes. Nous avons pu parler un peu. À son regard, j’ai deviné ses sentiments. Elle a dû deviner les miens.
Dans les jours qui ont suivi, je lui ai proposé de la ramener chez ses parents, en Haute-Normandie. Elle a profité de l’absence de son compagnon pour prendre ses affaires et monter dans ma voiture. Je l’ai ramené dans sa famille.
Les grandes vacances sont venues. Marina m’a annoncé qu’elle viendrait une dizaine de jours avec les enfants en juillet. C’est tout ! J’en suis resté abasourdi, mais je n’ai pas protesté. J’ai acheté une petite piscine pour les enfants. Pendant quelques jours, j’ai joué avec eux. Mais le cœur n’y était plus. J’aimais Marie.
Une fois les enfants partis, je suis allé la voir chez elle, quand ses parents étaient absents. Je vous laisse deviner comment la soirée s’est terminée. Je me souviens qu’à ce moment-là, je me suis dit que jamais plus je ne pourrais regarder Marina en face.
Marie travaillait désormais pour moi. Elle corrigeait mes textes et assurait le secrétariat. Je lui ai acheté un bel ordinateur. Elle s’est installée chez ma mère. En août, nous sommes allés pour deux semaines à la mer. Une sorte de lune de miel. Un soir, Marie m’a dit : « Vincent, ta femme ne sait rien. Tu peux encore choisir de revenir chez toi à la fin de ton contrôle judiciaire . Je le comprendrai et je quitterai ta vie ». Nous avons décidé d’envoyer un mail à Marina. Je lui expliquais que j’aimais Marie et que je ne reviendrais pas à Bruxelles. Nous verrions quelle serait sa réponse. Si elle m’avait supplié de revenir à la raison et de revenir à Bruxelles, je pense que je l’aurais fait. Mais elle n’a jamais répondu. Rien. Je suis donc resté avec Marie. Voilà toute l’histoire !
Regrettes-tu ton choix ?
Oui et non. Non parce que si j’étais rentré à Bruxelles, je n’aurais certainement pas eu le cœur de m’exiler loin de mes enfants. Aussi, aurais-je été neutralisé beaucoup plus rapidement, dès 2015 peut-être. De plus, en abandonnant ma famille, elle a été et reste protégée. Au cas où l’on interrogerait un de mes enfants pour savoir si son père est Vincent Reynouard, il pourra aisément répondre que oui, mais que je les avais abandonnés en 2011 et qu’ils n’avaient plus aucun contact avec moi.
Pour ma famille et pour la poursuite de ma mission révisionniste, mon choix a été le bon.
Mais ce ne sont pas les raisons pour lesquelles j’ai fait ce choix. J’ai choisi Marie pour des motifs purement égoïstes, parce que j’espérais jouir de la vie avec une femme qui me plaisait et qui m’ouvrait ses bras. Ce choix, je le regrette. D’ailleurs, j’ai déjà payé – puisque Marie m’a quitté en 2015 – et je suis persuadé que dans une prochaine existence je paierai encore. Abandonner ses enfants forme un karma très négatif.
Cet exemple montre comment la Providence tire un bien d’un mal. Sur le plan personnel, mon choix était un mal ; mais pour ma famille et pour le collectif, mon choix fut un bien. Voilà pourquoi je le regrette sans le regretter. Tout dépend du niveau auquel je me place.
La famille de Marie t’a-t-elle accepté ?
Au début, oui, très bien. Car elle m’a présenté comme m’appelant François et comme écrivant des livres de pédagogie en mathématiques. Elle a montré à ses parents l’ordinateur que je lui avais offert. Tout allait bien jusqu’au jour Marie voulut faire son « coming out » . Elle écrivit une longue lettre à sa famille (parents, oncles et tantes) afin de révéler qui j’étais : un national-socialiste révisionniste. Sa famille étant de gauche, vous imaginez sans peine la consternation.
Son père a voulu la ramener à la raison. Il s’est même adressé à une ancienne déportée, Magda Hollander- Lafon, pour parler à sa fille. Marie l’a invitée à débattre avec moi. Elle a refusé. Interrogée pour savoir si elle avait vu ne « chambre à gaz », l’ancienne déportée répondit négativement. Un jour, Marie discutait avec son père qui s’était un peu documenté sur la Shoah. Il lui ressortait les poncifs habituels. J’ai saisi le téléphone et lui ai proposé de débattre. Il a raccroché immédiatement. Plus tard, Marie lui a objecté qu’il ignorait le dossier. Elle l’a invité à lire les révisionnistes. Il a répondu qu’il préférait encore son ignorance à la négation. Il n’y avait donc rien à faire.
Tu étais donc totalement rejeté ?
Oui, totalement. La famille paternelle vivait dans le Nord. Pour l’enterrement de la grand-mère, Marie ne se sentait pas la force de conduire jusque-là. Je l’ai donc accompagnée. Je n’ai pu assister ni à l’enterrement, ni aller au cimetière, ni participer au repas familial organisé ensuite dans un hôtel-restaurant de la ville. Nous avions donc loué une chambre dans l’établissement pour la journée, afin que je puisse me reposer et travailler. Le soir, on frappa à la porte. La patronne de l’hôtel vint m’apporter un plateau-repas. Je la remerciais chaleureusement. Elle m’adressa un sourire très sympathique, comme pour dire : « Je compatis ». Lorsque, la famille étant repartie, Marie vint me rejoindre, je l’ai remerciée pour avoir demandé qu’on me monte un repas. Elle me répondit : « Moi, je n’osais pas. Mais à un moment, la patronne m’a chuchoté à l’oreille pour savoir s’il fallait donner à manger au « proscrit » qui était là-haut ». Elle avait bien compris la situation.
Une vie de proscrit. Vivais-tu encore chez ta mère ?
Non, nous avions trouvé un petit appartement trois pièces à Saint-Lô. Pour pouvoir le louer, sachant qu’officiellement, ni Marie ni moi ne travaillions, il a fallu fabriquer de fausses fiches de paye. Pour Marie, c’était tout nouveau et elle n’osait pas. Pour moi, c’était la routine.
Tu étais devenu un expert en faux !
Expert est un peu trop fort. Mais en effet, c’était devenu une habitude. À la maison, avant 2010, mes enfants m’entendirent souvent dire que j’avais confectionné un faux pour ceci ou pour cela.
Un jour, mon épouse devait se rendre à un rendez-vous administratif. Elle ne retrouvait plus un document qu’il fallait présenter. Un de mes enfants lui a dit tout naturellement : « Fais un faux maman ». Je précise toutefois n’avoir jamais utilisé de faux pour voler de l’argent. Non, il s’agissait toujours d’obtenir un droit qui m’aurait été octroyé si je n’avais pas été un révisionniste proscrit à cause de lois scélérates.
On peut donc parler de ce que les moralistes appellent la « compensation occulte ».
Exactement. D’ailleurs, si j’ai pu vivre décemment, je n’ai jamais roulé sur l’or. J’ai toujours mené une vie très simple, achetant principalement (livres, jouets, habits, meubles, électroménager, informatique) dans les magasins d’occasion. De toute ma vie, je n’ai jamais acheté une voiture neuve. J’ai toujours acheté des vieilles occasions qui comptaient 150000 à 230000 kms au compteur. Les autorités devaient le savoir, car elles ne m’ont jamais ennuyé en enquêtant sur ma « fortune ».
En 2011, la reprise de mes activités révisionnistes nous a permis de gagner de l’argent et même d’en mettre de côté. Quelques milliers d’euros. Nous encaissions les chèques sur le compte qu’un ami nous avait ouvert. Nous retirions l’argent au distributeur avec une carte de retrait. J’ai caché la réserve chez nous. Mais craignant une perquisition, j’ai acheté chez Emmaüs une vieille centrifugeuse. Je l’ai démontée et j’ai remplacé le moteur par une pierre aussi lourde mais moins volumineuse. Dans l’espace gagné, nous avons glissé les billets. Ce fut notre coffre-fort secret. La police ne l’a jamais découvert.
Parce que, bien évidemment ; les ennuis ont recommencé ?
Je dirais même qu’ils n’avaient jamais cessé. Un jour que j’étais venu signer à la gendarmerie dans le cadre de mon contrôle judiciaire, le gendarme me dit : « venez dans mon bureau, j’ai un document pour vous ». Il m’a montré un mandat d’arrêt. J’avais été condamné à un an de prison ferme pour « viol du droit d’auteur ». En 2008, j’avais réalisé une BD révisionniste en utilisant quelques dessins parus dans une publication de Charlie Hebdo (relative au procès Papon). L’auteur avait porté plainte. J’ai été conduit à la prison de Caen où je suis resté trois ou quatre jours. De là, j’ai été emmené à Paris. Un avocat commis d’office s’est présenté. C’était un juif. Mais il me défendit de façon très professionnelle. Il me conseilla de faire opposition à ma condamnation puisque j’avais été condamné en mon absence, et me promit de plaider pour ma remise en liberté provisoire. Le soir, je suis passé devant une femme juge. Une femme procureur demanda mon maintien en détention. L’avocat rétorqua : « Mon client a été arrêté au Commissariat, alors qu’il venait signer dans le cadre d’un contrôle judiciaire qui lui est imposé depuis des mois et qu’il a toujours respecté. On peut donc lui faire confiance ». J’ai été remis en liberté provisoire. L’avocat m’a prêté son téléphone pour prévenir Marie et m’a donné 10€ pour me rendre chez un ami.
Comme quoi…
Ce n’est certes pas cela qui me rend « judéo-indifférent ». Mais ce genre d’anecdote confirme.
Tu es donc passé une deuxième fois en procès pour cette affaire ?
Oui, un avocat m’a bien défendu. De mon côté, j’ai argué qu’au début de la BD, j’avais précisé la provenance des dessins. J’avais donc agi par ignorance du droit d’auteur, pas par malveillance. J’ai ajouté que 300 exemplaires de la BD avaient été diffusés, ce qui ne m’avait guère permis d’en retirer des bénéfices. J’ai été condamné à de la prison avec sursis et à une amende que je n’ai pas payée, étant sans ressources.
De quoi vivais-tu ?
Du RSA.
Tu devais donc trouver un emploi ?
Oui. Pendant plusieurs mois, j’ai argué que je donnais des cours particuliers et que je montais mon entreprise, avec Marie, pour donner des cours de maths-sciences et de français. Le contrôleur était très gentil. Il savait qui j’étais, mais il a toujours rendu de bons rapports.
C’est vers cette époque qu’en matière de révisionnisme, tu as progressivement abandonné l’écrit pour privilégier la vidéo. Tu avais donc décidé de changer de stratégie ?
Non, comme d’habitude, j’ai agi sur un coup de tête, puis j’ai improvisé. J’avais choisi de réaliser une vidéo sur un sujet précis, je ne me souviens plus quoi. Cela devait être une seule vidéo. Mais le succès m’a convaincu d’en faire une seconde, puis une troisième… C’est ainsi que j’ai petit à petit privilégié la vidéo. Avec ce média, je touchais beaucoup plus de monde. J’ai toutefois continué à vendre de l’écrit afin de financer le révisionnisme. En effet, qu’il s’agisse d’effectuer des recherches ou d’acquérir du matériel informatique, cela coûte de l’argent.
Avec les vidéos, tu es passé à la vitesse supérieure, car tu touchais désormais un public plus vaste.
Oui. Un matin, en sortant de la boulangerie qui faisait face à notre immeuble, j’ai croisé un jeune homme qui m’a regardé fixement. Trente minutes plus tard, j’ai reçu un e-mail : « Est-ce vous que j’ai croisé ce matin à la boulangerie ? » Le jeune homme habitait avec ses parents dans l’immeuble d’à côté. Ils nous ont invités un soir au restaurant.
Tu devenais donc plus connu, ce qui allait t’attirer de nouveaux ennuis.
C’était fatal. Je m’en suis aperçu après avoir été engagé comme professeur par Acadomia. Un jour, une élève m’envoya un message : « Avez-vous cessé les cours uniquement avec Acadomia ou ne donnez-vous plus cours du tout ? ». Immédiatement, j’ai consulté mon compte de professeur sur le site Acadomia. Il avait été fermé sans que je ne fusse prévenu. On m’avait congédié comme un malpropre. Peu après, j’ai appelé mes lecteurs à me soutenir car j’avais perdu tous mes élèves, ou presque. J’ai donné les références de mon compte bancaire. La banque m’a alors écrit pour m’informer qu’elle allait clôturer mon compte dans les trente jours.
Tes adversaires te traquaient, c’est certain.
En juillet 2014, un institut privé m’a engagé comme professeur de maths. J’avais postulé sans y croire, uniquement pour me justifier auprès de pôle emploi. Cette fois, je n’avais pas fait que des faux.
L’institut n’a pas cherché sur Internet pour glaner des informations à ton propos ?
Visiblement non . J’en ai moi-même été très surpris. Je me suis donc empressé de signer le contrat. L’institut préparait des élèves aux concours paramédicaux. Il était situé à Caen. Ne pouvant effectuer le trajet tous les jours, j’ai loué une chambre minable dans un immeuble miteux du quartier de la gare. Les trois autres chambres étaient louées par des déclassés, des paumés très gentils toutefois. Je partageais les toilettes avec l’un d’eux. Souvent, la saleté était assez repoussante. Mais le propriétaire ne demandait rien et j’ai payé d’avance six mois, en liquide. Il était ravi ! Nous n’avons signé aucun contrat. Il m’a juste donné un reçu.
À cette époque, une plainte avait déjà été déposée contre toi, et tu as subi une perquisition.
En effet. La vidéo attaquée était celle qui dénonçait l’embrigadement politique de la jeunesse au nom du
« devoir de Mémoire ». Marie et moi avions été interrogés à son propos. Une perquisition avait en outre été opérée : les policiers avaient saisi mon matériel vidéo, jusqu’au pied de la caméra.
Avaient-ils saisi tes ordinateurs ?
Non, car j’avais aménagé une cache très astucieuse derrière un bureau, dans l’espace vide réservé aux fils du matériel informatique. J’avais masqué cet espace à l’aide d’une planche fixée par des aimants puissants.
C’était quasiment invisible et les policiers n’ont rien vu. On y cachait nos ordinateurs, le courrier et les chèques à envoyer à notre ami.
Conformément à ton habitude, tu n’as pas nié être l’auteur ?
J’ai pris toutes les responsabilités, sans chercher à me défausser. L’inspecteur était si impressionné par mon honnêteté, qu’il me dit : « Vous êtes adorable ! » Marie me révéla ensuite qu’il lui avait confié une information positive : le procureur lui aurait dit que j’avais déjà suffisamment payé, donc que la peine serait très légère.
Y as-tu cru ?
Je ne m’en souviens plus. Mais peu après, nous avons reçu une lettre anonyme qui avait été déposée directement dans notre boîte. L’auteur disait travailler pour une administration qui allait me frapper durement. Il s’agissait très vraisemblablement de la Justice. Marie fondit en larmes. Depuis plusieurs mois, je sentais qu’elle n’en pouvait plus de cette vie. Nous avions eu un enfant en avril 2013 – elle me l’avait demandé – et, en tant que maman, elle devait aspirer à une vie plus tranquille.
Outre la condamnation qui t’a frappé, ce procès t’a fait perdre ton travail.
J’ai perdu mon travail avant même le procès. Les concours pour les écoles paramédicales commençaient fin mars ou début avril. Au mois de janvier, un autre institut privé caennais qui préparait les élèves contacta celui pour lequel je travaillais : leur professeur de math avait brutalement démissionné. Le directeur demandait si, pour deux mois, j’accepterais de travailler pour les deux instituts, avec des aménagements d’emploi du temps. Gentil, j’acceptai. Au moment de quitter mon établissement pour aller signer le contrat temporaire, une voix me dit : « Ça va t’attirer des ennuis ». C’était la même petite voix que six années plus tôt, la veille de mon anniversaire. Mais je ne l’ai pas écoutée. Je suis allé signer le contrat. J’ai alors rencontré une élève de Saint-Lô à laquelle j’avais donné des cours particuliers : elle fut ravie de savoir que je serai son professeur pendant deux mois. « Tu vois, me suis-je dit, tout va bien ». Mais le lendemain, je reçus un appel du directeur de l’établissement. Au ton lugubre de sa voix, j’ai tout de suite compris : « Mr Reynouard ? »
«Oui », ai-je répondu. « Ici le directeur de X, ce n’est pas la peine de venir demain ». « Ah ! Vous voulez que je déchire mon contrat ? ». « Oui, au revoir ».
A-t-il prévenu l’autre établissement ?
Bien entendu. Mon supérieur vint me voir : « Vincent, on m’a appris. Je n’ai pas osé aller voir ton site sur Internet. Mais il va falloir que tu démissionnes au plus vite ». Je suis parvenu à négocier une rupture à l’amiable. Elle serait effective le lendemain. Le jour même, j’ai prévenu les élèves de mon départ. Ils ont été très déçus. À la fin du cours, une demoiselle m’a dit : « Ne partez pas Monsieur ! Vous êtes un super prof ! ».
« Merci, c’est gentil, mais tu ne sais pas qui je suis en réalité ». « Bien sûr que si, tous les élèves le savent ici ! » Ils avaient cherché sur Internet. Pour la nouvelle génération, c’est tout naturel. J’en tombais à la renverse. « Ah ? Et… et vous n’avez pas prévenu la direction ? ». « Non. Nos parents nous ont demandé si vous nous faisiez de la propagande en classe. Nous avons répondu que non, que vous vous contentiez de faire votre travail. Ils nous ont dit que si vous étiez un bon professeur, alors il fallait que nous restions discrets ». Les élèves avaient donc caché qui j’étais.
C’est assez surprenant. Hélas, cela ne t’a pas empêché de perdre ton travail.
Oui, j’avais eu de la chance, beaucoup de chance, avec le premier établissement. J’aurais dû écouter ma petite voix.
Puis vint ton fameux procès à Coutances.
C’était le 11 février 2015 je crois. Une trentaine de personnes, en majorité des membres d’Égalité et Réconciliation vinrent me soutenir. Je me suis présenté sans avocat, Maître Delcroix étant désormais à la retraite. Dans la salle, les adversaires étaient très majoritaires. La tension était palpable. À un moment, le juge m’a demandé mes motivations : « Réhabiliter le national-socialisme dans ce qu’il a de réhabilitable », ai-je répondu. Un frisson d’horreur parcourut la salle.
N’était-ce pas un peu provocateur ?
Si j’avais éludé, les juges n’auraient eu aucun mal à montrer des photos, des couvertures et des titres d’articles prouvant que j’étais national-socialiste. Les juges aiment ça : jouer avec l’accusé qui nie maladroitement comme le chat joue avec la souris qu’il est parvenu à saisir, avant de la tuer. Je ne voulais pas leur accorder ce plaisir. « N’ayez pas honte de dire ce que vous n’avez pas honte de penser », dit un proverbe. C’est très vrai.
Tu as donc été condamné à deux ans de prison ferme, le double du maximum prévu par la loi.
Oui. Le soir, je fis la une du journal télévisé régional. Le lendemain, les journaux locaux consacrèrent de longs articles à mon procès. Sachant que l’hystérie était réelle, je suis allé habiter la chambre que j’avais louée jusqu’à la fin du mois de février. Mais un après-midi, Marie me prévint que les forces de l’ordre me recherchaient. Elles étaient venues à l’appartement. Craignant qu’elles ne connaissent mon adresse à Caen, j’ai immédiatement quitté ma chambre. Par chance, je disposais de notre voiture. Je suis parti me réfugier chez Jérôme Bourbon, à Paris. Je suis resté seul à l’appartement. Sachant qu’il était au treizième étage, donc je ne pourrais fuir par la fenêtre si la police venait, j’ai aménagé une cache dans un placard. En dévissant une planche pour l’approfondir, j’ai découvert une bouteille de vin rouge que les premiers occupants avaient déposée là. Elle datait de 1973 !
Cela t’a fourni un petit réconfort !
Je ne bois pas d’alcool. Je l’ai laissée à Jérôme.
Cette cache t’a-t-elle servi ?
Non. Chaque matin, par crainte d’une irruption de la police à 6 heures, j’allais me promener de 5h30 à 7h dans le quartier, afin d’être absent. Mais des policiers pourraient toujours venir dans la journée. Un jour, j’ai entendu le bruit caractéristique d’un talkie-walkie dans le couloir qui menait à l’appartement. Mon cœur a fait un bond : les policiers ! Ils arrivent ! Non, il s’agissait d’un homme venu inspecter les extincteurs à l’extérieur des appartements. Je vivais dans la crainte permanente. Peu après, Marie m’a raconté qu’étant sur le balcon pour nettoyer des bacs du réfrigérateur, un homme lui avait crié des insanités et l’avait traitée de
« pute de nazi ». Un soir, je suis venu lui rendre visite. J’en ai profité pour glisser les clés de la chambre dans la boîte aux lettres du propriétaire. Je suis reparti par le dernier train pour Paris.
Peu après, Marie me téléphona : le matin, lorsqu’elle avait pris la voiture pour emmener Sonia chez sa nourrice, deux hommes l’avaient suivie. Depuis, ils étaient sur le parking de l’immeuble à l’observer.
Ce ne sont pas les méthodes de la police.
Certes, mais que faire ? Marie ne pouvait pas prévenir la Police et dire : «Deux hommes m’ont suivie et m’observent », on l’aurait crue paranoïaque ! Nous nous sommes quittés sans rien décider. Mais quelques heures plus tard, Marie me téléphona en disant : « Bonjour mon petit lapin… » C’était un code pour me prévenir qu’elle n’était pas seule et qu’on l’écoutait. J’ai donc dit que j’étais en route pour Marseille. Marie m’a rappelé un peu plus tard : dans l’après-midi, elle s’était absentée pour faire des courses. À son retour, les deux hommes l’attendaient dans le hall de l’immeuble. L’appartement était au rez-de-chaussée. Lorsqu’elle ouvrit la porte, ils se précipitèrent et la poussèrent à l’intérieur. Là, ils lui ordonnèrent de s’asseoir. Ils lui montrèrent un papier avec l’adresse de ses parents et lui demandèrent mon numéro de téléphone. Elle le leur donna. Ils exigèrent qu’elle me téléphone pour vérifier. C’est alors qu’elle me dit : « Bonjour mon petit lapin ». Satisfaits, ils repartirent. Marie sanglotait. « J’en ai fait pipi sur moi », me dit-elle. Je lui conseillais d’appeler la Police. Mais elle était trop terrorisée. Elle n’en fit rien. Naturellement, je n’allais pas le faire moi-même.
As-tu su qui étaient ces voyous ?
Non, mais c’était sans importance. J’avais décidé de quitter la France où l’atmosphère devenait irrespirable. Je me suis donc réfugié chez mon ami Siegfried Verbeke, en Flandres, non loin d’Anvers.
Là, j’ai continué à réaliser des vidéos. J’ai appris que le procès en appel aurait lieu au mois de juin. Un avocat voulut m’aider en plaidant, Maître Wilfrid Paris. J’ai accepté, car je ne voulais pas assister à l’audience.
Avant la date fatidique, j’ai reçu une convocation à la Police judiciaire à Paris. Une nouvelle plainte contre moi était instruite. Je devais être interrogé début juillet.
Je savais qu’en appel, je serais condamné à un an de prison ferme, le maximum prévu par la loi. Dès lors, je risquais fort d’être arrêté et incarcéré lorsque, début juillet, je me rendrais dans les locaux de la PJ à Paris. J’ai donc décidé de ne pas me rendre à cette convocation. Mais je savais qu’un mandat d’arrêt serait alors lancé contre moi. Or, l’épouse de Siegfried Verbeke m’avait parlé d’une maison en Angleterre dont elle était propriétaire et qui était inoccupée depuis deux ans au moins. Elle me proposait d’y vivre. Pour moi, c’était une aubaine, car en Grande-Bretagne, aucune loi anti-révisionniste n’existait. J’ai donc accepté, en insistant pour que l’on se rende en Angleterre avant ma condamnation définitive, afin que je puisse franchir la frontière sans être arrêté. Début juin, nous sommes donc partis. Nous avons pris le Ferry-boat à Calais. En arrivant sur le sol britannique, j’ai ressenti une véritable libération.
Tu as donc pu vous installer dans une maison située non loin de Londres. Celui qui ignore comment cela s’est passé pourra croire qu’une internationale révisionniste existe, qui a financé la location d’une maison dès que tu en as eu besoin, là où tu en avais besoin.
Oui, il m’imaginera arrivant dans une habitation cossue, tout étant prêt pour m’accueillir. Or, la maison avait été louée à des Népalais qui l’avaient passablement dégradée et salie. Depuis, elle servait de débarras à la famille de l’épouse de Siegfried. Je suis donc arrivé dans une maison sale et délabrée. Un lit double permit à Siegfried et son épouse de dormir. Moi, je dormais sur un carton posé à même le sol. Le désordre était indescriptible. Pendant trois ou quatre jours, l’épouse m’aida à m’installer : elle fit remettre l’électricité, l’eau, le téléphone et m’aida à ouvrir un compte en banque. Nous rangeâmes et nettoyâmes au mieux, mais dans la cuisine par exemple, la crasse était partout : la fenêtre était si sale qu’on aurait dit du verre dépoli, alors qu’il s’agissait d’une couche de crasse. Au-dessus des placards, je trouvais des tranches de pain moisies, des paquets de chips vides, des verres en plastique usagés. Des portes étaient arrachées, le tuyau de douche avait disparu, la tuyauterie de l’évier était bouchée…
Telle était la réalité ; la réalité vécue, pas fantasmée.
Tu as pu échapper aux autorités françaises, mais ta situation était loin d’être confortable !
Du mois avais-je un toit. Avec Siegfried, nous avons acheté un bureau et un lit pour moi. Je me suis installé dans une petite chambre qui était moins encombrée (la maison comprenait trois chambres).
Quatre jours plus tard, ils sont partis. Je me revois les saluant sur le pas de la porte. Je me suis dit : « Te voilà seul en exil ».
Peu après, Marie me promit de venir avec notre fille. Cela me mit du baume au cœur. J’ai rangé la maison, nettoyé et installé une chambre pour notre fille. J’avais acheté un petit lit, des posters, des jeux, y compris un lustre enfantin rose avec des oies dessinées dessus.
Marie est venue. Elle m’annonça qu’elle avait quitté Saint-Lô et qu’elle s’était rapprochée de chez ses parents. Elle était venue en cachette, car ses parents acceptaient de l’aider à condition qu’elle rompe tout contact avec moi. Je lui ai proposé de venir s’installer ici en Angleterre. Les opportunités étaient nombreuses, elle pourrait trouver du travail et notre fille serait bilingue. Elle ne m’apparut pas convaincue.
Nous avons passé des jours très agréables. Notre fille jouait dans sa chambre et nous l’amenions jouer dans un parc non loin. Je montrais à Marie la petite ville, avec toutes ses commodités. Au bout de quelques jours, elles sont reparties. J’espérais les revoir vite, pour leur installation ici.
J’avais repris mes activités révisionnistes avec des vidéos. Ayant tout abandonné en France, je ne vendais plus rien. Quelques généreux donateurs me permettaient de vivre avec une petite réserve que j’avais constituée.
Avais-tu des projets pour l’avenir ?
Non. Comme d’habitude, je naviguais à vue. Un jour, un camion se gara dans la courette. Des gens en sortirent et déposèrent des fenêtres contre la maison. Je sortis pour leur dire qu’il devait y avoir une erreur, je n’avais rien commandé. Ils me montrèrent un bon de commande à cette adresse. Contactée, l’épouse de Siegfried m’apprit qu’en effet, elle avait commandé de nouvelles fenêtres. Or, les anciennes, en aluminium étaient encore bonnes. Elle me rassura en disant que son gendre paierait l’installation. Pendant plusieurs jours, des ouvriers s’activèrent. Quand le travail fut effectué, le gendre vint l’inspecter. Cela dura trois heures ! Trois heures de palabres : le gendre trouvait toujours à redire. Les ouvriers modifiaient quand c’était possible. Ils ajoutèrent notamment des aérations de sécurité en perçant les montants des fenêtres et en vissant des grilles. J’ai compris que le gendre ne voulait pas payer. Et en effet, l’épouse de Siegfried me dit qu’il avait refusé. J’ai dû payer. Cela m’a coûté toutes mes économies.
Pour m’en sortir, j’ai publié des annonces proposant des cours particuliers. Un institut français m’a engagé. Il s’occupait d’élèves français qui fréquentaient des lycées français à Londres. Mais j’étais soulagé .
Peu après, Marie vint seule. Elle me fit comprendre qu’elle ne viendrait pas s’installer en Angleterre. Entre nous, c’était fini. Ses parents lui avaient rappelé qu’au moindre contact, ils l’abandonneraient. Ne pouvant risquer une indiscrétion de notre fille, je ne la verrais plus. Je ne lui parlerais plus.
Tout cela a dû t’anéantir ?
Oui. Je me souviens, cela devait être un soir de novembre . Je revenais d’un cours particulier à Londres. Passant à vélo sur un pont de la Tamise ; je me suis arrêté. J’ai posé mon vélo et j’ai regardé l’eau en me demandant si j’allais sauter. Mais non, je n’ai pas sauté. J’ai repris mon vélo et je suis rentré chez moi.
Qu’est-ce qui, finalement, t’a permis de surmonter cette épreuve ?
Je ne parle ici que pour moi : dans mon cas, ce fut le bouddhisme. Il m’a appris : 1/ l’impermanence. Rien n’est destiné à durer dans le monde de la matière. Tout se modifie et passe comme les nuages un jour de vent. 2/ Le caractère éphémère de l’existence : au regard de l’éternité, une vie n’est qu’un battement de cils. Les bouddhistes affirment qu’aussi longtemps que nous vivons dans l’illusion, nous irons d’existence en existence, chacune étant faite pour apprendre. Les épreuves sont là pour ça : apprendre jusqu’à s’extraire du cycle des morts et des renaissances ; 3/ la compassion : se mettre à la place de l’autre, sincèrement, afin de comprendre ses motivations, ses actes et ses demandes. Cette vertu vous libère de la rancœur et de la colère. C’est ainsi que j’ai pu les surmonter.
Propos recueillis par Ulex, revu et corrigé par Vincent Reynouard.
































 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV

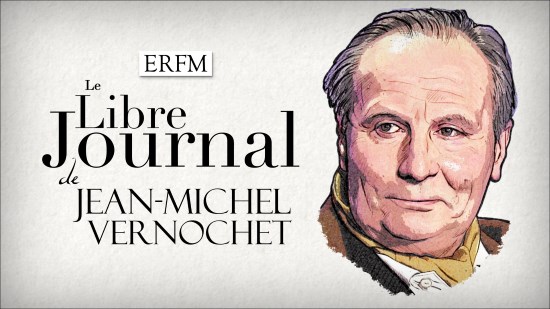
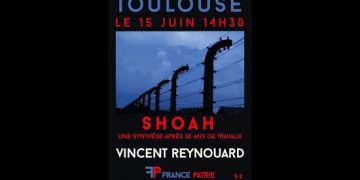






Témoignage exceptionnel. Reynouard est du bon côté de l’Histoire. Merci à Jeune-Nation.
Quelle épopée… et de l’autre côté, quelle haine persévérante !
Haine de la vérité, passion pour le mensonge !
J’ai tout lu. Quelle vie. C’est vraiment un « travail pour l’histoire ».
(à publier sous forme de livre)
Témoignage passionnant et instructif. Vincent est vraiment un homme extraordinaire de courage et de bienveillance, un exemple à suivre.
Je ne connais pas vraiment ce qu’est le revisionnisme. Ce n’est pas ma culture, je suis francaise mais d’origine etrangère, un peu foncée de peau. Je connais vaguement ce monsieur par les videos de Jerome Bourbon qui me fait beaucoup rire. J’ai vu sa derniere video en presence de ce monsieur et j’ai googlisé…je suis arrivee là et ai lu cette epopee passionnante. Hallucinant ce que ce pays devient. Depuis le covid c’est comme si tout s’etait eclairci mais le terrain etait déjà favorable. Mais on est souvent seul avec ses idees et il faut du courage et de la force pour les assumer. En cela ce récit est absolument remarquable… J’essaierai de prendre le temps un jour de me pencher sur ce sujet historique dont l’exploitation outranciere me pose question depuis toujours… mais il est tellement plus confortable de ne rien savoir.