Recomposition du monde ? (II)
Par André Gandillon
Suite de l’analyse d’André Gandillon (Partie I) au sujet des mesures douanières décidées par Trump début avril qui ont semé l’émoi et de leurs conséquences à travers le monde.
Une évolution en défaveur de l’Occident
Pour relever le défi, réel, qui se pose afin de permettre seulement aux peuples du monde occidental de ne pas se retrouver marginalisés, tout simplement, il faut un redressement spirituel, moral, et le rétablissement d’une rigueur dans l’éducation des jeunes générations et dans leur formation. Cela prend du temps et, dans le meilleur des cas, il faut compter de quinze à vingt ans pour obtenir des résultats tangibles et de nouveau commencer à rayonner. En Europe et singulièrement en France, cela passe par une Révolution nationale.
Trump et son équipe ont semble-t-il conscience du problème. Pour parer au plus pressé, ils n’ont d’autre expédient que de vouloir attirer sur le sol états-unien des entreprises installées présentement dans d’autres Etats et d‘importer des ingénieurs. D’ailleurs, actuellement, les fleurons en la matière sont des ingénieurs et des étudiants taïwanais et indiens venus dans les universités des Etats-Unis pour se former. Cette réalité ne manque pas d’ailleurs de poser problème car, dans l’industrie militaire, où nombre de postes sont réservés (à bon droit) aux seuls nationaux états-uniens, l’impossibilité de les embaucher pose de graves difficultés. L’idée de Trump est de tordre le bras aux peuples de la planète pour qu’ils viennent avec leurs usines et leurs ingénieurs s’installer aux Etats-Unis.

Notons toutefois que l’équipe Biden avait aussi compris quelles sont les faiblesses états-uniennes en la matière car elle avait mis en place un « aspirateur » à investissements étrangers avec l’IRA (Inflation Reduction Act), – l’Allemagne, pénalisée par des coûts élevés de l’énergie dont elle s’est suicidairement privée en coupant les liens avec le gaz russe, et contrainte de délocaliser outre-Atlantique en est un exemple. Nous avons là une manifestation supplémentaire de la continuité qui existe dans les politiques des Etats sur le long terme au-delà des changements de gouvernements et qui met en évidence un aspect de ce que l’on appelle « l’Etat profond ».
Cela précisé, si cette façon de faire apportera inévitablement quelques fruits plus ou moins juteux, seront-ils suffisants pour produire les effets bénéfiques escomptés ? Rien n’est moins sûr. Car la Chine est devenue elle-aussi suffisamment attractive pour attirer à elle entreprises et professionnels de qualité, tandis que les jeunes scientifiques chinois, restent au pays. Est symptomatique de cette tendance le fait que le système d’intelligence artificielle DeepSeek, avec ses performances élevées pour un coût bien moindre que celui des systèmes américains, qui se pose en concurrent sérieux des géants américains du numérique, a été conçu par des ingénieurs chinois qui ne sont jamais allés aux Etats-Unis.
Déjà, en 2022, la Chine représentait à elle seule 46,8 % des dépôts de brevets au monde (avec plus d’1,6 millions de dépôts) et 48,3 % de l’activité mondiale de dépôts de marques (avec plus de 7,5 millions de dépôts). Depuis lors, le phénomène s’est accéléré.
La Russie forme 450 000 ingénieurs par an, nombre en augmentation, c’est-à-dire plus que les pays de l’UE et les Etats-Unis réunis, ces derniers en formant 250 000, un nombre qui stagne, la France 37 000. La Chine, pour sa part forme 1,3 million d’ingénieurs par an, l’Inde 1,5 million.
En pourcentage de la population totale nous avons le palmarès suivant : Russie 0.31 % d’ingénieurs en 2022, Chine, 0.032%, Etats-Unis, 0.07% France, 0.17%. Il sera toujours possible de discuter de ce que l’on entend par ingénieur, mais force est d’observer que les pays du « Sud global » accélèrent leurs formations de scientifiques alors que dans le monde occidental, cela stagne. Quant à la France, on forme plus de sociologues que de scientifiques dans les sciences dites « dures »…
Au rythme actuel, les pays de la mouvance des BRICS sont en train de prendre de l’avance sur les pays occidentaux et les Etats-Unis. Un exemple parmi tant d’autres, le 15 avril, le PDG d’Apple a reconnu la supériorité technologique de la Chine sur les États-Unis. Tim Cook affirme que le fait de délocaliser la production en Chine n’est plus une question de faibles coûts de main-d’œuvre. Le facteur principal est le niveau élevé de formation et le grand nombre d’ingénieurs qualifiés avec lesquels les États-Unis ne peuvent pas rivaliser. Cook a noté que la Chine a déjà dépassé l’Amérique en termes de technologie, ce qui explique pourquoi Apple continue de s’appuyer sur l’industrie chinoise.
Dans le domaine des microprocesseurs, dans lequel les occidentaux ont été jusqu’ici les maîtres incontestés, la donne est en train de changer. La Chine, qui voici encore cinq ans ne pouvait produire que des puces de 14 nanomètres (nm) alors que les Etats-Unis en étaient à 5nm, en arrivent maintenant aussi à 5nm et vont se rapprocher des producteurs occidentaux qui tendent vers les 3nm. Par ailleurs, les Russes viennent de mettre au point leur propre machine de gravure des puces électroniques en créant une machine de lithographie à ultraviolets (EUV), menaçant le monopole de la société néerlandaise ASML en ce domaine. Ce ne sont là que quelques exemples parmi d’autres… La Chine, par ailleurs semble être en train de mettre au point des réacteurs nucléaires combinant fusion et fission, représentant une avancée technologique importante.
Tous ces exemples ont été cités pour faire prendre conscience que les Etats-Unis ne sont plus en mesure de dicter leur volonté au monde. Et surtout pas avec un « big stick ».
Présentement, sûre d’elle-même, la Chine fait plus que tenir tête aux Américains : elle prend des dispositions qui aboutissent à couper les ponts avec ces derniers. Elle gèle tous ses investissements sur le sol américain. Elle décide de se passer des microprocesseurs produits en occident, sachant qu’elle va être bientôt en mesure, de toute manière, de s’en passer. Elle a suspendu ses ventes de terres rares aux Etats-Unis qui en ont impérativement besoin.
Sachons que ces dernières années, la Chine s’est progressivement désengagée à l’égard des Etats occidentaux et s’est réorientée vers l’Asie du Sud-Est et ses voisins. Elle a réduit ses investissements vers les Etats-Unis de 85 % depuis 2022. Avec l’Inde, une synergie est en train de se mettre en place, celle-ci étant en train de prendre le relais de la Chine dans les productions de moyennes technologies, la Russie s’insérant avec succès dans le jeu. Le commerce chinois avec les Etats-Unis ne représente que 2 % du PIB chinois.

Les Etats-Unis ne pourront concurrencer véritablement la Chine et des pays émergents de même nature, non pas en pratiquant le mercantilisme mais en proposant des produits de qualité équivalente ou supérieure. Or présentement, la Chine dispose d’avantages sérieux par rapport aux Etats-Unis. Elle dispose de tous les éléments de la chaîne de production, depuis les matières premières jusqu’au produit final, ce qui n’est pas le cas des Etats-Unis qui doivent importer soit des matières premières, soit des biens intermédiaires.
En ce qui concerne la crise des droits de douane, nous n’en sommes qu’aux premiers développements. Il est inévitable que d’ici quelques semaines, quelques mois, des discussions s’engagent entre les Etats-Unis et les autres Etats du monde pour tenter de rétablir des relations commerciales mutuellement bénéfiques. Trump paraît être assez pragmatique, en dépit de ses foucades bientôt légendaires, pour tenir compte des réalités, quitte à faire un pas en avant et deux en arrière. Outre le fait qu’il a réduit – sauf pour la Chine – les droits de douane à 10 % après les avoir porté à 30 % en moyenne montre ce pragmatisme… de même que l’exemption de droits de douane sur les Smartphones, ce qui se comprend car, dépendant essentiellement de la Chine, les Etats-Unis pourraient s’en trouver privés dramatiquement, comme un assoiffé qui voit la source d’eau se tarir. Encore faut-il que la Chine accepte de leur en vendre !
Méthode chinoise et méthode yankee
Sur le long terme, la Chine n’est pas à l’abri de problèmes graves, récurrents dans son histoire. Mais pour le moment, elle est en phase ascendante et il est nécessaire de composer avec elle et non pas de l’affronter.
Nous avons, à propos de la prudence, mentionné l’hubris des Occidentaux, et les Etats-Unis au premier rang souffrent de ce vice. A la différence de la Chine qui avance ses pions avec un certain tact – la philosophie du « Tianxia » – les Etats-Unis en sont restés à la pratique de Théodore Roosevelt, celle du « Big Stick », du gros bâton.
La Chine étend son influence, propose des prêts avantageux dans le monde sous l’apparence d’un développement mutuellement bénéfique, alors que les Etats-Unis continuent d’utiliser la menace et la contrainte. La question de l’extraterritorialité du dollar est emblématique de cette pratique qui rebute même leurs alliés historiques. Le Canada a pris des mesures de rétorsion contre les droits de douane imposés par Trump et l’Australie se prépare à exporter son fer et son aluminium vers l’Asie et non plus vers l’Amérique… Mais tout cela n’est que péripéties sur un processus à long terme.
Une situation irréversible s’est créée et est illustrée par le fait que le PIB des BRICS a dépassé en parité de pouvoir d’achat (PPA) celui des Etats du G7. Pour échapper à l’impérialisme du dollar instrumentalisé politiquement de manière agressive, les BRICS s’activent à préparer la mise en place de leur système monétaire. Les discussions portent maintenant sur la question de quitter le réseau Swift qui est un outil de dépendance au profit des, Etats-Unis. Déjà la Russie, par nécessité, a lancé une alternative. Certes, le dollar en tant que monnaie internationale ne va pas disparaître rapidement. Mais un processus est enclenché et Washington ne tirera son épingle du jeu qu’en s’insérant dans le processus en cours en non pas en voulant le bloquer, par tout moyen si nécessaire.
Les tarifs douaniers présentés par Trump sont censés être une démonstration de force : notre marché est le plus grand du monde et si vous voulez continuer à exister, vous avez intérêt à nous vendre ce que vous produisez ou bien à venir vous installer chez nous. Mais voilà, les pays émergents et émergés comme la Chine vont aller ailleurs. D’autres marchés s’ouvrent à travers le monde à travers le système relationnel des BRICS, principalement. L’utilisation intensive du « hard power », autrement dit de la loi du plus fort, peut avoir un intérêt sur le court terme mais pousse à long terme les autres nations à s’y soustraire et présentement à quitter les réseaux américains.
La Chine procède avec onctuosité par la pratique des aides mutuelles. La chine construit des routes, des hôpitaux en échange d’accès à des intérêts stratégiques ; main généreuse en apparence, là où l’Occident a délaissé les lieux ou bien se montre arrogant ; la Chine s’implante certes à son avantage, mais ces pays en développement n’ont pas d’autre alternative. Citons quelques exemples. Le Pakistan sert au transit des produits chinois mais dispose maintenant du port de Gwadar sur l’Océan indien. Le Kenya bénéficie de la ligne Nairobi-Mombasa, le Laos de la LGV Yunnan Vientiane ; l’Ethiopie de la ligne Djibouti-Addis Abeba. Même la Serbie et la Hongrie, les mal-aimés des Occidentaux parce qu’ils ne se soumettent pas à leurs volontés, ont pu, grâce à la Chine, construire la ligne Belgrade-Budapest ; le Sri Lanka dispose du port de Hambantota, financé à hauteur de 85 % par la banque d’exportation et d’importation de Chine.
La reculade douanière de Trump
Venons-en maintenant à un événement, ponctuel récent : pour quelle raison Trump a-t-il reculé sur son coup de massue douanier ?
La question n’est pas anodine car, si elle s’explique de manière technique, elle ne laisse pas de poser d’autres questions à caractère politique.
Que les marchés boursiers aient connu un effondrement à la suite des annonces tarifaires de Trump, cela était prévisible, attendu même. Et, pour certains, comme en pareil cas, l’occasion de faire de bonnes affaires (ce dont certains commentateurs ont accusé Trump d’en avoir bénéficié, a tort ou à raison). Mais ce qui semble-t-il ne l’était pas, c’est le fait que le rendement des bons du Trésor états-unien à 10 ans soit passé de 3,9 % à 4,39 en quelques jours. En pratique, d’expérience, lorsque le marché des actions chute, par vente de celles-ci, les opérateurs se réfugient sur le marché des obligations d’Etat, dont la valeur augmente mais dont les rendements diminuent. Cette fois-ci, il n’en a rien été. Et cela a été l’élément déterminant qui a poussé Trump à reculer sur les tarifs douaniers.
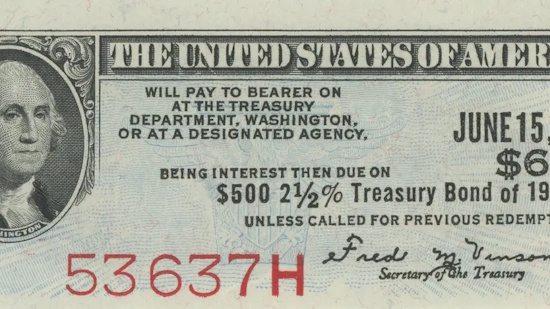
Pourquoi ? Un peu de théorie, tout d’abord. L’Etat a besoin d’argent ; il émet donc des titres d’Etat, autrement dit des obligations ; une obligation a trois éléments clés : sa valeur faciale, mettons 100 $ ; sa durée, 10 ans par exemple ; enfin son taux ici fixé à 5% ; cela signifie que le possesseur d’un bon touchera 5% pendant 10 ans et récupérera son capital à échéance.
Mais si au bout d’un an par exemple, il doit s’en libérer pour quelque raison, il doit la céder sur le marché secondaire. C’est alors que les choses deviennent sérieuses ; imaginons que de nouvelles obligations soient émises à 6 % : celles émises à 5 % deviennent moins attractives. Pour compenser cela, il faudra baisser leur prix de vente, par exemple à 83 $ et l’acheteur potentiel bénéficiera bien d’un rendement à 6 % ; il y a donc une relation inverse entre le prix des obligations et leur rendement.
Si les investisseurs vendent massivement leurs obligations, les prix baissent et les rendements montent ; et cette tendance persistante inquiète car elle signifie que les gens boudent les bons américains, dans le cas présent. Pour une économie aussi dépendante de la dette, c’est un signal d’alerte qui annonce une récession.
Mais ce n’est pas tout ; 25 % de la dette états-unienne arrivent à échéance en juillet prochain et si les rendements demeurent élevés à ce moment, refinancer la dette coûtera beaucoup plus cher à l’Etat. Et il semble que Trump voulait, à travers la baisse des bourses, pousser la Fed (Réserve fédérale) à baisser ses taux car souvent, lorsqu’elle baisse ses taux, ceux des bons baissent aussi ; donc Trump voudrait obliger la Fed à agir avant juin en ce sens, ce qui aurait fait emprunter à moindre coût pour un nouveau financement de la dette.
Or les choses ne se sont pas déroulées selon ce scénario. Certes, lorsque Trump a imposé ses tarifs douaniers (lesquels apparaissent erratiques, comme le montre la taxation de territoires inhabités, telles les îles Heard et McDonald, sauf par des phoques et des pingouins…), la bourse s’est effondrée ; mais là où il y a eu une surprise, c’est que là où normalement la baisse des actions entraine une ruée vers les obligations ce qui fait baisser leur rendement, on a assisté à une hausse des rendements.
Alors une autre hypothèse a été avancée : la Chine a-t-elle poussé à la crise ? Elle détient 100 milliards $ de bons sur un total de 800 milliards $ de bons existant. Elle en aurait vendu la moitié pour faire échec à la stratégie de Trump ; Pékin aurait eu intérêt à maintenir des taux obligataires élevés jusqu‘à fin mai. Or cette thèse ne résiste pas à l’analyse car dans le même temps, vendant ses obligations, la Chine devrait réinvestir cet argent ailleurs, ce qui aurait pour effet de soutenir sa propre monnaie ce qui n’est pas le cas. En outre, rien ne prouve que la Chine vende ses bons et, si elle le faisait, elle affaiblirait sa position en renforçant artificiellement sa devise. Par ailleurs, la Chine ne détient que 2 à 3 % de la dette américaine ce qui est marginal.
Mais alors, qui détient cette dette ? Les fonds spéculatifs américains. Or, ils sont très souvent exposés aux marchés financiers et utilisent un levier énorme pour maximiser leurs gains. Aussi, lorsque les marchés boursiers baissent, ils sont obligés de liquider rapidement des actifs qui sont vendus pour récupérer de l’argent liquide, du cash. C’est très probablement ce qui s’est passé et c’est ce qui alimente la hausse des taux obligataires. Cependant, ces fonds spéculatifs, ces « hedge funds », sont détenus par les puissances financières qui tiennent et dirigent la finance mondiale. Dès lors, étant donné que la politique de Trump contrarie leurs intérêts – Larry Fink, le patron de Blackrock a été très dur envers la politique du président américain -, nous devons poser cette question : n’y a-t-il pas eu quelque décision venant de cercles fermés visant à entrainer une hausse du rendement des bons du Trésor états-unien afin de donner un coup de semonce à Trump, voire de le contraindre à résipiscence ?
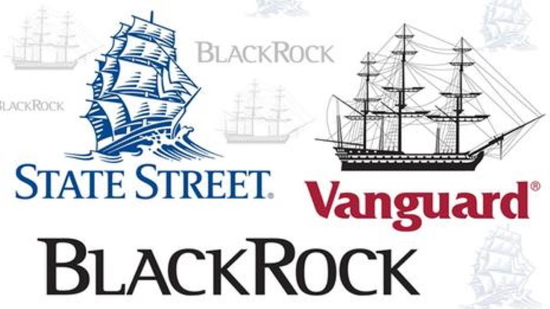
Arrêtons ici pour le moment. Des remous, voire des ouragans certains mais imprévisibles par leur ampleur et leur chemins nous attendent. Cela, d’autant plus que des questions de politique internationale, de géopolitique interfèrent. La question sioniste n’est pas des moindres. Celle de l’Ukraine en est une autre, proche de nous. Pour cette dernière, il semble s’agir plus d’une guerre comparable à celle de Trente ans qui a ensanglanté l’Europe au XVIIe siècle qu’à une guerre de 14-18. Contrairement à l’opinion répandue, il n’est pas souhaitable de voir se conclure un cessez-le feu débouchant sur une situation pourrie et purulente. La plaie doit être curée au fond et la Russie, qui détient toutes les cartes, ne doit pas faiblir, en souhaitant que ses dirigeants seront assez sages, « prudents », pour imposer une paix durable, comme les traités de Westphalie et le Congrès de Vienne ont su la faire chacun en leur temps. Mais c’est une autre histoire que nous n’aborderons pas ici.
Sachons seulement que si l’U.E. et les Macron, Starmer, Merz et autres Leyen, Kalas et consort persistent à vouloir utiliser la chair à canon ukrainienne pour « vaincre la Russie, » c’est cette U.E. qui disparaitra et c’est peut-être la seule bonne nouvelle de cette tragédie européenne et humaine.
Nous autres nationalises français, comme tous nos camarades nationalistes dignes ce nom chez nos voisins, savons que le redressement sera long et que, malheureusement, mais inévitablement, le salut de nos nations passera par l’effondrement de l’oligarchie anti européenne et anti chrétienne.
Le redressement se fera non pas par des déclarations tonitruantes, des coups de menton, mais en serrant les dents, en retroussant les manches, en se ressourçant dans nos traditions millénaires. Des mesures de protection économique seront indispensables, mais elles ne devront être que des mesures techniques de protection de nos outils de production, de reconstruction de ceux-ci, et non pas considérées comme un outil politique. Et le problème présent et de former les élites nationalistes de demain.


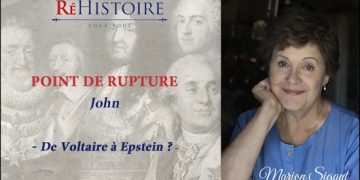



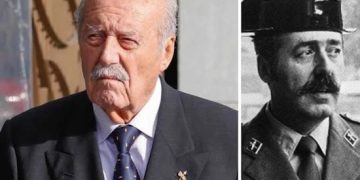





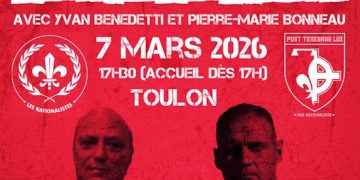



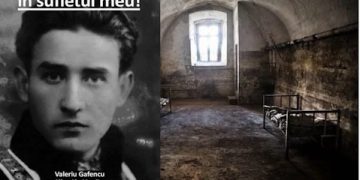



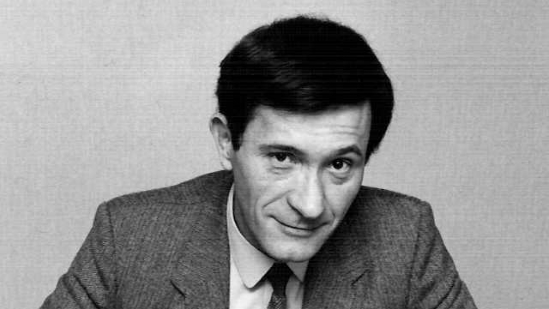
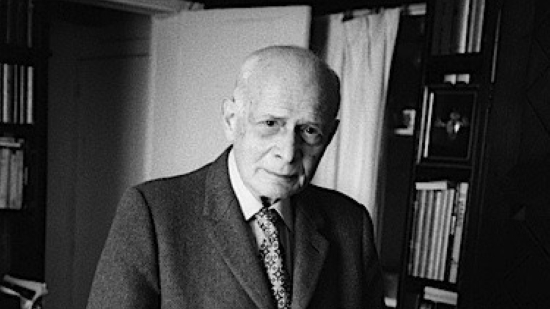







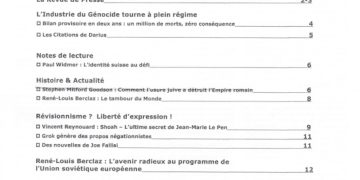
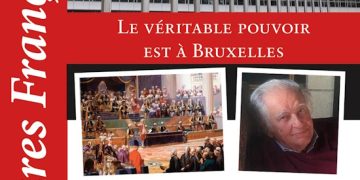
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV

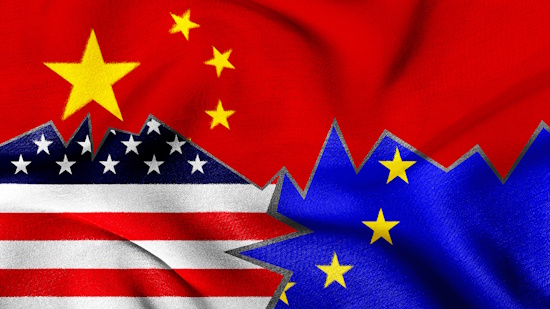




YEMEN / La résistance houthie frappe l’entité maudite ;
https://ssofidelis.substack.com/p/le-yemen-lance-pour-la-premiere-fois?img=https%3A%2F%2Fsubstack-post-media.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2Fd05b6b47-968e-40c3-92b8-51a1143dac8f_1092x1012.heic&open=false
ILLUMINATI / Les banksters du clan Rothschild dirigeants occultes de la Mafia khazare contrôlent trois mini états, outils pratiques de leur domination satanique sur le monde goy ! Ce sont « Washington D.C », « The City of London » et « »l’État du Vatican ; accessoirement ils font la loi à Monaco une Principauté franc-maçonne dirigé par un gouvernement corrompu et mafieux !!