La perversion des masses par la propagande « antiraciste » au cinéma
Nous reproduisons l’article datant de fin 2006 d’Hervé Ryssen qui n’est représentatif que d’une infime fraction du travail considérable que l’auteur a consacré, depuis des années, à révéler la perversion des esprits et des masses, par le biais de la propagande « antiraciste » dans la production cinématographique : la liste de ces films a été régulièrement mise à jour dans ses livres (12 livres, de 2005 à 2018), qui comportent tous au moins un chapitre sur la propagande au cinéma.
On a coutume de dire qu’en démocratie, les médiats constituent le « quatrième pouvoir », après le pouvoir exécutif (le gouvernement), le législatif (l’Assemblée) et le judiciaire. L’importance qu’a prise la télévision dans notre univers quotidien vient sans doute démentir aujourd’hui l’ordre bien établi des juristes et des politologues. La vérité est que les médiats, et notamment la télévision, occupent une place essentielle dans le formatage des esprits et la formation des opinions de nos contemporains. Point n’est besoin de s’appesantir sur ce sujet. Et sur le petit écran, le cinéma est encore le support le plus populaire pour faire passer un message dans les masses, invitées de préférence à regarder les « coups de cœur » des programmes-télés, qui vont invariablement au film le plus chargé d’humanisme et d’idéologie.
Le métissage
Le cinéma planétarien célèbre les vertus de la démocratie multiculturelle et du métissage : il s’agit, sous une forme ou sous une autre, d’amener le spectateur à concevoir un monde sans frontière et de lui inculquer la tolérance envers l’ « autre ». Dès les années 50, un cinéaste cosmopolite entendait sensibiliser le public au racisme de la société américaine. La porte s’ouvre (USA, 1950) raconte l’histoire survenue au Dr Brooks, un interne noir dans un hôpital. Il accueille un jour deux truands, Ray et John Biddle, blessés au cours d’un hold-up. John meurt, et Ray accuse le Dr Brooks de l’avoir tué… « Plaidoyer antiraciste qui suscita quelques remous à l’époque », nous apprend le Guide des films de l’historien Jean Tulard (2002). Le film est de Joseph Mankiewicz.
Les premiers films mettant en scène des couples mixtes sont pourtant si surprenants qu’il a fallu traiter le sujet à part entière. En 1967, le réalisateur américain Stanley Kramer a été l’un des premiers à faire l’apologie du métissage aux Etats-Unis, à travers le film Devine qui vient dîner ce soir. Kramer imagine une jeune beauté présentant son mari à ses parents. Vous l’avez deviné, celui-ci est un noir, sympathique, cultivé, intelligent, et dont le naturel désarmant et la gentillesse viennent à bout de la méfiance instinctive et vicieuse des bourgeois blancs américains. Le film remporta évidemment dix nominations aux Oscars. Il semblerait que la production se soit tarie dans les années qui suivirent, mais il serait nécessaire de pousser les recherches plus avant pour s’en assurer.
Police frontière (USA, 1982) est l’histoire d’un officier de l’immigration américaine, qui surveille les clandestins du côté d’El Paso. Il est un jour confronté à une situation cornélienne quand le bébé d’une jeune Mexicaine est kidnappé pour être vendu à un couple stérile. On imagine que le film de Tony Richardson entend nous apprendre la fraternité universelle.
L’idéal planétarien se manifeste avec beaucoup de succès dans le cinéma de science-fiction. Steven Spielberg, dans E.T, l’extraterrestre (1982), nous apprend à accueillir l’autre, l’étranger, ce qui est une très bonne chose dans l’absolu. Star Trek, ce feuilleton-culte où toutes les minorités ethniques sont représentées, est évidemment tout imprégné d’esprit planétarien. Quelques détails permettent aux initiés de se repérer dans les principes de la société Vulcain. Les scénaristes du feuilleton télévisé sont Leonard Nimoy et William Shatner. Les méchants sont curieusement représentés sous les traits d’hommes blancs, tandis que les gentils forment une humanité multi-ethnique.
Il est certain, en tout cas, que ce type de message de sensibilisation a connu un regain d’intérêt dans les années 1990. Dans Love Field (USA, 1993), Michelle Pfeiffer joue le rôle d’une belle blonde qui adore les Noirs. Nous sommes en 1963, aux États-Unis, et le président Kennedy vient d’être assassiné. Bouleversée, Lurene décide d’aller aux obsèques à Washington, malgré l’opposition de son mari, qui joue le rôle du crétin de service. Dans le car, elle fait connaissance avec un Noir et sa petite fille. Mais celui-ci reste froid et distant. Le comportement de cet « homme de couleur » lui semble louche, et l’enfant paraît avoir été kidnappé. A une halte, elle décide alors d’appeler la police, juste avant de se rendre compte de son erreur : cet enfant est bien sa fille, et si l’homme l’a enlevée, ce n’était que pour la libérer d’un horrible orphelinat après la mort de sa mère. S’étant amourachée de la petite, la belle blonde décide de ne pas les abandonner, et fuit avec eux. La police est maintenant à leurs trousses, convaincue que ce « nègre » a kidnappé à la fois un enfant et une jeune femme blonde qui s’apprêtait à le dénoncer. La scène de violence raciste a un peu tardé, mais elle est finalement arrivée, comme prévue : tandis que la voiture volée est tombée en panne, notre Noir se fait copieusement tabasser par trois sales cons de Blancs sur une route de campagne. La belle blonde va alors le soigner dans une grange, et lui offrir son corps. A partir de là, les jeux sont faits. A un motel où l’attend son mari, jaloux et fou de rage, la bagarre éclate entre les deux hommes. Le Noir, bon et débonnaire, aura évidemment le dessus sur le Blanc, coincé, mesquin et « frileux », comme dirait Alain Minc. La fuite en avant ne durera pas éternellement, on pense bien, mais tout rentrera dans l’ordre, après les arrestations. La jolie blonde va divorcer, et se mettre en ménage avec le Noir. Ce très beau film est signé Jonathan Kaplan. Ce réalisateur, qui avait hésité entre la carrière de cinéaste et celle de rabbin, signe ici un chef-d’œuvre antiraciste.
La mixité ethnique a été banalisée dans les années 90, et utilisée le plus souvent comme aspect secondaire du film, auquel le public n’est pas censé prêter attention. Les films de Quentin Tarantino, par exemple, œuvrent dans ce sens : dans Pulp Fiction (USA, 1993), on assiste aux délires meurtriers d’un duo de choc, un Blanc et un Noir. Le chef du gang est un Noir ; sa femme est une blanche complètement shootée. Dans Jackie Brown (1997), le principal personnage est un Noir, trafiquant d’armes, dont la femme est une petite blonde, là encore complètement camée. Dans Reservoir Dogs (1992), les personnages sont des chiens enragés qui s’entre-dévorent dans un impressionnant carnage. Ils sont tous blancs, et plus ou moins tarés.
En 1995, dans Liaison interdite, Paul Seed met en scène un soldat noir américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Celui-ci souffre du mépris de ses compagnons d’armes : ce sont des Blancs arrogants, méchants et racistes. Avec un ami, il est affecté aux cuisines du mess des officiers, où il rencontre Esther, une mère de famille dont le mari est parti au front. Très vite, ils se sentent attirés l’un par l’autre. Mais leur relation est mal vue : elle est anglaise et blanche, et il est américain et noir.
Independance day, de Roland Emerich (USA, 1995) a fait sourire : une immense soucoupe volante envahit le ciel, libérant un nombre infini de petites soucoupes qui prennent position au-dessus des plus grandes villes du monde. Un informaticien new yorkais décrypte les signaux émanant des étranges voyageurs. Ils ne sont pas du tout amicaux, et ils se préparent à attaquer la terre. Les deux héros qui vont sauver la planète sont un Noir, et un Juif hassidique. Ce n’est plus la peine de se cacher puisque le public ne voit rien !
Men in black (USA, 1997) est un film qui nous apprend à accueillir l’étranger, tous les étrangers, et mêmes les extra-terrestres. Nous ne le savons pas, mais ils sont déjà nombreux à vivre parmi nous et à avoir pris une forme humaine. Les membres d’une agence spéciale ultra-secrète sont ainsi chargés de veiller à la régulation de ces flux migratoires d’un nouveau genre et de garder secret l’existence de ces extra-terrestres afin de ne pas alarmer la population. Nos deux super-agents spéciaux ─ un Noir et un Blanc ─ sont ici amenés à traquer un Alien hostile, qui ne résistera pas à l’efficacité de ce tandem de choc. Bien que les deux soient aussi compétents l’un que l’autre, le Blanc est tout de même un peu fatigué. C’est donc le Noir qui va continuer la lutte et profiter des faveurs de sa nouvelle co-équipière ─ blanche. Le film a été réalisé par Barry Sonnenfeld, sur un scénario de Ed Solomon et une musique de Danny Elfmann. Il a en outre été produit par Steven Spielberg. Tous sont des extra-terrestres déguisés en êtres humains et des agents de la « Matrice ».
« Du passé faisons table rase ». A défaut de tirer un trait sur l’histoire d’avant 1789, on pourra la traficoter un peu, tout doucement, afin d’accoutumer le public a accepter l’univers cosmopolite et pluriel de la société de demain. Il en est ainsi pour Les Mystères de l’Ouest (Wild wild West, USA, 1999) : En 1869 aux Etats-Unis, des savants de renom ont mystérieusement disparus. Le président Grant demande alors aux agents West et Gordon de résoudre cette énigme. Un divertissement invraisemblable, dans lequel le réalisateur Barry Sonnenfeld a eu la bonne idée de prendre un acteur noir pour héros (Will Smith).
Le cinéma « anglais » connaît aussi cette tendance multiculturelle. Dans Dirty Pretty things (Grande-Bretagne, 2002), Stephen Frears raconte l’histoire de Okwe, un Nigérian clandestin, chauffeur de taxi le jour et veilleur de nuit dans un hôtel. Celui-ci découvre un trafic d’organes humains qui se déroule dans l’hôtel, mais aussi l’amour d’une jolie jeune femme blanche qui va lui faire aimer la vie en Angleterre.
Dans Les larmes du soleil (USA, 2003), le réalisateur noir Antoine Fugua dépeint une guerre civile entre tribus noires en Afrique. Une unité de l’US Army est chargée de récupérer une jeune Américaine dirigeant un centre de soins hospitaliers. Celle-ci, on s’en doute, est pétrie de principes humanitaires ; à tel point qu’elle refuse de suivre Bruce Willis et son commando de choc, si les blessés africains ne sont pas emmenés eux aussi. Bruce Willis va donc désobéir aux ordres, et ira jusqu’à faire massacrer la moitié de son unité pour sauver les Africains sous son autorité. Un dialogue du film fait comprendre au spectateur que si les Américains agissent ainsi, c’est pour « se racheter » de tous les crimes de l’homme blanc commis dans l’histoire. Mais c’est oublier un peu trop facilement qu’une bonne partie des Noirs vendus à l’époque de l’esclavage l’avaient été par d’autres Noirs, qui n’avaient cure de vendre leurs frères de race à des Blancs. Et si le réalisateur Antoine Fuga avait rappelé le rôle accablant des commerçants juifs dans la traite des Noirs, sans même parler des esclavagistes musulmans, dont le commerce dans l’Océan indien a duré quatorze siècles, il n’aurait de toute manière jamais pu produire son film.
Voici un film catastrophe : Le jour d’après (USA, 2004). Après les volcans, les tornades et les météores, le réchauffement de la planète provoque un raz-de-marée suivi d’une vague de froid. Le film est plat et ennuyeux, mais la fin est révélatrice de l’état d’esprit du réalisateur. En effet, les peuples du Nord sont obligés d’émigrer vers le sud. Le président américain déclare alors : « Les Américains, mais aussi de nombreux peuples sont aujourd’hui les hôtes de ce que l’on appelait autrefois le Tiers-Monde, nous étions dans le besoin et ils nous ont laissé entrer chez eux, ils nous ont accueillis ; je leur exprime toute ma gratitude pour leur hospitalité. » Le message du réalisateur Roland Emmerich est donc clair : il faut que nous laissions entrer tous les immigrés chez nous, car il est possible que demain, dans un avenir… disons incertain, nous ayons besoin d’eux nous aussi. Rappelons que Roland Emmerich est aussi le réalisateur d’Independance Day, le film dans lequel la Terre est sauvée de la catastrophe par un Noir et un juif hassidique. Sacré Roland !
La production française dans ce domaine est exemplaire : Dès 1988, dans Romuald et Juliette (1988), Coline Serreau nous montre une histoire d’amour interraciale. Romuald (Daniel A.) est le jeune PDG d’une importante entreprise, qui tombe amoureux de la femme de ménage, une antillaise mère de cinq enfants. Le scénario n’est évidemment pas très crédible, mais il reflète bien la volonté d’inculquer la « tolérance » et l’ouverture à l’autre.
Dans Itinéraire d’un enfant gâté (France, 1988), Claude Lelouch raconte l’histoire d’un homme (J.-P.Belmondo) qui a soudainement abandonné sa famille pour aller vivre en Afrique. Il réapparaît, deux années plus tard, pour reprendre ses affaires. Ici encore, on se rend compte que le mariage des Blanches avec des Noirs et des Sémites est une véritable obsession chez les réalisateurs juifs.
Dans L’Union sacrée (France, 1989), deux flics sont obligés de faire équipe dans une enquête sur un réseau islamiste, qui se finance par toutes sortes de trafics. Le Juif Simon Atlan (Patrick Bruel) et l’Arabe Karim Hamida (Richard Berry) se détestent cordialement. Et pourtant, face à l’intolérance et au fanatisme des méchants islamistes, ils vont peu à peu se lier d’amitié. Dans ce film, le Juif est un peu fou et sympathique, tandis que le flic arabe est sérieux et efficace.
Le commissaire, joué par Bruno Kremer, parle à ses hommes dans un langage direct : « Vous devez vous comporter comme des croisés, chargés de défendre le monde occidental ! Avec ces salauds-là, tous les coups sont permis ! » Il faut comprendre ici que, contre les méchants islamistes qui menacent notre belle démocratie multiculturelle, ce sont les Français de souche qui doivent une fois encore aller au casse-pipe. Les islamistes sont évidemment dépeints comme des bêtes féroces. Ecoutons l’un de ces dangereux tarés, dont le réalisateur a surpris la conversation à la terrasse d’un café : « On va transformer la vie de ce pays en cauchemar. Aujourd’hui on tape ici, demain là-bas. Il n’y a pas d’innocents qui comptent. »
Simon est séparé de Lisa, son épouse. C’est une goy, une petite française bien mignonne qui adore les juifs, mais qui n’a pu supporter la vie avec Simon, trop gosse dans sa tête. Lisa ne le supporte plus ; en plus, comme elle l’explique à Karim, sa belle-mère a fait circoncire son fils alors qu’elle-même n’a jamais imposé le baptême à l’église. Lisa s’occupe de vernissages et d’expositions dans une galerie d’art. Quand un attaché d’ambassade, un certain Rafjani se présente dans l’exposition de tapis qu’elle a organisée, elle n’hésite pas à le sermonner sur le droit des femmes dans son pays. Elles sont comme ça, les Françaises : moralisatrices, donneuses de leçon, et surtout, ouvertes à tous les vents de l’Orient. C’est comme ça qu’on les aime ! Et Lisa, qui a quitté le juif, va en effet tomber sous le charme de Karim.
Mais il se trouve que ce Rafjani est aussi le chef du réseau islamiste ─ comme par hasard. Le quartier général de ce réseau mafieux a enfin été repéré par nos deux super-flics. C’est un pseudo centre culturel. Les islamistes, qui sont vraiment des gens très méchants, y torturent un pauvre kabyle en lui fourrant un entonnoir dans la bouche et en lui versant deux bouteilles de whisky dans le gosier. A l’intérieur, apprend-on, « c’est un véritable arsenal ; on se croirait à Beyrouth ». Se retrouvant face à Rafjani, notre flic Karim n’hésite pas à lui lancer au visage : « J’ai honte d’appartenir à la même race que toi ! » C’est comme ça qu’on les aime, les musulmans : divisés, pleins de rancœur et de honte, et prêts à s’entre-tuer ! Rafjani, qui doit être expulsé du territoire, est vraiment plein de haine : « Je me vengerai, dit-il, même si je dois mettre Paris à feu et à sang. Allah Akbar ! »
Autre scène : Lisa, notre petite Française bien mignonne, dîne au restaurant avec Karim. Simon, qui est toujours amoureux d’elle, arrive de manière impromptue : « Tu te tapes ma femme en cachette ! » Toujours impulsif, Simon décide de jouer la partie à la roulette russe : « Tu gagnes, tu gardes ma femme ». Très courageusement, il place le canon du revolver sur sa tempe et tire : clic. Karim refuse de jouer à ce jeu stupide et se lève. Le juif tire alors en l’air, et là, le coup part : « T’es mort, dégage ! ». Karim, ne partira pourtant pas la tête basse et, très dignement, giflera Simon avant de s’en aller. Et l’on note que, dans ce duel terrifiant pour la femme blanche, le juif et l’Arabe savent rivaliser avec panache.
Mais les méchants islamistes entendent bien liquider ces deux flics trop consciencieux. Ici a lieu une scène d’anthologie du cinéma français. Le restaurant kasher de la mère de Simon est mitraillé en plein jour, comme à Chicago ! Lisa, grièvement blessée, va mourir à l’hôpital. Au cours de la cérémonie funèbre qui a lieu à l’église, Simon, plein de haine et de vengeance, n’y tint plus et sort précipitamment. La cérémonie religieuse catholique est évidemment perturbée (c’est comme ça qu’on les aime !) et Simon s’enfuit. La scène qui suit nous montre Simon priant à la synagogue, avec la kippa et le châle de prière sur la tête. On entend aussi son père prier pour lui dans le restaurant : « Donne-lui la force, donne-lui la rage ! » Po po po !
Le diplomate islamiste est finalement expulsé sans que Simon ait pu assouvir sa vengeance. Devant les caméras de télévision, Rafjani tente encore de se faire passer pour une victime, se plaignant de la dureté de traitement que lui a réservé « la patrie de Voltaire et d’Anatole France, protectrice des opprimés » (ces islamistes sont d’une perfidie !). Fort heureusement, tout ne finit pas si bien pour ce salaud d’islamiste, puisque l’on voit sa voiture exploser dans la nuit, avec la Tour Eiffel illuminée en arrière plan. Le film se termine sur ces quelques lignes qui apparaissent à l’écran : « Simon et Karim ont sans doute rêvé cette vengeance. La loi du talion ne sera jamais une réponse à la violence. Cette histoire est une fiction. La réalité est toute aussi cruelle. » C’est beau, non ? Apparaissent alors les visages du juif et de l’Arabe regardant au loin comme les statues d’un couple de prolétaires soviétiques. Bref, c’est du grand cinéma. C’est signé Alexandre Arcady, qui ne s’est pas foutu de nous. Aïe aïe aïe !
En 1989, Gérard Oury nous propose Vanille-fraise : Deux agents secrets ont pour mission de faire sauter un navire chargé d’une cargaison de missiles. « Il est noir, expert en explosif (et vachement sympa), nom de code : Vanille. Elle est blanche, et nageuse de combat, nom de code : Fraise !
En 1993, Matthieu Kassovitz signe le film Métisse : Lola est une « sublime métisse antillaise » qui a deux amants. L’un est blanc, juif et rappeur, et l’autre est noir, fils de diplomate et étudiant en droit. Elle leur fixe un jour un rendez-vous commun pour leur apprendre qu’elle attend un bébé. Entre les deux hommes, c’est d’abord la guerre. Mais le racisme entre le Juif et le noir n’est pas bien méchant, et bientôt, ils vont faire une vie à trois : le Juif, le Noir musulman et la métisse chrétienne. « Une comédie tonique qui n’a pas peur ni du poids des traditions, ni du choc des cultures », selon un grand hebdomadaire « PC ».
Le film Un, deux, trois soleil, de Bertrand Blier (France, 1993) est un modèle du genre : C’est la vie ordinaire et sombre de Victorine (Annouk Grinberg, épouse du réalisateur), gosse de banlieue. Sa mère est folle, son père alcoolique, et son premier amour a été assassiné par un beauf. Elle calme sa violence, rencontre Maurice, qui lui fait deux enfants. Le flic blanc, un imbécile, est marié à une mama noire qui lui donne des petits métis. L’institutrice blanche ne rêve que de se faire culbuter par ses grands élèves blacks et beurs. Jean-Pierre Marielle laisse sa porte ouverte la nuit pour les petits voleurs noirs, et leur offre à dîner avec ces mots : « Tu es la chance de mon pays. Quand tu seras grand, épouse une Française, bien blanche. »
Trop de bonheur (France, 1994) montre la vie de quatre adolescents dans le midi de la France à l’approche de l’été : Valérie, Mathilde, Kamel et son copain Didier. Ils se réunissent pour une soirée avec quelques autres dans la villa de Mathilde en l’absence de ses parents. Kamel aime Valérie. Musique, danse, alcool, émois affectifs, trahison, violence. Lorsqu’ils se retrouvent quelques années plus tard, à peine se reconnaissent-ils. Kamel vit maintenant avec Mathilde. Ce film qui porte l’estampille cosmopolite est signé Cédric Kahn.
En 1997, le réalisateur Robert Guédiguian présente Marius et Jeannette : A Marseille, Jeannette vit seule avec ses deux enfants, qu’elle a eu de deux lits différents. La grande fille lui a été laissée par un salaud qui l’a quittée : un con de blanc. Quant au fils de 12 ans, c’est un petit métis d’Africain qui travaille très bien à l’école. Son père, qu’elle regrette, parce qu’il était adorable, est malheureusement mort sur un chantier. Jeannette rencontre Marius. C’est un grand gaillard taciturne qui est vigile dans une usine désaffectée. Tous les personnages du film sont des braves gens du petit peuple qui, pour certains, ne cachent pas leurs sympathies communistes. Le film a naturellement été récompensé par un César pour la meilleure actrice en 1998.
Bernard Stora est le réalisateur du film Un Dérangement considérable (1999) : « Depuis l’enfance, Laurent Mahaut consacre toute son énergie à la réalisation de son rêve : devenir footballeur. Embrasser la carrière professionnelle permettrait en effet à ce joueur surdoué de mettre sa mère, Rose, et ses deux demi-frères, Djamel et Nassim, à l’abri du besoin ».
C’est encore Bernard Stora qui signe le scénario du téléfilm Une autre vie (2004) : le jeune Malien Ismaël Traoré, est venu étudier la médecine à Marseille, au grand désespoir de son oncle qui a arrangé son mariage. A l’hôpital, il rencontre Marta, une jolie blanche, et délaisse sa jeune femme africaine. Chez Bernard Stora, l’apologie du métissage semble être une obsession : alors que dans le roman d’Emmanuel Roblès, le médecin est un Blanc, Stora l’a remplacé par un Noir, pour sensibiliser le public à cette question : un téléfilm qui trouve bien sa place dans « La semaine de l’intégration » sur FR3.
Dans La Tresse d’Aminata (1999), Dominique Baron met en scène une adolescente sénégalaise adoptée enfant par une famille bretonne.
Le Pacte des Loups (France, 2000), raconte l’histoire de la bête du Gévaudan : une bête mystérieuse sévit dans les montagnes du Gévaudan en 1766, et fait de nombreuses victimes, sans que quiconque parvienne à l’identifier et à la tuer. Les gens ont peur. C’est un monstre surgi de l’enfer ou une punition de Dieu, on ne sait pas trop. L’affaire prend rapidement une dimension nationale et porte atteinte à l’autorité du roi. Le chevalier Grégoire de Fronsac est alors envoyé dans la région pour tenter de mettre un terme au massacre. Il est accompagné de l’étrange et taciturne Mani, un Indien de la tribu des Mohawks. Il est ceinture noire de kung fu et met de sérieuses raclées aux paysans du coin, probablement très racistes : un film de Christophe Gans.
Dans La ville est tranquille (France, 2001), se croisent les destins de plusieurs personnages : Michèle, ouvrière à la criée aux poissons sur le port de Marseille, est mariée à un chômeur alcoolique. Une fois sa dure journée de travail achevée, elle doit encore s’occuper du bébé de sa fille toxicomane, une adolescente qui se prostitue pour payer ses doses d’héroïne. Viviane, bourgeoise d’âge mûr et professeur de chant, est dégoûtée par le cynisme de son époux. Elle tombe amoureuse d’un de ses anciens élèves, le jeune Abderamane… Le réalisateur est aussi celui de Marius et Jeannette, film dans lequel on retrouvait aussi cette obsession du métissage de la race blanche : il s’agit de Robert Guédiguian.
Fatou la malienne (France, 2001) a 18 ans. Elle est née en France de parents maliens, et vient d’avoir son bac. Elle travaille dans un salon de coiffure afro de Paris. Elle est jolie, gaie, pleine de vie et d’ambition. La famille malienne est parfaitement intégrée, comme on l’imagine. Le papa travaille comme épicier. L’appartement est très propre est très bien décoré. Les costumes africains de toutes les couleurs sont splendides : c’est comme au théâtre. Hélas, les parents de Fatou décident de la marier à son cousin qu’elle n’aime pas, et elle se retrouve littéralement séquestrée au sixième étage, à côté de l’appartement de ses parents, sans avoir aucune possibilité de fuir. Mais Fatou va s’en sortir grâce à sa copine Gaëlle, une jeune Française qui n’a pas froid aux yeux et qui s’éclate avec ses copains arabes. C’est comme cela qu’on les aime ! Gaëlle va donc délivrer sa copine Fatou et l’emmène chez elle en Bretagne, ouvrir un salon de coiffure. Ainsi, la Bretagne s’enrichira de nouveaux petits Bretons. Le film de Daniel Vigne, présenté par Fabienne Servan-Schreiber, a évidemment reçu un 7 d’or en 2001. « Une réussite » selon l’Express ; « remarquable » selon France Soir ; « bouleversant » selon Télé 7 Jours.
En 2003, le réalisateur Olivier Lang signe un épisode de la série Docteur Dassin, généraliste, intitulé Des secrets trop bien gardés : « Dassin est confronté à un couple peu ordinaire : un Français de cinquante ans, entraîneur sportif, et une Africaine de dix-huit ans, qui vit dans une dépendance à son mari que Dassin trouve suspecte ».
Dans L’Homme qui venait d’ailleurs (France, 2004), François Luciani raconte l’histoire de Pierre, un médecin antillais, qui reprend le cabinet d’un confrère dans un village charentais. Nous sommes en 1893, et personne n’a jamais vu un homme de couleur. Evidemment, notre médecin est tout ce qu’il y a de plus sympathique. Il est libéral, grand, généreux, il porte bien, il est plein de bonté et de sagesse. En face de lui, François Luciani nous montre des Blancs méfiants, incultes, qui ne lui arrivent pas à la cheville. Comme les clients boudent son cabinet, il n’y tient plus : « – Mais pour qui se prennent-ils ces gens-là, dans leur pays de froid et de pluie ! » Un jour, dans un zoo ambulant, il voit des frères de race enfermés dans une cage derrière un panneau où est inscrit « cannibales ». Les Blancs, évidemment, ricanent bêtement, méchamment. Son sang ne fait qu’un tour, mais la fâcherie ne va pas durer bien longtemps, car il a grand cœur. Déjà, la plus jolie femme du pays semble éprise de lui. Dans une autre scène, la bonne de notre médecin nous apprend qu’à l’usine, le contremaître, a l’habitude de se taper toutes les ouvrières, et quand celles-ci tombent enceintes, elles sont obligées de partir. « – Ce n’est pas la pitié qui les étouffe, tous ces gens qui vont à la messe le dimanche », lâche-t-elle. La religion catholique, évidemment, est la religion des salauds et de l’hypocrisie. Autre scène encore : une épidémie s’étend dans le village ; lorsque le brave médecin se rend compte de son importance, il entre dans la salle du conseil municipal où s’interrogent les quelques notables. Bien entendu, le racisme des méchants l’empêche de siéger au conseil. Il s’impose néanmoins par sa supériorité naturelle, et s’exclame : « – Messieurs bravo ! A force d’avarice et de bêtise, vous êtes parvenus à vous mettre à dos une épidémie de choléra ! » Mais qu’importe, l’important est qu’il ait trouvé un cœur tendre dans cet océan de bassesse. Nous avons ici assurément l’estampille cosmopolite. François Luciani est d’une famille de rapatriés d’Algérie, tout comme le réalisateur-acteur Roger Hanin. Il a réalisé ici un très beau film contre l’intolérance.
Dans le même esprit, la série télévisée française PJ (Police judiciaire) reflète assez bien la volonté obsessionnelle de sensibilisation des masses par des histoires toujours très « politiquement correctes ». Un épisode de ce feuilleton plante le décor : une cité de banlieue. Des coups de feu sont tirés sur un groupe de « jeunes » qui écoutent de la musique un peu trop fort. Un des flics – une fliquesse – est une militante d’extrême-droite. C’est seulement par la suite que l’on découvre qu’elle a un fils qu’elle cachait, et qui est métis. Le père est en fait un Antillais, membre du service d’ordre du FN ! Ce scénario pour le moins « capilotracté », est signé Alain Krief.
En 2004, le cinéaste Edouard Molinaro nous a offert Les Cœurs des hommes : Un avion sanitaire, en provenance du Congo, vole vers Paris, avec à son bord des enfants qui doivent être opérés. Une équipe de médecins français tombe sous le charme de ces adorables gamins qui sont la France de demain. Dans Si j’avais des millions, le scénariste Philippe Niang paraît lui aussi obsédé de mettre en scène la mixité ethnique, puisqu’il récidive dans Un bébé noir dans un couffin blanc. On verra dans un autre chapitre que les noms asiatiques sont parfois trompeurs.
En 2005, Claude Berri nous a offert L’un reste, l’autre part, (avec un casting ethnique : Daniel Auteuil, Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg, Nathalie Baye et… curieusement, Miou-Miou). « Deux amis de longue date, Daniel et Alain, la cinquantaine, mariés tous deux depuis une quinzaine d’années, vont rencontrer l’amour. Pour Daniel, ce sera Judith (on se marie dans la communauté) au moment où le fils qu’il a eu de sa première femme Anne-Marie, devient tétraplégique à la suite d’un accident de moto. Alain, lui, rencontre Farida, une jeune Sénégalaise qu’il a engagé comme vendeuse dans sa boutique d’art africain. » En 2005 encore, la série télévisée « bien française » Plus belle la vie nous montre systématiquement des jeunes femmes blanches avec des Noirs, tandis que les jeunes hommes blancs jouent le rôle des homosexuels. Les scénarios sont signés Olivier Szulzynger.
La série télévisée P. J. (Police judiciaire) ─ une série « bien française » ─ présentait ce vendredi 19 août 2005 un épisode sur l’antisémitisme : Un cocktail molotov a été lancé dans une synagogue. C’est Agathe qui se charge du dossier, ce qui lui permet de renouer avec sa religion. Les suspects défilent alors dans les locaux de la police. Un jeune Arabe insolent laisse entendre ─ incroyable ! ─ que « les chambres à gaz n’ont pas existé ». Folle de rage, la fliquesse se jette sur lui avant d’être retenue par ses collègues. Un deuxième suspect standard arrive ensuite dans les locaux pour être interrogé. C’est un colosse noir, qui ne laisse pas lui non plus une bonne image de la jeunesse immigrée. Le troisième homme est un blanc d’extrême-droite, qui paraît plus humain, et même presque sympathique en comparaison des deux autres. Les Français de souche n’étaient pas habitués à tant d’égards, il faut le dire, mais les temps évoluent : en ce tout début de XXIe siècle, la communauté s’est rendue compte que l’extrême-droite française, diabolisée depuis longtemps par le système médiatique, représente un danger moindre que ces bandes d’immigrés fanatisés que l’on a fait entrer sur le territoire. Pourtant, ce ne sont pas ces personnes qui seront les coupables, mais un quatrième suspect, un jeune Juif en rébellion contre ses maîtres de la communauté loubavitch.
Un de ces rabbins est d’ailleurs interrogé dans les locaux de la police. C’est en effet un religieux qui donne le sentiment de vivre sur une « autre planète », récusant toute conception du bonheur offert par la société libérale occidentale. Entre les mains de pareil spécimen réactionnaire, notre jeune juif épris de « fun » et de liberté a alors craqué. Ce scénario répondait en fait à quelques affaires du même ordre qui avaient défrayé l’actualité du moment. En août 2004, effectivement, un incendie avait été perpétré dans un centre social juif parisien. L’affaire avait fait grand bruit, comme d’habitude, dès lors que l’on marche sur le pied d’un représentant de la sainte communauté. Mais il s’était avéré que le coupable n’était autre qu’un juif marginal et déclassé, que l’on s’empressa de qualifier de « malade mental ». Enfin, tout n’est pas perdu dans cet épisode qui finit même plutôt bien, puisque l’autre petite fliquesse est enceinte : « ─ C’est Karim ? ─ Non, non, répond-elle. Je ne te le dirai pas. Mais il y a un point commun avec Karim. » Ce feuilleton tout imprégné d’idéologie est signé Gilles-Yves Caro, sur un scénario de Brigitte Coscas.
Autre feuilleton : Joséphine, ange gardien, La Couleur de l’amour (France, 2005). « Engagée comme employée agricole dans la ferme des Revel, Joséphine fait la connaissance du propriétaire Thomas, qui va épouser Aminata, une jeune Sénégalaise rencontrée sur internet. Malgré ses efforts, Aminata ne parvient pas à se faire accepter par Claudine, sa belle-mère ». On imagine que cette dernière est un tantinet raciste, bornée et bigote. Ce téléfilm est signé Laurent Lévy. Pour TV Grandes Chaînes, c’est assurément « un épisode plein de bonne humeur et de générosité », qui mérite d’être frappé d’un « coup de cœur » de la critique.
Les films racistes anti-blancs
La marque de fabrique planétarienne se reconnaît aussi à un certain racisme plus ou moins larvé dans le scénario mais toujours très visible à l’écran.
Dans La chaleur de la nuit (USA, 1967), un officier de police de Philadelphie, spécialiste des affaires criminelles, est envoyé dans une petite ville du Sud pour aider la police locale à élucider une affaire de meurtre d’un industriel. Petit problème : il est Noir, et ces abrutis de Blancs ne peuvent le supporter. Mais Virgile Tibbs, qui est le spécialiste, découvre rapidement que les flics blancs font fausse route. L’homme est tranquille, consciencieux, d’une rare intelligence, et reste toujours calme devant le racisme immonde de ces petits Blancs arrogants qui ne lui arrivent pourtant pas à la cheville. Mais tout stupides qu’ils sont, ceux-ci se rendent bien compte finalement qu’ils ne peuvent se passer de lui. A plusieurs reprises, il faudra bien aller le chercher à la gare et le supplier de rester. Rapidement, son enquête va le mener vers le plus gros fermier de la région. Celui-ci est soupçonné d’avoir commandité l’assassinat de cet industriel dont le projet était de monter une usine et d’y embaucher des centaines de gens de couleur. Les jeunes de cette petite bourgade « frileuse » ne l’entendent pas de cette oreille, et vont traquer Virgile Tibbs dans une folle course poursuite. C’est évidemment dans une usine désaffectée que va se régler l’affaire, à coup de chaînes à vélo et de barres de fer. A quatre contre un, c’est plus sûr. Ils sont comme cela, les Blancs : vils, lâches et méprisables. Fort heureusement, le chef de la police arrive à point nommé, et sauve Virgile d’une mort certaine. Ce shériff, plein de préjugés au début du film, scelle l’entente entre les deux communautés. Le film a naturellement été récompensé par cinq Oscars. Il en aurait peut-être eu un sixième, si « Virgile » était reparti à Philadelphie avec la veuve de l’industriel assassiné. C’était pourtant une très jolie Blanche. Mais le réalisateur Norman Jewison, en 1967, ne voulait pas aller trop loin et craignait peut-être à ce moment-là une réaction de ces couillons de Blancs imprévisibles !
Le film Ces Garçons qui venaient du Brésil, raconte l’histoire d’un chasseur de nazis, Ezra Liberman qui, dans les années 70, met à jour un complot organisé par un groupement d’anciens nazis émigrés au Paraguay. L’horrible Docteur Mengele, ancien médecin-bourreau d’Auschwitz, en est le chef. Il vit dans une luxueuse villa, suffisamment isolée pour pouvoir continuer ses activités perverses sur la génétique, et semble régner sur un troupeau de domestiques amorphes qu’on dirait réduits à l’état d’esclaves : c’est l’homme blanc dans toute sa suffisance. Les nazis semblent tenir le haut du pavé sous le régime militaire du Paraguay, organisent ouvertement des réceptions dans de somptueux palaces. Ils mettent sur pied un mystérieux complot meurtrier qui sera finalement déjoué grâce à la ténacité du justicier Liberman. Le film est de Franklin J. Schaffner (USA, 1978).
Dans A double tranchant (USA 1985), un directeur d’un grand journal californien est accusé d’avoir sauvagement tué sa femme pour toucher l’énorme héritage. Persuadée de son innocence, une célèbre avocate accepte de prendre sa défense. Pourtant, au cours du procès, certains éléments la font douter, et notamment le comportement d’un des témoins, qui présente les caractères d’un dangereux psychopathe : il est blond, avec le type nordique. Il paraît dangereux et tente même de s’en prendre à l’avocate dans le parking. Ce ne sera pourtant pas lui le coupable, mais bien son propre client, le directeur de presse, qui avait su perfidement la séduire. Lui aussi est un blond au type nordique, mais l’avocate n’obtiendra la preuve de sa culpabilité que par hasard, après avoir gagné le procès et fait innocenter son client. Elle décide alors de le dénoncer, et d’avouer publiquement par la même occasion l’ignominie du procureur. En effet, lors d’une affaire remontant à plusieurs années, celui-ci avait escamoté une pièce du dossier qui aurait pu empêcher un autre inculpé d’être condamné à dix ans de prison. Le malheureux injustement emprisonné est un Noir. Les Noirs sont gentils, les Blancs sont méchants, et le film est signé Richard Marquand.
Dans Recherche Susan désespérément (USA, 1985), une jeune femme un peu coincée se transforme en punkette délurée, à la faveur d’une amnésie. Le scénario indigent n’a ici guère d’importance. On note simplement que dans une société « ouverte », « libérée » et très multiculturelle, le saxophoniste noir dans son appartement tient la place d’une icône démocratique, et que le rôle du sale con revient immanquablement à un homme aux cheveux blonds. Est-ce un hasard ? Le film est de Susan Seidelman.
Dans Cry Freedom (GB, 1987), Richard Attenborough nous montre l’Afrique du Sud des années 1970, où le régime d’Apartheid est imposé aux Noirs par les Afrikaners : le directeur d’un journal libéral prend fait et cause pour les Noirs et se lie d’amitié avec un de ses principaux leaders, Steve Biko. Celui-ci est assassiné en prison par des Blancs tous plus vils les uns que les autres. Les Noirs, en revanche, sont tous émouvants, dignes et respectables. Leurs manifestations pacifiques sont durement réprimées par une police impitoyable. Un film qui donne honte d’être blanc, et c’est exactement le but recherché.
Dans la même veine, le réalisateur Chris Menges a réalisé Un Monde à part, (USA, 1988), qui retrace les tensions en l’Afrique du Sud en 1963. Les Blancs sud-africains sont naturellement racistes, et la police peinte sous le jour le plus antipathique possible : haineuse, bornée et obsédée par un ennemi insaisissable. L’œuvre de Menges a naturellement reçu le Grand prix du jury à Cannes en 1988. Dans L’Arme fatale II, (1989), Richard Donner nous dépeint aussi les Sud-Africains blancs comme d’ignobles trafiquants de drogue.
Avec Mississipi Burning (USA, 1988), Alan Parker s’inspire d’une histoire vraie des années 60. Le FBI américain enquête sur la disparition de trois jeunes hommes appartenant à une association défendant les « droits civiques ». Ceux-ci – un Noir et deux Juifs – ont été tués par des racistes du Ku Klux Klan. Dans cette petite ville du Sud des Etats-Unis, les petits Blancs sont lâches, vils, mesquins ou franchement abjects. Leurs femmes obéissent docilement, mais ne rêvent que de fuir de pareils individus.
Dans La Main droite du diable, Costa-Gavras (USA, 1988) dénonce les milices d’extrême-droite aux Etats-Unis. Un animateur de radio un tantinet provocateur et « libéral » est abattu dans un parking. Celui-ci est juif, et ses assassins ont signé « ZOG » (Zionist occupational government) à la bombe à peinture. Les policiers du FBI enquêtent sur une milice d’extrême-droite du middle-West. Une jolie jeune femme est chargée de les infiltrer. Gary tombe vite amoureux d’elle et laisse voir ses penchants de psychopathe. Celui-ci insiste par exemple pour qu’elle l’accompagne à la chasse avec ses amis. C’est une chasse un peu particulière, puisqu’il ne s’agit pas moins que d’une traque humaine contre un jeune Noir lâché la nuit dans la forêt. L’homme sera naturellement abattu sous les yeux de la jeune femme. Gary pensait sans doute faire plaisir à sa nouvelle conquête, mais celle-ci est littéralement écœurée par ce à quoi elle a assisté. Néanmoins, ses supérieurs du FBI avec qui elle reste en contact insistent pour qu’elle continue l’infiltration dans le réseau d’extrême-droite. Un camp para-militaire révèle toute l’importance de l’organisation : ils détiennent les armes les plus sophistiquées et font preuve d’une grande détermination. Tous seront finalement arrêtés. Mais le combat contre cette pieuvre est loin d’être terminé, car l’on sait que ces réseaux sont soutenus par de puissants personnages, et des hommes politiques de tout premier plan qui cachent bien leur jeu et agissent en sous main !
Music box (USA, 1989) est un film qui revient sur les atrocités de la Seconde Guerre mondiale : Michael Laszlo est un réfugié hongrois installé aux États-Unis depuis 37 ans. Il est un jour accusé de crimes de guerre. Les dépositions des témoins étaient en effet restées bloquées pendant quarante ans dans les archives des Nations-Unies. Il est veuf, mais sa fille, avocate, est là pour le défendre. Bien entendu, elle ne croit pas un instant à ces histoires sordides, et décide d’assurer la défense de son pauvre père. « Ce sont les communistes qui sont derrière tout ça ! » tente-t-il de la rassurer. Il doit pourtant bien lui avouer qu’avant de quitter sa Hongrie natale après la guerre, il avait été policier sous le régime fasciste, mais « fonctionnaire dans un bureau », c’est tout. Sa fille, cependant, commence à avoir des doutes sur le rôle joué par son père pendant la guerre : « Ils ont une photographie de ta carte de membre des sections spéciales avec ta signature. C’est le gouvernement hongrois qui leur a envoyée. » De plus, des témoins l’ont identifié et l’accusent de choses horribles : « Quand je pense à tout ça, j’ai honte d’être hongroise, papa », en vient à déclarer sa fille (C’est comme cela qu’on les aime, les Hongrois !).
Un groupe de rescapés vient ensuite manifester devant sa maison avec des pancartes, pour rendre la vie impossible à ce militant anticommuniste bien connu. On lui casse ses carreaux avec des pierres. Un nouvel indice alarme encore la jeune femme quand son fils vient lui répéter ingénument, les paroles hautement criminelles de son grand-père : « Il dit que l’holocauste est fabriqué, exagéré ! »
Le procès commence enfin, et les témoins à charge se succèdent pour raconter les atrocités commises par les fascistes hongrois, toutes plus horribles les unes que les autres, et où l’on retient que « le beau Danube bleu était rouge de sang » : « Michka c’était le pire. Il aimait tuer le Juif. Il cherchait l’or et l’argent… le beau Danube bleu était rouge. C’est lui, je le reconnais. » Sa fille parvient pourtant à le tirer d’affaire, en prouvant les liens suspects de ces témoins avec les gouvernements communistes et le KGB. Son père est heureusement acquitté.
Ce n’est que plus tard, à Budapest, où elle est partie interroger un témoin, qu’elle découvre dans une boîte à musique les photos atroces qui accusent son propre père. Cette fois, la preuve était faite de sa culpabilité : « Je ne veux plus jamais te voir, papa. Je ne veux plus jamais que mon fils te revoit », lui lance-t-elle, le cœur plein de haine et de dégoût. Et quand la fille menace de tout dire à son fils, le méchant grand-père lui répond, sûr de lui et arrogant : « Il ne te croira pas. Ils ne te croiront pas. Ils diront que tu es folle ! » C’est comme cela qu’on les aime, les famille hongroises : déchirées, prêtes à s’entre-tuer. L’avocate envoie finalement les clichés à la presse, et c’est en regardant la photo de son père en uniforme de milicien, en première page du journal, que ce film se termine. Notons que Costa Gavras (encore lui !) a bien pris soin d’intégrer des images et de la musique du folklore hongrois tout au long du film, probablement pour mieux en dégoûter les spectateurs.
Le film de Milos Forman, Ragtime (USA, 1991) ne présente d’autre intérêt que d’être aussi un film moralisateur : en 1906 à New York, un pianiste noir, qui s’est acheté une voiture, est victime de la jalousie et du racisme d’une bande de blancs stupides.
Le fameux film de Jonathan Demme, Le Silence des Agneaux (USA, 1991), raconte la traque par le FBI d’un dangereux psychopathe qui laisse derrière lui des cadavres de jeunes femmes atrocement mutilés. Le très célèbre « agent Starling », Clarisse, une jeune femme policier qui n’a pas froid aux yeux, est sur la piste du tueur en série. Cette espèce de dangereux taré s’appelle Billy : c’est un grand blond aux yeux bleus. Il vit seul dans une maison sordide, et retient prisonnière dans un puits, au sous-sol de sa maison, sa prochaine victime qui ne cesse de hurler (« Elle met la crème dans le panier ! »). Billy aime les papillons et les armes à feux. Au détour d’une image, on peut apercevoir une énorme croix gammée sur son dessus de lit.
Barton Fink (USA, 1991) : En 1941, Barton Fink est un jeune auteur qui connaît soudainement le succès grâce à une pièce de théâtre. La première scène du film nous met tout de suite dans l’ambiance. Il est dans les coulisses, et assiste médusé au succès phénoménal de sa pièce : c’est le triomphe ! Le public applaudit à tout rompre et se lève, transporté d’enthousiasme par le sublime génie de ce petit auteur juif encore inconnu. Mais Barton Fink est quelqu’un de timide et de renfermé sur lui-même. Sa nouvelle notoriété lui vaut un contrat à Hollywood, qu’il commence par refuser : « Je me couperais du peuple », dit-il. Il est en effet devenu en peu de temps la nouvelle coqueluche de Broadway. Cependant, il ne résiste pas à la tentation d’une gloire plus grande encore, et arrive à Los Angeles où il rencontre un producteur truculent. Celui-ci est expéditif et haut en couleurs. C’est un juif originaire de Minsk, qui se déclare « plus fort que les autres youpins du coin ! »
Voilà donc Barton Fink à l’hôtel, devant sa machine à écrire. Le problème est que son voisin de la chambre d’à-côté est vraiment trop bruyant et l’empêche de se concentrer. Et voilà que celui-ci débarque dans son univers. Il est gros, rougeaud, brutal et alcoolique : c’est un goy ! Et pourtant, l’intellectuel délicat et timide qu’est Barton Fink va se mettre à apprécier cet individu simple et entier. Mais il lui faut aussi trouver un scénario au plus vite pour le tournage d’un film. Le problème est que Barton éprouve toutes les difficultés du monde à écrire le scénario qu’on lui demande. C’est le blocage, pendant plusieurs semaines ! Quand son producteur le reçoit chez lui, au bord de la piscine, Barton, tout penaud, a bien dû lui avouer que l’inspiration n’était pas encore au rendez-vous. Il doit alors subir les sarcasmes de l’adjoint, qui ne s’attendait certes pas à la réaction brutale du producteur, qui le chasse sans façon avant de renouveler sa confiance au petit génie qu’il a pris sous son aile. Son admiration envers Barton est telle qu’il va jusqu’à lui lécher la semelle de sa chaussure, par respect pour la noble fonction d’écrivain !
Barton rentre donc à son hôtel, rassuré. Fort heureusement, l’inspiration arrive enfin, et Barton parvient à écrire l’ensemble de son scénario en une seule nuit. Le résultat est tout simplement génial : Oui, Barton Fink a du génie ! Il déborde de joie au petit matin. Jamais il n’était parvenu à un tel degré de finesse et de perfection : « Je suis un créateur ! » Le soir, il va danser dans une boîte de jazz. Dans les jours qui suivent, il fait la rencontre d’un grand écrivain, mais qui s’avère finalement être un individu fort décevant, alcoolique, brutal et grossier, et qui traite durement sa fiancée. Sur un malentendu, si l’on peut dire, Barton passe la nuit avec celle-ci à son hôtel. Mais le lendemain matin, c’est la stupeur et l’effroi lorsqu’il découvre le corps ensanglanté de la jeune femme dans son lit. Que s’est-il passé ? Il n’y est pour rien, évidemment, et prévient tout de suite son voisin. Celui-ci le croit sur parole, et s’occupe de faire disparaître le corps.
Subitement, tout va donc très mal, d’autant que son producteur est très déçu, vraiment très déçu de son scénario. Lorsque Barton se présente devant lui, il est traité cette fois-ci comme le dernier des déchets et copieusement insulté ! Tout va donc maintenant vraiment mal pour Barton. La police ne tarde pas à enquêter sur la disparition de la jeune femme : il s’avère en fait que son voisin, le gros rougeaud alcoolique, est en réalité un dangereux psychopathe qui a pour habitude de décapiter ses victimes. C’est aussi un nazi : « Heil Hitler ! » s’exclame-t-il avant d’abattre deux flics à coups de fusil dans l’hôtel en flammes. Le film se termine ainsi. Si l’on fait le compte, tous les Blancs sont finalement des ordures dans ce film des frères Ethan et Joel Coen. Le film a bien entendu été récompensé par une palme d’or au festival de Cannes en 1991. John Turturro, il est vrai, est magnifique dans son rôle d’intellectuel juif « proche du peuple ».
Obsession fatale (USA, 1992) commence par une scène étonnante : dans un pavillon d’une jolie petite banlieue proprette, un cambrioleur, qui s’est introduit nuitamment, est surpris par le jeune couple. L’homme parvient à s’en sortir en menaçant la jeune femme d’un grand couteau de cuisine. L’agresseur est un Noir, les victimes sont blanches, ce qui n’est pas normal au cinéma. On imagine que le réalisateur ne va pas en rester là, et effectivement, dès la scène suivante, on se rend compte qu’il y a aussi des Noirs sympas, puisque l’un des deux flics qui arrivent pour rassurer notre joli couple est un homme de couleur. Son collègue ─ un Blanc ─ est aussi quelqu’un de très sympa et de très professionnel… mais seulement en apparence ! Car en réalité, c’est un dangereux psychopathe qui s’est épris de la jeune femme et qui va rendre au mari la vie infernale. Il va jusqu’à tuer son collègue noir, en même temps qu’un jeune dealer, et fera passer son crime pour une fusillade entre les deux hommes, ce qui ne l’empêchera pas de pleurer la mort de son ami devant les caméras de télévision. Bref, l’agression de l’homme noir au couteau est bien oubliée à la fin du film, où le psychopathe aux yeux bleus a une fois de plus le premier rôle. Il faut remercier ici M. Jonathan Kaplan (encore lui !).
Dans La Firme (USA, 1993), Mitch McDeere (Tom Cruise) est un jeune diplômé qui vient d’être recruté par la Firme, un puissant cabinet d’avocats de Memphis. Il est d’abord séduit et fasciné par les avantages qui lui sont offerts, mais se rend compte peu à peu que les dirigeants travaillent en fait pour un terrible gang mafieux de Chicago. Tous les avocats présentés – une bonne trentaine – sont blancs, catholiques et de type nordique. Ils symbolisent l’élite américaine dans ce qu’elle aurait de plus hypocrite et écœurant. Le film est signé Sydney Pollack.
En 1993 encore, paraît une comédie intitulée Les Valeurs de la famille Adams. La famille Adams est un peu spéciale : on ne sait pas trop si ce sont des sorciers ou des vampires, mais il est certain qu’ils adorent le démon. Ils vivent dans un manoir isolé de tout sur une colline ; ils s’habillent de noir, ils ont les cheveux noirs et le teint cadavérique. Leur morale est abjecte ; ils ont la passion de faire le mal, et pourtant, ils deviennent attachants par leur excentricité. Les deux enfants sont placés dans une colonie de vacances pendant quelque temps, avec d’autres petits américains, où toutes les petites filles sont blondes, tous les petits garçons sont blonds, et tous forment la majorité imbécile, lâche et intolérante. Bientôt, nos deux petits diablotins aux cheveux noirs seront mis en quarantaine par ce vil troupeau de blonds pétris de morale bourgeoise. Mais nos petits Adams ne vont pas se laisser faire. Ils vont réunir autour d’eux les autres individus opprimés de la colonie, tous ces enfants aux cheveux noirs injustement méprisés par ces blonds arrogants. Tous ensemble, ils vont faire un coup d’éclat dans le spectacle de fin de séjour où assistent les parents. Les blonds en prennent alors pour leur grade, comme il se doit. Les méchants et les affreux sont en fait les gentils, et les salauds sont invariablement les blonds : le film est de Barry Sonnenfeld.
Copland (USA, 1995) montre les méthodes policières peu orthodoxes de certains flics de New York. Beaucoup parmi eux ont fui la grande ville cosmopolite qu’ils exècrent, pour venir habiter Garrisson, une petite ville paisible, de l’autre côté du grand fleuve Hudson, où ils peuvent vivre en paix ─ entre Blancs. On ne tarde pas à comprendre que ces flics blancs, qui enterrent leurs morts au son d’une musique irlandaise, sont terriblement organisés, et qu’ils n’hésitent pas à falsifier les enquêtes, ni même à liquider les flics qui les dérangent. C’est en réalité un véritable gang mafieux qu’ils ont mis sur pieds. Mais le petit shériff du coin, qui avait fermé les yeux jusqu’à présent, va enfin avoir le courage de passer à l’action. Tous ces salauds sont des flics blancs, tandis qu’en face, à New York, la police multiraciale est vraiment super sympa. Ce film qui porte « la marque » est signé du très rusé James « Mangold ».
Dans Complots (USA, 1997), il y a les méchants, et il y a les gentils. Mais tout n’est pas si simple, car chez les méchants, certains ne sont pas si méchants que cela, et s’avèrent même être des gentils. Une seule certitude : tous les méchants sont des Blancs. Et une fois de plus, de ce côté-ci, les quotas obligatoires ne sont pas respectés. Le film est de Richard Donner.
Le racisme du cinéma planétarien peut aussi viser d’autres communautés. L’Arme fatale 4 (USA, 1998) met en scène un couple de flics de Los Angeles, un Noir et un Blanc qui ont découvert un réseau d’immigration clandestine chinois. Quatre cents pauvres hères étaient ainsi entassés dans la cale d’un navire, mais le Black, pris de compassion, et se rappelant sans doute ses ancêtres esclaves, décide de transgresser la loi et de recueillir une famille oubliée dans un canot de sauvetage. Nos deux flics ont tôt fait de remonter la filière jusqu’au chef de cette mafia qui fait entrer les Chinois par milliers aux États-Unis. Ceux-ci travaillent ensuite de longues années pour rembourser le prix du voyage et des faux papiers. C’est une redoutable organisation criminelle qui fabrique aussi de la fausse monnaie. Le film de Richard Donner est incontestablement drôle et spectaculaire. Il est aussi un des films les plus racistes qui existe. A notre connaissance, aucune communauté, à part la communauté blanche, n’a jamais été dépeinte par des cinéastes juifs de manière aussi outrageante. Ce traitement vient probablement du fait que la communauté chinoise est la seule qui fasse reculer la communauté juive sur le plan du business et de l’organisation communautaire.
On peut voir aussi dans le même genre le film XXL (France, 1997), qui dépeint sous un mauvais jour les Chinois de Paris dont l’activité commerciale fait reculer le business de la communauté juive dans le quartier du Sentier. Ici, c’est un cafetier auvergnat et un commerçant juif du textile qui vont nouer une alliance contre l’insupportable invasion asiatique. L’Auvergnat (Gérard Depardieu) est bon vivant, conquérant, sûr de lui, tandis que le Juif (Michel Boujenah) est angoissé, timide, inquiet. Mais le spectateur doit comprendre que leurs divergences sont, somme toute, très superficielles, et qu’ils ont des intérêts communs à défendre face à ces pourris de Chinetoques, que l’on peut donc insulter sans crainte d’un procès. Le réalisateur de ce film est Ariel Zeitoun.

La Ligne verte est un film de Frank Darabont, sorti sur les écrans en 1999 : Dans le pavillon des condamnés à mort de ce pénitencier américain, en 1935, il y a des gardiens de prisons ignobles, et des détenus pleins d’humanité. Tout cela est en effet tout à fait plausible. Les pouvoirs surnaturels du colosse noir, accusé du viol et du meurtre de deux fillettes, le sont moins. Celui-ci, est doux comme un agneau, innocent et accusé à tort. Il sera pourtant la victime des hommes, de l’injustice, et de la cruauté de gardiens psychopathes – blancs.
Dans Dany Ballint (2001), de jeunes néo-nazis sont embrigadés par une puissante organisation extrêmiste. Dany, leur chef, le seul type intelligent de la bande, est en fait un Juif angoissé, en rupture avec sa communauté. Une scène finale du scénario entend montrer contre toute vraisemblance que ces organisations nazies sont soutenues par la grande bourgeoisie américaine : le film est de Henry Bean ; le scénario de Mark Jacobson.
Runaway jury (USA, 2002) est l’histoire de la manipulation des jurés par le lobby des ventes d’armes aux Etats-Unis. Les « méchants » sont des blonds manipulateurs, terriblement organisés et efficaces qui agissent pour le compte du lobby des armes à feu. Espionnage, violence, chantage et manipulation sont leur spécialité ; tout est mis en œuvre pour gagner le procès, mais fort heureusement, ces salauds vont perdre à la fin grâce à l’intelligence du petit avocat Dustin Hoffman : un film de Garry Fleder, sur un scénario de David Lieven et Brian Koppelman.
L’esprit politiquement correct américain se retrouve évidemment dans un autre dessin animé : Pocahontas (1995), de Mike Gabriel et Eric Goldberg. Pocahontas, jeune indienne indépendante, refuse le mari que lui a désigné son père et s’éprend d’un aventurier anglais moins raciste que les autres, auquel elle renoncera finalement pour rester avec son peuple. Les Anglais sont avides, cruels et répugnants, les Indiens sont bons, sages, nobles et respectueux. Pocahontas a été étudiée pour plaire à tout le monde : elle est brune, sexy, le teint ambré, les yeux en amande : elle tient à la fois de l’Indienne, de la Noire, de la Chinoise, de la Berbère et de la Gitane. Elle revendique son « ethnicité planétaire ».
Dans Terminator II, le tueur psychopathe déguisé en flic est un homme blanc aux yeux bleus et aux traits nordiques, tandis que le génie de l’informatique qui met au point une puce miniature destinée à bouleverser l’humanité est un Noir repentant, qui accepte de détruire le fruit de son labeur pour sauver l’humanité.
Dans Matrix, de Larry Wachowski (USA, 1999), les humains sont entièrement soumis à un programme informatique qui domine toutes leurs pensées et toute leur vie. Ils croient exister, mais ne sont en fait que des esclaves des machines. Il ne reste plus qu’un petit nid de résistance humaine : Sion. Le film est truffé de messages kabbalistiques : le héros, Néo, est « l’élu », le libérateur mythique de l’humanité annoncé selon les prophéties, qui va pouvoir sauver « Sion », ainsi que le révèle « l’Oracle ». Les humains sont peints sous les couleurs d’une société multiethnique, tandis que la matrice, qui entend dominer l’univers, est représentée sous les traits de l’homme blanc : les agents Smith, qui, dans leurs costards-cravates, sont évidemment très pervers et très méchants. Une fois encore, ce sont les Blancs qui doivent endosser les responsabilités des véritables tyrans : car la matrice existe « pour de vrai » : c’est elle qui a fait le film.
Dans O’brother (USA, 2000), trois sympathiques lascars sont parvenus à s’évader d’un pénitencier du sud des États-Unis. Le début du film paraît être un hommage à la culture du sud profond, avec, au premier plan, la cavale de nos trois fugitifs, sur un fond de musique country. Mais l’habituel message antiraciste y trouve sa place après quelque temps : les hommes politiques blancs passent pour des magouilleurs hargneux, racistes et sans scrupules. Le Ku Klux Klan en prend naturellement pour son grade, et l’on comprend que rien ne vaut une bonne société multiraciale. Le message politique est ici habilement incarné dans un quadrige de « country music » formé de nos trois compères et d’un « Black » à la guitare. Il faut dire que leur musique est vraiment entraînante. On n’omettra pas de souligner que le système électoral ─ one man, one vote ─ est dépeint pour ce qu’il est : une escroquerie, où le candidat qui l’emporte est celui qui orchestre la meilleure campagne publicitaire. Un bon point tout de même, donc, pour les frères Joel et Ethan Coen.
Dans Panic Room (USA, 2001), une jeune femme très riche (Jodie Foster) et sa fille emménagent dans un immense hôtel particulier au cœur de Manhattan. La demeure est équipée d’une chambre forte conçue pour survivre en cas d’agression extérieure. Un soir, trois cambrioleurs pénètrent dans la villa. C’est alors le début d’une aventure terrifiante qui va très mal se terminer, car le magot qu’ils cherchent se trouve justement dans la pièce où se sont réfugiées les deux femmes qui ignorent tout des projets de leurs assaillants. Parmi les trois cambrioleurs, le colosse noir est le seul à être un peu intelligent : c’est d’ailleurs lui qui a conçu la pièce forte. Il est aussi le technicien et le plus scrupuleux des trois malfrats, puisqu’il refuse toute violence dès le départ. Le chef de l’équipe, en revanche, est un Blanc, un grand nerveux imprévisible, qui finira avec une balle dans la tête en tentant de s’en aller. Le troisième, un autre Blanc, très calme, s’avère en réalité être un dangereux psychopathe et un tueur fou. A la fin du film, cette espèce de taré s’apprêtait à tuer la jeune femme à coup de masse dans le visage. Fort heureusement, le Noir intervint juste à temps. Et c’est aussi ce grand Noir qui, dans des conditions difficiles, fit une piqûre à la petite fille souffrante et la sauva d’une mort certaine. Les Blancs sont méchants, les Noirs sont gentils ; le film est de David Fincher.
Décidément, il est dit que nous ne sortirons pas de ce schéma culpabilisateur, et il faut se rendre à l’évidence que la répétition calquée de ces modèles révèlent une volonté précise d’inculquer aux masses européennes un message bien précis, dans lequel on constate que la « tolérance » peut s’apparenter à un venin puissant et indolore qui assoupit la victime avant de la terrasser. On pourra certes objecter que la majorité des stars d’Hollywood sont encore des Blancs, mais il ne faut pas perdre de vue l’objectif planétarien n’est pas de détruire totalement les sociétés blanches, tellement utiles pour la prospérité des affaires, mais de conduire les hommes blancs à adopter la société plurielle, dans laquelle ils pourront garder la place qui leur revient : la deuxième. Et puis, c’est gens-là représentent encore la grande majorité du public qui fréquente les salles de cinéma. Il faut donc les ménager un peu, et les amener progressivement à accepter les nouvelles normes planétariennes. De toute manière, ainsi que le montre très bien le beau film du grand réalisateur Steven Spielberg, Les Aventuriers de l’Arche perdue (1980), la puissance de Yahvé est beaucoup trop grande pour que l’on puisse simplement songer à s’y opposer.
On pourra tout de même regarder avec un certain intérêt cette comédie de Barry Levinson : Des Hommes d’influence (USA, 1997). Rien ne va plus à la Maison Blanche : deux semaines avant les élections, le président est impliqué dans un scandale sexuel. Pour faire diversion, le conseiller du président expert en manipulations (Robert de Niro) lance une rumeur sur une guerre complètement imaginaire. Pour la mettre en scène, il contacte un producteur de cinéma (Dustin Hoffman). Tous deux vont détourner l’attention du public et bluffer toute la population avec des montages télévisés complètement trafiqués. Un film réjouissant, où l’on peut constater que le système est maintenant suffisamment sûr de sa puissance pour se dénoncer lui-même.
Le cinéma français n’est évidemment pas en reste dans cette discipline de flagellation de la population majoritaire. Jean-Jacques Annaud, dans La Victoire en chantant, (France, 1976) nous offre un aperçu de la présence française en Afrique en 1915, où une population de colons composée exclusivement de crétins alcooliques est opposée à des Noirs pleins d’humour.
En 1984, avec Train d’enfer, Roger Hanin lance un cinéma militant. Dans le numéro du 11 janvier 1985, l’hebdomadaire indépendant Tribune juive, dont le directeur, le rabbin Jacques Grunewald est connu pour ses sympathies de gauche, commente ainsi le film de Roger Hanin : « Assassinat atroce dans un train : un jeune Arabe est lynché et défenestré par trois recrues en goguette. A partir de ce fait divers, acte raciste émanant de trois paumés, Roger Hanin a construit un film dont il veut tirer une large morale, impliquant cette fois la France profonde tout entière. Plus question de trois garçons isolés et éméchés. C’est d’un véritable réseau néonazi qu’il s’agit, englobant toute une ville, voire le monde entier. » et Tribune juive ajoute : « Roger Hanin assure que, Juif algérien, on lui a appris dès l’enfance à aimer les Arabes. Apparemment, on ne lui a pas appris à aimer les Français. » Train d’enfer a bénéficié de l’aide de l’organisme d’avance sur recette, présidé par Bernard-Henri Lévy, c’est-à-dire d’une subvention financée par l’argent des contribuables français.
Dans Hors-la-loi, de Robin Davis (France, 1984), « quinze adolescents d’origines ethniques diverses, s’évadent d’un centre de redressement. Il font irruption dans un bal de village où le patron du bar, raciste, finit par tirer dans le tas. »
En 1995, dans La Haine, Matthieu Kassovitz dépeint la haine de la société française qui tenaille trois jeunes : un Arabe, un Noir et un Juif d’une cité de banlieue. On voit ici encore cette inclination à assimiler les Juifs aux éléments les plus défavorisés de la société. Matthieu Kassovitz se fait ici le porte-parole d’une frange d’immigrés rétifs aux lois et qui hurlent leur haine du système. Les blacks et les beurs deviennent l’incarnation d’un nouveau mythe de héros rebelle, mais reçu régulièrement sur tous les plateaux de télévision et bénéficiant du soutien des grosses maisons de production. C’est encore Matthieu Kassovitz qui signe en 2000 Les Rivières pourpres : dans les glaciers des Alpes, des cadavres atrocement mutilés sont retrouvés, avec les yeux crevés et les deux mains tranchées. Les enquêteurs vont suivre une piste qui va les mener à l’université locale, qui s’avère être une pépinière de dangereux néo-nazis. Là encore, le scénario est peu crédible, mais c’est amplement suffisant pour le public à qui le film est destiné.
Avec Taxi, sorti en 1998, Gérard Pirès a eu aussi beaucoup de succès : Sami Naceri, un fou du volant, parvient à bout d’une bande de dangereux malfaiteurs. Ces derniers sont des Allemands de type nordique, aussi cons que méchants. Dans Les Enfants du soleil, sorti en 2004, Alexandre Arcady prétend raconter le drame des Français d’Algérie, alors que son film n’est qu’une célébration de la communauté israélite. Le Français « pied noir catholique propre sur lui » comme dit l’auteur lui-même, s’appelle Lacombe. Comme « Lacombe Lucien », le milicien simplet et dangereux inventé par l’écrivain Patrick Modiano pour le film de Louis Malle.
En 1999, Alain Berberian nous a livré le film Six-Pack : à Paris, un commissaire de police s’acharne à vouloir mettre hors d’état de nuire un tueur en série américain. L’homme a déjà tué et mutilé cinq jeunes femmes. Mais celui-ci, attaché culturel à l’ambassade américaine, est protégé par l’immunité diplomatique. Il semble que des consignes viennent du ministère pour empêcher l’arrestation du coupable. En effet, l’affaire est utilisée par Paris pour peser sur les négociations commerciales avec Washington. Les méchants sont joués par des hommes de type nordique (le chef de la police, le psychopathe), tandis que les gentils (le commissaire Nathan, l’inspecteur Saül) une fois encore, sont joués par des acteurs bruns très typés.
En 2004, le réalisateur Stéphane Kurc nous a présenté Le Triporteur de Belleville : en 1940, dans la grande débâcle des troupes françaises, Victor Leïzer, un jeune Juif de Belleville, a perdu son régiment. Avec un autre soldat égaré, il erre dans la campagne française désertée de ses habitants. Le soir, les deux complices rencontrent un groupe de Sénégalais dans une ferme. Le chef des Sénégalais est agrégé de Français à Dakar. On l’a obligé à faire la guerre loin de chez lui. Il s’exprime parfaitement bien, avec un langage châtié : « – Ah, Messieurs, laissons là ces galéjades ! ». C’est avec une grande dignité qu’il préférera mourir, tué par les Allemands, plutôt que de se laisser faire prisonnier loin de son pays. Parmi les millions de soldats mobilisés qu’on pouvait voir sur le front, c’est sûr, les Juifs et les Noirs étaient probablement majoritaires, même si un calcul rapide doit nous mener tout au plus à 1 ou 2 % au grand maximum. Quand il s’agit de sensibiliser le téléspectateur français, tout est permis. Bien évidemment, dans le scénario retenu par Stéphane Kurc, les méchants sont très méchants, et les gentils sont très gentils.
Dans le genre ridicule, on a pu voir aussi un épisode de La Crim, un téléfilm bien français : un skinhead (personnage imaginaire, individu violent d’extrême-droite, au crâne rasé) est poignardé à mort dans une banlieue. Tout porte à croire qu’un Arabe a fait le coup, et celui-ci est arrêté. Mais l’enquête va démontrer que c’est le père de ce skinhead qui l’a tué, parce qu’il ne supportait plus que son fils soit d’extrême-droite. Le skin avait tué le frère de l’Arabe, qui était d’ailleurs un de ses amis d’enfance ! Ce scénario délirant est signé Ramsay Lévy.
Pour Le fabuleux Destin d’Amélie Poulain, (France, 2001), le scénario et les personnages étaient vraiment trop franchouillards : Serge Kaganski, critique du magazine Les Inrockuptibles, n’y tint plus, et déclara dans Libération du 30 mai 2001 : c’est « un film à l’esthétique figé et qui surtout présente une France rétrograde, ethniquement nettoyée, nauséabonde ». Cette haine de la France et des Français paraît être une obsession incurable. Si tous ces réalisateurs avaient eu envie de nous pousser au suicide, ils ne s’y seraient sans doute pas pris autrement. Cette France « nauséabonde » a été d’ailleurs fort bien filmée par François « Truffaut » dans Le dernier métro (1980), film qui relate la vie d’un théâtre sous l’occupation, et dans lequel on peut discerner aisément l’abjection française d’un côté, et le génie de l’humanité de l’autre. Ce dernier apparaîtra au grand jour dans la scène finale, acclamé par tous les spectateurs en délire qui reconnaissent enfin le seul, l’unique, le sublime génie créateur, incarné en la personne du petit « Lucas Steiner », qui avait été obligé jusque là de se cacher dans la cave du théâtre.
Dans la comédie d’Alain Berbérian, La Cité de la peur (France, 1994), l’acteur Dominique Farrugia vomit au visage d’un salaud, dans une scène hilarante. Et c’est encore beaucoup plus amusant quand les gens dont on se moque rient bêtement avec nous. Comme le disait le vers de Dante : « Au milieu de nous, le fourbe se rit de nous », ou quelque chose d’approchant.
Les films antichrétiens
Le cinéma planétarien se caractérise aussi fréquemment par sa charge antichrétienne. A la télévision et au cinéma, les chrétiens, et principalement les catholiques, sont en effet le plus souvent représentés comme des gens bigots, bornés et intolérants, voire même comme des violeurs ou des assassins. Quant au clergé catholique, il est le plus souvent dépeint comme un repère de sadiques et de pervers polymorphes.
Dans La Nuit du chasseur (USA, 1955), Robert Mitchum incarne un pasteur protestant, qui a une âme bonne et généreuse. Mais tout cela n’est qu’apparence, car en réalité il s’avère être un dangereux taré à la recherche d’un magot confié par un père à ses deux enfants avant son incarcération. Pourchassés sans pitié par ce pasteur psychopathe, les deux enfants se lancent sur les routes dans une fuite éperdue. Ce film de Charles Laughton incarne bien la volonté cosmopolite de salir la religion chrétienne.
A propos du film Ben-Hur (USA, 1959), voici ce qu’écrit Guy Konopnicki : « William Wyler est le type même du cosmopolite insupportable : né à Mulhouse en 1901, arrivé à Hollywood quand la France venait de reprendre l’Alsace ! Allemand ? Français ? Suisse ? Américain ? Cinéaste international, Wyler jouait avec toutes les légendes du monde. Le modèle de christianisme qui se dégage du chef-d’œuvre de Wyler préfigure le concile de Vatican II, et Judas Ben-Hur lance à Ponce Pilate un avertissement qui s’adresse autant à Washington qu’à Rome. » Nous voilà avertis. (Guy Konopnicki, La Place de la nation, Olivier Orban, 1983, p. 209).
Déjà, en 1960, Richard Brooks nous montrait, dans Elmer Gantry, le charlatan, que derrière le visage du bon pasteur, peut se cacher la pire des ordures. Son film avait naturellement été récompensé par un Oscar.
Le Cardinal (USA, 1963) est un film remarquable par la beauté de ses images et la noblesse d’âme du futur cardinal. Si le Vatican et l’Église y sont relativement épargnés, tout le poids de l’ignominie repose en revanche sur le petit peuple pratiquant. Ainsi, ces catholiques qui refusent encore que leurs filles se marient avec un juif font preuve de la plus détestable intolérance. Il en est de même sur la question de l’avortement. Et puisque le film est une succession de clichés, on comprend aussi fort bien que le Vatican détourne pudiquement la tête dès lors qu’il s’agit de prendre position sur la question raciale qui agite les États-Unis dans les années 60. Notre héros, évêque américain, intervient donc de manière officieuse dans cette ville du Sud où une église catholique a été brûlée parce que son curé était noir. Les racistes locaux ne l’entendent pas de cette oreille, et l’on assiste alors à une scène d’anthologie, où le jeune évêque intrépide est kidnappé par les militants du Ku Klux Klan. Il sera fouetté jusqu’au sang, au milieu d’une meute d’hommes encagoulés qui chantent et battent la mesure du Dixieland au son de l’harmonica, tandis qu’un crucifix géant flambe dans la nuit en arrière plan ! Ils ont le génie de la mise en scène, ces Klansmen ! ─ ou Otto Preminger, si vous préférez.
Dans Une belle fille comme moi (France, 1972), Charles Denner joue un rôle de dératiseur catholique. Le film est de François « Truffaut », sur un scénario de Jean-Loup Dabadie. La veuve noire, d’Arturo Ripstein (Mexique, 1977) est un film blasphématoire qui dénonce l’Église et les « bien-pensants ». The Runner Stumbles, de Stanley Kramer (USA, 1979) est l’histoire d’un prêtre qui tombe amoureux d’une jeune fille et qui se retrouve aux assises.
Monsignore (1982) est l’histoire d’un cardinal débauché qui réussit à séduire une nonne et se retrouve également devant une cour d’assises. Mais le cardinal est puissant : il tient la banque et sert de liaison avec la mafia. Le pape, qui est au courant de l’affaire, garde discrètement le silence. Le film est de Frank Perry.
Dans son film « magnifique et obsédant », Fanny et Alexandre, (Suède, 1982), Ingmar Bergman oppose entre eux deux personnages : un évêque – austère et lugubre – de l’Eglise luthérienne, et un juif – doux et charmant au possible. L’évêque maltraite ses enfants adoptifs, qu’il séquestre dans un grenier sans fenêtre. Ceux-ci seront sauvés par le Juif, qui aide aussi leur mère à recouvrer la liberté. L’évêque meurt d’une mort atroce, et le Juif le remplace à la tête de la famille. Bergman n’essaie même pas de donner à sa fable un quelconque réalisme : son Juif, un orthodoxe vêtu d’un vaste yarmulke noir, boit du vin en compagnie des Suédois lors d’un repas de Noël – chose qu’aucun juif religieux ne ferait pour rien au monde. Mais l’essentiel n’est pas là, vous l’avez compris.
Dans Crimes of Passion (1984), Anthony Perkins tient le rôle d’un évangéliste doux, très pieux, qui lit la Bible avec ferveur, mais qui fréquente les cinémas classés X et tombe amoureux d’une cleptomane. Il va d’ailleurs finir par la tuer dans une scène de débauche, et ce, « afin de sauver son âme » !
Agnès de Dieu (USA, 1985) se déroule dans un couvent canadien. Par une nuit d’hiver, une sœur accouche d’un bébé qui est retrouvé étranglé dans la poubelle. Sœur Agnès est inculpée de meurtre, mais elle affirme au juge qu’elle ne se souvient de rien. Le docteur Livingstone, une jeune femme psychiatre désignée par le tribunal, arrive donc au couvent pour tenter de tirer l’affaire au clair. La sœur qui lui ouvre la porte, a bien entendu un air détestable. La psychiatre interroge la mère supérieure, qui confirme que personne n’a rien vu. Pour cette dernière, le bébé est un miracle ; mais la psychiatre est beaucoup plus pragmatique : « Vous refusez de voir qu’Agnès a été violée ou séduite. » L’entretien avec la sœur Agnès est autrement plus intéressant : celle-ci est totalement innocente, en même temps qu’ignorante de la sexualité et de la procréation. En revanche, elle entre en extase et parle abondamment de son amour avec la Vierge Marie. On apprendra par la suite que cette pauvre fille qui avait été martyrisée par une mère alcoolique, a en fait été violée dans un passage secret qu’elle empruntait parfois et qu’a découvert notre psychiatre de service en allant fouiner dans les archives du coin. Cet être pitoyable est bien la seule personne un peu sympathique de ce couvent, car toutes les autres sœurs sont désagréables au possible. Et c’est manifestement le lot de tous les catholiques, puisque la maman du docteur Livingstone est elle aussi acariâtre en plus d’être amnésique, bigote et xénophobe, toute seule dans sa chambre d’hospice. Ce film lourdingue est de Norman Jewison, qui n’a pas l’air d’aimer beaucoup les catholiques.
Peur bleue (USA, 1985) : Une petite ville américaine vit dans la terreur car une bête tue et mutile ses habitants pendant la nuit. C’est en fait le pasteur qui se transforme en loup-garou ! Il sera heureusement tué d’une balle d’argent. Le film est de Daniel Attias, sur scénario de Stephen King qui est, paraît-il, un écrivain « génial ». Et l’histoire du rabbin qui se transforme en vampire par une nuit de pleine lune, vous connaissez ?
Le modèle du genre reste tout de même le célèbre film de Jean-Jacques Annaud, (aucune parenté avec Marthe Hanau, dont l’escroquerie des années 1930 est restée célèbre) Le Nom de la rose (France, 1986), dont le scénario est tiré du roman de l’auteur italien mondialement célèbre Umberto Eco : il s’agit d’une intrigue policière qui se déroule dans un monastère bénédictin du Nord de l’Italie au début du XIVe siècle. Les clichés sur le Moyen Age s’accumulent tout au long du film : tous les moines sans exception sont des tarés, d’une manière ou d’une autre. Ils s’engraissent sur le dos des pauvres paysans qui viennent apporter leur maigre récolte, tandis que ceux-ci vivent dans la fange et les ordures que veulent bien leur jeter les moines. L’Eglise catholique tout entière n’est que perversion : elle maintient les esprits dans l’asservissement et dans la peur du diable ; elle garde précieusement cachées toutes les merveilles contenues dans les livres grecs qui risquent de déstabiliser son pouvoir. Guillaume de Baskerville, le moine franciscain, magistralement interprété par Sean Connery, parviendra finalement à dénouer l’énigme et à récupérer quelques-uns de ces ouvrages interdits qu’il sauvera des flammes. Tout se finit évidemment par la torture et le bûcher. Le film a été réalisé avec la collaboration de Jacques Le Goff, un historien de l’école marxiste. Si l’on veut avoir un aperçu non marxiste de la magnifique époque que fut le Moyen Age, on lira avec profit ce tout petit livre de Régine Pernoud intitulé Pour en finir avec le moyen âge, édité au Seuil en 1977. Personne ne pourra nous faire croire que l’on bâtit des cathédrales avec des miséreux affamés et des esclaves. Notons aussi qu’à aucun moment dans ce film il n’est question de « rose ». Il s’agit évidemment d’un titre pour initiés à la kabbale, et à ce sujet, nous découvrons que l’auteur du récit, Umberto Eco, vient de préfacer en 2005 un livre d’un certain Moshé Idel, intitulé Mystiques messianiques, de la Kabbale au hassidisme, dans lequel il établit un parallèle entre le messianisme hébraïque et le marxisme : « D’aucuns ont vu des traces de messianisme, jusque dans la conception de Marx (juif) d’une transformation du monde, grâce à la rédemption des masses prolétaires. » On savait déjà que selon Marx, la religion était « l’opium du peuple », mais il faut surtout comprendre que, dans l’esprit du philosophe, c’est surtout de la religion catholique dont il s’agit.
Dans The Penitent, de Cliff Osmond (USA, 1988), Paul Julia tient le rôle d’un fermier de l’État du Nouveau-Mexique qui embrasse un culte catholique primitif et brutal, où les adeptes ont la joie d’assister à des sacrifices humains lors desquels les corps des victimes sont crucifiés. Dans d’autres films du même acabit, paraît-il, on assiste aussi à des scènes de sacrifices d’enfants chrétiens par des rabbins sanguinaires. Mais tout cela n’est que de la fiction, fort heureusement.
En 1988, La dernière tentation du Christ, de Martin Scorsese, montrait un Christ homosexuel, amateur de plaisirs charnels et possédé du démon.
The Handmaid’s Tale (1990) dépeint une Amérique cauchemardesque gouvernée par des fondamentalistes chrétiens. Le gouvernement théocratique interdit les livres qui ne diffusent pas le message biblique, rassemble des foules pour assister aux pendaisons ou aux tortures et utilise la force brutale pour faire appliquer toutes les lois de la Bible, même les plus obsolètes ; il instaure de surcroît des politiques génocidaires contre les minorités ethniques. Toutes ces fariboles n’empêchent pas ces chrétiens hypocrites de fréquenter les maisons de passe. Le film est de Volker Schlöndorff.
Pour rester dans l’esprit anticatholique, on peut citer aussi le réalisateur Constantin Costa-Gavras, dont le film Amen, a fait beaucoup de bruit. L’acteur Matthieu Kassovitz y joue le rôle d’un jeune jésuite qui, pendant la Seconde Guerre mondiale tente de sortir le Vatican de sa torpeur et d’inciter le pape Pie XII à dénoncer publiquement la barbarie nazie. L’affiche représente une croix gammée et une croix catholique entremêlées. Les critiques sont évidemment élogieuses pour ce film « bouleversant de vérité ».
Dans La montre, la croix et la manière (USA, 1991), Louis est photographe d’art dans le studio que dirige Norbert, spécialisé dans les compositions d’inspiration religieuse. Il recherche un nouveau modèle pour incarner Jésus, quand il rencontre un pianiste un peu fou, qui a une tête de Christ (Jeff Goldblum !). L’affaire est vite conclue. Le nouveau modèle incarne merveilleusement bien le Christ, sur la croix, à table avec les apôtres et dans tous les tableaux bibliques. Mais voilà que peu à peu, le faux Christ se prend pour le vrai ! Dans une scène cocasse, Jeff rentre chez lui avec pas moins qu’un espadon sur l’épaule, qu’il dépose sur la table de la cuisine et que sa femme va préparer pour le dîner. Celle-ci le met tout entier dans le broyeur, avec les pattes de canards ! Le plat qu’elle dépose sur la table, sous le nez de son mari est d’un noir immonde qui donne la nausée. Elle lui demande alors : « Est-ce que tu as trouvé notre seigneur Jésus ? » (gros plan sur l’horrible plat). Il est donc très clair que ce « Jésus » donne envie de vomir au réalisateur, et Ben Lewin entend faire partager son dégoût à son public.
Cape fear (Les nerfs à vif, USA, 1991) est l’histoire d’un taulard injustement condamné pour viol. Après quatorze années de prison, il sort enfin et entend bien assouvir sa vengeance jusqu’au bout contre son avocat véreux. Robert de Niro joue ici le rôle du dangereux psychopathe, et Martin Scorsese a eu la bonne idée de lui tatouer un énorme crucifix dans le dos, afin que l’on repère bien d’où vient sa dangerosité. Accessoirement, ce chrétien pentecôtiste fume l’opium et tente de séduire les petites filles, viole une femme, et persécute une famille, pour finalement mourir noyé dans un torrent. Ce Martin Scorsese fait un drôle d’Italien, non ?
La célèbre trilogie du Parrain, de Francis Ford Coppola, dépeint les mœurs de la mafia sicilienne aux États-Unis au début du XXe siècle. Le troisième épisode (1991) montre toute la puissance de l’Église catholique. En vérité, le Vatican est à la tête d’un immense parc immobilier dans le monde. C’est une puissance financière colossale qui traite avec la mafia. La mafia catholique est donc redoutable, et l’on imagine bien que les gouvernements occidentaux lui obéissent au doigt et à l’œil. La mafia juive est loin d’être aussi puissante !
Dans Alien 3 (USA, 1992), la navette du lieutenant Ripley s’échoue sur une planète où la « compagnie » n’a laissé qu’un pénitencier qui abrite de dangereux criminels : des tueurs, des violeurs, des psychopathes. Rien de très agréable pour la jeune femme, d’autant qu’elle commence à comprendre qu’un Alien était à bord de son vaisseau. Le commandant du pénitencier est une espèce de fasciste borné qui ne veut rien savoir de la présence de l’Alien. Il sera heureusement dévoré dès le début du film. Les prisonniers, quant à eux, se plient à une discipline religieuse très stricte, un mélange « de fondamentalisme chrétien teinté de millénarisme apocalyptique ». Ils sont habillés en moines, et tendent le bras à la romaine après le discours de leur chef. Mais ne nous y trompons pas, ils sont aussi de dangereux malades dont il vaut mieux se tenir écartés, d’autant qu’ils n’ont pas vu de femme depuis des lustres. Les salopards qui vont tenter de la violer sont tous des méchants Blancs, tandis que celui qui va la sortir de ce mauvais pas est un Noir costaud qui a de l’ascendant sur les autres. Il est manifestement le seul type un peu équilibré : C’est lui, le chef ! Il se sacrifiera pour sauver la vie de Ripley et piéger l’Alien. Le film est réalisé par David Fincher. Il y a Alien dans ma télé !
Virgin Suicides est un film américain de 1999 de Sofia Coppola : Vers 1970, dans une bourgade du Michigan, Cecilia, 13 ans, élevée par des parents catholiques intégristes se défenestre. Toutes ses sœurs se suicideront à sa suite, prouvant par là qu’une éducation catholique ne vaut pas une bonne famille juive : « Un film intelligent et bouleversant » nous dit le magasine de télévision. Dans le film Brazil, de Terry Gilliam (USA, 1984), on aperçoit de manière fugitive les errements des adeptes du catholicisme à travers une vieille femme qui n’en finit plus de se rafistoler en chirurgie esthétique : un vrai cadavre ambulant.
On peut aussi citer Les Evadés (USA, 1995), film dans lequel un directeur de prison se révèle être une fieffée ordure en même temps qu’un chrétien très pieux. Le film est signé Frank Darabont, que nous avons déjà vu à l’œuvre un peu plus haut, et qui confirme ici sa vocation planétarienne.
Le cinéma planétarien comme la philosophie du même ordre, a pour objectif de détruire l’attachement aux traditions. C’est évidemment dans cet esprit que Le Cercle des poètes disparus a été réalisé en 1990. Le film nous montre un pensionnat d’élite aux Etats-Unis, une vieille et noble institution pour les fils de la haute société. Dans ce pensionnat, un professeur de lettres, Mr Keating va bouleverser la vie des étudiants et dynamiter les vieilles valeurs poussiéreuses de ces chrétiens coincés. Ce film révolutionnaire, sans en avoir l’air, qui invite à rejeter les traditions et les normes, est signé Peter Weir.
C’est aussi le message d’un film comme La Différence, de Robert Mandel (USA, 1992) : David Greene rejoint l’une des écoles préparatoires les plus cotées de la Nouvelle-Angleterre. Ses qualités sportives et intellectuelles en font en quelques semaines une des vedettes de cette institution. Pour David, c’est la porte ouverte aux grandes universités, et l’espoir d’échapper à sa condition. Mais pour se faire admettre par ses riches condisciples, pétris de préjugés antisémites, et se faire aimer d’une jeune fille de bonne famille, David a été obligé de cacher sa judéité… jusqu’au jour où la vérité éclate. A ce moment-là, on comprend que l’élite catholique est vraiment composée d’individus immondes.
Priest (1995) met en scène un prêtre homosexuel vivant au vu et au su de tous avec son majordome, un autre prêtre alcoolique, un évêque pitoyable et une jeune gamine dont le père abuse régulièrement. Tous sont des adeptes de la religion catholique qu’ils accommodent chacun à leur manière.
Dans Star Treck V, the Final Frontier, Dieu est représenté comme un être mauvais et toutes les religions comme ayant été fabriquées par l’homme, et qui n’auront bientôt plus de signification. Toutes ? Non : car c’est un message uniquement destiné à l’exportation.
Johnny Mnemonics (1995) montre la nature maléfique d’un prédicateur qui a pris l’habitude de tuer les gens à coups de crucifix.
Peur primale (USA, 1996) : A Chicago, un archevêque est sauvagement assassiné. Un suspect est bientôt interpellé. C’est un adolescent mentalement limité qui a été retrouvé hagard, les vêtements maculés de sang. Il faisait partie des protégés de l’archevêque et chantait dans la chorale. On apprendra à la fin que c’est effectivement bien lui le coupable et qu’il simulait l’amnésie. Il entendait se venger de toutes les turpitudes ignobles de l’homme d’Église, qui l’obligeait régulièrement à partager sa fiancée avec d’autres choristes dans des partouzes à l’archevêché ─ pas moins ! Avec une telle imagination, on gage que le prochain film de Gregory Hoblit se déroulera dans la crypte d’une synagogue. Voici ce que sera le scénario : Les juifs pieux dansent une sarabande de tous les diables en hurlant. Au milieu du cercle, un jeune enfant chrétien à moitié inconscient et qui va être sacrifié, est victime de nombreux sévices. Heureusement, Mme Moreira, la femme de ménage portugaise qui s’est faite passée pour une juive afin de décrocher le boulot, parvient à la faveur d’un subterfuge, à s’emparer de l’enfant et à se réfugier au commissariat de police où elle raconte tout ce qu’elle a vu. C’est le début d’une nouvelle affaire Dreyfus. C’est marrant, non ?
Flight of the Black Angel met en scène un pilote de l’US Air Force, qui est aussi un chrétien fondamentaliste. Comme par hasard, il est atteint brusquement de folie meurtrière et massacre sa famille ainsi que quelques copains d’escadrille. Puis il imagine de nettoyer Las Vegas avec une bombe nucléaire tactique, et s’en justifie en prétextant qu’il ne fait qu’accomplir la volonté de Dieu : « Tout sur Terre doit être détruit… J’apporte la lumière du ciel aux malades, aux impurs, aux corrompus, aux menteurs. » Pas de doute, c’est un Marrane !
Même dans un amusant dessin animé tel que Shrek, on retrouve le message de mépris de la vieille civilisation : Nous sommes au Moyen Age ; Shrek est un ogre gentil et attachant, qui vit reclus dans sa forêt. C’est lui qui va aller affronter le dragon et délivrer la belle princesse. Le roi est un nabot teigneux et ridicule, ce qui n’est pas tellement dans la tradition européenne. Il prétend épouser la princesse, mais Shrek, qui en est tombé amoureux interviendra in extremis dans la cathédrale où est en train de se célébrer le mariage. Le bris des vitraux de la cathédrale par le dragon qui y a pénétré représente tout un symbole. C’est ce qu’ont voulu nous laisser William Steig, l’auteur du roman, et Ted Elliot, le scénariste.
Dans Les Rivières pourpres II (France, 2003), le réalisateur est fidèle au premier épisode, en ce sens où les cadavres retrouvés par nos deux mariolles révèlent des morts au moins aussi atroces. Là encore, bien évidemment, nous avons affaire à un réseau de dangereux néo-nazis qui s’avèrent terriblement organisés et qui ont pour quartier général un monastère de Lorraine, relié par des souterrains à la ligne Maginot. Les moines, qui combattent « pour une Europe blanche et croyante », ont des contacts avec de hauts personnages européens qui agissent aussi de manière souterraine : ils sont partout, ils tiennent tout, vous ne voyez rien ! La scène du mitraillage de la voiture, qui a finalement été perforée d’environ deux à trois mille balles de mitrailleuse pendant une longue minute, est probablement le grand moment du film d’Olivier Dahan, dont le scénario est de toute manière largement suffisant pour le public à qui le film est destiné.
Dimanche 3 avril 2005 : Le pape Jean-Paul II vient de décéder. La chaîne de télévision TF1 décide finalement de déprogrammer le soir même le film américain Seven, qui campe une espèce de taré catholique qui a entrepris d’accomplir sept meurtres symbolisant sa haine des sept péchés capitaux. Le film du réalisateur cosmopolite David Fincher passera donc une autre fois sur les écrans. Le même soir, la chaîne France 2 décidait elle aussi de changer son programme : le film L’associé du diable était reporté afin de ne pas froisser les susceptibilités des réactionnaires arriérés. Cette attention exceptionnelle à l’égard du public catholique reflète sans doute une légère appréhension sur les possibles réactions épidermiques de gens trop longtemps humiliés, car on ne voit pas que les responsables médiatiques soient enclins à éprouver quelque compassion ou mansuétude à l’égard de ces contribuables par trop méprisés.
Métissage et homosexualité
Mariage blanc (France, 2005) est un épisode d’un autre téléfilm « bien français » : Tuteur à Marseille, François Etchegaray aide les exclus de la société. René fait partie de ses protégés. C’est un grand gaillard costaud d’une quarantaine d’années, avec un beau visage nordique, mais il est un peu simplet et soupe-au-lait. En fait, rien ne lui réussit. Il échoue dans tous les petits boulots que parvient à lui décrocher son tuteur, et à quarante ans, il est encore chez sa mère qui semble lui dicter sa conduite. Ce Français dévirilisé va soudain tomber amoureux d’une Africaine. Il arrive donc chez François, fier de présenter la photo de sa compagne, Lela, qu’il souhaite naturellement épouser, quand bien même il ne l’a pas encore vue. C’est l’association Afrique Amitié qui lui a trouvé l’amour de sa vie, moyennant une importante somme d’argent. Car une Africaine, pour un pauvre abruti de Français, c’est le must ! La Rolls Royce du pauvre ! La somme d’argent que lui demande l’association rend tout de même François Etchegaray sceptique sur l’honnêteté de ces intermédiaires. Il comprend que René est en train de se faire avoir comme un pigeon, et que l’Africaine ne souhaite en réalité qu’un mariage blanc. C’est une belle histoire, non ?
Au début du film, le téléspectateur a pu voir que le généreux François s’occupait aussi avec attendrissement d’un couple de vieux homosexuels un peu aigris qui s’inquiétaient de leurs droits de succession. Apologie du métissage et de l’homosexualité : nous avons ici la marque de fabrication planétarienne d’une œuvre que signe Edouard Molinaro. Hélas, la fin de ce superbe téléfilm nous restera à jamais inconnue.
Dans My beautiful laundrette (Grande-Bretagne, 1990), Stephen Frears (encore lui) nous offre un coquetèle de clichés politiquement corrects : Omar, un jeune Pakistanais se voit confié une laverie automatique délabrée par son oncle dans un quartier déshérité de Londres. Comme il est très dynamique, il va la rénover et en faire une affaire qui marche, en prenant à son service un ancien ami, un pauvre loubard homosexuel anglais qui va aussi devenir son amant. La bande de copains de ce dernier se révolte à l’idée que leur pote se mette à travailler pour des « Pakis ». Ces abrutis sont évidemment très racistes, autant que fainéants. Heureusement, donc, que des Pakistanais dynamiques sont là pour faire tourner l’économie anglaise et pour faire des enfants aux anglaises. Apologie du métissage et de l’homosexualité, dénonciation du racisme : le film a reçu le César du meilleur film étranger, bien qu’il soit parfaitement ennuyeux. Si quelqu’un a vu la fin, il pourra nous la raconter.
Homosexualité
L’apologie de l’homosexualité est en effet un thème majeur du cinéma cosmopolite. In and out (USA, 1997), par exemple, est une comédie « tordante », paraît-il. Le professeur Howard Brackett enseigne la littérature à l’université d’une petite ville de l’Indiana, aux États-Unis. Il est apprécié par tous ses élèves, jusqu’à ce que sa réputation bascule un soir, quand, dans une émission de télévision, un ancien élève devenu une star du cinéma, remercie son ancien professeur « gay », en croyant bien faire. Howard Brackett est évidemment consterné par cette déclaration. Parents, amis et élèves le considèrent désormais d’un œil suspicieux. Il décide donc de se marier rapidement avec sa fiancée afin de couper court à la rumeur. C’était compter sans ce journaliste qui le poursuit partout avec sa caméra et qui l’encourage à faire son « coming out ».
Au cours de la cérémonie religieuse, à l’instant même de dire « oui » à sa fiancée, devant toute la famille et les invités réunis dans l’église, il renonce finalement et déclare à mi-voix d’un air résigné : « Je suis gay ». C’est la stupéfaction dans l’assistance. La cérémonie est évidemment perturbée (c’est une obsession cosmopolite), et le couple se déchire en public. Pourtant, le réalisateur nous fait comprendre que c’est beaucoup mieux ainsi. Autour d’Howard, la famille et les amis se montrent finalement compréhensifs. Le problème est qu’il a perdu son emploi à l’université, victime de l’intolérance de ces chrétiens coincés. La scène finale est un grand moment du cinéma planétarien : au cours de la cérémonie de remise des diplômes, élèves et parents, apprennent avec stupéfaction, que le professeur a en réalité été licencié. Ils se lèvent alors un par un pour déclarer qu’ils sont « gays ». Le film est signé Frank Oz.
Dans le même registre, citons simplement ici Un goût de miel (GB, 1961) qui raconte les relations de deux paumés : une adolescente, enceinte d’un Noir de rencontre, et un homosexuel. Le film est de de Tony Richardson. Presque rien, de Sébastien Lifshitz (France, 1999) est un autre film qui fait l’apologie de l’homosexualité chez l’homme blanc. Un film « qui tente de banaliser l’homosexualité masculine, qu’il montre en scènes très crues », peut-on lire dans le Guide des films.
Portraits juifs
Le cinéma planétarien aborde aussi parfois la vie de la communauté juive. La plupart du temps, l’image qui en ressort en premier lieu est celle d’une communauté injustement persécutée. Cette inclination, à travers la propagande cinématographique, n’est pas neuve, à en juger par ce qu’en dit Jonathan Weiss : « Au cinéma, en 1929, on jouait Le juif polonais de Jean Kemm, film qui présente un juif injustement accusé d’un crime. » C’est effectivement la posture classique du juif persécuté que reflète toujours le miroir du judaïsme. (Jonathan Weiss, Irène Némirovsky, Éditions du Félin, 2005, p. 58).
La comédie musicale de Norman Jewison, Un violon sur le toit (USA, 1971), dépeint la vie d’une petite communauté juive traditionnelle dans un village d’Ukraine, à la veille de la révolution bolchevique. L’atmosphère est bon enfant ; la musique traditionnelle et les chants transportent les cœurs : « Grâce à nos traditions, chacun sait qui il est, et ce que Dieu attend de lui », clame notre laitier. On reconnaît dans cette bourgade les personnages pittoresques du temps, telle ce rabbin entouré de ses fidèles, cette marieuse, ou encore ce vendeur de livres ambulant. La « tradition » est au cœur de cet univers du shtetl (les bourgades juives d’Europe de l’Est). Et pourtant, on la sent se déliter peu à peu tout au long du film, au fur et à mesure que les filles de notre laitier décident de n’en faire qu’à leur tête et d’épouser les jeunes hommes dont elles sont amoureuses. Pour notre laitier, cette situation nouvelle est incompréhensible. La « tradition » est tout simplement en train de se perdre, et l’on veut bien comprendre son déchirement. Sa fille n’est pas amoureuse du boucher, mais du jeune tailleur : c’est un fait. Après de douloureuses réflexions, il donne finalement son accord pour ce mariage. Mais hélas, mille fois hélas, sa deuxième fille va bientôt choisir pour époux un jeune juif révolutionnaire qui éprouve peu de respect pour la « tradition ». On le verra haranguer la foule sur une place de Kiev, avant d’être arrêté par la police du tsar. Quant à sa troisième fille, elle ne fait pas moins que de tomber amoureuse… d’un goy ! Cette fois c’en est trop. La Loi juive ne plaisante pas avec cela, et les parents la répudient. Pour eux, dorénavant, elle n’existe plus.
En fond de cette histoire s’ajoutent les convulsions politiques de l’époque, et bientôt, les policiers russes préviennent les juifs qu’ils vont devoir quitter le shtetl, par ordre du tsar. Les juifs, qui sont priés de partir sous trois jours, se résolvent à partir après un bref sursaut d’indignation : après tout, quelle importance pour un juif de vivre ici ou ailleurs ? Le violoniste, qui jouait sur un toit au début du film, continue sa mélodie derrière le convoi de ces juifs qui commencent ici une longue errance. Cette belle fresque de la vie d’un shtetl est sans doute un peu idéalisée, mais elle reflète bien les mutations que les juifs ont dû accepter pour entrer dans le monde moderne, ainsi que leur étonnante capacité d’adaptation aux situations, devant les nécessités du temps.
Yentl, de Barbara Streisand (USA, 1983), est un film amusant, réalisé d’après le roman d’Isaac Bashevis Singer. Dans un village juif de Pologne, au début du XXe siècle, Yentl est une jeune femme qui vit avec son père, un homme instruit. Sur la place du marché apparaît le vendeur de livres ambulant, qui crie à tout va : « Illustrés pour les femmes, livres saints pour les hommes ! » C’est résumer beaucoup de choses en très peu de mots, car effectivement, la tradition juive fait peu de cas des femmes, à qui il est d’ailleurs interdit d’enseigner les choses saintes. Mais Yentl aime les livres et n’a qu’un souhait : étudier le Talmud, comme les hommes. A la mort de son père, elle décide donc de se couper les cheveux et de se faire passer pour un garçon. C’est ainsi qu’elle part à la ville où elle fait la rencontre d’Avigdor, qui emmène « son » jeune ami à Bechev, où il y a le centre d’études, la yeshiva.
Le soir, nos deux compères dorment chez les parents d’Avigdor, et Yentl apprend avec effroi qu’il n’y a qu’une chambre, et qu’elle doit fatalement dormir dans le même lit que lui ! La scène, il faut le dire, est ici vraiment amusante. Comment va s’en sortir Yentl pour qu’Avigdor ne s’aperçoive pas que son compagnon est en réalité une femme ? La tension est à son comble quand Avigdor, qui est déjà couché et très fatigué, s’impatiente de voir Yentl arrêter d’étudier et éteindre la lampe ! Yentl invente alors un stratagème à la hâte, et qui dénote cette capacité à se tirer d’affaire avec un aplomb déconcertant, quitte pour cela, à tordre un peu les textes sacrés. Ainsi, nous apprenons que chez les juifs : « deux célibataires dans le même lit doivent se mettre dos à dos ! » Avigdor est un peu interloqué, mais probablement trop fatigué pour relever le défi !
A la yeshiva, Avigdor va devenir le compagnon d’étude de Yentl. Un jour, il lui présente sa fiancée. A une réflexion de Yentl : « Que peut-elle penser ? », il répond simplement : « Je n’ai pas besoin qu’elle pense. » Et ce bref dialogue confirme bien la situation des femmes chez les juifs. Sous son déguisement, Yentl venge cette situation pénible faite aux femmes, puisqu’elle n’est pas moins que la meilleure élève de la yeshiva. Désespérant d’être aimé par son ami à qui elle a avoué son amour, mais qui ne plaisante pas avec la tradition, Yentl finira par partir pour l’Amérique. Sur le bateau, qui l’emmène, une fois de plus, elle chante son amour pour Dieu et pour son père, qu’elle confond dans sa complainte mélodieuse. « Je te vois, je te vois dans le ciel… Regarde papa, regarde-moi voler ! ».
Dans Moi Ivan, toi Abraham (1993), Yolande Zauberman nous montre la vie de quelques juifs polonais en 1933. Dans cette bourgade, où vivent aussi des catholiques, on a vite fait de rendre les juifs responsables de tous les maux. Il est vrai que les traditions chrétiennes sont imprégnées d’intolérance et de folie. Les chrétiens ne voient-ils pas dans les yeux du petit Abraham le regard du diable ?
Un soir de shabbat, un chrétien colérique et soupçonneux entre de force chez un vieux juif pour voir enfin ce qui se trame derrière ces volets clos. Il veut en avoir le cœur net et voir de ses yeux toutes ces innombrables atrocités dont on accuse les juifs. Il se précipite dans la pièce principale, et là, c’est la stupéfaction ! Ici, la caméra filme lentement la pièce : une table, des chaises, les bougies qui brûlent dans l’obscurité ; bref, rien qui puisse valider la thèse du complot ! Tous ces soupçons qui pèsent sur les juifs sont évidemment ridicules, car les juifs n’ont rien à cacher : rien. Il faudra donc bien que tous ces préjugés prennent fin un jour. C’est le seul point intéressant de ce film, pour lequel la touche « avance rapide » de votre télécommande vous sera ici précieuse. Ce qui n’empêche pas la critique de se pâmer : « Yolande Zauberman a signé un film indispensable » (Danièle Heymann, Le Monde) ; « la mise en scène est d’une sensibilité, d’une émotion extraordinaire » (Joshka Schidlow, Télérama) ; « Yolande Zauberman atteint à l’universel » (Claude Lanzmann, Le Journal du Dimanche).
Les personnages juifs sont aussi présents dans les films pour le « grand public ». Leur rôle de premier plan dans l’idéologie communiste apparaît assez bien dans Nos plus belles années (USA, 1973), qui dépeint la vie d’une militante communiste dans une université américaine à la fin des années trente. Barbara Streisand joue une jeune juive qui se dépense sans compter pour la cause. Elle personnifie ici parfaitement cet inlassable militantisme si caractéristique des intellectuels juifs. C’est avec beaucoup de courage qu’elle prendra la parole sur le campus de l’université, pour dénoncer « le fascisme et le grand capital », défendre les Républicains espagnols, et la « paix ». Bien évidemment, elle parvient à émouvoir tous les étudiants. Son militantisme frénétique est pénible pour son entourage. Elle parvient néanmoins à séduire Robert Redford, le goy tranquille, qui a toujours un peu de mal à comprendre ce qu’il lui arrive. Le film est de Sydney Pollack.
Le pianiste (2001), montre la vie d’un pianiste virtuose à Varsovie qui a beaucoup succès auprès de ses admiratrices polonaises. « M. Szpilman, vous êtes vraiment quelqu’un de merveilleux ! » lui déclare une belle blonde. Mais la situation internationale est tendue, et la guerre va briser la vie de notre héros. Tout commence pourtant pour le mieux, en ce mois de septembre 1939, quand la famille Szpilman, réunie autour du poste de TSF, apprend que l’Angleterre et la France viennent de déclarer la guerre à l’Allemagne. Chacun laisse éclater sa joie et se félicite : « C’est merveilleux ! » Mais hélas, tout dégénère très vite avec la victoire des armées allemandes. On voit alors des scènes écœurantes, comme ce pauvre vieillard qui se fait gifler en pleine rue par un soldat, qui lui intime l’ordre de descendre du trottoir (c’est vraiment révoltant !).
Notre famille juive est aussi obligée, pour survivre, de vendre le piano à un salaud de Polonais qui profite de la situation. Pendant le maigre repas du soir, le vieux père donne son avis : « Ce sont les banquiers juifs qui devraient persuader l’Amérique de déclarer la guerre à l’Allemagne » (rien de nouveau sous le soleil !). Se produit alors une scène atroce : des soldats allemands déchaînés viennent de pénétrer dans l’immeuble d’en face, interrompent un repas, et demandent à toute la famille de se lever. Comme le vieillard sur son fauteuil roulant n’obtempère pas immédiatement, les Allemands… atroce… le balance par la fenêtre, lui et son fauteuil. Tout le monde est finalement emmené vers les camps de travail. Les cadavres jonchent les rues. Une femme pleure parce qu’elle a été obligée d’étouffer son bébé pour ne pas que les Allemands les découvrent tous les deux. Les exécutions sommaires se succèdent, en pleine rue… atroce… Roman Polanski… film… atroce…
Nous ne récapitulerons donc pas tous les films sur cette période qui tournent systématiquement autour du thème de la persécution. Mentionnons simplement Au revoir les enfants, de Louis Malle ou encore Le vieux fusil (France, 1975), bien que dans ce dernier, les victimes soient des villageois bien français. Mais le résultat est le même, si l’objectif est de formater les esprits sur cette période « sombre » de l’histoire. Les historiens, là encore, ne regarderont pas de trop près. Mais le film de Robert Enrico n’a pas été réalisé pour eux.
La propagande cosmopolite s’est considérablement débridée ces dernières années. Pendant longtemps, elle n’a pu se montrer au grand jour, du fait du poids des « préjugés » de ces goys dont il faut toujours se méfier un peu. Cette propagande trouvait alors surtout à s’exprimer à travers l’apologie du « libertinage », afin de saper progressivement l’idéal de la cellule familiale, qui représente depuis toujours le noyau de la civilisation européenne. C’est dans cette direction que les cinéastes cosmopolites sont allés chercher leur inspiration, faute de pouvoir laisser s’épancher librement leur imagination fébrile. Les œuvres filmant l’adultère sous un jour favorable sont donc innombrables. Par la suite, on fit plus ouvertement l’apologie de l’homosexualité. Il a fallu plusieurs décennies de travail sur le psychisme de « la bête » avant de pouvoir lui montrer des images où les gens de son espèce jouaient le rôle des homosexuels, tandis que ses plus belles femmes partaient avec « l’homme de couleur ».
Mais nous ne sommes sans doute pas encore parvenus au point le plus bas de cette glissade vers la fosse à purin. Les temps approchent où l’on nous montrera sur les écrans cette foule bigarrée, cosmopolite, adulant ses Grands Prêtres et se prosternant devant le roi de la maison de David. Ce serait effectivement l’idéal, mais Yahvé nous laissera-t-il goûter à cette extase ?
Hervé Ryssen
Pour soutenir Hervé Ryssen : Hervé Ryssen – Les livres























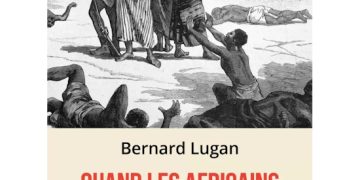






 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV









Merci à Monsieur Ryssen pour tout ce qu’il fait; ses livres sont un trésor pour nous qui sommes tellement écrasés par toutes ces propagandes (((…)))
Dieu le bénisse!
Il s’agit d’une nouveauté relativement ancienne… Songez au rôle du poète dans « La Guerre de Troie n’aura pas lieu » de Giruadoux… lui même un temps (peu avant la « Dernière ») nommé à la propagande.
Excellent tour d’horizon. Trės complet aussi. Magistralement mené au pas cadencé. Cela donne envie de relire « Les tribus du cinéma français » de Lucien Rebatet.
À propos de « Amen! » de Gavras – une ptioyable production après des œuvres bien menées comme « Z » ou « l’aveu » (l’une servant à excuser l’autre – personne n’est dupe de l’habileté de notre… « pâtre grec », lui « aussi »… etc…) le coup de maître des virtuoses du « Midrach »: RIEN n’est montré de quoi que ce soit qui « gênerait » ou serait susceptible de générer la controverse… tout est dans la suggestion d’une porte close qui vibre (comme le « plupti-violon-du-monde »… un instrument faire suinter des « trémolis » qui couinent à vous fendre les cœurs). Imaginez ce que vous pourrez, gentils gentils! Voilà du non-dit indicible où chacun peut apporter son manger. Dans l’art de la houtzpah ça confine à la virtuosité.
Également peut-être relever que ce film de commande descend en droite ligne de la fable de Rolf Hochhut: « Le Vicaire »…