Municipales : parité obligatoire dans les villages, dernier coup porté à la France enracinée
Le 7 avril 2025, sous les lambris bien chauffés de l’Assemblée nationale, les députés ont voté l’extension de la parité homme-femme aux communes de moins de 1 000 habitants pour les élections municipales. Il est prévu que cette réforme s’applique dès les prochaines élections municipales de mars 2026. En apparence, une simple évolution du code électoral. En réalité, une offensive majeure contre la vie locale , contre les communes rurales, contre cette France profonde que les technocrates ne comprennent pas – ou qu’ils cherchent à dissoudre.
L’uniformisation par le haut
Dans la bouche des promoteurs de cette réforme, les mots sont toujours les mêmes : « progrès », « justice », « égalité ». Mais ce qu’ils appellent progrès est souvent un effacement , une mise au pas idéologique. Ils prétendent travailler pour l’égalité en imposant la parité à des territoires où le problème n’a jamais été l’inégalité mais le manque d’engagement qui résulte de la solitude et de la lassitude des édiles locaux face au conséquences excessives de responsabilités écrasantes (notamment pénale) et d’une bureaucratie kafkaïenne dans les relations avec les autres collectivités et l’État (subventions et financement).
Imposer à une commune de 400 âmes une stricte alternance homme-femme sur une liste électorale revient à faire entrer de force la complexité rurale dans les tiroirs bien rangés de la pensée dominante. Peu importe la réalité, peu importe les disponibilités, les parcours, les engagements : ce qui compte, désormais, c’est l’équilibre arithmétique des sexes. L’idéologie l’emporte sur la vie.
Une fracture entre Paris et les villages
Ce vote traduit une méconnaissance totale du terrain. Dans nombre de petites communes, les maires peinent déjà à boucler leurs listes. Le tissu associatif s’effiloche. Les jeunes parents, les services publics disparaissent. Et pendant que l’on débat à Paris de parité obligatoire, les maires de campagne font eux-mêmes la tournée des foyers pour trouver un secrétaire de mairie ou un conseiller qui accepte de se porter candidat.
L’État ne propose pas de solutions concrètes. Il ajoute des contraintes. Il complique la tâche de ceux qui, encore debout, tentent d’administrer la France vivante à bout de bras. La parité, dans ce contexte, n’est pas une avancée. C’est un luxe de riches imposé aux pauvres. C’est une règle pour les grandes agglomérations appliquée aux hameaux et aux villages qui n’ont ni les moyens ni les effectifs pour y répondre.
Une réforme qui nie les réalités humaines
La parité obligatoire ne valorise ni les femmes, ni les hommes. Elle transforme chacun en pièce détachée d’un schéma préconçu. Elle ne fait pas émerger des vocations : elle force des engagements. Elle ne suscite pas l’envie de servir : elle définit des profils à remplir. Et elle jette le soupçon sur toute candidature spontanée : est-ce la personne qui a été choisie, ou bien le sexe qui a été coché ?
Cette réforme ne promeut ni stabilité, ni vitalité politique. Elle créera de l’arbitraire, des désistements, de l’incompréhension. Pire : elle accentue le divorce entre la population rurale et le pouvoir central.
L’égalitarisme contre l’ordre naturel
Il faut le dire sans détour : la parité obligatoire n’est pas une justice, c’est une contrainte. Elle repose sur une idée fausse de l’égalité, qui voudrait que toute différence soit suspecte, que toute asymétrie soit corrigée par une règle. Ce n’est pas ainsi que l’on honore les personnes : c’est ainsi que l’on nivelle les sociétés.
Une commune ne fonctionne pas comme une commission ministérielle. Elle repose sur l’équilibre des tempéraments, la confiance, l’engagement individuel. Forcer la composition des listes, c’est nier la liberté de constituer une équipe cohérente, fonctionnelle, enracinée.
L’autorité en haut, les libertés en bas !
Ce n’est pas de parité dont les communes ont besoin. C’est de considération, de moyens, de stabilité. C’est que l’État cesse de leur compliquer la vie au nom d’idéaux qu’elles n’ont jamais réclamés. L’égalité réelle ne passe pas par les décrets, mais par la liberté laissée au peuple de s’organiser selon les réalités connues.
Au lieu d’imposer un format unique à tous, redonnons aux villages la capacité de choisir leurs représentants selon leurs propres critères. Cela s’appelle le bon sens, une vertu aujourd’hui bien plus rare que les réformes déconnectées des réalités…


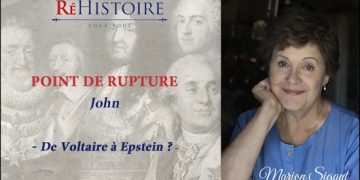



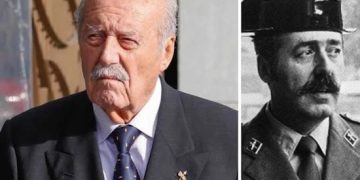





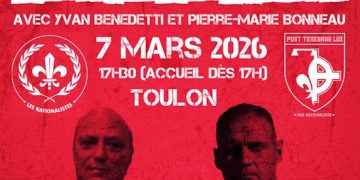



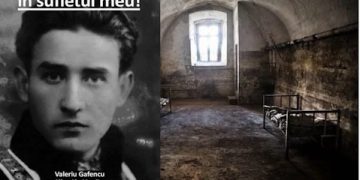



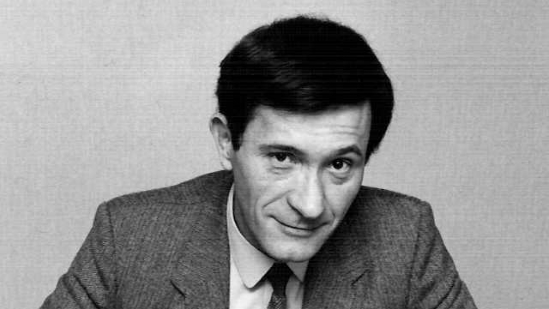
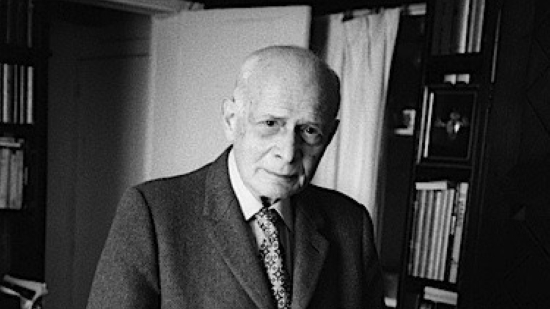







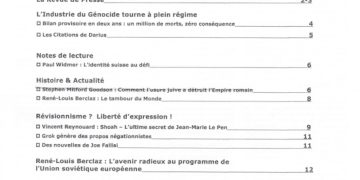
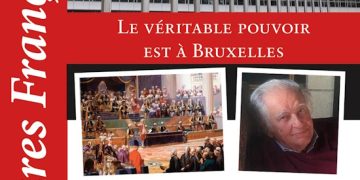
 Jeune Nation TV
Jeune Nation TV






« Seul ce qui est semblable peut être égal. Ce qui n’est pas semblable ne peut être égal »
Aristote, Politique (citation approximative de mémoire)
Le mythe de l’égalité sert à détruire tout ce qui dépasse, comme dans l’histoire de Procuste de la mythologie grecque, pour faire entrer l’Humanité dans une uniformité abstraite et mortelle.
Ce bandit qui vivait au bord d’une route invitait les passants dans sa maison, les installait dans son lit pour qu’ils se reposassent et raccourcissait ceux qui dépassaient et allongeait ceux qui étaient trop courts, les tuant ainsi après cette torture. Thésée qui passait par là le tua de son épée.
Pas d’humanité sans dieux et sans héros.
Décidément ! Cette « Lettre de Jeune Nation » est un régal intellectuel !
Surtout – hélas ! – si l’on se risque à comparer avec d’autres sites se voulant « de droite », sans même comprendre à quel point ce critère d’avant-hier est dépassé.
A peine se réjouit-on de l’analyse de Monsieur de Longpré, sublimée par une reviviscence de subtilités littéraires évoquant nos plus brillants auteurs, que l’on est confronté à un commentaire se référant aux héros de la mythologie.
Merci à tous d’élever nos débats à ce niveau.
Rassurez-vous,on est au bon niveau…